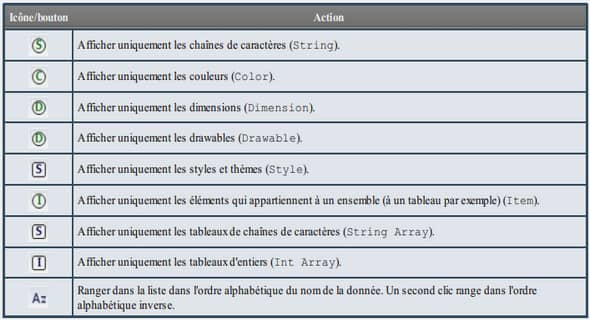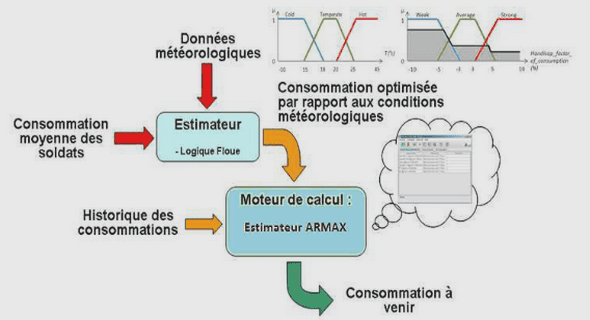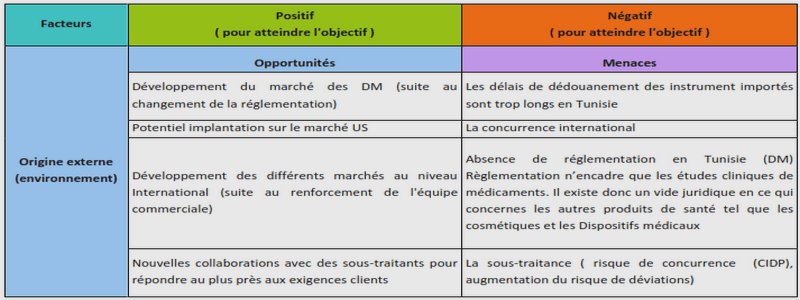Les relations et les plaisanteries
L’humour, nous dit Freud4, naît soit chez une seule personne qui adopte une attitude humoristique, soit entre deux personnes. L’humour procure du plaisir : tant qu’à son auteur qu’aux auditeurs sensibles. À cela s’ajoute son caractère « libérateur », « sublime » et élevé ». L’humour vise ainsi à affronter la réalité, à se défendre des douleurs que la réalité provoque, mais aussi d’éprouver le plaisir intellectuel que nous fournit l’esprit. Freud remarque, en ce qui concerne le mécanisme de l’humour du point de vue émotionnel, que l’attitude de l’auteur de l’humour vis-à vis de celui qui en fait objet rappelle celle d’un adulte vis-à-vis d’un enfant. Dans ce cas de figure, l’adulte reconnait les vanités » de l’enfant, et c’est cela qui le fait rire. L’« humoriste », en termes de Freud, affirme sa supériorité via son humour, tout en reconnaissant la position inférieure des autres (relation père/enfants).
Le rire, l’humour, l’une des émotions qui permettent à la société de « faire ensemble », de contrebalancer les tendances de l’individualisation, de divers conflits, des clivages sociaux qui divisent de plus en plus de personnes. Ce besoin de communication et de solidarité entre les personnes s’exprime, entre autres, par la plaisanterie, qui joue plutôt sur la construction ou bien l’actualisation de liens interpersonnels que sur la division ou l’opposition5. L’humour en tant que caractéristique humaine permet de réguler la vie émotionnelle de la personne et de ses communications avec le monde extérieur. Il diminue les traumatismes causés par des situations ou des événements faisant partie de la vie quotidienne, et permet à la personne de s’adapter et de s’intégrer avec succès au monde extérieur. La plaisanterie offre à la personne la possibilité de relativiser, de se détacher des situations de la vie quotidienne, de remplacer des réactions « négatives » par des émotions « positives ». Du point de vue psychologique, la création de la plaisanterie et la recherche du comique se distinguent par leur lien soit avec l’esprit, ou bien avec la sphère émotionnelle. Le rire est provoqué par la plaisanterie, et c’est grâce à lui que l’ordre établi des choses peut se faire bouleverser. Sans tenir compte des situations extrêmes, le rire témoigne de la satisfaction, de la situation émotionnelle confortable. L’humour est un moyen de défense qui protège la personne des traumatismes psychologiques, mais aussi a des capacités thérapeutiques, qui aident à se remettre des angoisses provoquées par la réalité. Il aide à s’adapter aux conditions de vie, à prendre du recul et trouver du comique dans des choses qui nous entourent et des situations qui nous arrivent. Au niveau de la société, l’humour assure une fonction de baisser les tensions provoquées notamment par les normes sociales. Comme l’illustre Geneviève Calame-Griaule6 par un exemple dogon :
Dire à sa femme que la soupe est trop salée provoquerait une querelle ; lui dire que sa boîte à sel est certainement encore pleine la fait rire et détend l’atmosphère. Comment se disputer avec quelqu’un lorsqu’on vient de rire avec lui ? ».
Le rire et les plaisanteries servent à réaliser la communication dans la société, à établir et à maintenir les liens entre ses membres, et en même temps, ces relations sont souvent elles-mêmes source du rire et des plaisanteries. De même, le rire sert à réguler cette communication, il est géré par des règles : de quoi, dans quelles circonstances peut-on rire dans telle ou telle autre société ? G. Calame-Griaule attire notre attention sur le fait que le rire est avant tout un « phénomène culturel », et la compréhension et l’adhésion à ce qui est considéré comme comique dans une culture témoigne de l’intégration de la personne. Les plaisanteries peuvent être réservées à une population, à une classe d’âge, aux représentants d’un métier ou un autre groupe7. En même temps, le rire peut exclure les intrus, établir des frontières, dans le cas où l’on rit de l’autre et où le rire peut se rapprocher à la dérision.
Apprendre à percevoir des plaisanteries devient un véritable apprentissage, comme lorsqu’il s’agit d’apprendre une langue étrangère. G. Calame-Griaule8 évoque l’exemple du colloque consacré au rire, où les réactions du public différaient énormément, certains plaisanteries introduites lors des communications sur le rire des Touaregs, des Biélorusses, des musiciens, des sourds etc., ont provoqué le rire, d’autres n’ont pas été comprises (et l’explication des plaisanteries détruit leur spontanéité, et même leur sens). Une histoire drôle n’est pas drôle pour tous : le degré de compréhension de la plaisanterie permet de détecter si la personne fait partie du cercle restreint des « connaisseurs ». Et expliquer par la suite le « sel » de l’histoire à ceux qui ne l’ont pas compris ne les fait pas rire (c’est une réaction spontanée qui arrive au moment où on entend la blague), mais les informe sur ce que les autres, ceux qui ont ri, y ont trouvé de drôle9.
Eliane Daphy10 soulève un problème d’ordre méthodologique qu’elle a rencontré lors de ses enquêtes de terrain sur le rire des musiciens français : on s’échange des plaisanteries à l’instant, sur le coup ; il s’agit de quelque chose indéniablement lié au contexte. De ce fait, il est d’une part difficile pour le chercheur d’enregistrer son corpus in situ, mais d’autre part, la fixation des plaisanteries par la suite car on ne peut pas les faire répéter par les informateurs, et elles n’ont plus aucun sens en dehors des circonstances de leur emploi. Si on demande de raconter une plaisanterie, on atteint le même objectif : soit le refus, soit l’oubli, soit un texte dépourvu de contexte.
Le choix du sujet
J’ai eu la chance de préparer mes deux diplômes de Master à l’Université d’Etat de Saint-Pétersbourg, et ensuite à l’Université de Provence. Mes travaux de mémoire et mes premiers terrains portaient sur les noms de famille en Casamance, la région que j’ai eu le plaisir de découvrir pour la première fois en automne 2007. Les différents patronymes, avec leurs diverses déclinaisons, avaient les partenaires de relations à plaisanterie qu’il suffisait de répertorier.
Lors de ma toute première enquête de terrain, j’ai constaté la proximité du « mode opératoire » des relations à plaisanterie dont nous avons entendu parler aux cours de bambara à l’université avec celui que j’ai pu apercevoir lors de mon rapide passage en Guinée. Arrivée chez les Mandinka, quelques jours après, j’ai commencé à découvrir, avec curiosité, que les relations à plaisanterie avaient, cette fois, quelque chose de particulier : j’avais l’impression d’en entendre parler plutôt que de les observer dans la vie quotidienne des membres de ma famille d’accueil.
Il était tout à fait naturel de comparer la réalité déjà connue (bien qu’il s’agisse de connaissances plutôt théoriques récupérées soit dans les retours d’expériences de terrain de mes professeurs, soit de quelques discussions avec des étudiants maliens) avec la réalité vécue, nouvelle et restant à découvrir.
La différence que j’ai senti au premier regard, n’était, en effet, liée qu’à des difficultés linguistiques qui ont diminué avec la familiarisation progressive avec la langue mandinka, mais aussi à quelques particularités contextuelles : d’autres noms de familles répandus sur place, d’autres populations formant des liens spécifiques entre eux. Le fond restait globalement le même, mais il m’a fallu certains efforts pour pouvoir comprendre avec certitude les spécificités des relations à plaisanterie des Mandinka.
cette-époque-là, mes connaissances des populations joola se limitaient aux groupes qui portaient une forte influence mandinka, s’exprimaient en mandika, et ne gardaient que quelques traits de leur « culture d’origine », qui n’étaient pas évidents, n’étaient pas mis en valeur, et ne me permettaient pas de faire quelque comparaison car les distinctions même entre les deux populations étaient floues et peu précises.
Lors de ma première rencontre avec Odile Journet-Diallo en vue de préparer une thèse de doctorat sous sa direction, la question du choix de sujet de recherche s’est posée en premier lieu. Notre discussion sur les différentes possibilités d’ouverture de mes recherches antérieures a débouché sur l’idée suivante : il serait intéressant d’envisager une étude comparative, qui s’inscrirait dans le cadre des thématiques traitées dans le laboratoire (à ce moment-là, le Cemaf d’Ivry), dont le terrain principal serait la Casamance, et qui pourrait en même temps mobiliser mes quelques connaissances de l’aire mandingue et des Mandinka en particulier, tout en orientant mon intérêt de recherche vers les Joola, la population que j’avais encore à découvrir.
Le sujet qui a réussi à réunir tous ces critères était celui des relations à plaisanterie. Bien connues et largement étudiés dans l’anthropologie africaniste, les relations à plaisanterie n’ont pas fait objet de recherche exclusive sur le matériel ethnographique joola et mandinka. Je pourrais ainsi prétendre à une originalité de thématique qui pourrait apporter une contribution substantielle aux travaux ethnographiques sur la sous-région, mais aussi de faire le point sur les données dispersées concernant les relations à plaisanterie chez les Joola et les Mandinka disponibles dans des ouvrages ethnographiques et les confronter à des informations recueillies lors de mes propres enquêtes de terrain. En plus, afin de pouvoir analyser en profondeur les relations à plaisanterie chez les deux populations, il a été indispensable de réaliser un travail préalable de description des différents aspects de l’organisation sociale et familiale.
Le sujet de ma recherche peut, certes, paraître « vieillot », ou « banal », ou même peu original. Néanmoins, lors de ce travail, j’ai toujours gardé l’objectif de mettre en évidence sa pertinence pour les personnes dont je parle, son intemporalité ou encore son actualité. À la suite des écrits de Mauss et Radcliff Brown, de l’analyse de Pierre Smith, et surtout du numéro 184 des C ’E f c , il reste encore beaucoup d’informations non-explorées à propos des relations à plaisanterie. Ces dernières ont, bien évidemment, subi des évolutions, elles se sont introduites dans le discours politique et médiatique, dans la vie associative, elles sont présentes aujourd’hui sur les réseaux sociaux numériques. Tout cela laisse à penser que les relations à plaisanterie gardent le statut d’un fait social remarquable dans plusieurs sociétés africaines et nécessite notre attention en tant que chercheurs, sur une longue période de temps.
Le choix du sujet de la thèse étant définitivement établi, l’étape suivante consistait à déterminer le prisme auquel ce sujet devrait être traité. L’étude critique de la bibliographie disponible m’a permis de me repérer et de me positionner vis-à-vis des travaux antérieurs.
La terminologie
En ce qui concerne les Mandinka, le mot employé pour désigner les relations à plaisanterie, au sens large, est sànawuyaa. Le même terme est, par ailleurs, utilisé pour parler de la relation des cousins croisés – bien évidemment, cela n’est pas dû au hasard, comme nous pourrons l’observer dans le chapitre consacré aux relations à plaisanterie et les liens familiaux.
A cela s’ajoute un deuxième terme mandinka : dànkutu, qui, étant un sous-ensemble de sànawuyaa, a pour caractéristique principale l’interdiction du mariage entre les représentants des groupes concernés (par exemple, les clans). Dànkutu fait toujours partie de sànawuyaa, mais toutes les relations sànawuyaa ne comportent pas d’interdit matrimoniaux (même au contraire, rappelons-nous des mariages préférentiels entre les cousins croisés), et donc ne sont pas toutes dànkutu.
Les informateurs attribuent systématiquement des caractéristiques qualitatives à l’un et à l’autre mot. Si sànawuyaa et généralement connoté avec le jeu et la plaisanterie, dànkutu, à son tour, est décrit comme « sacré », « sérieux », « fort ». Il est éventuellement possible d’analyser la relation dànkutu en parallèle avec la distinction chez les Bambara de sànankuya kunan (amer) / jòli (le sang) / jugu (méchant), qui sous-entendent l’interdiction de mariage et sont, de manière générale, plus restrictives11.
En expliquant les relations à plaisanterie, mes informateurs mandinka ont l’habitude de les présenter comme un lien entre les deux groupes (ou personnes) : à w y ’ì téema comme sànawu, sànawumaa (le suffixe de relations réciprocales pour les termes de parenté -maa) et (le suffixe de nom d’associés –ñoo).
Ces termes sont bien connus et n’ont jamais posé problème à mes informateurs mandinka. Pourtant, chez les Joola, je n’ai pas rencontré une telle unanimité.
Ma question de savoir comment dire en joola (en dialecte joola parlé par mes interlocuteurs) « relation à plaisanterie » laissait mes informateurs confus. Il semblait que dans leur vocabulaire ils rencontraient des difficultés à trouver spontanément le mot que je leur demandais. Souvent, la réponse était négative – le mot que nous cherchions n’existerait pas12.
Certains de mes informateurs Joola (je prends le risque de supposer que c’étaient probablement ceux qui maitrisaient la langue mandinka ou cohabitaient avec les Mandinka) nomment le phénomène en question asanawuya, donc en employant le terme mandinka « joolaïsé ».
Plusieurs parmi mes interlocuteurs Joola ont reconnu le mot ráari13, en rapport avec les relations à plaisanterie, mais c’est moi-même qui leur ai proposé cette option et qu’ils ont tout de suite validé : oui, en effet, on pouvait parler ainsi de ces relations.
Dans certains cas, mes informateurs joola employaient entre eux le mot wolof kal, qui veut dire « relations à plaisanterie ». Souvent, lorsqu’il s’agissait d’expliquer à quelqu’un l’objectif de ma présence dans cet endroit-là, donc la personne la plus informée disait aux autres que je m’intéressais au kal. Suivant mes informateurs, il m’est arrivé à moi-même d’employer ce terme wolof dans les cas où je me rendais compte que je rencontrais des difficultés à me faire comprendre.
Le seul mot qui, non sans difficulté, et après quelque temps de réflexion, m’a été fourni par la majorité de mes informateurs, était le terme ageloor, qui contenait l’idée de se moquer de quelqu’un ou bien taquiner quelqu’un sans se fâcher. D’après mes expériences, c’est bien ce dernier qui saurait le mieux exprimer l’idée des relations à plaisanterie, dans les conditions où un seul terme clair, précis et partagé par toute la population fait défaut.
Les appellations françaises du phénomène qui fait l’objet de notre étude, sont par ailleurs également bien connues en Casamance. Lors d’une discussion ou un entretien en français, mes interlocuteurs parlent des « cousinages à plaisanterie », dans le cas où ils n’emploient pas le terme en langue locale : « Et quand on appartient à un clan, il y a tout de suite un autre clan qui est le clan cousin. C’est ce que vous appelez le cousinage à plaisanterie. Il va plus loin que ça. Ce n’est pas seulement « à plaisanterie ». Mais il y a un lien fondamental qui relie ces deux clans »14. Pour d’autres, le terme local est introduit dans la discussion en français : « Le sànankuya est né des conflits. Parce qu’il y avait tellement de conflits entre les hommes qu’il fallait donc trouver le sànankuya pour pouvoir, par exemple, raffermir les relations entre les hommes »15.
Dans les textes ethnographiques, francophones ou anglophones, on trouve également une variété terminologique.
A.R. Radcliffe-Brown parle de « joking relationships »16, et ce terme anglais est largement repris par les chercheurs de la tradition britannique et dans les articles rédigés en anglais17. Il est possible, dans la moindre mesure, de rencontrer également le raisonnement en termes de « joking alliances »18, « joking kinship »19, ou encore « joking pacts »20. Dans cette unanimité et entente terminologique, Tal Tamari propose de faire le point sur les différentes appellations de ce phénomène en apportant un regard critique sur ce sujet : ainsi, les relations à plaisanterie entre les groupes (tels que les clans) seraient à analyser en tant que « pactes », car elles sont basées sur une alliance fixée par un pacte de sang mythique. Celles-ci seraient à distinguer des autres pratiques de relations à plaisanterie, notamment celles qui relient les différents membres de la famille21.
Dans la tradition francophone, le choix de dénomination de ce phénomène est beaucoup plus vaste, et varie en fonction de l’époque, mais aussi d’un auteur à l’autre.
Ainsi, au début du XXième siècle, Maurice Delafosse, en présentant la notion de clans et de totems, note l’existence de « sortes d’alliances », ou bien de « sénékoun » (terme bambara)22. Plus tard, en 1929, Henri Labouret consacre son article à la « parenté à plaisanteries », de même que Marcel Mauss, la même année23. Dans les ouvrages du milieu du siècle, on emploie toujours le terme local, mais on parle en même temps de la « parenté à plaisanterie »24.
Dans les remarquables contributions des années 1930-70, l’esprit critique et analytique s’instaure dans la pensée ethnographique. Denise Paulme consacre son travail à la « parenté à plaisanteries », aux « alliances » et « pactes de sang »25. Marcel Griaule met en doute le terme habituel et présente son analyse des Pierre Smith27 parle des « parentés à plaisanterie », plaisanterie ».
La nouvelle génération des chercheurs travaillant sur le phénomène en question, ont tendance à employer le terme de « relations à plaisanterie »28, ou encore « relations de plaisanterie »29. Certains auteurs préfèrent parler des « cousinages » ou bien « cousinages à plaisanterie »30. D’autres, en revanche, préfèrent garder le terme plus fréquemment employé auparavant de « parenté à plaisanteries »31, ou, toujours, de privilégier le terme en langue locale32.
Tout au long de mon texte, j’emploie abondamment le mot mandinka sànawuyaa, tout comme le feraient spontanément mes informateurs. Pour les exemples joola, je fais le choix de privilégier le terme français « relations à plaisanterie ».
En effet, comme nous venons de le voir, un vaste éventail de choix terminologique s’offre nous. Ceci dit, j’ai trouvé le terme de « relations à plaisanterie » plus adapté aux particularités de cette institution, notamment chez les Joola. Je rejoins les chercheurs pour lesquels la « parenté » à plaisanterie s’appliquerait plutôt aux relations spécifiques entre les membres de la famille, comme les grands-parents et les petits-enfants, ou bien les cousins croisés. Le mot « cousinage » parait difficilement employable dans le contexte joola, malgré le fait que l’emploi de ce mot peut être justifié chez les Mandingues. Le raisonnement en termes d’alliances semble également bien pertinent dans le contexte Mandingue, mais peu adapté aux réalités joola.
C’est dans la nécessité de disposer d’un terme plutôt neutre et générique, et en même temps applicable aux deux populations étudiées, que je parlerai, dans cette thèse, des relations à plaisanterie chez les Mandinka et les Joola.
Etat de l’art et objet de recherche
Orientations théoriques générales
Depuis plus d’un siècle, les relations à plaisanterie ont fait partie des sujets bien connus de l’anthropologie. Ce sont les matériaux ethnographiques ouest-africains qui font entrer les relations à plaisanterie dans le discours savant.
Les ouvrages ethnographiques fondamentaux du début de XXième siècle nous font découvrir ce phénomène qu’on retrouve chez plusieurs populations de l’Afrique occidentale (Wolof, Toukouleur, Mossi, Peul, Bambara, Sénoufo, etc.)33. L’attention particulière est portée à la description de leur organisation sociale, c’est ainsi que l’on apprend l’existence des clans, auxquels sont rattachés des noms ayant, à leur tour, des différentes déclinaisons dont le totem. Certains de ces clans sont liés par une alliance appelée sénékoun en bambara. Cette relation a quelques caractéristiques principales que nous retiendrons :
Possibilité, et même prescription, d’« insultes » entre les membres des clans concernés, sans qu’il y ait une réaction négative. Ce même comportement serait par ailleurs condamnable dans d’autres circonstances ;
L’obligation de l’entraide et de l’assistance entre les membres des clans concernés.
Les exemples wolof et peul d’Henri Labouret contribuent à l’image universaliste des relations à plaisanterie qui sont présentées comme un phénomène véritablement omniprésent dans toute l’Afrique Occidentale. Ces relations concernent non seulement les clans, mais aussi certains membres de famille, notamment les cousins croisés. Chaque partenaire de relations à plaisanterie a un nombre d’obligations vis-à-vis de l’autre, par exemple, lors des démarches en vue de mariage. Ils peuvent en outre se traiter mutuellement d’« esclaves » et affirmer ainsi leur supériorité. Ce type de relations peut également exister entre les ethnies, parmi lesquelles nous retiendrons les Peuls et les Sereer, ainsi que les Sereer et les Joola. La relation à plaisanterie a dans son origine un pacte de sang, qui se traduit dans un récit d’origine comportant souvent le motif du sang versé qui a fait naître ce lien spécifique entre les clans et, par conséquent, entre les membres de chaque clan34.
De nombreux chercheurs ayant travaillé en Afrique de l’Ouest ont été attirés par le système des noms claniques développé sur ce territoire, chacun de ces nom ayant des attributs tels que les équivalents, le totem, l’appartenance à un des groupes socio-professionnels, etc. Le travail du Lieutenant Molinie35 en est un exemple pertinent. Concernant les partenaires de relations à plaisanterie, ce dernier contribue à approfondir notre connaissance sur les fonctionnalités de ces relations : les partenaires de relations à plaisanterie jouent le rôle d’intermédiaire dans des conflits, ou encore si une rupture de l’interdit a lieu, ils interviennent également dans les démarches matrimoniales. Dans certains cas, il n’est pas possible de se marier avec son partenaire de relation à plaisanterie, ce qui n’est pas néanmoins une règle générale.
Tout un nombre de travaux qui sont considérés comme « classiques » dans l’étude des relations à plaisanterie, ont construit la base de notre compréhension de ce phénomène. Une discussion scientifique à ce sujet se déroule au cours de plusieurs années entre M. Mauss, D. Paulme, A.R. Radcliffe-Brown et M. Griaule, sur les pages de la revue Africa: Journal of the International African Institute.
Denise Paulme36 analyse l’alliance mangou chez les Dogons, qui relie les groupes. Elle remarque quelques particularités qui distinguent le mangou et le sanankuya. Le premier peut également s’établir entre les régions, entre les Peuls et les forgerons, ou encore au sein de la famille, entre un homme et les femmes qui peuvent éventuellement devenir ses épouses (femmes de ses frères, sœurs de sa femme et leurs filles, femme de son oncle utérin), entre les grands-parents et les petits-enfants. On découvre l’interdit d’agresser physiquement son partenaire de relation à plaisanterie et même de voir son sang. D. Paulme présente diverses possibilités d’expression de cette relation : insultes, comportement déviant lors des cérémonies funéraires. L’explication de cette tradition met en avant la problématique de pacte de sang.