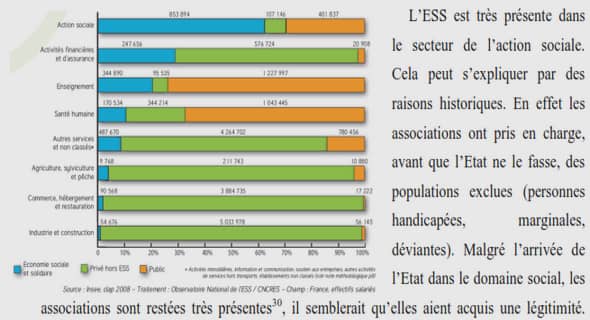Les chocs subis par les chevaux
En dépit de leurs protections et des règlements qui sanctionnent les coups qui leur sont portés, les chevaux subissent régulièrement des chocs. Souvent sans conséquences, ils occasionnent parfois des chutes. Les chroniqueurs se plaisent à les relever comme au cours de ce combat de Gaston IV de Foix au Pas de Châlons-sur-Marne où, « le cheval dudit ardenois cheut sur le cul, et tint à bien peu que homme et cheval ne renverserent par terre »188. Le plus souvent, la chute du cheval et de son cavalier n’ont pas pour origine un coup porté directement sur l’animal. La force du choc sur certaines parties de l’armure du chevalier peut y suffire. Au Passo Honroso, un coup puissant de Pedro de Nava sur le plastron de Lope de la Torre, en direction du cœur, fait tomber à terre ce dernier ainsi que son cheval189. De même, la frappe de Pedro de Silva sur le garde-bras gauche de Pedro de los Rios, entraîne la chute de son cheval à terre190. Ces rudes collisions réclament quelques temps morts mais les combats reprennent, sans même changer de cheval.
Parfois, le choc subi par le cheval est beaucoup plus préjudiciable. Le cheval du comte d’Escalles est tué dans un combat contre le bâtard de Bourgogne au cours de l’emprise menée par ce dernier à Londres, en 1467191. Apparemment, l’absence de lice pour séparer et guider la course des deux animaux en est à l’origine. Cependant, la barrière n’est pas une garantie absolue : Lope de Ferrera frappe le cheval de Sancho de Villacorta sous le niveau de l’œil gauche, lors de leur affrontement au Passo Honroso. Le fer et un bout de la hampe d’environ un empan pénètrent sous la protection de l’animal. Villacorta n’a pas d’autre solution que de descendre de sa monture, retirer la lance de son destrier et se procurer un autre cheval192.
Deux combats du Passo Honroso font figure de cas exceptionnels dans le non-respect des chevaux. À chaque fois, un chevalier mécontent d’avoir eu son cheval blessé s’en prend à son tour au destrier de son adversaire. En quelque sorte, la frappe de Sancho de Ravanal sur la croupe du cheval d’Alfon de Cavedo apparaît comme la réponse au mauvais coup qu’avait subi le cheval du premier quelques courses auparavant. En rompant les parements et en faisant saigner le cheval de son adversaire, Ravanal se fait justice (du moins fait-il justice à son cheval). Cette pratique peu courtoise n’est pas du goût des juges qui déclarent la lance de Cavedo rompue, pour la laideur du coup de Ravanal. Le contentieux autour de la question des chevaux ne s’arrête pas là puisque Ravanal touche à nouveau le cheval de Cavedo à la seizième course193.
Dans le combat qui oppose Lope de Estuñiga à Juan de Villalobos, les chevaux sont encore pris pour cibles : dès la première course, Estuñiga touche le cou du cheval de Villalobos tandis que ce dernier fait de même au destrier d’Estuðiga, déchirant les parements de l’animal. Villalobos change son cheval blessé. La huitième course du combat semble être la réponse de la première : Villalobos perce l’oreille du cheval d’Estuðiga, faisant jaillir le sang. Les juges déclarent alors la lance d’Estuðiga rompue et les armes terminées. La querelle des chevaliers s’est tournée vers leurs chevaux194 quelques exceptions près, les chevaux sont épargnés par les vilains coups. Dans la multitude de rencontres que les chroniqueurs des pas d’armes ont détaillées, très peu signalent ou laissent deviner de véritables agressions à leur encontre. Comme ces animaux sont utiles, appréciés et chers, les pas d’armes sont élaborés pour qu’ils soient protégés. Le risque zéro n’existe pas et quelques accidents graves surviennent mais ils font partie du quotidien et les chevaliers savent qu’ils doivent être attentifs dans les différents domaines de leur pratique équestre. Même s’ils existent, les cas de blessure de chevaux restent donc faibles en proportion des combats. On peut oser la comparaison et affirmer que les chevaliers sont plus souvent blessés que leurs montures lors des emprises et pas d’armes : la lice qui sépare les courses est pour les animaux un véritable rempart.
L’armement
Aux XIIème et XIIIème siècles, à la guerre comme au tournoi, l’armement du chevalier se compose essentiellement, selon Pierre André Sigal, de la lance et de l’épée, accessoirement de la masse d’armes195. Au XVème siècle, l’épée est toujours l’arme caractéristique du chevalier et la lance celle des combats à cheval. Cependant, la hache est particulièrement appréciée dans les emprises et pas d’armes alors que la masse d’armes ne l’est pas. Plus rarement, certaines armes peuvent aussi servir : dagues, bourdons, gagne-pain196.
Le type d’arme utilisée lors d’une emprise ou d’un pas est chaque fois défini par avance. Parfois, les affrontements se succèdent au moyen d’un seul type d’arme. C’est le cas de la plupart des pas tenus dans la Péninsule ibérique, en France et notamment à la cour d’Anjou. Le Passo de la Fuerte Ventura, le Passo Honroso ou celui de Valladolid s’organisent autour de joutes à cheval avec lances. Il en va de même pour les Pas de Nancy, de Châlons-sur-Marne, de Saumur ou de Tarascon. En revanche, à la cour de Bourgogne, les combats sont plus diversifiés puisque lances, épées et haches sont utilisées alternativement. Néanmoins, même en Bourgogne, la joute à cheval est la plus prisée et la majorité des combats s’effectuent à la lance car la visibilité du combat est accrue par rapport à l’utilisation de l’épée ou de la hache. L’autre intérêt se situe dans le côté spectaculaire des coups : les lances explosent sur l’adversaire quand la charge atteint son objectif, ce niveau, une différence apparaît entre les emprises d’armes et les pas. Les premières reposent sur un seul duel tandis que les seconds s’organisent autour d’une succession d’affrontements à un contre un. Les organisateurs des pas n’ont pas besoin de structurer les combats pour qu’ils se prolongent : un combat très court est immédiatement suivi d’un autre. À l’inverse, dans une emprise, un seul affrontement à la lance peut s’achever en moins de trente minutes. Pour pallier cette trop grande rapidité éventuelle des combats, l’ajout d’armes s’avère être un bon moyen pour assurer un temps de confrontation satisfaisant pour les spectateurs. Outre les préférences des chevaliers, le choix des armes est donc une garantie de spectacle. Ce dernier doit durer, connaître des moments intenses et être visuellement facile d’accès.
La lance
La lance est l’arme la plus représentative des pas d’armes et aussi la plus prisée par les organisateurs. En dehors du Pas de la Dame Sauvage où l’utilisation de la lance est accessoire et le Pas du Perron Fée qui repose pour partie sur l’épée, tous les pas font de la lance l’arme reine. Les coups brutaux, rapides et faciles à identifier, y compris pour le spectateur novice, assurent un spectacle de qualité.
La lance se compose de plusieurs parties : la hampe, le fer et la rondelle. La hampe est la partie allongée qui constitue le corps de la lance. Elle peut être en bois de frêne ou en sapin qui offre une possibilité d’éclatement supérieur, donc une dangerosité de frappe moindre. Le matériau utilisé permet de distinguer les lances de joutes de celles de guerre où les combattants recherchent des bois résistants. Viollet le Duc considère que la longueur d’une lance est d’au moins quinze pieds (soit plus de quatre mètres cinquante), atteignant parfois les cinq mètres197. Il faut tout de même considérer qu’environ quatre vingt centimètres se situent en arrière de la main porteuse, de manière à faire contre-poids et à reposer sur le faucre198. En effet, une lance pèse de quinze à dix-huit kilogrammes199. Il est donc nécessaire de réfléchir à la position de son centre de gravité. L’arrière de la lance est souvent conçu pour être plus lourd, à proportion, que l’avant. La longueur de lance correspond à une situation courtoise. Des lances plus courtes sont nécessaires à la guerre tandis que celles des pas d’armes présentent l’avantage d’offrir un spectacle plus ample et se rompent avec plus grand fracas. La rondelle, en acier, empêche la main de glisser en servant de butoir, ce qui permet d’appuyer les coups. La rondelle sert aussi de protection puisqu’elle couvre une zone tout autour de l’avant du gantelet, sur un diamètre d’une quinzaine de centimètres. Étant donné la longueur et le poids de la lance, un système d’attache sur l’armure est conçu pour que le chevalier puisse la tenir à une main, l’autre tenant les rênes et supportant éventuellement un bouclier.
Le fer est fixé au bout de la hampe, la plupart du temps émoussé, afin de limiter la possibilité de pénétration directe dans l’armure adverse. Cependant, certains combats s’effectuent avec des lances au fer pointu et tranchant, on parle alors de lance à fer émoulu. Ce modèle, utilisé au Passo de Valladolid, explique l’arrêt prématuré de cette fête de chevalerie en raison de la gravité des blessures. En effet, la pointe à fer émoulu est faite pour percer l’armure de l’adversaire200. Il en est de même pour le Pas de l’Arbre Charlemagne dont les chapitres précisent que « le noble homme qui touchera à l’escu violet, semé de larmes d’or, sera tenu de courre onze courses de lances à fers émoulus »201. Pour ce pas, comme pour celui de la Belle Pèlerine, il n’y a donc pas une volonté manifeste de diminuer le risque lié aux affrontements.
Le choix des fers est un des paramètres essentiels de modulation du risque encouru dans l’exercice de la joute. Généralement, le contexte courtois des pas conduit à les réglementer pour qu’ils soient moins dangereux. Cette question reste néanmoins délicate à trancher pour les organisateurs car il faut préserver les chevaliers des blessures et en même temps maintenir un niveau de risque suffisamment élevé : sans lui, point de bravoure démontrée. De nombreuses discussions relatives au choix des fers ont cours entre chevaliers et juges. Les litiges à ce sujet sont fréquents. Au Passo Honroso, même si le type de fers est prévu par les chapitres, il faut toute la diplomatie de Lope d’Estuðiga pour convaincre don Juan Niño de Portugal de présenter ses lances aux juges afin d’en vérifier la conformité202. Après de longues tergiversations, ce dernier finit par accepter de faire monter des fers retravaillés par les armuriers du pas203.
Au fil du temps, de plus en plus de précautions sont prises pour prévenir les blessures. Dans les pas les plus tardifs, les lances utilisées sont moins dangereuses. La pointe n’est plus aussi acérée. La partie finale de la lance, souvent dénommée « rocher », est constituée d’une couronne à trois branches non contondantes. De la sorte, le fer a moins de chance de pénétrer l’armure adverse. L’utilisation de lances dites courtoises (c’est à dire au fer émoussé en arrondi, évasé ou en rocher) occasionne des chocs moins risqués et limite les blessures. Cette volonté est organisatrice de la plupart des règlements des pas et se traduit par des interdictions et des obligations sur la forme des lances. Au Pas de la Bergère, les rochers sont dits courtois204. Le Pas du Perron Fée suit également cette orientation puisque les courses se font « avec des lances mesurées garnies de crochets à bouts ronds »205. La recherche de sécurité se traduit également par d’autres aspects. Ainsi, le chapitre XII du règlement du Pas de la Fontaine aux Pleurs précise qu’« ils courront avec des lances identiques jusqu’à ce qu’elles soient rompues ou le fer abîmé sur une longueur d’un doigt au moins : ils utiliseront des selles de guerre sans que le cavalier soit attaché à ladite selle »206. L’adaptation permet alors à celui qui réceptionne le coup de lance d’amortir le choc par un effet de recul, puisqu’il n’est pas attaché à la selle. Si le risque de chute demeure, celui de prendre un coup du rocher à pleine vitesse sans l’amortir est amoindri.
L’étroite surveillance des juges concernant le type de lances utilisées est également destinée à maintenir l’égalité des chances. Ce principe est presque toujours présent dans les chapitres. Il peut se traduire par l’utilisation de lances identiques, à l’image du Pas de Saumur dans lequel les combattants s’avancent avec « pareille lance, longueur n’avoit différence »207.
Le plus souvent, les lances ne sont pas parfaitement semblables. Dans ce cas, elles sont présentées aux deux chevaliers, la bienséance laissant le combattant assaillant choisir le premier. Au Passo de la Fuerte Ventura, les chevaliers semblent disposer à leur guise d’au moins deux sortes de lances : normales ou grosses. Les premières sont plus faciles à rompre, donc intéressantes à utiliser. Les secondes, plus résistantes, permettent de frapper plus fort et de montrer sa puissance. Cet aspect n’échappe pas au fauconnier-écrivain du roi de Castille qui souligne que le souverain a émerveillé le public pour avoir rompu deux grosses lances, ce que personne d’autre n’a réussi ce jour là208. Au Passo Honroso, les chevaliers effectuent leur choix parmi un chariot de lances. Ils peuvent choisir des petites, moyennes ou grosses lances, sans tenir compte de ce que fait l’adversaire. De même, lorsque Jacques de Lalaing combat contre Jean de Boniface à Gand, la lance du Bourguignon est plus grosse et plus solide que celle de son adversaire. Cette situation n’est pas forcément avantageuse si on considère que l’une des manières de vaincre est de rompre plus de lances que son opposant. Quoi qu’il en soit, les deux protagonistes se sont mis d’accord, au préalable, par l’intermédiaire des juges et des rois d’armes. Parfois, il arrive que les chevaliers fassent une demande exceptionnelle pour utiliser leur lance personnelle. Dans ces rares cas, les armes sont obligatoirement soumises à l’approbation des juges et l’information est transmise à l’adversaire pour qu’il puisse éventuellement choisir de combattre avec des pièces de harnais en plus ou en moins. De cette manière, l’égalité des chances au départ est assurée. Les chapitres du Pas de la Pèlerine en donnent un exemple : « et livrera la belle Pèlerine les lanches touttes d’une sorte et longueur, dont le chevallier estrangier avera le choix au prendre ; mais chascun chevallier furnira de fers à son plaisir »209. L’assaillant choisit sa lance dans un stock d’armes identiques mais il peut y installer les fers de son choix, étant précisé par ailleurs que les lances sont à fer émoulu.
L’étude du type de lances utilisées lors des pas d’armes fait apparaître plusieurs tendances. Tout d’abord, ces armes, spécifiques à la joute, tendent à devenir de moins en moins dangereuses. Ensuite, les différentes alternatives (lances identiques, choisies ou soumises à vérification) permettent de respecter le principe d’égalité des chances au départ. Enfin, le choix de la lance s’insère dans une stratégie complexe : chaque chevalier la choisit en fonction de ses forces, de ses faiblesses et de ses objectifs. Si les deux champions ne disposent pas forcément d’un matériel identique, il est librement consenti et réfléchi. L’expertise du chevalier se révèle donc à travers sa capacité à choisir le matériel le plus adapté à la situation.
La lance à pied
Les combats opposant des chevaliers à pied avec des lances sont plutôt rares dans le cadre des pas. Quand ils ont lieu sous cette forme, ils ne sont pas essentiels et précèdent une autre arme. À pied, la lance est uniquement introductive aux affrontements. Son utilisation consiste parfois à donner le signal de début du combat.
Les lances utilisées à pied sont plus courtes que celles prévues pour les joutes à cheval. Cependant, leur longueur varie selon le règlement et la forme d’affrontement imposée aux chevaliers. En effet, on peut distinguer les situations de « pous » de lance de celles de jet. L’affrontement en « pous » de lance reproduit celui de la joute à cheval mais sans l’animal. Les chevaliers s’avancent à pied l’un vers l’autre et doivent rompre leur lance en frappant l’adversaire par la pointe. La vitesse des coups est nettement atténuée par rapport aux combats à cheval puisque la vitesse créée par les animaux a disparu. Le recul dont dispose le chevalier après chaque coup lui permet de prendre de l’élan. Cependant, à pied, compte tenu de l’équipement qu’il porte, on peut considérer que sa vitesse de déplacement est quasi-nulle. La seule vitesse de bras entre en compte, ce qui limite beaucoup les chocs violents. Ainsi, dans le combat à pied du seigneur de Ternant contre Galiot de Baltasin, les chevaliers doivent-ils reculer de sept pas après chaque assaut210. Ces quelques mètres d’élan n’aboutissent pas à des chocs très brutaux ni dangereux, du fait de la faible maniabilité des armes.
L’utilisation de la lance, à pied, reste quelque peu marginale et absente des grands pas d’armes, que ce soit celui du Passo Honroso, de l’Arbre Charlemagne, de la Fontaine aux Pleurs ou de l’Arbre d’or. Sa présence n’est pas révélée par les chroniqueurs, ce qui signifie que les chevaliers ne s’opposent pas de cette manière ou bien que ce ne sont pas des moments importants des combats, l’essentiel reposant sur les autres formes d’opposition. Quand le règlement prévoit de débuter un combat à pied avec des lances, les chevaliers sont souvent pressés de passer à une autre arme. Lors de l’emprise menée par Jacques de Lalaing en Écosse, le chevalier bourguignon, accompagné de Simon de Lalaing et Hervé de Mériadec, affronte trois seigneurs écossais211. Les six chevaliers s’opposent à pied, munis de lances. Avant la rencontre, les Bourguignons ont décidé de jeter immédiatement leurs lances pour se saisir de leurs haches. Face à cette stratégie, les Écossais tentent d’abord de résister avec leurs lances mais les abandonnent rapidement, au profit de leurs haches. Seul James de Douglas tente un coup d’estoc au visage de Mériadec avant de prendre sa hache. Ce déroulement de combat montre bien qu’à pied, la lance n’est pas une arme essentielle mais plutôt encombrante.
Le deuxième type d’affrontement à pied avec des lances consiste à jeter l’arme sur l’adversaire, comme un javelot. Dans ce cas, la lance sert aussi d’arme introductive à une autre. Cependant, ces jets de lance réclament une grande attention de la part des chevaliers car les coups peuvent être décisifs : la lance peut alors transpercer les protections des combattants. D’un geste décidé, Jean de Rebremettes cherche à viser la tête d’Henri de Sasse et Georges Chastellain, admiratif, écrit que, s’il l’avait atteint, il l’aurait tué212. De son côté, le seigneur de Haubourdin fait la douloureuse expérience d’un jet de lance contre le bâtard du Béarn, au Pas de la Belle Pèlerine. Touché au bras, le fer pénètre la chair profondément213. Ici aussi, la lance est introductive à une autre arme mais elle s’avère plus dangereuse que pratiquée en « pous » de lance.
L’épée
L’épée est l’arme emblématique des chevaliers. Elle est nécessaire pour leur adoubement et certaines, à mi-chemin entre mythologie et histoire, sont vénérées, à l’image de Durandal, l’épée incassable de Roland, d’Excalibur, l’épée mythique remise par Merlin à Uter Pendragon puis transmise à son fils, le roi Arthur, ou encore de Tizona, l’épée du Cid, qui avait appartenu au légendaire roi Búcar du Maroc.