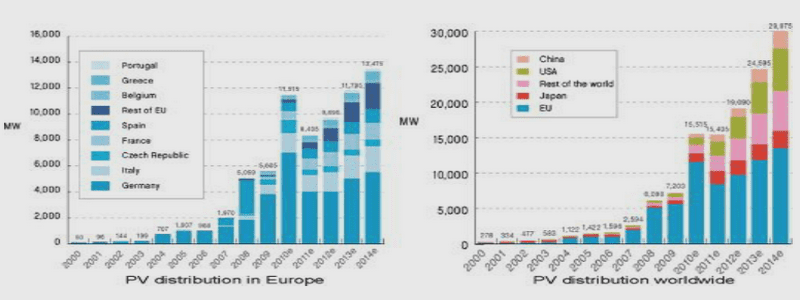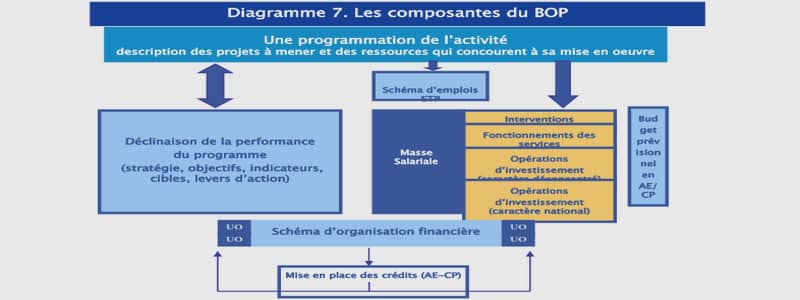Les conditions d’émergence du mbalax à Dakar
Depuis les XVIIe et XVIIIe siècles jusque dans les années 1920, des marins africains, souvent originaires du Cap Vert, et engagés sur des navires marchands comme dans les armées coloniales, popularisent à leur retour le répertoire musical cubain et la guitare espagnole, dont l’usage ne se développera cependant véritablement qu’au début du XXe siècle (Bolster 1998). Les populations sénégambiennes sont ainsi mises en contact avec les musiques qui donneront naissance au « son », genre musical afro-cubain apparu entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle (Shain, 2002 : 85-86). C’est l’apparition de la radio et les prémisses d’une production discographique qui participent à la diffusion de la musique cubaine au Sénégal, au départ dans les classes aisées, puis jusque dans l’ensemble de la population. Considéré aujourd’hui comme une des influences les plus notables de la musique populaire sénégalaise du XXe siècle, le titre « El Manizero », de Don Azpiazu est publié en 1930 sur le label RCA Victor26, avant d’être diffusé partout dans le monde, et notamment en Afrique de l’ouest (Collins 1994). Il s’agit d’un disque qui trouve son inspiration dans la musique des grands orchestres de jazz américains en y incorporant des rythmes cubains. Le gramophone reste cependant réservé à cette époque aux élites coloniales, et la musique cubaine ne se diffuse plus largement dans la population sénégalaise qu’avec l’avènement de la radio, qui apparaît au Sénégal en 1939, avec la création de Radio-Dakar, utilisée principalement pour un usage militaire (Sagna 2001). Ce n’est qu’en 1946 que sont introduits les premiers bulletins d’informations, diffusés à partir de la métropole, et les premières émissions locales qui sont diffusées depuis Saint-Louis à partir de 1952 (ibid., 2001). Mais à une époque où la musique cubaine, les boléros, les tangos, et les biguines étaient en vogue à Paris, Radio-Dakar propose également des programmes de musique de danse, destinée aux employés des administrations coloniales (Gibbons 1974). La musique dite « latine » devient ainsi peu à peu un élément central de la culture sénégalaise27. Mais la musique cubaine ou afro-caribéenne ne constitue pas la seule importation d’une musique extra-sénégalaise sur le territoire national au XXe siècle : les soldats sénégalais de retour de la première guerre mondiale rapportent aussi avec eux les musiques qu’ils ont écoutées en Europe pendant le conflit (jazz et fox-trot) ainsi que quelques gramophones (Nago Seck 2010).
Les premiers orchestres composés de musiciens sénégalais apparaissent dans les années 1930. Ces derniers sont souvent salariés de la fonction publique, font partie des élites urbaines plutôt que des classes populaires28 et c’est au milieu des années 1950 que ces premiers groupes commencent à se professionnaliser. On trouve par exemple des orchestres comme le Guinea Jazz, ou les Déménageurs à Dakar, et la Lyre ou le Saint Louisien Jazz à Saint-Louis29, qui jouent un répertoire alternant les standards de la chanson française, de la musique latino-américaine, mais aussi des musiques afro-brésiliennes comme le gambe ou l’asiko (Collins, 1994; Shain, 2002; Thioub & Benga, 1999). Influencés par les musiques afro-américaines que les soldats américains basés à Dakar pendant la seconde guerre mondiale diffusent au Sénégal, d’autres groupes, comme le Harlem Jazz fondé par le saxophoniste Bira Gueye, se consacrent aussi à la reprise de succès de rock et de blues (Dieng, 2020). À Thiès30, le chanteur Abdoulaye Ndiaye, qui a fait ses premiers pas dans la musique en chantant dans les cérémonies kassak31, crée son groupe, le Thiossane Club en 1952 et explique : « Je suis issu d’une famille de griots et j’y ai appris le chant traditionnel. Dans le même temps, j’ai écouté la musique de Tino Rossi, Chuck Berry, BB King ou encore Duke Ellington. Tout ça nous a influencés »32. Ces musiciens ont pour la plupart fait leur apprentissage en dehors du système scolaire : certains d’entre eux ont eu la possibilité de bénéficier d’un enseignement musical ensembles rythmiques (cymbales métalliques, caisses claires et grosses caisses telles que celles qu’on trouve dans les fanfares) (Thioub et Benga, 1999). Dans les années 1950, certains groupes sont subventionnés par l’administration coloniale, qui leur accorde des prêts pour acheter des instruments, met à disposition des locaux de répétition, ou met en place des cours de musique. Mais d’autres groupes arrivent tout de même peu à peu à acheter leurs propres instruments, ce qui leur permet alors de « s’émanciper de la tutelle coloniale » (Shain, 2002 : 88), et leur donne la possibilite de se soustraire au salariat. Cependant, beaucoup de musiciens continuent jusqu’à la fin des années 1950 à exercer leur activité musicale en parallèle de leur activité professionnelle principale. La pratique de la musique reste ainsi perçue à cette époque comme une activité de loisirs, et non comme une « activité professionnelle sérieuse » (Wane, 2015 : 196). Les concerts ont en effet lieu dans des hôtels, des bars et des cabarets, perçus comme des lieux de débauche, fréquentés par des personnes à la « moralité douteuse » (Thioub, 1997 : 1117), ce qui pèse sur la réputation des musiciens et sur la façon dont leur activité est envisagée par la société sénégalaise de l’époque. À la veille de l’indépendance, et à l’opposé de ce qui se passe dans d’autres pays d’Afrique de l’ouest, comme par exemple au Ghana ou au Congo34, la musique populaire sénégalaise n’est cependant pas un vecteur de subversion contre l’administration coloniale. Elle est jouée dans des espaces et des temps de loisirs et de détente, plutôt que dans une volonté d’expression politique, même déguisée (Benga 2002). La musique latino-américaine reste omniprésente, et comme le rapportent Ibrahima Thioub et Adrien Ndiouga Benga, les musiciens ont recours aux services d’étudiants en espagnol et en portugais qui les aident à traduire les paroles des chansons les plus populaires et à corriger leur diction (Thioub et Benga, 1999 : 217).
Après l’adoption de la loi-cadre Defferre du 23 juin 195635, et à la suite du référendum de 1958, le Sénégal devient une république au sein de la Communauté française. Les représentant des pays francophones d’Afrique de l’ouest négocient la même année la création de la fédération du Mali qui regroupe le Sénégal, la République soudanaise (actuel Mali), la Haute-Volta (actuel Burkina Faso) et le Dahomey (actuel Bénin), et dont la constitution est approuvée par les délégués des pays concernés le 17 janvier 1959. Le Dahomey et la Haute-Volta quittent la fédération en janvier 1960, sous l’influence de la France et de la Côte d’Ivoire (Cissoko 2005). L’assemblée fédérale du Mali est présidée par Léopold Sédar Senghor36, le gouvernement fédéral étant présidé par le soudanais Modibo Keïta37, avec un gouvernement constitué de quatre ministres de chacun des deux pays. Mais les désaccords entre sénégalais et soudanais s’accumulent rapidement, tant au niveau du projet politique que des nominations, et les députés sénégalais votent l’indépendance du pays le 20 août 1960. Le 5 septembre suivant, Senghor est élu président de la république du Sénégal (Ndiaye, 1980).
La création du Star Band en 1959 marque le début d’une nouvelle période pour la musique sénégalaise (Diop, 2002b; Stapleton et May, 1987). Créé par Ibrahima Kassé, propriétaire du Miami Club à Dakar, cette formation propose dans un premier temps une musique afro-cubaine, avec des paroles chantées en espagnol, mais fait progressivement évoluer son répertoire en remplaçant les percussions cubaines congas par des tambours sabar, sous l’impulsion du chanteur Pape Seck38. Les rythmes wolofs39 et sénégambiens sont aussi adaptés à la guitare (Simon Broughton et al. 2006). Ces ensembles sabar, qui seront amenés à prendre une place déterminante dans l’identité sonore des musiques populaires sénégalaises de la seconde moitié du XXe siècle, correspondent à un groupe de cinq tambours40, aux timbres différents et à chacun desquels s’attachent des motifs rythmiques spécifiques : le nder aux timbres plus aigus, les gorong-talmbat et gorong-mbabas utilisés par les solistes, le mbëng mbëng avec ses sonorités plus graves, et le lamb, souvent accompagnés par le tama (tambour d’aisselle à tension variable). Ils sont présents dans toutes les cérémonies sénégalaises, qu’elles soient publique ou privées : compétitions de lutte, courses hippiques, moment des récoltes, circoncision, mariage, tatouage, hommages à Dieu, anniversaire du Prophète, ramadan (Penna-Diaw, 2010, 2016). Les percussionnistes des années 1960 sont ainsi très demandés. Lama Bouna, Mbass Gueye, ou Vieux Sing Faye sont alors parmi les plus populaires, mais la référence à cette période reste incontestablement Doudou Ndiaye Rose, qui a continué à enrichir le répertoire rythmique du sabar jusqu’à son décès en 201541 (Benga 2002). Le théâtre national Daniel Sorano, une salle de spectacle polyvalente d’environ mille places, est inauguré à Dakar par le président Senghor en 1965, et c’est dans ce nouvel équipement culturel qu’est organisé en 1966 le Festival Mondial des Arts Nègres (Senghor, 2004). C’est à cette occasion que la langue wolof est pour la première fois intégrée à de la musique dite « occidentale », lors d’une performance du saxophoniste Bira Gueye accompagné par la chanteuse Mada Thima42 qui composent et interprètent l’hymne du festival (Benga 2002). D’autres sources évoquent aussi Seydina Insa Wade, également cité comme un des premiers sénégalais à chanter en wolof, dans un style cependant plus proche du folk, avec une instrumentation marquée par les rythmes sabar, la voix, et la guitare acoustique, et des textes puisant leur inspiration aussi bien dans les contes de ses aïeux que dans la situation politique du pays (Nago Seck 2010). La musique de tous ces artistes continue à évoluer durant les années suivantes, portée par des groupes comme le Star Band ou Orchestra Baobab, qui modernisent leur répertoire tout en continuant à y incorporer des influences musicales incluant les musiques sénégambiennes locales. Mais ces groupes restent relativement marginaux sur la scène musicale sénégalaise, dépassés en popularité par la salsa, le rock, la pop, et le reggae partir de l’indépendance et jusqu’au début des années 1980, le concept de négritude est mis en avant par le président Senghor dans une démarche de soutien au secteur artistique et culturel, afin de permettre aux Sénégalais de mieux connaitre et de valoriser leurs cultures et leurs identités (Senghor, 1971). Des programmes spécifiques sont mis en œuvre pour inciter les orchestres à intégrer les langues nationales sénégalaises à leurs répertoires, et pour créer une musique authentique et locale » (Benga, 2002 : 79). Mais les tentatives de mélange des instruments traditionnels avec les instruments dits « modernes » ne semblent pas convaincre le public, qui continue à leur préférer les musiques salsa, jerk, reggae, funk, ou pop. Des festivals de rock et de jerk sont d’ailleurs organisés à Dakar dans les années 1960 et plébiscités par la population, comme le Festival de Rock et de Jerk organisé en 1967 au Théâtre de Verdure, présidé par Johnny Halliday, et sponsorisé par Salut Les Copains43, Europe 144, Dakar Matin45 et Air Afrique46. La capitale accueille aussi régulièrement des chanteurs et des musiciens internationaux comme Françoise Hardy, James Brown, The Jackson Five, ou Gilbert Bécaud (Benga, 2002 : 79). Un programme initié en 1962 par l’État sénégalais permet par ailleurs l’implantation de plus de 145 postes radio d’écoute collective à travers tout le pays, qui sont gérés bénévolement par des instituteurs, des infirmiers ou d’anciens combattants. Les radios étrangères émettant en ondes courtes peuvent ainsi être captées, notamment Radio France Internationale (RFI), La Voix de l’Amérique, Radio Moscou ou la BBC, mais aussi, dès 1970, Radio Syd, une radio privée émettant depuis la Gambie (Sagna 2001). Contrairement aux radios nationales maliennes ou ivoiriennes, qui disposaient alors de studios où ont été enregistrés de nombreux disques (Mazzoleni 2011b), il ne semble pas que les studios radio sénégalais aient été utilisés pour des enregistrements destinés à être diffusés ou commercialisés. À cette période, on se sert alors de disques vinyles sur lesquels Bernardo, un français établi au Sénégal enregistre directement certains groupes, avec un rendu sonore d’une qualité approximative (Ndour 2008) la fin des années 1960 et durant toute la décennie 1970, de nouvelles formations comme Xalam, The Sahel, et Ouza font leur apparition, en s’inscrivant dans la même démarche que leurs prédécesseurs, c’est à dire en continuant à mettre en avant les percussions sabar47 et les chants wolof, qui font de plus en plus référence à la religion musulmane, aux confréries mourides48 et aux valeurs traditionnelles49, tout en incorporant à leur musique des influences jazz, rock, et rythm and blues plus contemporaines et venues d’occident. Les instruments utilisés par ces groupes sont généralement le saxophone, la guitare électrique, la batterie, la basse électrique et les percussions sabar et tama. Sans qu’il soit possible de déterminer précisément à quel moment cette appellation apparaît, la musique de ces groupes est progressivement qualifiée de musique mbalax. Le terme désignait jusqu’alors une série de motifs rythmiques joués sur certains percussions sabar. Comme l’explique Doudou Ndiaye Rose : « Le mbalax est joué sur le nder ou le mbëng mbëng, et il fait une partie du rythme. Si il n’y a que le mbalax, ce n’est pas complet »50. Mais le public et les artistes s’approprient cette terminologie pour l’associer au style de musique jouée par les groupes précités, sans doute en référence aux rythmes et aux percussions sabar intégrées aux orchestres. Youssou Ndour précise ainsi que « la musique aurait pu s’appeler le sabar, ou d’autres rythmes, ou autre chose, mais (…) mbalax c’est beau, c’est original »51. Aux débuts de Xalam, le mbalax a du mal à s’imposer, ainsi que le raconte Henri Guillabert, pianiste du groupe : Au départ on jouait après l’école, on copiait les tubes, mais on s’est dit qu’on ne pouvait pas continuer à reprendre des tubes, qu’il fallait qu’on améliore notre jeu. On a commencé par essayer de jouer la musique traditionnelle sénégalaise en la jouant avec des instruments : guitare, piano et tout. La première fois qu’on a répété on trouvait ça génial, mais la première fois qu’on a joué ça dans un bal, l’organisateur est venu en disant : « Arrêtez ça, jouez nous de la musique pour danser ». Et ça c’était le mbalax, mais pour lui c’était de la musique folklorique, il fallait la mettre de côté, il avait besoin de la salsa, du funk, du rock.52
Xalam est un des premiers groupes à s’exporter en dehors des frontières nationales. Après une première tournée africaine en 1975 avec les musiciens sud-africains Hugh Masekela (saxophone) et Miriam Makeba (chant), ils sont invités en 1979 au festival Berlin Horizonte, et c’est l’enregistrement de cette performance qui constituera leur premier album distribué en dehors du Sénégal53 (Mazzoleni 2008). À la même période, le groupe Touré Kounda, formé au milieu des années 1970 à Paris par deux frères sénégalais, connait un succès grandissant en France avec une musique qui mélange influences wolof, rythmes sabar, mandjak54 et joola55, et mélodies portugaises. Grâce à leur popularité en France et à leurs réseaux, ils permettent à des orchestres sénégalais comme Xalam de faire le voyage et d’être invité dans des festivals de ce qu’on commence à appeler les musiques du monde, à Paris et en Europe.