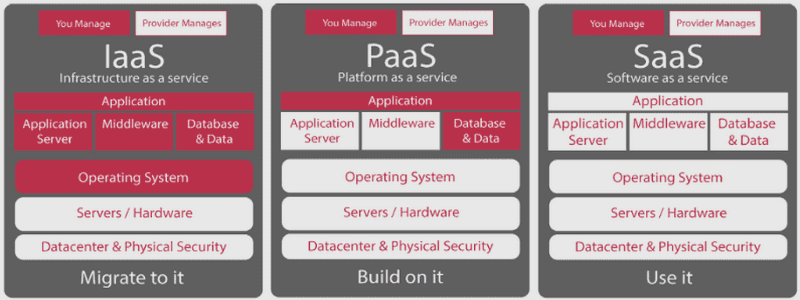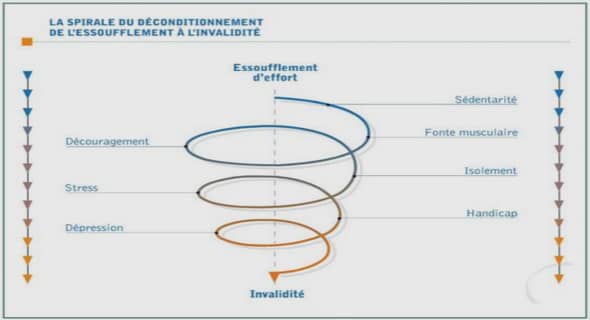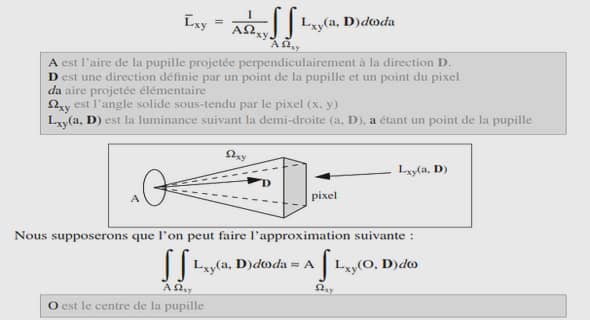Une structure sociale, ethnique et politique héritée des inégalités face à la propriété de la terre
Avant la conquête espagnole, il existait des terres communales indigènes. La terre était cultivée en commun ou individuellement selon les besoins. Avec l’arrivée des Espagnols en 1523, beaucoup de ces terres vont peu à peu être colonisées, et les populations indigènes vont y tra-vailler au bénéfice des colons. L’indépendance du Guatemala en 1823 s’établit sur les bases d’une société agraire divisée en deux groupes bien distincts. Les propriétaires fonciers criollos contrôlent la possession des terres et règlent les conflits que cette répartition entraîne, notam-ment en légiférant pour consolider la structure agraire coloniale. L’autre groupe est celui des Indigènes, ignorés des gouvernants, exploités mais rendus dociles depuis la violente répression de la révolte de Totonicapán en 1820. Cette révolte visait à former un gouvernement indigène 13.
Les Criollos ont œuvré à l’indépendance pour pouvoir récupérer l’entièreté du pouvoir économique et politique. Leur stratégie justificative a été d’exalter l’idée qu’ils étaient des purs descendants des conquistadors, qui avaient lutté et travaillé dur pour coloniser ces territoires et ces populations. L’héritage qu’ils revendiquaient alors était celui de la propriété de la terre et des Indigènes. L’Indigène était considéré uniquement comme un sujet en situation de dé-pendance, au service du colon. Revendiquer le passé pour le Criollo revenait à défendre l’ordre colonial en s’appropriant les charges d’administration des territoires et des populations, dans un nouveau contexte national 14. Le rôle de l’Indigène, dans ce projet criollo dit « conservateur », était simplement d’être dominé et soumis à l’exploitation. Cette volonté de continuité coloniale et d’appropriation foncière, en faveur des élites revendiquant leur ascendance espagnole, fut vivement contestée par une nouvelle classe possédante ladina.
Cette classe naît vers la fin du XIXème siècle, alors qu’une grande partie des terres nationales et ecclésiastiques leur sont vendues. Au sein de la population émergente métisse, qu’on appellera donc plus tard « ladina », une élite agricole se forme, achète ces propriétés terriennes et commence à les accumuler, allant même jusqu’à grignoter petit à petit sur les terres communales indigènes. Les terres sont alors sujettes à de fortes spéculations. Les Indigènes travaillent comme journaliers pour un salaire misérable dans les plantations de la bourgeoisie ladina et de l’oligarchie criolla. Les propriétés indigènes se concentrent de plus en plus dans la région de l’Altiplano, peu propice aux grandes plantations. La répartition des privilèges est alors négociée entre une classe possédante ancienne criolla restreinte et une classe possédante nouvelle ladina, un peu plus étendue, qui continue de s’approprier illégalement des terres indigènes 15. Déshéritée du pouvoir politique et économique à l’indépendance, cette nouvelle classe ladina met en avant sa volonté de construire le futur de la nation autour de l’idée de progrès. Son projet libéral, défini comme « civilisateur », prend pour modèle les États-Unis et des nations européennes telle que la France. L’éducation est le fer de lance de ce projet libéral, dont l’objectif est de « moderniser » économiquement la nation.
Durant les deux siècles qui suivent l’indépendance, des régimes conservateurs puis libéraux vont se succéder à la tête du pays, et imprégner les structures politiques guatémaltèques. Au pouvoir en 1871, le courant libéral ancre l’idée que la construction d’une identité nationale doit être placée au centre des préoccupations politiques. Dans les symboles nationaux, on réinvesti les héros pré-hispaniques et les éléments civilisationnel de l’époque maya la plus florissante, tout en rompant le lien qui les uni aux populations indigènes actuelles. L’objectif est simplement de construire les bases d’une nation différente de celle des européens. Les Indigènes sont exclus de la nation, sous des prétextes combinant le racial et le culturel. Cette infériorisation permet de justifier leur domination et leur exploitation pour renforcer les bases économiques du pays 16. En faisant disparaître les groupes de classe basés sur l’origine (le sang, la race), ce système libéral s’est mis à réguler implicitement la participation politique et les ressources à partir des différences culturelles. C’est sur ces différences que s’établit la citoyenneté guatémaltèque et sa négation conjointe, sur la base du binôme Indigène-Ladino. La conscience nationale s’élabore autour d’une identité citoyenne spécifique : l’identité ladina. Cet imaginaire place l’Indigène comme un citoyen de deuxième ou de troisième catégorie, car il est perçu comme inutile à la nation 17.
La combinaison de la pensée coloniale conservatrice criollapuis libérale ladina engendre un paradoxe dans la domination ethnique. D’un côté la nation se conçoit comme uniforme, en niant l’existence d’une culture distincte à celle officielle au sein de la nation. Mais petit à petit le métissage devient la culture nationale en privilégiant la domination blanche. Il s’agit alors de promouvoir l’assimilation des Indigènes, leur incorporation à la nation, notamment en les rendant hispanophones par des dispositifs éducatifs. L’éducation est ainsi présentée comme un instrument de « ladinisation », c’est à dire une manière de « rendre ladinas » les popu-lations du Guatemala, et particulièrement les Indigènes, en tant que condition préalable à la possibilité d’exercer des droits citoyens. Mais le droit constitutionnel à l’éducation pour tous ne s’appliquait, en pratique, que pour les Ladinos urbains. L’éducation des Indigènes est renvoyée la responsabilité de ceux qui avaient peu d’intérêt pour son développement : les propriétaires des plantations qui disposaient de la main d’œuvre indigène. L’éducation en tant qu’instrument idéologique de ladinisation autour de symboles nationaux ne s’applique donc qu’aux popula-tions non-indigènes. Elle renforce alors l’affirmation de l’existence d’un groupe ladino, assimilé au groupe de citoyens guatémaltèques. De ce fait, l’extension réelle du système éducatif aux po-pulations ladinas, et uniquement à ces populations, a été fondamentale pour la distinguer plus fortement socialement et politiquement de ceux qu’il fallait exclure de la condition de citoyen : les Indigènes 18. Ce cas est spécifique au Guatemala, par opposition à l’application intense de politiques assimilationnistes dans lespays voisins, faisant peu à peu disparaître la catégorie in-digène. Au Guatemala, la nation ne s’est finalement jamais construite depuis la rédemption de l’Indigène dans le métissage indifférencié, mais depuis une fracture sociale de la population en deux étiquettes ethniques dichotomiques et même antagoniques : celle de l’Indigène et celle du Ladino, qui perpétuent le pacte colonial de la coercition indigène. Les Indigènes sont ainsi restés un collectif social présent, numériquement très important,mais subordonné aux intérêts de l’État, de l’oligarchie et de la bourgeoisie ladina naissante, entre la ségrégation et de timides intentions d’assimilation 19.
La construction de la nation depuis la Réforme Libérale de 1871, a donc permis de consi-dérer que les Ladinos étaient les seuls citoyens qui avaient des droits politiques, par opposition aux Indigènes, considérés arriérés et incapables d’exercer ces droits, et dont la culture nuisait à la construction nationale. On les renvoyait alors à une seule utilité : l’exploitation de leur travail dans les plantations agricoles en pleine expansion 20. Cette politique libérale promulgue une lé-gislation qui permet de mettre la main-d’œuvre indigène à disposition des propriétaires terriens et des dirigeants d’entreprises agricoles, notamment par des mesures autorisant la surexploita-tion et la migration forcée 21. La construction d’une citoyenneté guatémaltèque, concomitante la disqualification des Indigènes sur des motifs culturels, les relaient alors d’autant plus à des positions subalternes. Ils sont contraints de se mettre à la disposition d’un « développement de la nation », idéologisé vers les intérêts des nouveaux capitaux et propriétaires terriens 22.
En 1901, l’entreprise états-unienne United Fruit Company achète massivement des terres au Guatemala pour y produire du café, des bananes et du sucre. Elle devient en quelques années le plus gros propriétaire terrien du pays. Le développement économique national guaté-maltèque dépend de plus en plus des investissements et des exportations nord-américaines 23. Dans la première moitié du XXème siècle, l’aggravation de l’inégalité dans la répartition des terres engendre des inégalités sociales de plus en plus fortes. Le climat social et politique se durcit, surtout dans les zones rurales. À partir des années 1930, sous le gouvernement de Jorge Ubico, se développent des dispositifs policiers et militaires, ainsi qu’une législation facilitant la répression des populations indigènes rurales, leur travail forcé dans les grandes plantations ou leur enrôlement contraint dans l’armée. Des privilèges sont accordés aux officiers militaires les plus dévoués, à qui on offre de vastes propriétés terriennes. Le salaire et les conditions de vie et de travail des journaliers agricoles indigènes se dégradent, et les propriétaires terriens sont au-torisés à les abattre s’ils quittent les plantations sans autorisations 24. Pour Ubico, les hommes indigènes seraient amenés à s’alphabétiser et à se « civiliser » au sein des casernes, dans le cadre d’une mobilisation militaire obligatoire. C’est pour cela qu’il ne juge pas nécessaire d’autoriser l’ouverture d’un Institut Indigéniste au Guatemala, bien qu’il y ai adhéré par convention, lors du 1er Congrès indigéniste inter-américain au Mexique en 1940. Pour autant, l’Indigène guaté-maltèque se trouve soumis et contrôlé par des dispositions légales qui vont contre sa dignité, sa liberté et son bien-être, tel que le travail forcé 25. Durant toute la période des gouvernements libéraux, le pouvoir des propriétaires terriens s’est réaffirmé, dans l’exploitation de la richesse laborale indigène. Pour cela, le racisme ségrégationniste contre les Indigènes s’est perpétué conjointement au racisme assimilationniste, tant dans sa version co-active que civilisatrice et persuasive 26.
Dans les années 1940, les classes moyennes ladinas montrent une forte lassitude face à une société figée qui ne tient aucun compte de la montée de leur puissance économique. Le pouvoir politique reste aux mains de l’oligarchie agraire, de l’armée, et du capital étranger 27. De plus, la situation d’exploitation est telle qu’ils craignent une révolte indigène. De 1944 à 1954, se succèdent deux gouvernements qui mettent en place des grandes mesures socio-économiques, modérées mais symboliquement fortes, après des décennies d’une politique entièrement dévouée aux intérêts états-uniens et de l’élite ladina agro-exportatrice.
Le président Arévalo (1945-1951) abolit le travail forcé, récupère des terres offertes par Ubico à ses généraux ainsi que des fincas allemandes, autorise l’activité syndicale, impose l’éga-lité salariale entre hommes et femmes, interdit l’appropriation privée des terres communales, abolit la discrimination raciale et met en place un véritable plan d’éducation 28. La plupart de ces mesures demeurent sans résultats significatifs, si ce n’est de visibiliser les inégalités et d’impul-ser l’idée qu’il est impératif de procéder à des réformes politiques d’ampleur pour les réduire 29. Dès 1945, Arévalo permet l’organisation politique des Indigènes et promeut l’amélioration de leurs conditions économique, sociale et culturelle, en tant qu’intérêt national. L’ensemble de ces processus menés de 1944 à 1954, contribuèrent à une véritable et profonde politisation de certains secteurs indigènes, qui furent violemment réprimés après le coup d’État de 1954 30.
Arévalo crée l’Institut Indigéniste National pour concevoir une nouvelle politique sociale nationale auprès des populations indigènes et recenser leurs caractéristiques socioculturelles. Les instituteurs sont formés en prenant en compte les différents groupes linguistiques. Il s’agit réellement d’incorporer les groupes indigènes à la nation, en commençant par l’alphabétisation et l’éducation. La Révolution de 1944 permet donc enfin d’étendre le droit réel à l’éducation aux populations indigènes. Mais cette éducation persiste à être conçue depuis l’idéal d’une na-tion guatémaltèque homogène autour de l’identité ladina. La ladinisation est perçue comme le meilleur moyen d’atteindre une égalité. Il est notamment considéré impératif que tous les Indigènes puissent parler espagnol pour pouvoir exercer leurs droits. Dans ce contexte, les Indi-gènes sont encore associés à une certaine « arriération », mais cette fois en raison d’un système féodal d’exploitation qui perdure depuis la colonisation et ne leur a pas permis de se dévelop-per. Il faut alors les y aider par une éducation qui les amènera vers la citoyenneté, en parallèle d’une réforme agraire qui les rendra socialement libres. En ce sens, on peut considérer que la décennie révolutionnaire de 1944 à 1954 est finalement le seul moment où se développent des politiques indigénistes effectives, avec une réelle intention d’intégrer les populations indigènes la nation dans une perspective assimilationniste. L’Indigène n’y est pas considéré comme un sujet culturellement distinct, mais comme un sujet arriéré depuis des siècles par la situation coloniale.
Árbenz Guzmán succède à Arévalo en 1951, avec 65 % des suffrages. Il instaure le début d’un système de sécurité sociale qui inclut la couverture des accidents du travail et de la maternité 31. Mais surtout, il met en place une réforme agraire qui vise à réquisitionner des terres non-cultivées, en friche ou jachère, détenues par de grands propriétaires terriens, pour les redistribuer sans discrimination raciale aux paysans sans terre. Il est estimé qu’en 1945, 2 % de la population du pays possèdait 72 % des terres cultivables et n’en exploitait que 12 %. Le Guatemala compte trois millions d’habitants, et la réforme d’Arbenz profite en peu de temps à 500.000 personnes pauvres, Indigènes et Ladinos confondus. Ils peuvent enfin accéder un peu de terre, pour de l’agriculture vivrière principalement et la vente de surplus 32. Les propriétaires des lots expropriés sont indemnisés en bons d’État à 3 % d’intérêt. Le montant de l’indemnité correspond à la valeur des parcelles, telle qu’elle figure dans la dernière déclaration de revenus. Les gros exploitants sont également amenés à payer des impôts, alors qu’ils en étaient presque totalement exonérés jusqu’alors. Par cette réforme modérée, Árbenz Guzmán cherche à développer une agriculture intégrée à une économie de marché et à transformer les rapports de production, pour adapter le Guatemala aux exigences de l’économie capitaliste et du libéralisme moderne, et l’ouvrir à l’industrie. L’économie guatémaltèque bénéficie grandement de ces changements, mais la United Fruit Company, particulièrement visée par cette réforme car, en 1950, elle ne cultive que 15 % des terres qu’elle possède, n’entend pas délaisser même une infime partie de ses avoirs et de ses privilèges. La firme refuse de supporter des contraintes auxquelles elle n’était pas habituée, telles que « payer l’impôt, rendre des comptes devant les élus du peuple, respecter des lois sociales, accepter les règles de la concurrence et surtout voir son immense patrimoine écorné au nom de l’intérêt général » 33.
La United Fruit Company cherche alors du soutien auprès de sa patrie états-unienne. Pour cela, elle mène des actions de propagande contre le gouvernement de Árbenz Guzmán en agitant le spectre de la menace communiste par des campagnes de désinformation, en plein début de guerre froide. Les actionnaires et les dirigeants de la firme ont de nombreux proches au sein de l’appareil d’État états-unien, notamment à la C.I.A., et mènent en parallèle une action de lobbying. En 1954, sous prétexte de lutte contre le communisme, Árbenz Guzmán est renversé par un coup d’État, orchestré conjointement par la C.I.A., la United Fruit Company et les propriétaires issus de l’oligarchie guatémaltèque dépossédés par la réforme agraire. Les petits paysans qui avaient bénéficié des terres saisies sur les grosses exploitations sont expropriés, souvent par la force. Le nouveau gouvernement supprime les taxes et impôts pour les sociétés étrangères. Il rend illégale l’action syndicale, ce qui engendra une grande répression, marquée par l’assassinat de 8000 syndicalistes paysans dans les deux premiers mois qui suivent le putsch. Le vote à bulletin secret est également aboli. 34 En 1997, la déclassification partielle de documents d’archives de la C.I.A. confirmera le rôle prédominant de la United Fruit Company et des services secrets dans le coup d’État, ainsi que dans la mise en place des politiques qui ont suivi 35.
Cet événement politique décourage les Guatémaltèques aux idéaux révolutionnaires, qui se rendent compte qu’un changement ne se produira pas par les urnes, d’autant plus face à l’union des forces entre les États-Unis, les firmes étrangères, l’oligarchie et l’armée. Néanmoins, des groupes de résistances se forment autour de mouvements issus de la société civile, du milieu universitaire et syndical… La répression est immense et de plus en plus de militant·e·s rejoignent des groupes armés de guérillas, qui, en se cachant dans les montagnes, bénéficieront peu à peu du soutien ou de la participation de membres de communautés paysannes indigènes. Démarrent alors les 36 ans du conflit armé, marqués par d’innombrables violences et massacres.
Après 1954, l’idée d’assimilation reste ancrée, mais plus depuis le nationalisme populaire de la décennie révolutionnaire. Il est remplacé par un nationalisme militaire. Ce n’est pas un nationalisme intégrateur concernant la population indigène, mais un nationalisme ladino anti-indigène : « si dans le pays des plantations de café, l’ I ndigène avait une raison d’exister, dans un pays « moderne », il n’a plus sa place » 36. L’assimilationnisme reste au devant du point de vue rhétorique mais les pratiques ségrégationnistes se réinstaurent de plus belle. Ce nouvel assimilationnisme discursif se définit comme anti-communiste et contre-insurrectionnel. Ce nouveau support s’intègre à l’idéologie de ladinisation. Si la « modernisation » a touché les populations indigènes, dans le sens de leur urbanisation croissante, de leur emploi salarié, de leur poursuite d’études pour certains, cela ne les a pas amenés à faire disparaître leur identité indigène, ni dans leur manière d’être perçus, ni dans leur sentiment d’appartenance. L’exemple le plus flagrant est l’affirmation de l’identité maya avec l’émergence du mayanisme, par des élites indigènes urbaines, disposant d’importants capitaux économiques et culturels. C’est pourquoi on peut affirmer que la ladinisation est une idéologie éloignée d’une constatation scientifique de la réalité. Elle part de l’idée que certaines cultures sont arriérées, et que leur modernisation les fera disparaître. Il n’était pas imaginé que la culture maya pouvait se transformer et se moderniser, et revendiquer d’autant plus une appartenance identitaire indigène 37.
Accès aux terrains et choix méthodologiques
Chaque texte écrit par des chercheurs en sciences humaines n’est pas le reflet d’une réalité mais plutôt celui d’une sensibilité » 1
L’enquête présentée ici est issue d’un travail ethnographique qui s’est déroulé sur quatre années. Un recueil de données, des observations participantes et une soixantaine d’entretiens ont été menés dans le département de Huehuetenango, durant deux mois en 2012, cinq mois en 2013, cinq mois en 2014, un mois en 2015. Assez vite, j’ai repéré plusieurs types d’acteurs auprès desquels mener mon enquête : institutionnels, professionnels, communautaires.
Pour comprendre au mieux la complexité du monde social que j’ai étudié, j’ai opéré des choix méthodologiques, selon des logiques que je tenterai ici de restituer. Prendre conscience du façonnage de mon matériau en fonction des chemins que j’ai empruntés dans mon travail de terrain a alimenté la construction, le traitement et l’analyse de mes données. À travers une démarche réflexive, je tâcherai de témoigner du rapport subjectif par lequel j’ai appréhendé mon objet, car « l’objectivation scientifique n’est complète que si elle inclut le point de vue du sujet qui l’opère » 2. Afin d’objectiver les analyses qui seront présentées dans ce manuscrit, je décrirai donc brièvement les différents terrains qui ont servi de base à cette thèse, la manière dont j’y ai accédé, les choix méthodologiques opérés, et les principales difficultés que j’ai rencontrées dans cet exercice.
Terrain auprès d’acteurs institutionnels
Sonder le discours institutionnel à partir des sources écrites et audiovisuelles
Pour comprendre le fonctionnement des programmes de planification familiale au Guate-mala, j’ai d’abord exploré de nombreux rapports écrits, ou autres supports de présentations, produits par des institutions finançant ces programmes, ainsi que des interviews médiatisées de responsables de ces institutions. L’exploitation de sources écrites et audiovisuelles institution-nelles, disponibles sur internet, avaient pour objectif principal de saisir les idéologies affichées qui sous-tendent les financements de ces programmes. J’ai par la suite enrichi ces premières données par une ethnographie des supports éducatifs fournis par ces institutions aux profes-sionnel·le·s de santé, à destination des populations ciblées par les programmes.
Lors de mon arrivée dans le département de Huehuetenango, en septembre 2012, j’ai pu visualiser un panorama d’institutions et d’organisations publiques et privées, dont l’action était directement en lien avec des programmes de planification familiale et de santé reproductive. J’ai uniquement ciblé les programmes comportant une dimension non-lucrative, et dont l’accès était le plus généralement gratuit. Il s’agit donc des programmes les plus accessibles, qui touchent le plus d’usagères dans tout le département, généralement menés dans les structures fréquentées par les populations modestes. J’ai réalisé des entretiens avec les responsables locaux des institu-tions que j’ai identifiées, publiques (en jaune sur le schéma ci-dessous) et non-gouvernementales (en orange). Je les interrogeais principalement sur les modalités d’application des demandes for-mulées par les organismes finançant les programmes dont ils avaient la charge (en bleu sur le schéma). Au cours de mes terrains, je me suis ainsi entretenue avec des membres de direc-tion de l’Hôpital National de Huehuetenango, de centres de santé ruraux, d’antennes locales d’ONGs (Aprofam, Pasmo, Fundaeco), de fondations. . . J’ai également assisté à des réunions entre différents responsables d’institutions dans le cadre de la mise en place d’actions collectives institutionnelles d’amélioration de la santé reproductive sur le département.