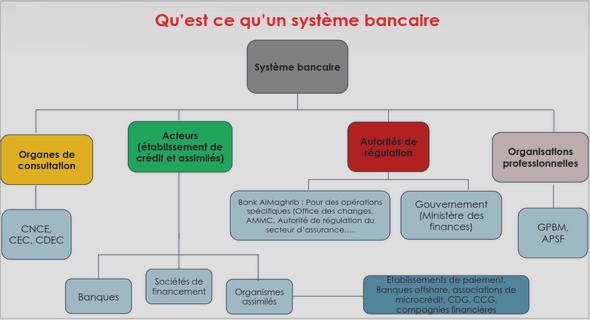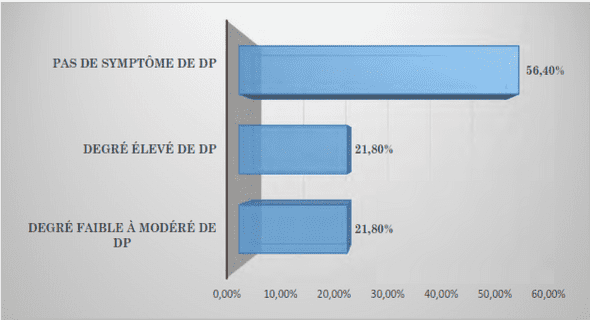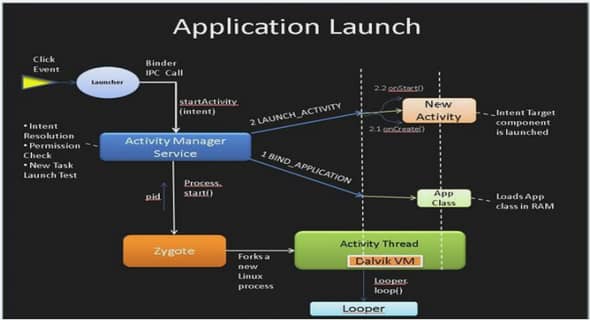Usages des TICE à l’école
Dans un souci de modernité et pourquoi pas pour tirer profit de l’intérêt suscité par toute nouvelle innovation, l’école n’est pas passée à côté de technologies qui furent intégrées, au fur et à mesure, au processus de l’enseignement. Du coup, on assiste à une évolution des technologies connues sous l’appellation des TICE, en référence à leurs utilisations dans des buts éducatifs.
Quoi qu’elles en soient considérées comme des outils ordinaires ou comme un vecteur de changement, les TICE deviennent omniprésentes dans le paysage de la classe et aujourd’hui on ne peut imaginer l’école en dehors des technologies.
L’école primaire semble un terrain plus propice que l’école secondaire en ce qui concerne l’intégration des technologies (Alberganti 1999 ; Harrari 2000). Le fait d’avoir un seul enseignant qui passe toute la journée avec les mêmes élèves lui permet d’initier des actions impliquant les technologies à n’importe quel moment.
L’enseignant du primaire n’a pas les contraintes temporelles propres à l’enseignant du secondaire qui ne dispose que de très peu de temps en compagnie de mêmes élèves. De plus, l’enseignant du premier degré est libre d’organiser la classe et les activités. Si on rajoute l’absence d’examens et l’absence des dates butoirs en général, on peut conclure que l’école primaire bénéficie de facteurs favorables au développement des compétences informatiques chez les élèves (Harrari 2000).
Le développement des usages est lié aux fonctionnalités des TIC (Poyet, 2009). Sans insister sur ce sujet, nous indiquons que des taxonomies des TIC, selon leurs fonctionnalités, ont été proposées (Bibeau, 2006), ainsi que des typologies des usages (Baron, 1996 ; De Vries, 2001 ; Basque, 2002).
Baron (1996) propose une organisation du champ de TICE à partir de trois pôles. Selon cet auteur, nous retrouvons un premier pôle constitué par les technologies éducatives, au sens large. Ces technologies représentent « des moyens pour enseigner et apprendre ». Les instruments généraux regroupent des outils « permettant de changer le rapport traditionnel au texte, aux données numériques, à la documentation, à la communication ». Le traitement de texte ou encore le thesaurus, les plans de classements, les mots clés sont quelques exemples d’instruments généraux. Une troisième catégorie regroupe les instruments disciplinaires, spécifiques de différents domaines enseignés. On cite en guise d’exemple, des logiciels de lexicologie ou de calcul, les systèmes de dessin, les simulations.
Afin de mieux cerner les usages des TICE à l’école en France, nous rappelons brièvement quelques points clés dans l’évolution de ces technologies. Ce récit passe forcément par l’histoire des technologies et les expérimentations, les interrogations, ainsi que les différentes mesures qui accompagnent leur évolution.
Il faudra souligner que les premiers usages des technologies à l’école, liés surtout à l’apparition et l’introduction des ordinateurs, renvoient à l’enseignement de premières notions informatiques, tant pour les élèves que pour les enseignants, très peu ou pas du tout habitués avec l’ordinateur. Cependant, l’informatique en tant que discipline n’existe pas à l’école primaire ce qui lance un véritable débat opposant les adeptes de la nécessité à privilégier l’informatique en tant que discipline (Arsac, 1980) et les adhérents à l’idée de l’informatique comme outil au service de l’enseignement (Hebenstreit, 1980).
On peut noter aussi que la présence des informations sur l’usage informatique dans les textes officiells reste timide jusqu’à la fin des années ’90 (Beziat, 2009).
C’est avec l’introduction du « B2i – Brevet informatique et internet », que le Ministère de l’Education tranchait sur le débat existant autour de l’informatique en tant qu’objet et en tant qu’outil. Dans l’esprit du B2i, l’informatique n’est plus considérée comme un objet d’enseignement, mais comme un moyen permettant aux élèves l’acquisition des connaissances et compétences informatiques « dans le cadre des activités ordinaires des disciplines enseignées » (MEN, B2i, 2000) et « tout au long de leur cursus, à l’école, au collège, dans les lycées d’enseignement général et technologique, les lycées professionnels, les centres de formation d’apprentis (CFA) et les sections d’apprentissage (SA) gérés par des établissements publics locaux d’enseignement (EPLE) »(MEN, B2i, 2006).
Les expérimentations « princeps » à l’école élémentaire démarrent en 1970 (Harrari, 2000) et s’intéressent à la mise en place de premiers usages d’ordinateurs. Des équipes au sein de l’INRP (Institut national de recherche pédagogique) et de l’IREM (Instituts de recherche sur l’enseignement des mathématiques) réalisent des essais, liés à l’utilisation du langage LOGO à l’école primaire, avec des élèves de CE2, CM1 et CM2. Le but de ces expérimentations était l’étude de « la pratique active de l’informatique par l’enfant » (Harrari, p. 105) et la sensibilisation des enfants pour l’informatique.
Le rapport de DGPC (Direction Générale des Programmes de Premier Cycle), publié en1981, mentionne une première expérimentation du LOGO dans une école maternelle de Villejuif en 1979, ainsi que deux expérimentations du même langage auprès des élèves de cours moyen (école Gué-Bernisson du Mans) et auprès des élèves de 6e appartenant à la section de l’éducation spécialisée (Maisons-Alfort). Les résultats soulignent l’apport de l’utilisation du langage LOGO au niveau de compétences transversales, telles que « reprise de la confiance en soi, apprentissage de la rigueur dans le raisonnement, suppression des cycles erreur-sanction » (Beziat, 2009, p.14).
La fin des années ’80 marque l’apparition des ordinateurs dans l’enseignement scolaire, dans le sens où les ordinateurs deviennent plutôt présents qu’intégrés, insérés (Harrari, 2000).
Cependant, l’introduction des notions d’informatique à des enfants de cet âge est considérée comme inappropriée. Des rapports comme celui du Simon (1981) ou du Schwartz (1981), même s’ils affichent des points de vue différents, plus ou moins optimistes, soulignent des difficultés quant à la généralisation des ordinateurs dans les écoles maternelles et primaires.
Le manque d’équipement en ordinateurs, des logiciels pauvres, des difficultés de manipulation par les enfants font que seulement des enseignants motivés se lancent dans des activités de bricolage pour mettre en œuvre l’informatique à ce niveau scolaire.
L’année ’85 constitue un tournant pour l’informatisation de l’école par le lancement du plan ITP « Informatique pour tous » (MEN, 1985b) qui prévoit l’initialisation à l’outil informatique non seulement pour tous les élèves, mais aussi pour tous les citoyens. Ainsi, des ateliers informatiques ouverts dans les écoles s’adressent à égale mesure aux élèves, aux enseignants et à tout individu intéressé par les technologies. Selon Chaptal (1999) son ouverture sur la société nuit au principe tant défendu d’une informatique discipline. Le plan fût critiqué aussi pour sa dimension industrielle (Baron et all., 1996). De plus, avec ce plan les expérimentations et les démarches d’équipement passent derrière l’impératif industriel (Béziat, 2009).
En parallèle avec l’équipement des écoles en ordinateurs, de nouveaux projets sont mis en place dès 1981. Il s’agit des expérimentations concernant la télématique. Suite aux premiers usages sociaux de la télématique, des programmes initiés par différents organismes (comme par ex. l’Académie de Versailles) s’adressent à l’enseignement scolaire (Robert, 1985). Un premier bilan, plutôt négatif du point de vue des usages développés, n’empêche pas la conduite de ces actions. Les réseaux télématiques permettront ensuite la mise en réseau des écoles éloignées, qui font leur apparition avant l’arrivée de l’Internet, favorisant la communication entre les acteurs du système scolaire.
La vague Internet marque une petite révolution dans les années ’95-‘96. L’arrivée de l’Internet et les discours qui accompagnent les expérimentations contribuent à leur multiplication. Les opérations d’équipement ainsi que celles de câblage à l’Internet s’accélèrent. Des rapports, commandés par l’Etat, rendant compte des usages des technologies l’école et à l’heure de l’Internet se rajoutent aux résultats des expérimentations menées par les chercheurs.
Une étude menée, entre 2001 et 2002, par la Direction de l’évaluation et de la prospective (Verdon, 2003), interroge un nombre assez important d’enseignants (368 enseignants du primaire et 1922 enseignants du second degré) sur leurs usages des technologies. L’étude porte sur plusieurs types d’usage, tel que l’usage personnel, l’usage professionnel, l’usage dans le cadre des activités avec les élèves (avec ou sans manipulations de l’ordinateur par les élèves). Complétés en 2004 et présentés sous la forme d’un dossier (DEP, 2004), les résultats indiquent un taux élevé d’utilisation des TICE, 87% des enseignants du primaire déclarant utiliser les technologies (83% en faisant manipuler leurs élèves, 4% sans faire manipuler leurs élèves). Pour le second degré, les pourcentages varient, allant de 45% jusqu’au 95% pour des enseignants du lycée. De plus, l’étude mentionne des usages diversifiés pour la plupart des enseignants interrogés, seulement 1% d’enseignants se limitant au simple usage de l’Internet. Les résultats mettent aussi en évidence l’importance que les enseignants accordent aux aides éducateurs qui préparent les matériels et supervisent l’activité. Au niveau de la formation pour les TICE, 67% des enseignants du primaire indiquent l’autoformation comme la modalité la plus fréquente de se former à l’usage des technologies éducatives.
Certains résultats de cette étude furent contestés, surtout le taux de 83% des enseignants indiqués comme utilisant les technologies avec leurs élèves de manière régulière (Baron, 2005 ; Bruillard, 2005).
Baron (2005) donne plusieurs explications pour rendre compte de la différence existant entre le résultat de cette étude et ceux des recherches. D’abord, il s’attaque à l’échantillon composé davantage d’écoles issues des ZEP, ce qui le ne rend pas représentatif. Une deuxième explication réside dans la possibilité que le questionnaire fût rempli par des personnes motivées par les TICE. Enfin, selon Baron, on peut supposer que les usages recensés correspondent à des utilisations que les enseignants font grâce aux aides éducateurs aussi.
Quant à Bruillard, dans la postface de la publication « Quels « usages » des TIC à l’école élémentaire ? » (2005), il insiste sur la distinction entre le terme « usage » et utilisation » pour expliquer le résultat qui lui semble trop élevé. Dans son opinion, en dehors des usages, qui renvoient à des « phénomènes s’inscrivant dans la durée », l’étude répertorie aussi des « utilisations ponctuelles, circonstancielles » des TICE qu’on ne peut pas qualifier d’ « usages ».
A partir d’une analyse des sites d’écoles primaires, Moussa (2000) réalise une taxonomie des usages scolaires liés à la production de sites web par les écoles primaires qui lui permet de rendre compte du caractère limité des usages liés à l’internet.
Selon Chaptal (2003), la situation des TICE dans l’enseignement primaire et secondaire en France se caractérise par l’existence d’une tension entre, d’un côté, un taux d’équipement assez élevé, et, de l’autre côté, un développement insuffisant d’usages. Une analyse du système éducatif américain lui permet de mettre en évidence surtout les différences par rapport au système français, pour rendre compte ensuite des similitudes au niveau de difficultés posées par l’intégration de TICE à l’école. Le déploiement de TICE en France devient de plus en plus comparable avec celui des Etats Unis où l’accès à l’Internet c’est banalisé ces dernières années.
Pourtant, des études (Pouzard, 1997, Bérard-Pouzard, 1999) montrent que l’usage des TICE reste encore limité, malgré les efforts au niveau des équipements et de la connexion à l’Internet.
Un des facteurs qui influence sur le développement des TIC en France est, selon Chaptal (2006), le fait que les enseignants ne perçoivent pas la valeur que les TIC rajoutent à l’éducation.
Bruillard et Baron (2006), identifient plusieurs facteurs impliqués dans la genèse des usages des TICE. Les environnements technologiques présentent des limites liées aux technologies et aux modèles utilisés lors de leur conception. C’est le cas de l’hypertexte, qui se voit restreint par le Web de la manière dont « les liens sont noyés dans les documents eux-mêmes, ils sont unidirectionnels et non typé » (Bruillard et al., 2006, p.3). Les contextes nontechniques, comme « la pression du marché qui impose sa loi à la plupart des usages répandus », constituent un facteur qu’on ne peut pas ignorer. En fin, les acteurs jouent un rôle décisif par les décisions prises. Les enseignants, par exemple, des véritables gatekeepers (Cuban, 2001), prennent des décisions, basées sur leurs valeurs et leurs croyances, qui ont un impact sur le développement des usages.
Selon Chaptal (2007), quatre attitudes tentent d’expliquer le fossé créé entre équipements et usages. On a cherché à expliquer cette différence par « le conservatisme supposé des enseignants » (Chaptal 2007), car le développement des usages des TICE repose en grand partie sur la volonté des enseignants d’intégrer les technologies dans leurs pratiques. Cependant, au fil des années les enseignants ont montré une certaine disponibilité envers les technologies comme la participation aux de stage de formation du plan « Informatique pour tous » (Chaptal, 1999).
Dans un deuxième temps, les chercheurs se sont penchés à montrer l’efficacité, voir la non-efficacité des TICE. Pouts-Lajous (2001) insiste sur le fait que la question de l’efficacité des TICE partage les chercheurs en partisans et adversaires des TICE, certains soulignant les effets négatifs et nocifs que l’ordinateur peut avoir sur le plan cognitif, physique et psychologique, alors que pour d’autres l’excès serait le seul facteur nocif. Des études comparant l’usage des TICE dans une classe « pilote » avec une classe témoin, appelant aux méthodes traditionnelles, montrent qu’il n’existe pas des différences significatives (Russell, 1997).
Les deux autres attitudes doivent s’intéresser « aux perspectives de changement de l’école avant d’examiner ensuite le caractère unique de la situation présente » (Chaptal, 2007). Il s’agit d’abord d’un changement de modèle pédagogique. Chaptal parle du constructivisme et de la possibilité de le généraliser. Du côté technologies, on attend qu’elles cessent « d’être un élément de complexité supplémentaire pour offrir des perspectives concrètes d’amélioration de son action pour l’enseignant » (Chaptal, 2007, p. 143).
Comme le remarque Beziat (2009), « fournir du matériel ne suffit pas à faire sens en pédagogie, au moins en l’état actuel des pratiques, et il faudra un peu plus que des déclarations pour amener toute une profession à faire de l’ordinateur un instrument réellement ordinaire en classe » (Beziat, 2009).
En 2010, le Ministère de l’Education Nationale lance le plan DUNE (développement des usages numériques à l’école) visant à accroitre l’usage pédagogique des technologies. Les mesures annoncées se regroupent autour des cinq axes principaux et concernent la facilitation de l’accès aux ressources numériques, la formation et l’accompagnement des enseignants dans le développement des pratiques intégrant les TICE, la généralisation des ENT, l’accroissement des partenariats avec les collectivités locales et le développement des usages responsables au niveau des élèves (plan DUNE, MEN, 2010).
Au niveau des ressources numériques, le plan DUNE prévoit, le lancement d’un portail de référencement des ressources pédagogiques, de l’édition publique et privée ». Des « chèques ressources numériques », destinés à équiper les établissements scolaires, sont distribués aux écoles retenues suite à l’appel à projet. De point de vue de la formation, après avoir identifié les besoins des enseignants concernant l’utilisation des technologies éducatives, le plan annonce des formations au sein de l’établissement ainsi que des formations académiques. La généralisation des ENT passe d’abord par la généralisation des cahiers de textes numériques, pour couvrir ensuite les autres services offerts par un ENT. Des partenariats avec les collectivités locales sont prévus, avec un soutien complémentaire pour les écoles impliquées dans le projet. Une attention particulière est accordée « à l’apprentissage de l’usage responsable de l’Internet » (plan DUNE, MEN, 2010).
En juillet 2012, le Rapport de l’Inspection Générale de l’Education sur le plan DUNE rend compte des résultats de sa mise en œuvre. Nous allons nous pencher sur les constats concernant les usages des technologies dans l’enseignement primaire en essayant, à partir de ce rapport, de crayonner le tableau de la situation actuelle en matière des pratiques pédagogiques intégrant les technologies à ce niveau. Le rapport mentionne les observations faites dans huit écoles, des observations qui montrent « un changement du modèle d’intégration des TICE dans les pratiques pédagogiques ; l’affirmation du leadership des collectivités territoriales pour toute évolution de l’équipement ; une interrogation forte sur les besoins en matière de ressources pédagogiques ; une sensibilisation aux usages responsables de l’internet insuffisamment engagée » (Rapport IGEN- IGAENR, 2012).
Selon ce rapport, les usages sont développés d’une manière inégale et ils ne correspondent pas aux prescriptions du plan DUNE. D’ailleurs, le plan n’a pas engendré de réflexion sur les usages du numérique. Quelques exemples montrent un usage très limité, voire même basic des différents outils à la disposition de l’enseignant qui ne valorise pas les potentiels de ses instruments (des TBI utilisés pour afficher des textes, des iPads qui servent pour prendre des photos ou pour des travaux d’écriture).