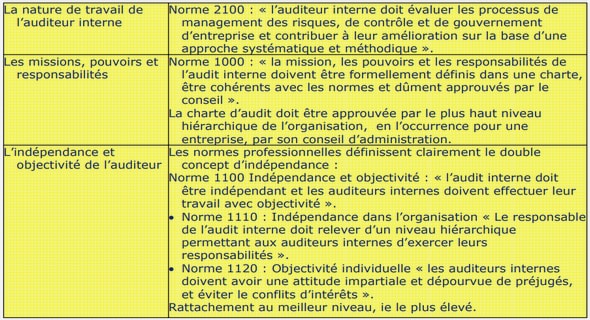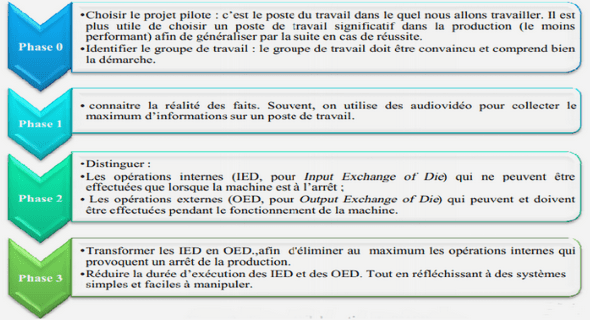Vocare, uocatio, leurs préverbés et préfixés : étude
sémantique
Sur les substantifs en -tiō Le substantif uocātiō est formé par dérivation suffixale à partir du verbe uocāre : à la base verbale uocā- a été adjoint le suffixe -tiō. À la suite d’É.BENVENISTE, on interprète ce dernier comme une forme élargie du suffixe indo-européen *-tey/-ti, qui sert à former des noms d’action et qu’on trouve notamment en grec sous la forme -σις (cf les substantifs du type ποίησις). Il s’agit donc d’une formation qui n’est pas spécifique au latin mais qui est particulièrement productive dans cette langue. Remarques morphologiques Le suffixe -tiō peut s’adjoindre à plusieurs types de bases verbales5 : 1) des bases verbales thématiques – sans redoublement : sur emō est formé emptiō (la consonne p entre la base verbale et le suffixe est épenthétique) ; sur gerō est formé gestiō ; sur lĕgō est formé lēctiō, sur dīcō, dīctiō… – des bases verbales formées par analogie avec les thèmes d’infectum thématiques sans redoublement : dīuidō / diuisio ; cēdō / cessiō … 2) des bases verbales athématiques – sans redoublement, avec généralisation du vocalisme plein radical et maintien de la flexion athématique : stāre / statiō – sans redoublement, avec généralisation du vocalisme réduit radical et maintien de la flexion athématique : dăre / dătiō – à redoublement : reddō / redditiō ; addō / additiō ; condō / conditiō) des bases verbales radicales élargies : quaerō / quaestiō … 4) des bases verbales de formation suffixée – des bases verbales qui présentent dans la conjugaison un élargissement nasal ou dental (dans ce cas, l’élargissement n’apparaît pas dans le substantif formé à partir du suffixe -tiō) : relinquō / relictiō ; frango / fractiō ; pungō / punctiō ; tendō / tentiō Toutes ces bases verbales sont des bases verbales d’infectum. LES SUBSTANTIFS EN -TIŌ – bases verbales formées sur le suffixe *-eye/o6 : moneō / monitiō ; moueō / mōtiō ; tondeō / tonsiō ; spondeō / sponsiō … – bases verbales formées sur le suffixe *-y-(e/o)- : capiō / captiō ; dormiō / dormītiō. – bases verbales terminées par le morphème -ā7 : uocāre / uocātiō ; laudō / laudātiō ; appellāre / appellātiō . Si tous les verbes latins n’ont pas servi, loin de là, à former des dérivés en -tiō, la majorité des types de formation de thèmes verbaux d’infectum est compatible avec ce type de formation suffixale. Les thèmes verbaux ayant servi à la formation d’une flexion mixte thématique/athématique, tels que esse, ferre, uelle, ne correspondent à aucun substantif bâti sur cette formation, pas plus que les thèmes verbaux présentant le suffixe indo-européen *-ske/o-. On peut supposer que ce dernier type de formation est phonétiquement incompatible avec un suffixe commençant par une dentale. Pour des raisons sémantiques évidentes, les verbes d’état présentant le suffixe *-ē- n’ont donné aucun déverbé en -tiō : l’adjonction d’un suffixe dénotant le procès à une base verbale dénotant l’état aurait représenté un oxymore morphologique. Reste une dernier type de formation, rare, qui n’a donné aucun dérivé en -tiō à l’époque classique : les thèmes verbaux thématiques à redoublement. À époque tardive, cependant, un substantif déverbal formé sur inserō , préverbé de serō (qui appartient à ce type de formation) est attesté, insertiō, qu’on trouve notamment chez Augustin d’Hippone et Isidore de Séville. Si on prend la classification en types de conjugaison définie par les grammairiens et en usage de nos jours dans l’apprentissage du latin, on constate qu’à l’exception des verbes dits irréguliers, le suffixe -tiō peut servir à former des substantifs à partir des verbes appartenant à toutes les conjugaisons. Il y a donc peu d’obstacles morphologiques et phonétiques au développement et à la productivité de ce type de formation, et un seul obstacle sémantique réel, le cas des verbes d’étatAppartiennent à cette catégorie aussi bien des bases verbales formées par adjonction du suffixe au radical que des bases verbales à radical élargiLa présence du suffixe *-y-(e/o)- dans des dénominatifs du type causāre / curāre n’étant probablement plus ressentie par le sujet parlant à l’époque des premiers textes littéraires latins qui nous sont parvenus, nous avons choisi de regrouper tous les verbes à base verbale en -ā sous un même paragraphe, aussi bien ceux qui sont formés à partir de ce suffixe que ceux, comme laudāre, dont la formation relève d’une extension analogique de ce morphème. LES SUBSTANTIFS EN -TIŌ
Sémantisme et productivité de ce type de formation
Sémantisme
Ce suffixe appartient, selon la classification définie par M. FRUYT8 , aux suffixes « qui opèrent une transformation syntaxique : base et dérivé y ont le même contenu sémantique, l’opération de dérivation n’a servi qu’à translater une catégorie grammaticale dans une autre ». De fait, le suffixe –tiō sert à former des noms de procès à partir de bases verbales. La notion de nom de procès est ainsi définie par M. FRUYT9 : « un nom de procès est un substantif ayant la même valeur dénotative qu’un verbe correspondant auquel il est associé en synchronie dans le sentiment du sujet parlant, de sorte qu’il sert à l’expression nominale du procès ». Cette définition implique que le sémème originel de tout substantif en – tiō formé sur une base verbale est : Σ1 : /action/ /de X/, X étant le sémème du verbe dont le substantif est dérivé.
Productivité
Productivité en latin archaïque et classique
La simplicité du rapport entre le verbe et le substantif explique sans doute la très grande productivité de ce type de formation, et ce dès l’époque archaïque. Expeditio (Bell. Pun. Strzelecki I, 4) et oratio (Com. Ribbeck IX, ) sont attestés chez Naevius, cognatio (Frg. Vahlen, III, 4, 8), scriptio (Frg. Vahlen, III, 4, 8), inscriptio (Frg. Vahlen Praet. ), pour ne citer qu’eux, le sont chez Ennius. Pacuvius emploie dictio (Frg Ribbeck Tr. IV, ), itio (Frg Ribbeck Tr), oratio (Frg Ribbeck Tr), profectio (Frg Ribbeck Tr) ; on trouve, entre autres, domuitio (Frg. Dangel Ast) et ratio (Frg. Dangel Neopt. ) dans les fragments d’Accius. Chez Plaute et Térence, l’emploi de ces substantifs se fait encore plus fréquent. On relève par exemple chez Plaute ambitio (Amp. ), consuetio (Amp), expurgatio (Amp65), fraudatio (As), pactio (Aul. ), curatio (Cas). Térence emploie quantitativement moins de substantifs en -tio que Plaute mais on trouve 8M.FRUYT () 9M.FRUYT (2) LES SUBSTANTIFS EN -TIŌ cependant chez lui existumatio (Haut. ), purgatio (Haut), postulatio (Hec) ou gestio (Phorm). Ces relevés ne se sont pas exhaustifs mais ils attestent la productivité de ce type de formation et de sa grande maniabilité puisque Plaute n’hésite pas à en jouer dans ses créations lexicales à but comique, en créant parasitatio (Amp) à partir du verbe parasitor, qui est quasiment un hapax chez lui (Pers6), ou subigitatio (Cap. ), à partir d’un fréquentatif de subigo, subigito. Productif à époque archaïque, le suffixe l’est encore plus à époque classique.
Productivité en latin tardif
Le premier tableau montre donc que la formation suffixale en -tio est productive à l’époque classique. Mais qu’en est-il en latin tardif ? En comparant les occurrences à époque classique des substantifs figurant dans le tableau et les occurrences en latin tardif, nous avons constaté que la majorité des occurrences des termes étudiés se trouvait en réalité en latin tardif, comme le montre le graphique suivant : Cf le tableau n°1 dans lequel figurent ces données en annexe. Attestations en latin tardif LES SUBSTANTIFS EN -TIŌ L’axe des abscisses représente le nombre total d’occurrences (latin classique + latin tardif) pour chacun des termes étudiés, l’axe des ordonnées le pourcentage d’occurrences en latin tardif par rapport au nombre total. Les limites chronologiques des deux périodes que notre enquête compare sont celles retenues par BREPOLiS pour ses bases de données : l’Antiquitas (période classique pour notre enquête) va du 3ème siècle avant Jésus-Christ à la fin du 2ème siècle de notre ère ; la période tardive recouvre l’Aetas Patrum I (soit les œuvres de l’Antiquité tardive jusqu’à l’an de notre ère) et l’Aetas Patrum (soit les œuvres composées de 1 à la mort de Bède le Vénérable, en 7). Les deux périodes ne sont pas exactement de durée égale (entre un demisiècle et un siècle d’écart). Pour éviter tout biais dans l’interprétation des résultats obtenus lié à cette disparité de durée ou à la disparité du nombre d’œuvres appartenant au corpus pour chaque période, nous ne retenons pas comme significative la barre des % mais celles des 7%, qui permet de corriger ces éventuels biais. L’analyse du graphique et du tableau permet de mettre en évidence plusieurs faits. Sur soixante-trois termes étudiés, trente-sept ont au moins 7% d’occurrences en latin tardif et vingt-trois plus de 8% et, sur les vingt substantifs de la liste les plus attestés sur l’ensemble des deux périodes, dix-neuf ont plus de 7% de leurs occurrences en latin tardif. Plus de la moitié des substantifs étudiés connaissent donc une fréquence d’emploi plus élevée à époque tardive. Parmi les substantifs employés à plus de 7% en latin tardif se trouvent aussi bien des termes peu employés au total que des termes beaucoup plus fréquemment employés. Sept termes ont moins de % de leurs attestations en latin tardif. Pour les cinquantesix autres, la fréquence d’emploi ne baisse pas en latin de manière significative. Il n’y a que trois termes qui sont attestés à moins de % en latin tardif : auctio, oppugnatio et ductio. Parmi eux, seul ductio a moins de % de ses occurrences (,4%) en latin tardif. On remarque sur le graphique que les termes dont le nombre total d’attestations est le plus faible sont également ceux qui ont le moins d’attestations en latin tardif par rapport au total. Cette étude montre donc que les substantifs en -tio d’usage courant en latin classique sont encore plus attestés à époque tardive qu’à époque classique et qu’on peut dégager une tendance de l’époque tardive à employer davantage les dérivés déjà employés à époque classique.
Introduction |