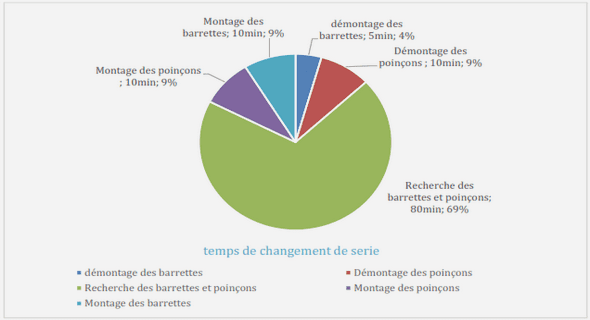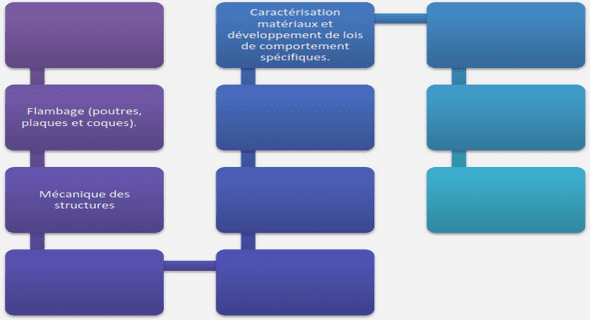Analyse financière des comptes consolidés
Ce sont les pertes des exercices antérieurs qui ont provoqué cette chute des ressources propres. Sans ces pertes les ressources propres seraient d’environ 400 000 € de plus. L’endettement serait moins élevé. Visiblement, la société n’a pas fait d’augmentation de capital pour combler ses pertes. Dans ce bilan, il y a différentiation entre emplois financiers et emplois industriels : Ce qui nous permet de voir qu’ici ce sont essentiellement des emplois industriels. L’entreprise mise plus sur les emplois industriels que sur les emplois financiers. La conception « pool de fonds » du bilan fonctionnel permet de remédier aux inconvénients de la conception fonctionnelle horizontale. Cependant : – Elle ne repose sur aucune règle simple, telle que la couverture du BFRE par le FRNG. – Son utilisation est complexe. Inconvénients de la conception fonctionnelle horizontale : – Principe d’affectation de ressources aux emplois : ce qui n’est pas le cas pour le bilan financier pool de fonds. – Conception de la trésorerie : dans la conception horizontale, la trésorerie est simplement considérée comme un solde, c’est-à-dire la différence entre le fonds de roulement net global et le BFR. Et cela ne correspond pas à la conception de l’entreprise depuis quelques années. La présentation des stocks d’emplis et de ressources est fondée sur le principe de la non-affectation.
Cette présentation repose sur une conception de l’équilibre financier beaucoup plus élaborée que la conception horizontale. Dans la conception horizontale, la notion d’équilibre financier s’appréhende uniquement sous l’aspect du risque de faillite. La conception de l’équilibre financier sous-jacente à l’analyse de type « pool de fonds » s’appuie au contraire sur l’arbitrage « rentabilité-risque » et suppose une gestion de la dettes et conception particulière du rôle des actifs de trésorerie. Remarque : Dans la théorie financière, on considère que les actionnaires ont intérêt à privilégier les dettes fin plutôt que les fonds propres. Donc, les dirigeants doivent donc faire un arbitrage entre les intérêts et les risques. Effet de levier : Si le taux de rentabilité économique est plus élevé que le taux d’intérêt, l’entreprise a intérêt à emprunter. Les dettes financières seront plus rentables que les fonds propres. Mais ceci n’est vrai que si le taux de rentabilité économique est supérieur au taux d’intérêt. Sinon, l’entreprise n’a pas intérêt à emprunter. Or, les actionnaires attendent une rentabilité élevée de l’entreprise. Donc, le fait que l’entreprise se finance au moyen de dettes financières demande à ce que les investissements que choisissent les dirigeants soient rentables = rentabilité économique plus élevée que les taux d’intérêt. Pour les dirigeants, les fonds propres sont moins risqués que l’endettement financier. Plus les capitaux propres sont élevés par rapport à l’endettement, moins il y a de risque de faillite et moins la rentabilité sera élevée.
De fait, les dirigeants ont intérêt à choisir les… Attention : La théorie financière dans le monde est anglo-saxonne. Aux États-Unis, on a de très grandes entreprises où l’actionnariat est dispersé. Par rapport à la plupart des entreprises en Europe où l’on trouve surtout des actionnaires « principaux. » Les actionnaires vont plutôt pousser les dirigeants à faire de l’endettement financier plutôt que de faire appel aux capitaux propres. La théorie du Free Cash flow, lancé par les Américains dans les années 80 : C’est ce qui va rester du cash flow une fois que l’entreprise a versé les dividendes et financé les investissements de croissance. Dans cette théorie, on indique que le FCF doit être redistribué aux actionnaires. L’objectif est de contraindre les dirigeants de se financer par l’endettement financier, ce qui va le pousser à privilégier les investissements les plus rentables. Mais plus rentable signifie aussi plus de risques.Le choix de la structure des emplois repose sur le choix d’un niveau de risque éco, auquel correspond un niveau de rentabilité éco. La rentabilité éco doit permettre d’atteindre la rentabilité requise par les actionnaires après avoir rémunéré les créanciers. La structure du bilan fonctionnel résulte donc des niveaux de risque économique, financier, et de faillite, que l’entreprise a choisi d’assumer afin de satisfaire ses actionnaires. Par conséquent, pour interpréter le bilan fonctionnel, il faut se référer au modèle de l’effet de levier financier, qui permet de comprendre les choix par l’E en termes de risque et de rentabilité.Il apparaît qu’il était intéressant de financer l’actif par un CBC plutôt que par emprunt de 2 ans. B a couru un risque lié à l’incertitude sur le niveau du taux d’intérêt et sur l’éventualité d’un non-recouvrement du CBC, mais ce risque a été rémunéré par une économie de frais financiers. Donc, si les E anticipent une baisse des taux d’intérêt elles auront tendance à préférer un endettement à CT renégociable plutôt qu’un endettement stable à LMT.