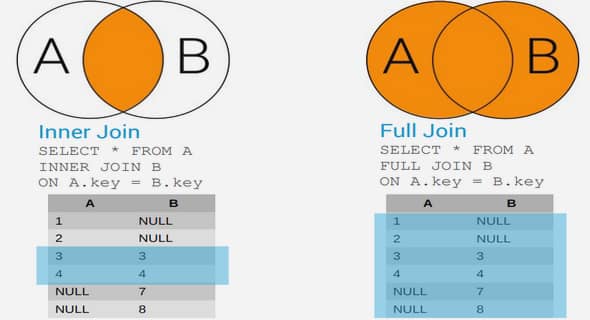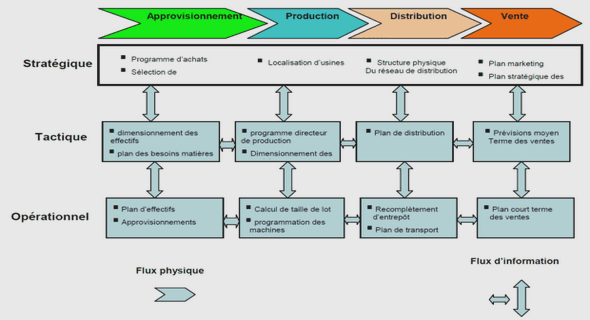Quand l’histoire religieuse rencontre l’histoire des femmes et du genre
Si aucune recherche comparative n’a pour l’instant été entreprise à leur sujet, les associations que nous avons étudié ont en revanche fait l’objet d’une monographie chacune.
La Ligue patriotique des Françaises a été étudiée par Odile Sarti, qui a publié en 1992 un ouvrage sur cette association en développant une approche dynamique, où elle souligne le rôle moteur de la riposte à la sécularisation et aux lois de 1901 et 190587. Son travail fait suite à quelques articles publiés dans les années 1980 par Sylvie Fayet-Scribe et Anne Marie Sohn88. Dans ce travail d’histoire des femmes, elle analyse la mobilisation féminine contre l’offensive des Radicaux. S’appuyant principalement sur les archives de l’association – qui n’étaient pas encore classées à l’époque – et sur celles du département du Rhône et des archevêchés de Paris et de Lyon, la thèse de l’historienne américaine a constitué une première « phase accumulative » de savoirs sur cette mobilisation de masse89. L’importance du nombre d’adhérentes de ces associations pose la question d’un engagement féminin massif dans des organisations conservatrices longtemps négligées par l’historiographie. Elle soulève également le problème de la signification de ces adhésions.
L’histoire des femmes a investi à nouveau ce terrain dans la lignée des travaux de Gisela Bock sur le maternalisme90. Anne Cova, en reprenant les recherches menées sur la protection de la maternité, a développé de façon novatrice une comparaison du point de vue de la défense de la maternité entre la L.P.D.F., la Ligue des femmes françaises et l’Union féminine civique et sociale. Son travail met l’accent sur l’importance de l’action sociale, la mise en place de structures spécifiques dans ces associations pour protéger les mères et les enfants et encadrer la maternité, et les évolutions de ces associations au lendemain de la Grande guerre91. Ces aspects, dans leur dimension politique, seront traités dans la deuxième partie de notre recherche.
Enfin, récemment une thèse a été soutenue à l’université de Michigan sur la Ligue patriotique des Françaises par Carolyn Comiskey92 qui met au jour l’existence d’un nationalisme féminin très marqué dans des structures féminines catholiques comme la L.P.D.F. mais aussi Le devoir des femmes françaises de Françoise Dorive – association et revue fondées en 1902, à caractère antisémite. L’insistance nouvelle sur cette dimension politique de la L.P.D.F. correspond à un renouveau de l’historiographie sur ces mouvements.
L’association italienne a, elle aussi, fait l’objet d’une monographie publiée en 1988 par l’historienne du catholicisme Cecilia Dau Novelli93. Cette dernière s’est appuyée sur les archives personnelles de Cristina Giustiniani, déposées aux Archives générales de l’ordre prêcheur (A.G.O.P.) à Sainte-Sabine (Rome). Dans la monographie qu’elle consacre à l’association de ses débuts à la modification des statuts proposés par Benoît XV en 1919, elle développe l’idée d’une voie d’émancipation féminine catholique dans la société et dans l’Église. Pour autant, l’auteure souligne bien que l’économie générale des rapports sociaux de sexe dans l’Église ne s’en trouve pas bouleversée. Il s’agit plutôt de la promotion d’un modèle de féminité active, de la possibilité d’une alternative légitime au mariage et au couvent pour les catholiques, et de l’accès à la parole publique pour des citoyennes privées du vote. S’ils ne remettent pas radicalement en cause la place des femmes dans l’Église et dans la société, nous voudrions montrer que ces changements incrémentaux constituent néanmoins les prémisses d’une redéfinition des rôles telle qu’observée par Céline Béraud à la fin du XXe siècle94.
Massivement présentes dans les églises95, plus pratiquantes que les hommes au XIXe siècle, participant aux pèlerinages96, les femmes ont pourtant été négligées par l’historiographie religieuse jusqu’à une période récente97. Le courant catholique de l’associationnisme féminin s’appuie en France sur l’expérience congréganiste à laquelle la loi de 1901 met un terme98. Les historiens ont mis en évidence la participation très forte des femmes à l’activité philanthropique et charitable au XIXe siècle, entendue comme une forme de citoyenneté sociale pour certaines des animatrices des sociétés féminines.
L’Italie connut, elle aussi, une interdiction des ordres religieux avec la loi du 8 juillet 1866, interdisant les ordres religieux, exception faite des congrégations de vie active, notamment les congrégations féminines enseignantes et hospitalières99. Entre la congréganiste, étudiée par Claude Langlois, la dame d’œuvre et la militante d’action catholique spécialisée telle que l’incarna Armida Barelli (1882-1952) en Italie, les formes d’engagement féminin catholique ont évolué notamment sous la contrainte des législations anticléricales votées par le Parlement du Royaume d’Italie et celui de la IIIe République française100. L’encyclique Rerum Novarum du pape Léon XIII (1878-1903) publiée en 1891, légitime la transformation de l’engagement religieux accordant plus de place aux laïques dans l’apostolat101. À cette occasion, de nombreuses fidèles ont investi l’action sociale catholique, comme leurs frères chrétiens, proposant une alternative au socialisme pour résoudre la question sociale « l’évangile à la main »102. Dans le même temps, les mobilisations féministes ne laissent pas le monde catholique indifférent. Tant en France qu’en Italie, la question féminine devient une préoccupation pour certains théologiens, hommes d’Eglise ou militants de la première démocratie chrétienne, comme Romolo Murri (1870-1944) en Italie, qui relient la question féminine à la question sociale. Chez les jésuites, on trouve également les témoignages d’une préoccupation grandissante pour la question féminine, tant dans les articles publiés dans la Civiltà cattolica que dans les brochures de l’Action populaire de Reims, mais traitée dans une perspective de contre-offensive face au féminisme libéral. Comme nous le montrerons ensuite, c’est cette dernière approche qui semble prévaloir dans la fondation de la Ligue des femmes françaises à Lyon en 1901 ou de la Ligue patriotique des Françaises en 1902103. Ainsi, nous verrons sous quelles formes est progressivement définie cette « question féminine », à la fois par les hommes d’Église et par les femmes catholiques.
Ces évolutions du monde catholique sont elles-mêmes accélérées en France par la politique anticléricale menée par le gouvernement de bloc républicain de Waldeck-Rousseau (1899-1902). Après le vote de la loi de 1901 qui nécessite pour les sociétés religieuses une autorisation préfectorale, celles-ci sont condamnées à l’exil ou à la modification des formes de leur activité. La requalification passe, pour certaines de leurs membres, par un investissement au sein d’associations de laïques – séculières – autorisées comme la Ligue des femmes françaises, fondée en 1901, ou la Ligue patriotique des Françaises.
La Ligue patriotique des Françaises et l’Unione fra le donne cattoliche d’Italia ont pour point commun de représenter l’action catholique féminine tout en professant une attitude de soumission totale à la hiérarchie. Elles ont constitué les premières organisations nationales pour les catholiques (le féminisme chrétien de Marie Maugeret était essentiellement parisien, le Fascio femminile d’Adelaide Coari une expérience milanaise), ouvrant aux catholiques la possibilité de s’investir dans une structure collective de masse. Ces associations sont ainsi les laboratoires où se définissent les figures en évolution de la militante d’action catholique, selon des dynamiques communes mais aussi avec des singularités nationales et locales.
Pendant féminin de « l’invention de l’homme politique moderne » décrite par Eric Phélippeau, la militante est d’abord une notable104. Après la religieuse cloîtrée, puis la congréganiste, la militante laïque vient renouveler le modèle d’apostolat féminin, posant implicitement la question de la redéfinition des normes de genre pour ces femmes catholiques. Cette modalité d’engagement profite de la brèche ouverte depuis la Révolution par les religieuses séculières, congréganistes, tertiaires, qui pour certaines ont développé au sein de l’Eglise des stratégies implicites d’émancipation, ainsi que l’a montré à plusieurs reprises Lucetta Scaraffia dans ses travaux sur les religieuses entrepreneuses et certaines fondatrices de congrégation du XIXe siècle, ainsi que Franscesca Cabrini (1850-1917) ou Teresa Eustochio Verzeri (1801-1852), fondatrice en 1820 des Sœurs du Sacré-Cœur de Jésus qui obtint de haute lutte que son institut de perfection soit dirigé par une supérieure générale105.
C’est donc à la croisée de l’histoire des femmes et de l’histoire religieuse que se situe notre travail, s’inscrivant en cela dans un courant historiographique qui, s’il est très fécond en Italie, ne s’est cependant pas penché beaucoup plus avant sur l’U.D.C.I., en raison de l’absence d’archives accessibles pour la période de l’entre-deux-guerres106. Il existe en effet de l’autre côté des Alpes une forte tradition d’études de l’histoire des femmes catholiques que l’on ne retrouve pas en France107. Les travaux de Paola Gaiotti de Biase portent ainsi sur le féminisme chrétien du début du siècle dernier, interrogeant les relations de genre dans l’Eglise. Emma Fattorini, Lucetta Scaraffia et Gabriella Zarri dans les ouvrages collectifs qu’elles ont dirigé, ont donné une visibilité à des approches plus nuancées dans l’analyse des rapports sociaux de sexe au sein de l’institution catholique108. C’est la perspective adoptée, entre autres, par Lucetta Scaraffia, qui a montré comment, dans le contexte social du XIXe siècle et du début du XXe siècle, l’Eglise et les congrégations ont offert des voies d’autonomisation, voire d’émancipation, pour certaines femmes109.
En France, ce n’est qu’à la fin des années 1990, que l’histoire religieuse française semble s’intéresser davantage aux femmes110. L’ouvrage pionnier de Claude Langlois sur les congrégations au XIXe siècle a ouvert la voie à d’autres recherches sur le XXe siècle111. Bruno Dumons a publié une série d’articles sur la Ligue des femmes françaises, fondée à Lyon en 1901 par Jeanne Lestra et le jésuite Antonin Eymieu, afin de lutter contre les mesures du gouvernement radical. L’historien y voit une forme de mobilisation politique féminine qui se poursuit jusqu’en 1914. Cette analyse pose le problème de la définition d’une activité politique quand, précisément au nom de l’obéissance au pape, la L.F.F. abandonne la compétition électorale pour se tourner exclusivement vers l’action religieuse dès 1902112.
L’histoire des femmes puis du genre, l’histoire religieuse ont ainsi constitué un premier apport pour étudier ces associations. La science politique a ensuite fourni d’autres outils pour construire notre objet de recherche, à mesure que la question des processus de politisation de l’action s’imposait à l’analyse.
TYPOLOGIE DES SOURCES
Nous avons travaillé sur plusieurs types de sources : les imprimés, et principalement les publications de ces associations. Tracts, manuels de militantes, les rares affiches ou photographies sont venues compléter ce premier support de travail. À ces imprimés s’ajoutent les correspondances de certaines ligueuses et militantes avec la direction des associations, la correspondance avec le secrétaire d’État du Vatican, les procès-verbaux des réunions du conseil central de la L.P.D.F. de 1901 à 1914. Les rapports de la Sûreté générale sont venus s’ajouter à ces sources internes du monde catholique. Nous n’avons pas eu accès en revanche au même type de document en Italie.
Les fonds d’archives
Archives des associations
Les deux associations que nous avons étudiées ont laissé des fonds d’archives importants aussi bien en France qu’en Italie. Si le fonctionnement institutionnel peut être appréhendé assez facilement du point de vue administratif, la pratique des dirigeantes se donne à voir de façon plus complexe. De manière plus générale, la conservation de documents exposant le point de vue des protagonistes en tant que militantes, les justifications de leur engagement, l’explicitation de leur prises de position ou la façon dont elles résolvaient les éventuelles contradictions qu’elles observaient entre les discours et leurs pratiques sont absentes de nos sources. Cela tient d’abord à l’ethos de la militante catholique qui est marqué par l’humilité et l’accomplissement silencieux de l’apostolat en vue du salut. Nombre d’entre elles ont sans doute détruit leurs archives personnelles à l’instar de la supérieure des filles du Cœur de Marie113.
Archives de la Ligue patriotique des Françaises (1902-1933)
Les archives de la L.P.D.F. ont été conservées par l’Action catholique générale, qui a son siège dans un hôtel particulier de la rue de l’Université à Paris, acheté en 1938 par la Ligue féminine d’Action catholique française (1938-1954). Le projet de la direction actuelle de l’association héritée de la L.P.D.F. est de verser ce fonds aux Archives de l’Église de France d’ici quelques années. Pour le moment, sont conservés dans les caves plusieurs mètres linéaires de cartons qui ont été classés par les militantes et une stagiaire archiviste de l’école des Chartes. Les anciens inventaires et la mise à jour après recollement sont disponibles sous forme d’un cahier manuscrit datant de 2001. Nous avons pu accéder relativement facilement aux documents, que nous souhaitions consulter, et bénéficier d’un accueil exceptionnel de la part de la direction de l’association qui a mis à notre disposition une photocopieuse et un bureau afin que nous puissions effectuer notre recherche dans les meilleures conditions possibles.
Outre les imprimés des différentes branches de la L.P.D.F. et des comités locaux que nous évoquerons plus bas114, les archives de l’association contiennent la correspondance du secrétariat central avec Rome115, la correspondance avec les comités locaux et les ligues internationales116, la documentation – souvent lacunaire – sur le mouvement117. La majorité des correspondances est manuscrite. Les comptes rendus de réunion sont la plupart du temps rédigés de la main de Marie Frossard. Les lettres adressées au pape en revanche sont souvent dactylographiées.
Certains cartons ne contiennent pas les originaux mais un résumé fait a posteriori des activités : c’est le cas du carton H. 247 « Relation avec les pouvoirs publics » qui ne comporte qu’une chronologie dactylographiée en 1954 ; c’est aussi le cas des archives de Mlle du Rostu (1891-1979) secrétaire générale de la L.F.A.C.F. de 1935 à 1952 dont les cartons ne contiennent presque rien sur la fondation des Jeunes de la L.P.D.F en 1923118.
Les statistiques et fichier des adhérentes n’ont pas été conservés. Nous ne disposons donc d’aucune preuve tangible du nombre considérable d’adhérentes revendiquées par la L.P.D.F. qui soit conservée à l’association. Le seul carton censé receler des données quantitatives ne contient aucun document chiffré précis pour la période mais seulement un résumé119. Nous avons donc pris le parti de nous fonder sur les estimations fournies par la Sûreté générale et par les rapports envoyés au Secrétariat d’État du Vatican, qui recoupent les chiffres avancés par la L.P.D.F.
Si les chiffres semblent donc vraisemblables, les motivations de l’adhésion restent pour nous en partie énigmatiques : les traces dont nous disposons sont les écrits des dirigeantes nationales. La parole des militantes de comités locaux est perceptible dans la correspondance conservée par le Secrétariat central. Mais seuls les documents relatifs à des conflits ou à l’administration courante ont été conservés, l’administration courante restant lisible principalement dans les registres contenant les copies sur papier de soie des lettres rédigées par Marie Frossard.
La logique de conservation qui a présidé à la sélection des documents émerge dans certains cartons relatifs à la fondation. Pièces à conviction devant prouver la conformité du comité parisien de la L.P.D.F. à l’égard du Vatican, les lettres ont été soigneusement archivées, semble-t-il par les filles de Marie à la tête de l’association. La plupart du reste de la documentation ne semble pas avoir fait l’objet d’une conservation méthodique pour la période qui nous concerne. Ces sources d’une grande richesse ne nous ont pas permis pour l’instant de mener à bien une analyse prosopographique des militantes et dirigeantes. Elles ont cependant fourni une base de travail solide pour analyser la politisation féminine au sein de l’association, tout autant par ce qu’elles disent, que pour ce qu’elles laissent deviner en creux, des actes de déviance, des transgressions de frontières établies.