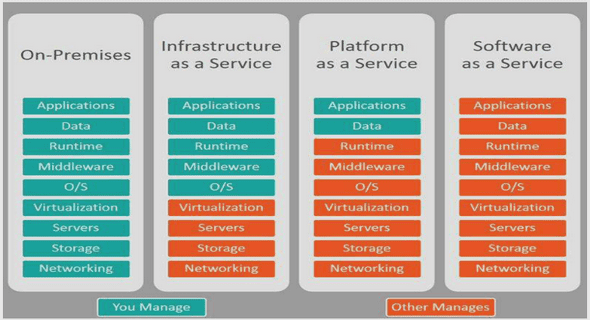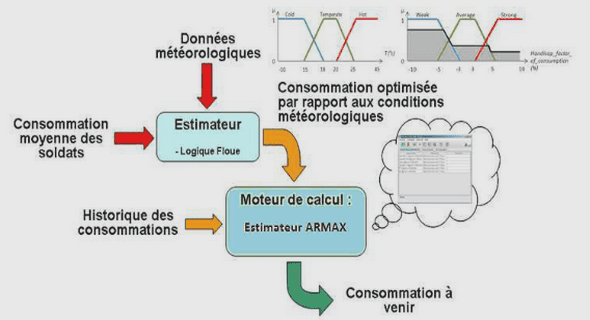Effets sur les systèmes respiratoire et immunitaire
De plus en plus de données scientifiques font le lien entre des pathologies comme l’asthme et/ou
des troubles immunoallergiques et certains produits contenant des COSV. La revue de la littérature conduite par Jaakkola et Knight met par exemple en évidence une possible relation entre l’exposition à des matériaux en PVC contenant des phtalates et des troubles de types asthme, rhinites allergiques, bronchites chez l’homme adulte et l’enfant (Jaakkola and Knight 2008). Ces mêmes troubles immunoallergiques ont été observés chez des souris exposées en période périnatale (Midoro-Horiuti et al. 2010) ou in utero (Nakajima et al. 2012) au BPA.
L’apport des approches mécanistiques
Les approches in vitro permettent de mieux comprendre les mécanismes ou modes d’action de ces composés sur notre organisme. Nous avons vu précédemment que la testostérone et les enzymes de la stéroïdogénèse semblaient être des cibles privilégiées des COSV. La testostérone est produite par les cellules de Leydig via les enzymes de la stéroïdogénèse et des protéines de transports. Dans ces cellules, la production est d’abord initiée par le transfert du cholestérol de la membrane externe à la membrane interne des mitochondries par la steroidogenic acute regulatory protein (StAR). Dans les mitochondries, l’enzyme cytochrome P450 side-chain cleavage (P450scc) convertit le cholestérol en prégnénolone qui est ensuite transportée dans le réticulum endoplasmique lisse où il est transformé en progestérone par la 3 -hydroxysteroid dehydrogenase (3 -HSD), en androsténédione par la 17α-hydroxylase (P450c17 ou Cyp17a1), puis en testostérone par la 17 -hydroxysteroid dehydrogenase (17 -HSD) (Figure 2).
Comme présentée précédemment, la synthèse de testostérone peut être inhibée par un grand nombre de COSV. Certains de ces composés semblent en effet capables d’inhiber la production d’enzymes clefs de la stéroïdogénèse (notamment la StAR et la P450scc), c’est le cas de certains pesticides (Jin et al. 2011; Saradha et al. 2008; Wang et al. 2011; Zhang et al. 2007), de phtalates (Borch et al. 2004, 2006a, 2006b; Lehmann et al. 2004), du BPA (Akingbemi et al. 2004; Nakamura et al. 2010) ou encore du B[a]P (Chung et al. 2011; Liang et al. 2012). La synthèse d’autres protéines produites par les cellules de Leydig, comme l’insulin-like factor-3 (Insl3), semble également être inhibée par des COSV tels les phtalates (Borch et al. 2006b; Hannas et al. 2011, 2012; Howdeshell et al. 2007). La diminution de la synthèse de ces protéines est une des causes de nombreux troubles de la reproduction. Chez les individus mâles, une exposition pendant la période fœtale peut conduire à des malformations de types cryptorchidie (non descente testiculaire) ou hypospadias (fermeture incomplète de l’urètre). En période post-natale, cette diminution peut entrainer une altération de la qualité et de la quantité de spermatozoïdes et donc avoir une influence sur la fertilité future (Skakkebaek et al. 2001; Welsh et al. 2008).
Dans le cas des troubles du système nerveux, les données in vitro apportent également des éléments de compréhension quant aux mécanismes impliqués. La mort neuronale semblerait être un des évènements clefs de ces troubles neurologiques (Cheng et al., 2009; Zhang et al., 2013). Sur la base des données publiées dans la littérature (Kumar et al. 2013), la Figure 3 résume les principaux mécanismes responsables de la mort neuronale qu’empruntent les COSV.
Plusieurs COSV ont été décrits comme agissant à différents niveaux de ces mécanismes. Comme décrit dans la figure β, la mitochondrie semble être un des compartiments clefs dans l’apoptose cellulaire. Elle est la cible directe ou indirecte de nombreux COSV. En effet, un certain nombre d’entre eux sont décrits comme pouvant induire une augmentation de la concentration de calcium (Caβ+) intracellulaire, via par exemple l’activation de récepteurs NMDA (et/ou AMPA) conduisant à l’ouverture des canaux calciques. Cette augmentation des taux calciques va conduire une dépolarisation (puis une dégradation) de la membrane des mitochondries ainsi qu’à la production d’espèces réactives de l’oxygène (ROS). La dégradation des mitochondries va induire la libération du cytochrome c (Cyto c), la libération de facteurs pro-apoptotiques mais également la production de ROS. Tous ces mécanismes vont conduire à la mort du neurone (via la dégradation directe de l’ADN ou par l’activation de protéines de mort, les caspases). Les BDE-209, 47, 99 et le BPA peuvent induire une augmentation de la concentration calcique intracellulaire (J. Chen et al., 2010; S. Lee et al., 2008; Yu et al., 2008), entrainant une dégradation mitochondriale. Les mitochondries sont également la cible d’autres polluants comme les insecticides organochlorés dieldrine et lindane (Sharma et al. 2010) ou le B[a]P (Nie et al., 2014). Certains d’entre eux comme le PCB-52 (Lee et al. 2005), le chlorpyrifos (Ki et al. 2013) ou les précédents dieldrine, lindane, BDE-209 ou BPA induiraient la production de ROS. D’autres comme les PCB-77 et 153 (Sánchez-Alonso et al. 2003), le DEHP (Lin et al. 2011) ou les précédents B[a]P, BDE-47 et BDE-99 pourraient activer la voie des caspases. L’exposition à ces COSV, quel que soit le mécanisme d’action mis en œuvre, pourrait donc conduire à la mort neuronale.
Ces données toxicologiques in vitro permettent de mieux appréhender les mécanismes impliqués dans la toxicité de ces molécules. Il est cependant difficile d’établir des relations causales entre les mécanismes d’action issus des données in vitro et les effets observés dans les études épidémiologiques car les effets mesurés, les espèces, les doses et les durées d’exposition sont très différents, c’est pourquoi il subsiste encore de nombreuses incertitudes sur la connaissances des effets des COSV chez l’homme, nécessitant de mettre en œuvre des approches pour aider à la décision.
La problématique des mélanges aux faibles doses : Comment évaluer leurs impacts sur la santé ? Si les effets de nombreux COSV sont manifestes chez l’animal, ils sont plus difficiles à mettre en évidence chez l’homme. En effet, dans le cas des expositions environnementales, l’homme est soumis à de faibles doses de mélanges4 complexes. Dans le cas des faibles doses, les relations quantitatives exposition/effet ne sont pas toujours bien établies et la question du risque sanitaire n’est par conséquent pas élucidée. L’impact sanitaire des expositions cumulées est par conséquent peu connu et peu pris en compte dans les décisions de santé publique et le développement de stratégies d’évaluation des mélanges est devenu une priorité de recherche.
Dans ce type de situation d’incertitude portant sur la nature des mélanges dans des expositions environnementales et sur leur impact, l’approche d’évaluation quantitative des risques sanitaires (EQRS) peut être un outil intéressant. Cette approche, codifiée au début des années 1980 par le National Research Council des Etats-Unis, comporte 4 étapes (NRC 1983) : Identification du danger (identification du ou des polluants responsables d’effets spécifiques)
On entend par « mélange », la présence d’au moins deux substances. Un mélange de deux substances est un mélange simple qu’il est relativement aisé d’étudier. En revanche, lorsqu’on s’intéresse à de nombreuses substances, il s’agit de mélanges complexes. Il existe deux grands types de mélanges complexes : les mélanges complexes issus d’une source ou d’un procédé connu (par exemple, un processus de combustion va engendrer des HAP et/ou des dioxines) et les mélanges complexes qui proviennent des aléas des contaminations environnementales et des différents usages de produits chimiques. La difficulté de ces derniers est de les identifier afin de pouvoir évaluer leurs impacts sur notre santé. Le fait de disposer de données de contamination des logements représentatifs d’un territoire est intéressant pour identifier et étudier les substances auxquelles les populations sont exposées de manière concomitante. Le cas de l’environnement intérieur est donc intéressant en ce sens.
Evaluation de l’exposition (détermination de la mesure et de l’ampleur de l’exposition humaine) Caractérisation du risque (description de la nature et de l’ampleur du risque pour la santé humaine, incluant les incertitudes)
Ce type de démarche est applicable dans des situations et contextes où l’environnement est contaminé et a pour finalité d’apporter des éléments d’aide à la décision dans un contexte d’incertitude. Cela permet d’estimer l’ampleur d’un problème de santé publique et, pour le décideur, de mettre en place des mesures de gestion proportionnées. La démarche d’EQRS décrite par le NRC a largement été utilisée depuis les années 80 mais permettait surtout la gestion des risques substance par substance. La démarche a donc évolué vers l’évaluation des risques cumulés ou « cumulative risk assessment » (CRA). Cette approche CRA regroupe un certain nombre de méthodes d’évaluation des risques cumulés. L’article présenté dans ce chapitre, Construction de valeurs toxicologiques de référence adaptées à la prise en compte des mélanges en évaluation des risques sanitaires : méthodes existantes et application récentes », publié en 2014 dans Environnement Risques et Santé, propose un historique de ces méthodes et présente à travers des exemples de la littérature, leurs applications actuelles. L’idée fût de faciliter l’accès à ces nombreuses approches, publiées ces dernières années, aux décideurs et aux évaluateurs de risques, car actuellement peu de recommandations institutionnelles permettent de prendre en compte les mélanges dans les démarches d’évaluation des risques cumulés, comme récemment signalé par la SFSE dans sa note sur les mélanges6.