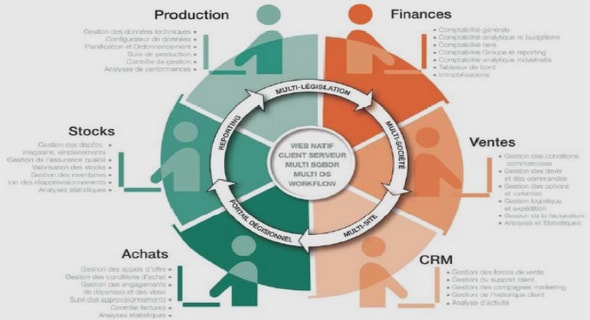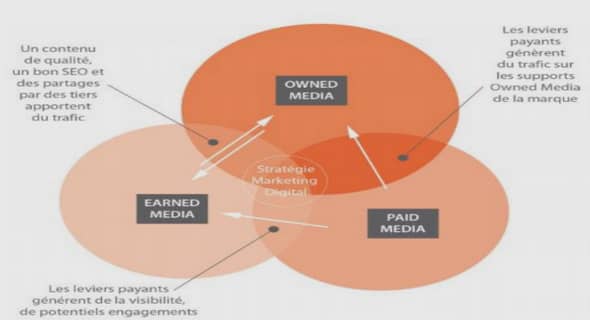Méthode et matériaux
Le TS, en français, se compose de parties sélectionnées du rapport RSE de Renault publié en 2013, concernant l’année 2012, disponible en ligne. Au sein des parties sélectionnées, seulement les titres et le corps du texte ont été retenus ; graphes et encadrés ayant été exclus. Le TS comprend 4 681 mots, soit 25 779 caractères, espaces non compris. Le texte cible (TC), en suédois, s’adresse à un public intéressé par le secteur automobile et la RSE.
La première phase du travail de traduction a consisté à lire l’ensemble du TS, afin de prendre connaissance de l’esprit du texte et le message global que les auteurs ont voulu faire passer. Puis, dans un deuxième temps, la traduction en tant que telle a eu lieu. Enfin, le TC a été relu et corrigé. Nous avons cherché à rédiger un TC véhiculant le même message que le TS, ce qui nous a conduit vers une stratégie de traduction plutôt libre : notre traduction est pragmatique.
Lors de cette traduction, un certain nombre de sources ont été consultées :
• les dictionnaires en ligne, notamment Norstedts stora franska ordbok, disponible en ligne via Wordfinder ;
• des textes parallèles : notamment la communication RSE de Volvo, entreprise suédoise ayant beaucoup de points communs avec Renault ;
• le site du GRI : incontournable afin d’identifier les termes exacts pour le vocabulaire propre au reporting dans la langue cible ;
• le site de l’association CSR Sweden (benchmark pour la communication en suédois autour du concept RSE, voir annexe A)
Un certain nombre d’exemples de notre traduction ont été sélectionnés, de par leur intérêt pour notre analyse, tel que précisée au § 1.1. Ces exemples sont numérotés de 1 à 20 et sont présentés au fur et à mesure de l’analyse au § 3. Pour des raisons de clarté, les parties de l’exemple concernées par la discussion concécutive ont été écrites en caractère gras.
L’analyse se présente en trois chapitres, suivant la logique énoncée au § 1.1. Ainsi, dans 3.1 nous discutons la traduction sous l’angle de la terminologie en nous intéressant à l’influence de l’anglais sur le français et sur le suédois. Le § 3.2 porte sur les mots abstraits ou à la mode et nous cherchons à savoir si ce genre de mots est plus fréquent dans la communication publique des entreprises françaises ou suédoises. Au § 3.3, nous étudions les différences syntactiques en analysant la traduction de phrases françaises ayant donné lieu à plusieurs phrases suédoises.
Ce mémoire comprend également quatre annexes. Notre étude sur la terminologie RSE auprès des membres de l’associaton CSR Sweden, justifiant nos choix de traduction (voir § 3.1.1) se trouve dans l’annexe A. Les statistiques presentés concernant notre traduction du terme RSE, également discutés au § 3.1.1, se trouvent dans l’annexe B. Dans l’annexe C, nous présentons un tableau résumant le calcul concernant le nombre de phrases dans le TS et le TC, discuté au § 3.3. Afin de valider certains termes et expressions suédois (voir § 3.1.2), nous avons contacté Renault Nordic AB au cours de notre traduction : cet échange est présenté en annexe D.
Quelques abréviations sont utilisés dans ce mémoire : Développement Durable – DD, GRI – Global Reporting Initiative, ONU – Organisation des Nations Unies, RSE – Responsabilité Sociale de l’Entreprise , TC – texte cible, TS – texte source.
Recherches antérieures / Points de départs théoriques
Chaque langue a sa vision du monde, avance Eco (2003:45), et en comparant le suédois et le français cette phrase prend tout son sens. Nous allons faire un tour d’horizon sur ces différences en regardant ce qui a pu être constaté sur l’ouverture à l’anglais, les mots et expressions à la mode, et, enfin, les différences syntactiques.
Recherches antérieures
La terminologie : l’influence de l’anglais
L’Académie française qualifie la concurrence de l’anglais comme « une réelle menace pour le français » et les commissions ministérielles constituées dans ce cadre s’emploient à « indiquer, parfois même à créer, les termes français qu’il convient d’employer pour éviter tel ou tel mot étranger » (Académie française). Prenons l’exemple du mot anglais mail. D’après l’Académie française, le terme courriel « doit être préféré à l’anglais electronic mail et son abréviation e-mail ». La langue suédoise, au contraire, est plus ouverte à l’influence étrangère. En consultant le dictionnaire Svenska Akademiens Ordlista (SAOL), nous pouvons constater que mejl, à savoir un emprunt de l’anglais orthographié à la suédoise, y figure, ainsi que e-post. Il convient de noter que mail ne figure pas dans SAOL. Cela illustre bien l’ouverture suédoise à des termes étrangers, mais de façon pragmatique. Sture Allén, membre de l’Académie suédoise, résume que de tels nouveaux mots doivent en effet avoir une orthographe et une conjugaison rendant leur utilisation pratique en suédois (Språktidningen décembre 2012:24). Olle Josephsson, linguiste suédois renommé, illustre la différence d’attitude par rapport à l’anglais chez les jeunes Français et les jeunes Suédois en avançant que les premiers trouvent leur langue plus belle que l’anglais alors que la tendance est à l’opposée chez les derniers (Josephsson 2004:132). Cette attitude suédoise se vérifie également chez les adultes et surtout dans le monde du travail. Un grand nombre d’entreprises suédoises ont en effet adopté l’anglais comme langue officielle au bureau (pour la communication écrite un tant soit peu officielle) et cela est souvent considéré comme quelque chose de positif (Josephsson 2004:137) : l’anglais est mieux coté que le suédois. L’attitude est à l’opposé en France. Créé à l’initiative du Ministère des Affaires étrangères et européennes, le site « Oui, je parle français dans mon entreprise » est une initiative dont le but est de promouvoir le français dans le monde professionnel, en France et à l’étranger (www.diplomatie.gouv.fr).
Les mots abstraits ou à la mode
Ce mémoire se base sur la traduction d’un texte destiné au grand public, publié par une grande entreprise française. Nous allons donc nous concentrer sur ce genre de textes et nous pouvons constater que les mots utilisés pour passer un message ne sont pas choisis uniquement pour leur sens sémantique. D’autres facteurs influencent également, dont celui de l’effet de mode. Les mots à la mode, en anglais « buzz words », sont abstraits pour la plupart et il s’avère souvent difficile d’identifier leur sens réel (Lindstedt 2013:86). Les « buzz words », « so labeled because they make a pleasant buzzing sound in your ears while you roll them on your tongue – may overwhelm you into believing that you know what you’re talking about when you don’t: your audience might suspect the truth » (Management Review 1970 Volume 59:60) ; ils permettent donc un beau discours sans qu’on s’engage sur des choses concrètes et tangibles. Par ailleurs, nous venons de voir qu’il existe une réelle volonté française de protéger la langue contre des influences étrangères. Or, même si des recommandations très concrètes existent, nous constatons néanmoins que l’influence étrangère est bel et bien là et qu’elle nourrit les effets de mode. Cela donne lieu à un autre type de « buzz words », dont le sens français se fait peu à peu remplacer par le sens anglais. Lederer appelle cela « la pénétration insidieuse de significations étrangères sous les formes hypocritement familières de mots français » (Seleskovitch & Lederer 2001:291). Pour cette enseignante de l’Ecole Supérieure d’Interprétes et de Traducteurs (l’ESIT), il s’agit d’une forme de transcodage » : le terme étranger est simplement traduit « mot pour mot » plutôt que sens pour sens ». Elle prend pour exemple le mot projet qui a peu à peu perdu son sens d’origine en français, et justement pour les raisons évoquées ici. Selon Le Robert, un projet se définit comme : « image d’une situation, d’un état que l’on pense atteindre ». Il s’agit bien de quelque chose qui n’est pas encore réalisé. Or, dans l’utilisation courante de ce terme en français aujourd’hui, notamment dans la communication des entreprises, le sens de projet n’est rien d’autre que le sens du mot anglais project : une opération qui se traduit dans les faits. Le terme projet est en effet couramment utilisé dans le monde des entreprises en désignant des opérations en cours.
Nous n’avons pas pu trouver de travaux traductologiques concernant les mots abstrats ou à la mode.
Les différences syntactiques
Lors de cette traduction, nous avons été confrontés à la différence syntactique entre le suédois et le français. Nous constatons notamment une proportion élevée de propositions incises et de propositions subordonnées en français et par effet miroir une proportion élevée de propositions principales en suédois comparée au français (Ingo 1997:197). Comme vu en introduction, l’étude approfondie d’Eriksson démontre qu’il existe en général, en effet, un écart quantitatif en nombre de phrases utilisées pour exprimer un même contenu sémantique ; le français utilise en moyenne 955 phrases tandis que le suédois en utilise 1 000, soit un écart de 4,5 % (Eriksson 1997:41). Cela s’explique en partie par le choix du traducteur pendant le processus de traduction, puisque il y a rarement une seule et unique « bonne traduction » mais au contraire une multitude de possibilités. Il est en effet indéniable que le traducteur individuel a une très grande influence sur le TC, comme le discute longuement Christina Gullin dans son ouvrage Översättarens röst (Gullin 1998:36-37). Vinay & Darbelnet (1977:31), eux, avancent que « en LA [langue d’arrivée] le traducteur devra compter avec les servitudes qui entravent sa liberté d’expression et il devra aussi choisir entre les options qui s’offrent à lui pour rendre les nuances du message ». Nous sommes conscients que l’étude de Gullin, ainsi que la plupart des exemples traités par Vinay & Darbelnet, concernent des traductions littéraires où, effectivement, le traducteur a plus de liberté que le traducteur de textes de spécialité, comme le nôtre, mais ces mêmes principes peuvent quand même être appliqués sur des traductions de notre type. Or, il n’en est pas moins qu’une partie de ces différences, une partie non négligeable, en ce qui concerne la traduction entre le français et le suédois, est due à ce que Vinay & Darbelnet (1997:50) appellent la « transposition obligatoire ». Les auteurs la décrivent comme le « procédé qui consiste à remplacer une partie du discours par une autre sans changer le sens du message » (Vinay & Darbelnet 1977:96). Or, concernant la traduction entre le français et le suédois, il convient d’apporter une précision formulée par Eriksson. Ce dernier accentue le fait que les termes de syntagmes et de propositions (principales et subordonnées) – les « unités de traduction », sont plus exacts que le terme « parties de discours », employé par Vinay & Darbelnet. Ce sont en effet les propositions qui sont les constituants syntaxiques qui se transposent (Eriksson 1977:21-22).
Un autre aspect des différences syntactiques est l’utilisation des charnières dans le texte. Un des conseils mis en avant dans le guide Ecrire pour être lu, publié par l’Union européenne pour la rédaction en français consiste à « [accorder] une grande attention aux mots de liaison qui aident le lecteur à suivre votre raisonnement ». Le français est en effet considéré comme une langue « oratoire » (Vinay & Darbelnet 1977:225). Ainsi, il est impensable de rédiger un texte en français sans avoir recours à des « charnières » ou « articulations » : ces mots de liaison qui guident le lecteur tout au long du texte.
Le français, tout au moins dans la langue littéraire, philosophique, scientifique et juridique, affectionne les articulations, et se passe difficilement des précisions qu’elles peuvent apporter dans le déroulement de la pensée. L’anglais, au contraire, même dans ses formes classiques, fait beaucoup moins appel aux articulations explicites, donc laisse au lecteur le soin de suppléer lui-même les articulations qui s’imposent et joue plutôt avec la juxtaposition des phrases et segments de l’énoncé. (Vinay & Darbelnet, 1977:222)
Sans prétendre que l’anglais et le suédois soient identiques, il semble que cette distinction entre le français et l’anglais peut également s’appliquer au suédois. Le français se distinguerait donc du suédois en ce qui concerne l’usage des termes ayant pour seule raison d’être de clarifier le déroulement de la pensée.
Il est en effet difficile d’imaginer un texte en français sans une structure apparente, visualisé par des charnières, qui lient les idées entre elles et qui guident le lecteur tout au long du texte (dans un premier temps, puis, enfin, en effet, …). En suédois, ce principe est tout aussi important, mais cela ne passe pas forcément par l’utilisation de tels mots (för det första, dessutom, slutligen, nämligen, …), même s’ils existent. Dans Vägar genom texten, ouvrage suédois traitant de l’analyse de texte non littéraire, les auteurs s’intéressent aux différentes manières de lier le texte (textbindning), aspect critique pour que le texte soit clair pour le lecteur final. Le sujet est traité en trois parties : referensbindning, tematisk bindning et konnektivbindning. Ce dernier correspond au principe de lier les idées à l’aide des mots « connecteurs » (Hellspong & Ledin 1997:80-90). Au sujet des mots connecteurs, les auteurs nous avertissent qu’il ne faut pas en abuser. Cela risquerait en effet de rendre le texte « enfantin » (barnslig) : les choses seraient trop clairement dites, ce qui pourrait offusquer le lecteur (Hellspong & Ledin 1997:90). En français, en revanche ( !), les mots connecteurs, les charnières, sont nécessaires à la construction d’un texte et leur utilisation n’a rien « d’enfantin ». Dans leur ouvrage classique, Stylistique comparée du français et de l’anglais, Vinay & Darbelnet s’intéressent aux différences entre le français et l’anglais en termes de « attitude » de la part du locuteur. Ils démontrent que l’anglais est une langue « objective » : en anglais, le locuteur fait part de ses observations au fur et à mesure qu’elles se présentent ; le message est composé d’éléments juxtaposés, une méthode qui rappelle les recommandations de Hellspong & Ledin vues plus haut. Vinay & Darbelnet appellent cela un développement « intuitif » ou « sensoriel ». Le locuteur français, au contraire, prend position et invite son lecteur à suivre son raisonnement, en utilisant des mots charnières justement : il s’agit d’un développement « raisonné » (Vinay & Darbelnet 1977:221). Nous pensons que le suédois s’approche de l’anglais et que les conclusions de la comparaison français-anglais réalisée par Vinay & Darbelnet pourraient également être vérifiées en comparant le français et le suédois.
Nous constatons également que la traduction du français en suédois semble poser les mêmes types de difficultés que celles observées lors de la traduction grec – français, le grec étant la langue rhétorique par excellence. « Si l’on traduit toutes les particules, on alourdit intolérablement la phrase française. Si on les escamote, on fait disparaître un des traits essentiels du génie grec » (Vinay & Darbelnet 1977:223).
Concepts traductologiques
Notre TS faisant partie de la communication publique d’une grande entreprise dont l’objectif consiste à véhiculer un message auprès des différentes parties prenantes ainsi qu’au public. Lors de la traduction, notre ambition a été de porter ce même message global : la traduction est donc pragmatique avant tout.
Tout au long de l’analyse, nous faisons référence à quelques concepts traductologiques, définis ci-dessous.
Traduction littérale / Transcodage
La traduction littérale consiste à traduire « mot à mot ». Il s’agit d’une traduction de type « directe ». Or, il n’est pas rare qu’une telle traduction résulte dans un TC inacceptable : le TC « donne un autre sens, n’a pas de sens, est impossible pour des raisons structurales, ne correspond à rien dans la métalinguistique de LA [langue d’arrivée], ou, correspond bien à quelque chose mais non pas au même niveau de la langue » (Vinay & Darbelnet 1977:46-49).
D’après Marianne Lederer (Seleskovitch & Lederer 2001:15), « transcoder » consiste à aller d’une langue à l’autre en convertissant des signes en d’autres signes [sans se soucier du sens que portent ces mots dans ce contexte précis] ».
En traduisant, il convient d’être vigilant lorsqu’une « traduction littérale » ou un transcodage » semble possible. Il se peut en effet que le sens porté par le mot en question, dans le contexte donné, ne soit pas le même dans le TS et dans le TC.
Equivalence / Bruksmotsvarighet
Ingo (2007:154) définit « bruksmotsvarigheter » comme des traductions « som inte är direkta semantiska motsvarigheter men som ändå väl förmedlar den pragmatiska informationen ». Cette ambition – de transmettre de l’information pragmatique quitte à ne pas traduire chaque terme par sa correspondance sémantique directe – résume bien ce que nous avons cherché à faire tout au long de notre traduction. Ce procédé de traduction est discuté sous le nom « d’équivalence » par Vinay & Darbelent (1977:52), qui soulignent que deux textes peuvent parfaitement mettre en œuvre des moyens stilistiques et structuraux entièrement différents tout en rendant compte d’une même situation.
Analyse
L’analyse se fera en trois parties en suivant l’ordre annoncé en introduction et repris dans la partie sur la recherche théorique.
La terminologie : l’influence de l’anglais
Avant d’analyser individuellement les termes propres à la RSE, nous allons poser un cadre général. Il est aujourd’hui impensable pour les grandes entreprises de faire l’impasse sur la RSE dans leur communication publique, si elles souhaitent rester crédibles dans ce monde où le reporting et les divers classements sont devenus incontournables, aussi bien en termes d’image que de performance. Ce contexte, qui pose les entreprises des quatre coins du monde face aux mêmes contraintes de reporting, impose donc une terminologie commune. Or, chaque acteur doit également trouver sa manière de communiquer autour de ce concept au niveau local. La communication doit être claire et compréhensible, aussi bien pour les agences de notation et d’autres acteurs mondiaux, que pour les employés, les clients, les fournisseurs et pour le marché local dans son ensemble. Il en résulte une communication dans plusieurs langues sur ce sujet : l’anglais pour la communication internationale et, dans notre cas, le français respectivement le suédois pour la communication locale. La terminologie commune existe : l’ONU propose un programme de dix principes intitulé « Global Compact », qui pose un cadre pour les entreprises. En outre, l’organisation « Global Reporting Initiative » (GRI) propose une grille d’indicateurs ainsi que du soutien aux entreprises souhaitant aligner leur reporting sur la base du GRI. Ces deux sources sont anglophones à l’origine, mais proposent également de la documentation dans d’autres langues, notamment en français. Le GRI communique en vingt-quatre langues (contre sept quant au Global compact), dont le suédois. Il incombe ensuite aux entreprises d’utiliser cette terminologie à bon escient et surtout de l’intégrer dans leur communication habituelle sur ce sujet de façon harmonieuse.
Nous allons maintenant analyser ces termes individuellement.
Responsabilité Sociale de l’Entreprise (RSE)
Le terme principal de ce mémoire est celui du titre du rapport traduit : Responsabilité Sociale de l’Entreprise (RSE). Il apparaît en effet 44 fois dans le TS. En français, il s’agit d’une traduction « directe » de l’anglais : Corporate Social Responsibility (CSR) – Responsabilité Sociale de l’Entreprise (RSE). Ce choix de traduction s’explique par la tradition française d’éviter l’import des termes étrangers, expliquée au § 2.1 La terminologie : l’influence de l’anglais. Afin de faire le choix de traduction en suédois, il a été nécessaire d’étudier un certain nombre de publications d’entreprises suédoises afin de voir comment elles communiquent à ce sujet. Il a donc fallu trouver ce que Vinay & Darbelnet nomment une « équivalence » (1977:52), terme discuté sous le nom de « bruksmotsvarighet » par Ingo (2007:154). Pour cela, les dix-neuf entreprises membres de l’association CSR Sweden ont servi d’échantillon. Ainsi, une étude (voir annexe A) sur les termes employés par ces entreprises suédoises a été réalisée, grâce aux données du site de cette association. L’étude démontre que la tendance penche pour l’utilisation du terme samhällsansvar (pour 43 % des entreprises étudiées), mais que l’abréviation anglaise CSR est également couramment utilisée (24 %). Les entreprises restantes utilisent les termes samhällsengagemang (19 %) et hållbarhet (14 %). Il est à noter que malgré la petite taille de la présentation de chacune (150-200 mots grosso modo), 38 % des entreprises membres utilisent au moins deux termes pour parler de ce concept. Ces résultats rejoignent ce que Josephsson avance sur l’ouverture suédoise aux influences étrangères (Josephsson 2004:132), de par l’emploi du terme CSR en tant que tel. Dans la traduction réalisée dans le cadre de ce mémoire, le choix a été fait d’alterner ces différents termes, afin de refléter au mieux le TS.
Nous allons regarder de près deux exemples, puis voir de façon plus synthétique comment nous avons choisi de traduire RSE tout au long du texte.