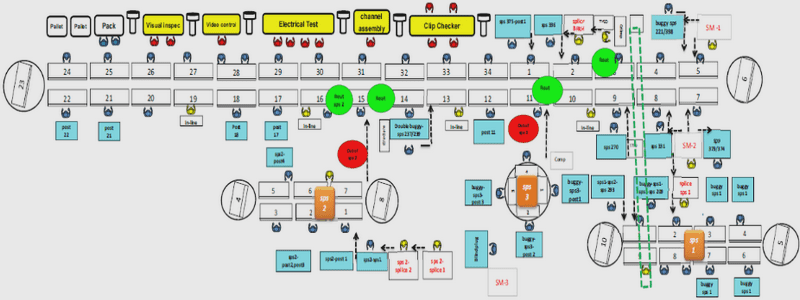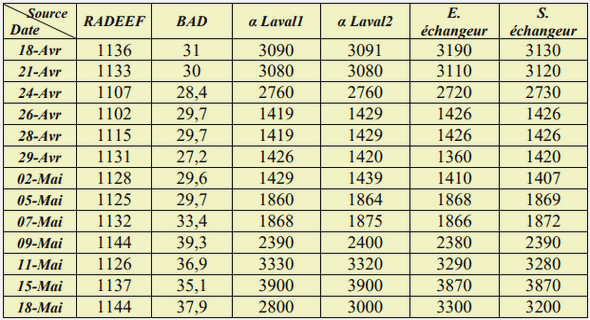Présentation de l’enquête et des méthodes d’analyse
Pour notre enquête, nous avons décidé de nous rendre dans l’est du Canada afin de faire une étude quantitative directement sur place. L’étude a été réalisée dans la province du Nouveau-Brunswick dont 31.9% de la population a le français comme langue maternelle (Statistique Canada, Recensement 2011). Nous nous sommes concentrés sur le Nord-Est de la province, connu sous le nom de Péninsule acadienne. Nos participants vivent principalement dans la grande municipalité de Tracadie formée de 18 petites localités totalisant environ 16 000 habitants et le village de Neguac avec ses 1 678 habitants, des régions majoritairement francophones.
Premièrement, nous nous sommes assuré que les participants à l’étude sont des descendants des premières familles acadiennes et originaires du Nouveau-Brunswick, c’est-à-dire que leur généalogie remonte jusqu’aux colons du XVIIe siècle. Deuxièmement, nous leur avons demandé des renseignements personnels tels que leur lieu de naissance et de vie actuel, et leur niveau d’éducation. Nous nous sommes arrêtés à 150 participants. Le tableau suivant présente la distribution des participants d’après leur lieu de vie actuel. Il faut mentionner que nous avons inscrit dans le tableau ci-dessous quatre grandes sections contenant la municipalité de Tracadie qui compte six petites localités ; les villes de Caraquet et Lamèque ; le village de Neguac comptant deux petites localités ; et les villes du Sud-Est comptant trois grandes villes.
Comme notre hypothèse touche le niveau d’éducation, qui est souvent lié à l’âge, nous avons considéré cinq générations. Étant donné que le mot génération pouvait avoir plusieurs significations », nous nous sommes basé sur celle de Statistique Canada qui le définit de cette façon :
En général, on définit une génération comme un groupe de personnes qui ont à peu près le même âge et qui ont vécu, le plus souvent pendant leur enfance ou au début de l’âge adulte, des événements historiques particuliers, tels qu’une crise ou une période de prospérité économique, une guerre ou des changements politiques importants. Ces événements peuvent influencer leur vision du monde. (Statistique Canada, 2011).
Nous avons finalement retenu la classification suivante :
• La génération silencieuse1 (naissance avant 1946)
• La génération des baby-boomers (1946-1964)
• La génération X (1965-1979)
• La génération Y (1980-2000)
• La génération Z (après 2000)
Nous présentons ci-dessous le tableau II sur le niveau d’éducation de nos participants d’après les cinq générations choisies pour l’étude. Pour réussir ce tableau, nous avons coté tous les questionnaires d’après le niveau d’éducation de chaque individu (voir Annexe 1). Nous avons utilisé les lettres A (aucun diplôme d’études) ; B (diplôme d’études secondaires) ; C (diplôme d’études post-secondaires) et D (études en cours). Par après, nous avons calculé le total ainsi que le pourcentage pour les trois niveaux d’études. L’enquête nous indique que 17 personnes sur 30 (56,7%) de la génération silencieuse ne possèdent aucun diplôme : « Le recensement de 1941 avait démontré que le Nouveau-Brunswick était la province la plus illettrée au Canada et que la cause principale de cet humiliant taux d’analphabétisme se trouvait chez les Acadiens » (Savoie, 1978 :31). En comparaison, 30% de la génération suivante n’a aucun diplôme d’études secondaires mais 63,3% a un diplôme d’études post-secondaires. Il faut préciser que les deux dernières générations sont en majorité en train d’étudier à présent.
Afin de vérifier la présence des anciens mots français dans le parler acadien, nous devions trouver ces mots. En premier lieu, nous avons consulté le Dictionnaire du français acadien (Cormier, 1999) et nous avons retenu une trentaine de mots dont l’explication historique indiquait « Héritage de France » ou « Héritage des parlers de France ». Nous avons vérifié, par la suite, dans le dictionnaire Le Petit Robert (2017) la confirmation de leur absence. Nous avons finalement choisi 20 anciens mots pour l’étude. Ces mots figurent dans l’annexe 2, avec une définition moderne ainsi que l’explication historique.
En deuxième lieu, nous avons composé une phrase pour chaque mot dans laquelle l’ancien mot ou le mot moderne pouvait être choisi pour compléter la phrase concernée. Le questionnaire a été conçu pour nous donner une idée de la fréquence d’utilisation des anciens mots à l’oral. Tous les interviewés ont été avisés du but du mémoire et du fait que ce formulaire ne les engagerait à rien. De plus, nous les avons informés qu’il fallait répondre spontanément au questionnaire et qu’il fallait choisir les mots employés habituellement et non les mots qui leur semblaient être meilleurs. Cela étant, nous sommes conscient qu’en dépit de la sincérité, les résultats peuvent être approximatifs en raison du fait que chaque personne n’a qu’une appréciation relative de sa propre pratique langagière. Le questionnaire est présenté à l’annexe 3.
Nous avons remis le questionnaire à 30 personnes de chaque génération amenant l’enquête à un total de 150 personnes descendantes des premières familles acadiennes. Après la compilation des résultats, nous regarderons de près le taux d’utilisation des anciens mots en fonction de chaque génération. Nous analyserons l’incidence du niveau d’éducation sur les résultats recueillis. Et finalement, nous essayerons d’identifier les mots choisis de l’étude qui sont encore très présents dans le langage oral de la population étudiée et ceux qui sont en voie probable de disparition.
Évolution de la langue française de l’Europe à l’Acadie d’aujourd’hui
Le français de l’Europe jusqu’au Canada
Afin de dresser un portrait complet de l’évolution de la langue, commençons par le début. Dans l’antiquité, en France, appelée autrefois la Gaule, le peuple parlait le celtique. Quand Rome envahit le pays, l’occupation ayant duré plusieurs siècles, le latin, la langue des envahisseurs, s’impose sur le territoire de la Gaule (Walter, 2016 :14-15). Par la suite, d’autres peuples de tous les coins de l’Europe sont arrivés en Gaule avec leur bagage culturel et leurs parlers pour brasser des affaires. Les différents parlers des marchands et commerçants s’amalgament avec la langue des conquérants et une nouvelle langue chargée d’emprunts de mots arabes, italiens, espagnols, allemands, anglais voit peu à peu le jour (Galichet et als., 1969 : 371). Malgré la domination incontestable de Rome sur tout le territoire, le latin ne régnait pas partout. Les habitants ont toujours conservé leurs dialectes : Rome ne parvint jamais à substituer sa langue aux dialectes indigènes […] Une résistance irréductible lui vint du peuple, les mères, et du clergé, les druides […] ce n’était plus du celtique, ni non plus du latin. C’était une langue nouvelle en voie de formation (Poirier, 1928 : 12-13).
Cette langue française était divisée en langue d’oïl parlée dans la région parisienne et l’ouest de la France, et en langue d’oc parlée dans le sud de la France. La décadence et la chute de l’Empire romain permettent à la langue française d’oïl de s’émanciper et de se développer, car la langue d’Horace et de César, gisait méconnaissable, sous les décombres » (Poirier, 1928 :15). Le français de la région parisienne s’enrichit au contact fréquent avec d’autres parlers d’alentour et c’est ainsi qu’il arrive à supplanter les autres dialectes. Et c’est en 1539 que la francisation commença réellement à s’imposer grâce à la proclamation de « l’ordonnance de Villers-Cotterêts » (Labrune et als., 2016 :38).
Vers 1604, débute le temps des colonisations. Les grandes puissances européennes décident de découvrir d’autres mondes afin d’exploiter de nouvelles richesses. La France veut propager la foi chrétienne et la langue française dans le Nouveau Monde. Selon Tardif et als. (1978 :120), pour émigrer au Canada, différents groupes sociaux étaient choisis dans les régions de la Normandie, de l’île de France, du Poitou et de Saintonge (les provinces de l’Ouest, la région parisienne, le pays de Loire). Ces pionniers : Venus de Poitou, de la Saintonge, de la Bretagne ; apparemment aussi des matelots déserteurs de la Normandie, de l’Aunis et de la Gascogne ; deux Basques ; quelques soldats licenciés, originaires de Paris, qui tous se fondront dans les deux groupes primitifs, pour former une colonie homogène, adoptant les mêmes coutumes, pratiquant la même religion et parlant la même langue (Poirier, 1928 :46).
Cela dit, les Français, débarqués au Canada, emportent avec eux leur façon de parler. C’est à ce moment que les colons de ce nouveau monde et les Français commencent une évolution langagière différente car les Français suivent l’évolution « de la mère patrie » (Tardif et als., 1978 :123).
L’enseignement du français dans l’Acadie coloniale jusqu’en 1755
Au tout début de la colonisation, ce sont les missionnaires et quelques laïcs qui déploient leurs efforts pour dispenser l’enseignement aux Amérindiens et aux enfants des colons européens. Dès 1606-1607, Jean de Poutrincourt, fondateur de Port-Royal, ramène de France le jeune avocat et écrivain, Marc Lescarbot, premier instituteur de l’Acadie (Landry et Lang, 2001 :47). En 1611, ce sont deux jésuites, les pères Biard et Massé qui débarquent à Port-Royal pour participer, eux aussi, à l’effort d’enseignement (ibid., 2001 :47).
Mais, entre 1613 et 1710, les tensions entre la France et l’Angleterre constamment en guerre, se répercutent dans le Nouveau-Monde entre la Nouvelle-France et la Nouvelle-Angleterre. À l’occasion de ces tensions, l’Acadie, région de la Nouvelle-France formée de la Nouvelle-Écosse et une partie du Nouveau-Brunswick se retrouve souvent au milieu de cette rivalité. Dès 1613, les colons acadiens subissent l’attaque de Samuel Argall, commandant de la première expédition anglaise à contester la colonie française d’Acadie. Il va incendier Port-Royal, capturer des missionnaires et quelques colons. Mais, plusieurs colons résistent à l’attaque et s’enfuient dans les bois pour éviter la mort (Squires, 2003). Les missionnaires jésuites partis, ils reçoivent l’aide des Récollets2 pour l’enseignement de la religion et du français : « En effet, de 1619 à 1624, quatre Récollets étaient venus de France pour évangéliser les Hurons sauvages d’Acadie » (Arsenault, 2004 :39).
Après la signature du traité de Saint-Germain-en-Laye en 1632, la France conserve le Canada et l’Acadie. Isaac de Razilly est nommé gouverneur de l’Acadie. Pour assurer l’enseignement de la langue française, il demande l’aide des capucins. Ces moines fondent la première école en Acadie, le séminaire de la Hève, en 1632-1633 : « Grâce aux missionnaires capucins, c’est à l’Acadie que revient l’honneur d’avoir possédé les premières écoles et le premier séminaire en Amérique » (Le Gresley, 1925 :30). En plus des missionnaires, les laïcs font leur part. Il y a le Seigneur Charles de Menou d’Aulnay qui consacre une partie de sa fortune à la fondation d’une colonie permanente en Acadie (Kennedy, 2012 :175). Vers 1640, une autre maison ouvre ses portes. C’est une école de filles sous la direction de Mme de Brice, gouvernante des enfants d’Aulnay. Elle est venue au pays avec ses deux fils missionnaires capucins. Elle enseigne aux jeunes filles acadiennes et aux Amérindiens pendant une douzaine d’années (Robichaud, 1943 :5).