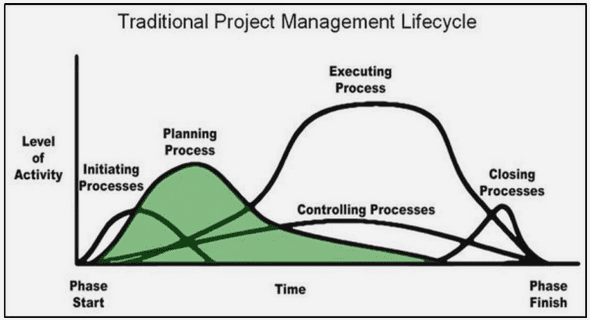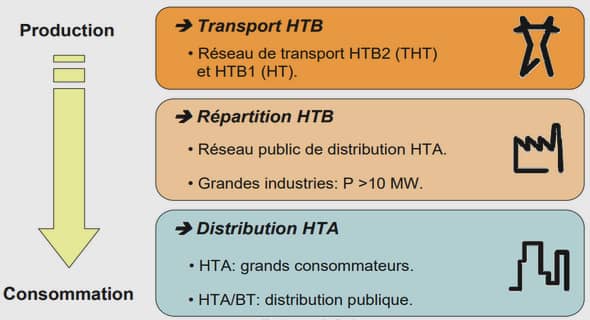Des aides d’urgences aux programmes de développement
La prééminence de l’aide d’urgence dans les politiques de sécurité alimentaire en Éthiopie est ancienne. Mais elle est aujourd’hui remplacée en partie par des programmes de développement, conduits « à marche forcée » (Bach, 2016) par les nouvelles orientations de l’État développementaliste tracées conjointement avec la Banque mondiale et les agences onusiennes, telles que l’Unicef et le Pam. Nous verrons, toutefois, que l’urgence n’est pas totalement gommée des nouveaux dispositifs, rentrant plutôt en concurrence avec leurs orientations et mises en œuvre.
Depuis les années 1950, l’aide occidentale en Éthiopie – principalement américaine – fut longtemps limitée à des aides d’urgence. Cette prépondérance s’explique par l’absence d’antériorité de relations postcoloniales généralement favorables aux politiques de développement, puis par la réticence des donateurs occidentaux lors de la guerre froide à appuyer le régime communiste du Derg, préférant le canal de l’aide d’urgence gérée par les humanitaires (Fourtado et Smith, 2009). Pendant la famine des années 1970, l’aide était exclusivement composée d’aide alimentaire d’urgence. Lors des années 1980, les donateurs orientèrent leurs réponses selon un cadre explicatif physico-écologique mettant en avant les causes combinées de surpopulation, de la dégradation des sols et de sécheresses. Ce cadre permettait de relier les actions humanitaires d’apport en aide alimentaire avec des actions de développement, à travers des travaux de reforestation et de lutte anti érosion organisée comme le Food For Work (FFW) – vivres contre travail – maintenus jusqu’au début des années 2000 sous la forme des activités dites d’Employement Generation Schemes (EGS) (van Uffelen, 2013). À partir de 1991, l’évolution des programmes d’urgence s’articulaient avec les différents programmes de développement co-produits avec la Banque mondiale. Axé vers la sortie des aides d’urgence, le Sustainable Development and Poverty Reduction Program (SDPRP) est un programme global de réduction de la pauvreté prévu jusqu’en 2015, et qui promeut une restructuration de l’État et la libéralisation de l’économie. Plusieurs programmes se sont succédés depuis 1991 : l’Emergency Recovery and Reconstruction Program (ERRP, 1991-1993), un Programme d’Ajustement Structurel (Pas, 1996-1998) ; le Poverty Reduction Strategy Program (PRSP I, 2000-2004) ; le PRSP II ou Plan for Accelerated and Sustained Development to End Poverty (Pasdep, 2005-2010) puis le Growth and Transformation Plan (GTP, 2011-2015). Le fil conducteur de ces programmes suivait les principes édictés par le régime éthiopien de l’Agricultural Development Led Industrialization (Adli). À l’origine, l’Adli postulait que la croissance de la production industrielle devait être initiée par le développement agricole en priorisant l’amélioration des cultures vivrières des populations rurales pauvres. Focalisée sur la lutte contre la pauvreté et sur des politiques de protection sociale et d’appui à l’agriculture domestique, le gouvernement éthiopien pensait pouvoir atteindre l’autosuffisance alimentaire et créer les conditions favorables au développement industriel. Dans un premier temps, le PRSP I (2000-2004) amorça l’ouverture d’une politique libérale, programmant la libéralisation des prix et des marchés (suppression des subventions, réduction des droits de douane, réforme bancaire, etc.) avec le renforcement du secteur privé et la réforme de la fonction publique. Suite au constat d’une marginalisation de l’Éthiopie engendrée par le Pas, il s’accorda avec les Objectifs du Millénaire (MDG) des Nations unies, en cherchant à renforcer le système gouvernemental. Il prévoyait l’expansion des services de base, tels que l’enseignement, les services médicaux, l’approvisionnement en eau et l’amélioration des infrastructures (routes, urbanisme et télécommunication). Enfin, il impulsa de nouvelles orientations de la politique de sécurité alimentaire, notamment par le remplacement de l’aide alimentaire d’urgence par le Productive Safety Net Programme (PSNP) et par le couplage d’une politique d’appuis individuels aux petits paysans avec le développement d’une agriculture extensive. Cette politique se traduisit en des programmes de petites constructions de captages d’eau de pluie et d’irrigation, une restructuration des coopératives agricoles, le support des institutions de micro-finance, l’accès à des packages agricoles à crédit, et enfin, le déploiement de formations des agents gouvernementaux de développement villageois.
Mais la crise alimentaire de 2002/2003 mit en évidence les limites de cette politique n’ayant pas atteint ses objectifs d’autosuffisance et toujours dépendante d’apports conséquents d’aide d’urgence. Passée la crise, reconnaissant l’échec partiel de sa politique conduite jusqu’ici, Meles Zenawi déclara la sécurité alimentaire comme priorité nationale. Une nouvelle coalition pour la Sécurité Alimentaire institua la volonté gouvernementale de s’affranchir de la dépendance de l’aide d’urgence. Jugée éronnée, l’Adli subit un virage radical en s’orientant vers une économie de marché. Elle passa d’une politique pro-pauvre privilégiant les aides individuelles auprès des petits agriculteurs vers un politique plus libérale favorisant les aides aux investisseurs privés et « paysans entrepreneurs ». À partir de 2005, le Pasdep (2005-2010) et le Growth and Transformation Plan GTP (2010-2015) mettent l’accent sur l’implantation de politiques de croissance macroéconomique prônée par l’élargissement » des objectifs de l’Adli au renforcement de la croissance macro-économique à visée exportatrice. L’Adli accentue sa politique d’appui au secteur privé, orientée vers le développement d’industries agricoles à forte intensité de main-d’œuvre et la mécanisation extensive destinées à l’exportation. Le Pasdep accélère les orientations productivistes de l’agriculture extensive, de l’agriculture paysanne « modèle » et des entreprises privées. Le GTP prolonge la politique de développement macroéconomique, en renforçant l’agriculture d’exportation, le développement des ressources naturelles (mines, extraction du pétrole en Ogaden, géothermie, etc.) et des infrastructures routières, ferroviaires et urbaines. Ainsi, grâce à l’appui de capitaux étrangers, le pays a effectivement procédé à un virage économique – donné à voir au travers des chiffres officiels de croissance macro-économique à deux chiffres. L’agriculture de rente à grande échelle destinée à l’exportation (fleurs, coton, épices, etc.) et aux biocarburants a explosé. En parallèle, avec le soutien des partenaires étrangers – dont notamment la Chine – l’État s’est lancé dans des travaux de grande ampleur, comme le réaménagement d’Addis-Abeba, des infrastructures routières et ferroviaires, de barrages au sud du pays et sur le Nil Bleu (Dereje Feyissa, 2011 ; Fouéré et Maupeu, 2016 ; Markakis, 2011). Dorénavant, la stratégie de développement du pays priorise la commercialisation agricole (Planel et Bridonneau, 2015), l’exploitation des ressources énergétiques hydroélectriques et une politique de grands travaux (Fouéré et Maupeu, 2016). Elle vise en 2025 à hisser l’Éthiopie au rang des pays à revenu moyen (Lefort, 2015 a). Inscrite dans le GTP, la production agricole doit dorénavant être guidée par le marché et créer de l’emploi, et ce, à travers l’attraction des investissements étrangers sur la terre, le support aux grandes exploitations et le passage à la grande agriculture mécanisée, ainsi que l’appui aux micro et petites entreprises agricoles. Le développement de l’agriculture commerciale repose sur des fermiers cumulant le « share cropping », la location et les appuis directs et de l’agriculture commerciale à grande échelle impliquant le secteur privé. Fin des années 2000, cinq millions d’hectares de terres étaient déjà loués à des groupes internationaux en bail emphytéotique pour créer de grandes fermes mécanisées sur l’exportation (coton, riz, huile)24. À l’échelle villageoise, le développement agricole repose sur les exploitants en capacité d’intensifier les produits agricoles destinés aux marchés domestiques et à l’exportation, mettant en avant les « investisseurs » et nouveaux entrepreneurs » ruraux et en sélectionnant des « fermiers modèles » (Lefort, 2012). En confiant ainsi la croissance agricole à l’initiative privée et à la commercialisation des produits, « la masse des agriculteurs (est) de fait plus ou moins abandonnée à son sort, en clair, aux lois du marché » (Lefort, 2015b, p. 3).
Ces modes de gestion entrepreunariale se combinent à des programmes d’assistance aux populations plus vulnérables touchant plusieurs millions de personnes : le Food Security Program (FSP), le déplacement de populations ou resettlement, et des programmes nutrionnels. En 2005, le FSP est officiellement lancé pour cinq ans (2005-2010). Il se décline en un filet de sécurité (Productive Safety Net Programme, PSNP) et des apports du Household Asset Building program (HABP) et du Complementary Community Investment (CCI).
L’agriculture « d’agrobusiness » à grande échelle est mise en œuvre sur des terres expropriées par l’État et mises en location à des investisseurs privés étrangers. Structurée depuis 2002 par un dispositif légal avantageant les investisseurs étrangers et par les programmes quinquénnaux de lutte contre la pauvreté, cette politique s’est décuplée à partir de 2007, jusqu’à couvrir près de 3,6 millions d’hectares de terres en 2010, loués principalement à des sociétés indiennes, souadiennes, américaines (Dessalegn Rahmato, 2011).
Le Safety Net (PSNP)
Le PSNP constitue le programme central de la nouvelle politique de sécurité Alimentaire. Il est couplé avec un programme d’appui technique, intitulé Other Food Security Programmes (OFSP), axé sur l’apport de packages agricoles à crédit et la construction de micro-systèmes de captages d’eau et d’irrigation (Gilligan et al., 2008 ; van Uffelen, 2013). Il postule que l’amélioration des revenus et des biens conduira chaque foyer à retrouver une autonomie alimentaire pour être en capacité d’affronter de nouvelles crises. Il apporte un appui pendant six mois aux familles vulnérables par un apport en cash, en nature ou par un apport direct. Mobilisant principalement la Banque mondiale, avec la plupart des donateurs, tels que DFID, USAID, le Pam, CIDA, l’apport financier au PSNP s’estimerait à 1,7 billions jusqu’en 2015 (Dessalegn Rahmato, 2013). C’est le programme de filet social le plus vaste en Afrique. Il initie plusieurs nouveautés : des cycles d’aide programmés sur des périodes de cinq ans, le couplage de l’aide alimentaire avec un apport en cash, l’apport de packages agricoles à crédit. Il implique de distinguer les populations atteintes d’insécurité alimentaire chronique » bénéficiant du PSNP et les populations bénéficiant d’une aide alimentaire d’urgence touchées par les crises « aigües ». Enfin, c’est un programme d’aide graduel, qui prévoit un retrait progressif des familles estimées être sorties de la précarité selon un processus de « graduation » (Dessalegn Rahmato, 2013 ; Planel 2016 ; van Uffelen, 2013).
La première période de 2005 à 2010, ciblant cinq millions de personnes puis huit millions en 2009, a été prolongée jusqu’en 2015 car ses objectifs initiaux n’étaient pas atteints. En 2012, le PSNP s’oriente vers une approche plus transversale, incluant la santé, le social, l’emploi et l’économie. Il est incorporé dans un programme de protection plus large (le National Social Protection Policy) avec l’objectif de se libérer de l’aide internationale par une augmentation de la taxe sociale et d’établir un lien entre la protection sociale formelle et informelle, en particulier les associations et associations coutumières (id.)
Comme dans le cas de l’attribution des programmes d’aide alimentaire, l’aide du PNSP est conditionnée à la participation à des travaux publics d’amélioration des infrastructures locales (routes, écoles, centres de santé, etc.). Ces travaux ne sont pas nouveaux, renouvelant le Food For Work (FFW) des années 1970 puis l’Employment Generation Schemes (EGS) des années 1990. Critiqués pour leurs détournements dédiés à des activités privées, ces travaux collectifs n’avaient jamais obtenu de résultats sur les capacités individuelles, mais étaient plutôt synonymes de travail obligatoire des populations. Pour autant, le principe a été renouvelé, sans qu’il n’y ait eu ni évaluation ni phase pilote (Dessalegn Rahmato, 2013).
En 2010, le PNSP n’est pas parvenu à sortir le nombre prévu de familles de l’insécurité alimentaire. Il est prolongé jusqu’en 2015. En 2014, le gouvernement comptait atteindre l’autosuffisance alimentaire des groupes ciblés (avec 80 % de graduation prévue par le GTP), en visant de passer de huit millions à un million de personnes. Cet objectif est jugé irréaliste par les donateurs qui pensaient devoir encore consolider le programme, allant à l’encontre de l’exigence gouvernementale d’atteindre des résultats rapides en réaménageant le calendrier en décennies plutôt qu’en années (van Uffelen, 2013). Les taux de « graduation » sont beaucoup plus bas qu’attendus, et un grand nombre de familles graduées » sont encore en situation d’insécurité alimentaire. Il s’avère aussi qu’en dépit de l’hétérogénéité des critères de graduation, les officiels resteraient « obsédés » par le respect des quotas à atteindre, incluant des bénéficiaires « gradués » dès lors qu’ils ont pris un crédit, sans tenir compte de leurs capacités de remboursement, ni de l’amélioration de leurs activités et revenus. Le cash serait plus utilisé pour la consommation que pour l’investissement. La graduation est jugée trop rapide et prématurée par les familles « graduées », qui ne seraient parfois même pas informées de leur changement de statut (Aschale Dagnachew Siyoum, 2013). Plus globalement, si les résultats s’avèrent positif en matière d’amélioration à l’accès à la nourriture, aux services et de constitutions de biens, l’impact du PSNP en matière de réduction de la pauvreté est questionnable. Combiné avec les autres programmes agricoles, il n’aurait contribué à augmenter l’autonomie des familles ciblées qu’à environ un mois. Globalement, si on estime que la pauvreté rurale est passée de 40 % (2004) à 30 % (2010), la couverture du PSFP est jugée insuffisante, quand les besoins se monteraient à vingt millions. Il resterait donc toujours insuffisant pour renverser l’insécurité alimentaire, et cela, sans pouvoir ni répondre au défi foncier, ni à celui de la démographie (Dessalegn Rahmato, 2013).
Le resettlement
Démarré en 2003 mais aujourd’hui suspendu, le resettlement était un programme de réinstallation des populations affectées vers des zones fertiles qui visait près de deux millions de personnes. Au début des années 1990, il était déconsidéré à cause de la coercition et des injustices exercées sous le Derg, et de sa mauvaise planification du transfert de populations d’une région à l’autre. Il avait été relancé vers 1996, mettant en avant la dimension « volontaire » des paysans, des déplacements intrarégionaux et une meilleure planification. Il devient la priorité gouvernementale à partir de 2002, en dépit des réticences des donateurs. Une première phase pilote toucha près de 45 000 familles (2002-2003). Elle fut suivie d’une phase d’extension (2004-2006) déplaçant 149 000 familles en régions Amhara, Oromia et en région Sud (Southern Nations, Nationalities’ and Peoples’ Regional State – SNNPRS). En 2008, ce programme est suspendu à cause de son coût élevé (217 millions de dollars), du manque de terres et de la compétition foncière avec les autres programmes agricoles intensifs. Au final, seulement près de la moitié de la population prévue a été déplacée. Il s’avère que ce programme n’a réduit ni la pauvreté, ni l’insécurité alimentaire mais a plutôt déplacé les populations rurales pauvres vers des zones reculées, les marginalisant et les rendant invisibles (Hammond, 2008).
Les programmes nutritionnels
Depuis le début des années 2000, le champ de la nutrition infantile en Éthiopie s’est complètement transformé, évoluant de programmes d’ONG urgentistes de prise en charge thérapeutique à des programmes intégrés au système de santé public géré par le ministère de la Santé. Ces programmes articulent la détection et prise en charge médicalisée de la malnutrition étendue à l’échelle du pays jusqu’à des niveaux « communautaires ». Auparavant, les autorités éthiopiennes étaient réticentes à l’implantation des centres de traitement thérapeutiques gérés par les ONG, qui attiraient l’attention des médias dans un contexte où la visibilité de la malnutrition infantile était encore marquée par les images sensationnalistes des famines des années 1970 et 1980. Ce malaise s’expliquerait également par le fait que ces formes d’intervention et leurs fonds échappaient à l’expertise et au contrôle de l’administration (Jézéquel, 2008). Il fallait négocier terme à terme leur ouvertures, les critères d’admission des enfants, l’emploi des produits thérapeutiques, la capacité d’admission des cas sévères en milieu hospitalier, etc. Mais la sévérité de la crise en 2000 en Ogaden démontra la nécessité d’apporter d’autres réponses que l’aide alimentaire. À partir de 2001, les appels d’urgence annuels commencèrent à intégrer des composantes non alimentaires, telles que l’eau et l’assainissement, l’agriculture, la santé et la nutrition. D’une part, à l’initiative de l’Unicef et du Pam, l’Unité de coordination de nutrition d’urgence (ENCU) est créée à l’intérieur du département d’alerte précoce (aujourd’hui le DRMFSS). Peu visible et manquant de moyens à ses débuts, l’ENCU s’est attelé à contrôler et standardiser les enquêtes nutritionnelles pour créer un centre de données fiables. En charge de la coordination des programmes nutritionnels, il s’est ensuite développé en créant des branches régionales venant en appui aux départements d’alerte précoce. La collaboration avec les agents du SAP a longtemps été houleuse, mettant en compétition le savoirs d’ingénierie agricole des agents du département d’alerte précoce avec le savoir médical des experts nutritionnels, mais aussi le partage des responsabilités et des ressources de l’aide (id.). D’autre part, à partir de 2003-2004, toujours en collaboration avec l’Unicef et le Pam, l’Éthiopie s’est progressivement dotée d’un système de surveillance nutritionnelle et de soutien aux populations vulnérables à la malnutrition (enfants de moins de cinq ans, femmes enceintes ou allaitantes). Il consiste en un programme de dépistage nutritionnel et de vaccination de plusieurs millions d’enfants et de mères (Enhanced Outreach Strategy – EOS) et des programmes de prise en charge thérapeutique (Therapeutic Supplementary Feeding Program – TSFP et Therapeutic Feeding program – TFP) qui apporte les aliments de supplémentation aux femmes et enfants, de façon préventive mais aussi curative de la malnutrition aigüe. L’Éthiopie a été le premier pays d’Afrique subsaharienne à expérimenter les projets de type « communautaire », devenus les Community Management of Acute Malnutrition (CMAM), notamment lors de la crise de 2003, qui fut l’occasion de les expérimenter. Aujourd’hui élargie à l’ensemble du pays, un protocole de traitement de la malnutrition a été adopté en 2007 au niveau national. Le CMAM est fondé sur l’emploi conjugué des composés nutritionnels prêts à être consommés (Ready to Use Therapeutic Food – RUTF) et des modes de prises en charges ambulatoires. Facilitée par l’usage pratique des RUTF et des méthodes de détection rapide de mesure du périmètre brachial (MUAC), cette approche combine la surveillance et la prise en charge de la malnutrition via le réseau des structures de santé locales et des groupes villageois (Jézéquel, 2008). L’approche communautaire s’est accentuée en 2010, avec la création de « community-level development armies » composées de cinq personnes, qui, aux échelles villageoises encadrent 25 à 30 familles (Villanucci et Fantini, 2016). Outre que la CMAM développe des structures plus pérennes et intégrées aux structures nationales de santé, il permettrait à l’administration de mieux contrôler le traitement de la malnutrition et ses ressources associés, ainsi que la question sensible d’image médiatique négative en en « diluant » la visibilité, voire en la contrôlant (Jézéquel, 2008). Enfin, en 2010, la mise en place d’une plate-forme nationale de lutte contre la malnutrition rassemblant plusieurs ministères, agences de l’aide et de la recherche institutionnalise la volonté nationale d’inscrire l’éradication de la malnutrition comme priorité nationale. D’après les chiffres du rapport final MDG, la malnutrition aurait baissé de 2,5 % par an depuis 2000 (MDG, 2013). Enfin, pour donner un ordre de grandeur, en 2015, ce dispositif aurait traité près de 300 000 enfants atteints de malnutrition aigüe dans environ 10 000 centres thérapeutiques, avec 85 % de récupération et 0,2 % de décès (MOH, 2015).
En conclusion
Dégagé des postures historiques de déni des crises pour s’accorder à les reconnaître – voire à les exagérer -, l’État développementaliste affiche une capacité assumée de gestion des crises, ayant pour effet de désamorcer les risques d’emballement médiatique25. Nous assistons à un déploiement de grande envergure de programmes de prévention et de réponses à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle. Ces programmes participent d’un glissement de paradigmes des politiques de sécurité alimentaire : l’un passant des aides d’urgence vers des programmes de développement social, un autre passant des programmes exclusivement basés sur l’aide alimentaire à des programmes étendus de prise en charge de la malnutrition, et un dernier où l’on passe d’une aide individualisée à la petite paysannerie à la valorisation de l’entrepreunariat privé. Fortement teintés par les idéologies de l’aide d’urgence contre celles de l’aide au développement, ces différents programmes – l’aide d’urgence, le PNSP, la prise en charge nutritionnelle et le resettlement – se superposent et se concurrencent à la fois.
Malgré la croissance de l’investissement international et de la production agricole, l’insécurité alimentaire et ses territoires de la faim n’ont cessé de s’étendre, malgré le contexte de forte croissance économique. La réduction de la dépendance à l’aide alimentaire n’est pas encore atteinte, dont le coût dépasse parfois ceux du PSNP. Le nombre de bénéficiaires de l’aide d’urgence est croissant, touchant entre cinq et huit millions (de 2000 à 2002), 12,6 millions en 2003 et sept millions en 2007. L’aide d’urgence a concerné entre deux à trois millions de personnes par an (en 2005 et 2006) et entre quatre et six millions par an (entre 2008 et 2011), sachant qu’à partir de 2005, elle se combine au PSNP, cumulant un apport alimentaire global de l’ordre destiné à sept et dix millions de personnes (2005-2007) puis quatorze et quinze millions de personnes (2008-2009) (Dessalegn Rahmato, 2013). Le maintien de l’aide d’urgence entre en contradiction avec la tendance au développement d’une aide globale dorénavant pensée à plus long terme, orientée vers la recherche de l’autonomie alimentaire et reposant sur la « responsabilisation » des individus. Elle s’impose au gré des crises, se superposant avec le PSNP et le Ressettlement. D’un côté, les partenaires internationaux estiment que le filet social est un système qui s’inscrit dans la durée, voire la continuité à travers un système plus large de protection sociale. De l’autre, le gouvernement postule que la sécurité alimentaire sera atteinte rapidemment grâce à une autosuffisance fondée sur l’agriculture domestique.
Si cette juxtaposition de programmes engendre des frictions et des contradictions, elle révèle toutefois trois grandes tendances dans l’exercice de leur planification. L’une qui consiste à se référer à des critères de ciblage de plus en plus fins et complexes – passant de critères d’insécurité alimentaire globaux à des critères distinguant le « chronique » de « l’aigü », puis à des critères de malnutrition – relevant d’expertises différentes, voire concurrentes. La deuxième qui tend à déboucher sur des indicateurs abstrait et « macro » faisant tous référence, mais invérifiables, tels que les données et courbes de production alimentaire, les taux de graduation du PSNP, le nombre de bénéficiaires de l’aide, les taux de malnutrition, etc. Ces tendances vont dans le même sens que celle des nouveaux Objectifs de développement durable (ODD), dont la démultiplication de critères quantifiés (plus de 200 critères pour 17 objectifs) aboutit à une abstraction bureaucratique extrêmement poussée. Enfin, ces registres formels d’abstraction quantifiée ne permettent ni de penser, et a fortiori, ni de rendre compte des distortions et de leurs effets dans l’application réelle de ces programmes, qu’il s’agisse de ciblages géographiques inégalitaires ou des pressions exercées sur les populations par l’administration lors de leur mise en œuvre. Nous appréhenderons cette invisibilité de la dimension politique (politic) des SAP en la réinscrivant dans les enjeux plus larges de stratégies d’extraversion de l’aide.
Le SAP comme élément de stratégies d’extraversion
Outil « macro » de pilotage, d’évaluation et de représentation des impacts des différents programmes lancés par l’État développementaliste, le SAP, à travers le contrôle des outils de planification constitue une composante des stratégies d’extraversion de l’aide facilitant la centralisation du pouvoir du régime en place. Pour mieux cerner cet enjeu, nous nous référons aux notions de « situation thermidorienne » et « d’extraversion » développées par Jean-François Bayart (2008 et 1999).
Sortant d’une phase de transition post-révolutionnaire et d’ouverture à la libéralisation économique et de démocratisation dans un contexte de globalisation néo-libérale, le régime éthiopien s’apparente une situation que Jean-François Bayart (2008) qualifie de « thermidorisme contemporain »26. Cette situation se caractérise notamment par trois points saillants. Les deux premiers sont relatifs à la monopolisation du pouvoir et de l’économie par l’élite « thermidorienne » – les membres du parti de l’EPRDF : la démocratisation y procède de faux-semblants en « trompe-l’œil », où derrière les apparences du multipartisme, l’État-parti annihile tout contre pouvoir et annule toute impartialité administrative. Par ailleurs, l’élite politique de l’EPRDF s’accapare l’économie du pays, où la privatisation de l’État » procède d’une mise en concession de l’économie nationale articulée autour de réseaux clientélistes liant les dirigeants aux conglomérats bénéficiaires. Le dernier point est relatif aux liens étroits entretenus avec les agences de l’aide internationale.
En premier lieu, revenons sur la montée de la classe thermidorienne de l’EPRDF. Après la chute de la junte militaire en 1991, les anciens maquisards, regroupés sous l’égide du Front démocratique révolutionnaire des peuples éthiopiens (Ethiopian People’s Revolutionnary Democratic Front, EPRDF) et de son leader Meles Zenawi, ont instauré un État ethno-fédéral inédit, en s’engageant vers la décentralisation politique, la libéralisation économique et le multipartisme. Fondée en 1989, 26 Jean-François Bayart se réfère à la période historique thermidorienne de la France de 1794-1799, mettant fin au gouvernement révolutionnaire et marquée par le retour d’une république bourgeoise, libérale et réactionnaire. S’appuyant sur les cas concrets du Cambodge et de l’Iran, il démontre comment, dans ces « situations thermidoriennes », l’ouverture l’économie mondiale participe d’une stratégie ambivalente de transformation d’une élite politique issue de la révolution – dans notre cas, porteuse d’une idéologie révolutionnaire – en classe politique dominante. S’inscrivant dans la perpétuation de l’idéologie révolutionnaire, elle passe du registre de l’utopie mobilisatrice révolutionnaire à celui de la raison gestionnaire. Elle couple l’accumulation du pouvoir et du capital selon la procédure classique de chevauchement » entre les positions de pouvoir et les positions d’accumulation économique (Bayart, 2008).
l’EPRDF est une coalition de plusieurs organisations27, qui sert de faire-valoir au Front populaire de libération du Tigré (Tigray People’s Liberation Front, TPLF), l’un des principaux mouvements de guérilla contre le Derg, dont Meles Zenawi est alors président, tout en lui conférant l’apparence de l’ouverture et de démocratie (Fontrier, 2012). Aujourd’hui, le TPLF contrôle les principaux instruments de pouvoir, dont la sécurité, l’armée et les services de renseignements (Bach, 2016), de telle sorte qu’il est considéré comme l’oligarchie dirigeante de l’EPRDF (Chinigò et Fantini, 2015). Guidés par une idéologie hybride de « démocratie révolutionnaire », sorte de bricolage normatif mixant principes du marxisme-léninisme et du libéralisme (Bach, 2011), les cadres de l’EPRDF s’orientent vers des politiques pro-poor de lutte contre la pauvreté, qui doivent émerger de la base tout en restant encadrées par l’État (Planel, 2015 et 2016). Si le nouveau régime s’engage à amorcer les processus de libéralisation économique et politique, il s’avère que derrière cet affichage, le Parti suit le fil conducteur de l’autoritarisme tracé dès les années 1990 par ses visées hégémoniques (Bach, 2016). Il renouvelle ainsi les traditions autocratiques et centralisées des régimes précédents – certes selon des méthodes jugées moins brutales – mais qui consistent en un détournement des dispositifs et des processus démocratiques, tout en affinant le contrôle bureaucratique des populations (Dereje Feyissa, 2011).