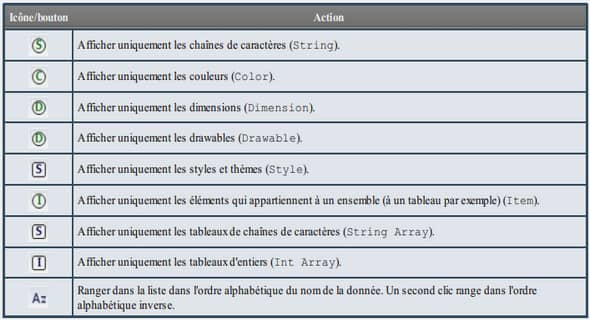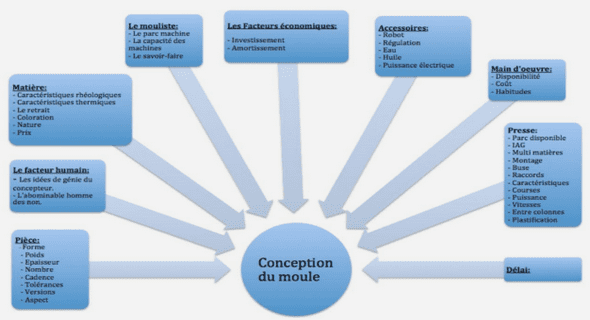L’émancipation urbaine de la fin du XIIe siècle au début du XIVe siècle
Il n’est guère étonnant que cette période ait particulièrement retenu l’attention des historiens, puisque c’est au cours du XIIIe siècle qu’Erfurt connut un changement et une transformation progressive de sa position face à l’archevêque, avec le gain d’un degré de liberté de plus en plus important4. Au XIIe siècle, on assista à la mise en place du Conseil de ville et à un premier accroissement des pouvoirs de la ville, qui joua notamment un jeu politique subtil entre les archevêques, la noblesse régionale et les empereurs successifs. La construction d’un gouvernement urbain n’alla pas sans heurts ni conflits tant internes qu’externes : un premier interdit frappa la ville entre 1241 et 1244 (lancé par l’archevêque Siegfried III). Les rapports de pouvoirs entre les différents groupes urbains intéressés au gouvernement évoluèrent également. On peut considérer qu’un Conseil de ville fut fermement établi au mitan du siècle (dans les années 1248-1252) ; profitant des luttes entre l’archevêque et les Hohenstaufen, les bourgeois de la ville s’émancipèrent des ministériaux archiépiscopaux – avoué, écoutête, chancelier et échanson1. A la fin du Moyen Age, il ne restait en ville qu’un avoué agissant en théorie pour le compte de l’archevêque mais dont le rôle était limité, et un procureur qui présidait la cour archiépiscopale et avait des fonctions judiciaires et fiscales.
La ville fonctionna dès lors comme une institution autonome de prise de décision, dotée de son propre sceau attesté en 1220. Celui-ci néanmoins conservait les marques du lien à Mayence : Martin, le patron de la ville et de l’archevêché, trône sous des voûtes romanes, tenant la crosse épiscopale dans la main gauche et faisant un geste de bénédiction de la main droite. L’inscription « Erfordia fidelis est filia Mogontine sedis » proclamait en outre la volonté de paix et de soumission de la ville envers un seigneur ecclésiastique. La mitre fut ajoutée sur le sceau autour de 1250, ainsi que des ornements sur les éléments d’architecture encadrant Martin. Les mêmes motifs étaient utilisés sur le petit sceau de la ville, qui servit à partir des années 1350 pour les documents de moindre importance2.
Les ambitions du Conseil à exercer un pouvoir unique et autonome en ville conduisirent à de nouveaux affrontements avec l’archevêque, en particulier sous l’épiscopat de Werner (1259-1284). Le conflit culmina en 1279, lorsque l’archevêque Werner répondit aux ambitions politiques urbaines par une arme non plus politique et temporelle mais spirituelle : il frappa la ville d’un interdit qui ne fut levé qu’en 1282 et que les historiographes postérieurs qualifièrent d’« affreux interdit » (furchtbares Interdikt)3.
La fin de cet interdit ne signifia pas la fin des conflits ; ils ne furent réglés de façon plus pérenne qu’en 1289 avec la rédaction de la Concordata Gerhardi avec l’archevêque Gerhard II par laquelle, outre le pardon des offenses qui avaient motivé l’interdit, Gerhard accordait de nombreux droits à la ville. Le traité fut préparé par deux actes dont l’un concédait à la ville le droit de battre monnaie, d’administrer le marché et les deux offices d’écoutêtes, pour six ans, en échange de 800 marcs d’argent1, et l’autre établissait l’affermage des offices ministériaux au Conseil d’Erfurt qui devait en confier l’exercice annuellement à des bourgeois de la ville2. Là encore l’affermage était prévu pour six ans ; les dettes de l’archevêque néanmoins assurèrent la reconduction de cet affermage jusqu’en 1305 sans interruption.
La Concordata Gerhardi à proprement parler fut établie en novembre 1289 et prit la forme d’un long traité, rédigé en allemand, de cinquante-cinq articles concernant la juridiction (articles 1 et 2), le droit du Freizins (3 à 9), le droit de battre monnaie (10 à 39), les droits de douane (40 à 50) et de marché (52 à 54) et les attributions des deux écoutêtes, pour la ville et le faubourg du Brühl (55)3. Le texte délimitait les droits de l’archevêque, de ses officiers et du Conseil, à l’appui souvent de textes plus anciens auxquels la Concordata faisait référence. L’archevêque se réservait notamment le lucratif droit de découpe des draps et la haute justice (tandis que le Conseil était compétent pour les questions d’héritage, de dettes, de monnaie, de commerce et d’ordre public).
Les luttes internes à la ville
L’affrontement de la ville contre son archevêque ne se fit pas non plus dans la concorde interne et la construction d’un privilège erfurtois ne doit pas masquer les luttes entre différents groupes urbains, luttes dont l’enjeu était essentiellement la participation au pouvoir décisionnel nouvellement acquis. Ces oppositions propres à la commune apparurent dès le début du processus d’émancipation, dès lors que la première étape, la constitution d’un Conseil de ville doté de pouvoirs bien délimités, fut terminée. Le Conseil était un enjeu de pouvoir interne à la ville et non plus seulement un enjeu d’accroissement de la distance envers le seigneur archevêque. Un nouvel ordo du Conseil fut écrit en 1255. Il établissait la liste des familles ayant la capacité consulaire1 (une trentaine) et élargissait ce faisant la participation au Conseil, notamment en direction des tailleurs et des tisserands2. Ces familles étaient désignées sous le nom de Gefrundete, les Amis, et Geschlechte, les lignages. Les fonctions occupées au sein du Conseil et de l’administration urbaine étaient en revanche indiquées en latin.
Cette ouverture du Conseil était le résultat des crises avec l’archevêque : les familles exclues du Conseil avaient utilisé la situation afin de modifier les rapports de force internes à la ville, comme cela fut le cas dans d’autres villes de l’Empire, telles Spire ou Cologne3.
Les luttes face à l’archevêque furent aussi l’occasion d’une remise en cause interne à la ville de la légitimité des familles consulaires4 à détenir, seules, l’autorité sur la commune.
La situation d’interdit en particulier déclencha un vif mécontentement des habitants face à leurs élites politiques et la perte d’influence d’une partie de ces familles consulaires. Les marchands et artisans y entrèrent plus largement après une révolte, en 1283, qui aboutit à l’élargissement du Conseil (dix sièges furent ajoutés). A partir de 1310 la commune prit part au processus de vote. Mais ces changements ne provoquèrent pas, contrairement à 1255, de modifications véritables dans la composition sociale de la couche dirigeante. En effet, les membres du Conseil apparaissaient toujours comme très nettement séparés du reste des bourgeois, et les Gefrundete, membres les plus anciens, restèrent les plus influents, se réservant les postes les plus prestigieux et les plus importants au sein du Conseil. Ils formaient un groupe urbain à part grâce à leur communauté d’intérêts et de manière de vivre, leur sociabilité fermée, leurs liens économiques et matrimoniaux5.
De la discontinuité à la rupture
Ce Conseil acquis progressivement des droits variés, celui de battre monnaie, celui d’organiser les métiers, celui de gérer la communauté juive, celui de rendre la justice, des droits de police notamment sur les marchés, des droits de douane, des droits fiscaux.
Le Conseil de ville acquit également progressivement des compétences et droits en matière de monnaie1. Erfurt abritait un atelier monétaire depuis le XIe siècle et des frappes eurent lieu en ville sans interruption tout au long du Moyen Age2. Le droit de battre monnaie passa des archevêques au Conseil en 1354. La ville produisit essentiellement des pièces de faible valeur, des Pfennige ou Scherfen, qui servaient avant tout au petit commerce quotidien plus qu’au négoce lointain3. La première production de Groschen eut lieu en 1465 sous la forme d’un re-marquage de pièces étrangères pour en faire des pièces locales. L’action fut entreprise en lien avec Mühlhausen et Nordhausen4. Cette action fut répétée en 1468, en même temps qu’un premier Groschen erfurtois était frappé par la ville5. La production de petites pièces ne cessa pas pour autant ; des Pfennige furent frappés à huit reprises et des Scherfen à quatorze reprises dans les trente dernières années du XVe siècle. La frappe de la monnaie était aussi liée à la fiscalité et en particulier à la taxation des parcelles et à la perception du cens de l’archevêque comme propriétaire éminent du sol6.
La ville parvint donc à se ménager un régime particulier qui en faisait une exception au sein du territoire de l’archevêque et la distinguait du droit ordinaire. Cette discontinuité juridique doublait alors la discontinuité topographique qui caractérisait la ville. Certes l’Electorat dans son ensemble, comme tous les territoires de l’Empire, était morcelé et archipélagique. Mais au sein de cet espace discontinu, l’éloignement et l’isolement le plus grand était celui de la ville d’Erfurt qui formait l’un des deux points les plus extrêmes au nord-est de l’ensemble, à environ 285 kilomètres de Mayence et environ 85 kilomètres des villes de l’Eichsfeld, l’ensemble territorial mayençais le plus proche d’Erfurt1. L’exclave territoriale devint ainsi également une exclave juridique. Cette rupture est certes à nuancer, en ce qu’elle était somme toute très ordinaire dans un Empire marqué par l’enchevêtrement des territoires, mais aussi dans un monde médiéval où l’enchevêtrement des droits et le feuilletage des autorités étaient très forts. Ce pluralisme légal et cet empilement grandissant caractérisaient aussi l’Empire moderne commençant. Les nouveaux droits s’ajoutaient plus qu’ils ne supprimaient les anciens ; c’était moins un renouvellement ou un changement que des ajouts permanents qui faisaient du territoire un palimpseste, projection foncière des palimpsestes rangés à l’abri des archives.
Néanmoins, le cas est unique à l’intérieur de l’Electorat. En outre, cette situation d’empilement de droits multiples et parfois contradictoire, et la construction d’une situation exceptionnelle et hors du cadre normal du territoire, furent sources d’un affrontement de plus en plus violent entre la ville et l’archevêque à la fin du Moyen Age.
Toute exclave que la ville pût être, elle demeurait en effet dans la souveraineté de l’archevêque, dont la marque la plus visible était la perception du Freizins sur de multiples parcelles de la ville. Le Freizins était le cens recognitif de l’autorité de l’archevêque sur le sol. Il avait été introduit par l’archevêque Adalbert Ier autour des années 1116-11202. Dans le même mouvement de prélèvement, ce cens reconnaissait la liberté de certaines parcelles (comme le montrait le nom de la taxe, Freizins) et rappelait que la liberté ne pouvait être accordée que par le seigneur-archevêque (« de manu archiepiscopali »). On possède une ordonnance de 1495 qui détaillait les modalités de versement du cens3.
Le cens lui était versé à la Saint-Pierre-et-Paul, le 29 juin, en deux endroits de la ville suivant la localisation des parcelles concernées, soit à la cour de l’archevêque près de la cathédrale Sainte-Marie, soit à l’église des Marchands sur l’Anger, la place du marché à la guède qui formait le centre économique de la ville. Toutes les parcelles cependant n’étaient pas soumises au Freizins4. Ce cens a donné lieu à la production de la plus importante série d’archives erfurtoise, les Freizinsregister, dont 350 volumes nous sont parvenus pour la période allant de la fin du XIIIe siècle à la fin du XVIIe siècle1.
La complexité de ces rapports entre la ville et l’archevêque était clairement manifestée par le rituel d’entrée de chaque nouvel archevêque en ville, variation sur la cérémonie de l’accueil d’un seigneur par ses sujets dans laquelle on pouvait lire le renversement des rapports de force2. Ce n’était plus le seigneur qui venait recevoir l’hommage de sa ville sujette et soumise, mais deux partenaires égaux en force qui se reconnaissaient mutuellement des droits. L’ordre du rituel faisait même de la ville le seigneur puisque c’était l’archevêque qui devait lui prêter serment, et devait le faire en premier, avant de recevoir l’hommage de la ville. Accueilli lors de sa première visite à Erfurt par le Conseil, il jurait de conserver à la ville tous ses privilèges en utilisant les mêmes mots que les conseillers lors de leur entrée en fonction : « das wir unsern hern dem bischof von Mencz, unserm hern dem greffen, unserm hern dem viczthumben, der stad zu erfurt und den burgern, richen und armen, ire rechte behalten ane allerley ubel liste, also ferre, als wir das wissen und vermogen »3.
Après 1440 et l’élection de Dietrich d’Erbach, les archevêques se dispensèrent de ce rituel et ne revinrent plus dans la ville d’Erfurt avant deux siècles4. Cet évitement de la ville montre à la fois la désapprobation des archevêques successifs face à l’évolution politique de la ville et son détachement de l’Electorat, mais aussi leur impuissance à y répondre, à asseoir de nouveau leur souveraineté sur la ville et à la faire reconnaître par les bourgeois. Ceux-ci se contentèrent de l’envoi d’une lettre par laquelle ils reconnaissaient l’élection du nouvel archevêque et demandaient la confirmation des privilèges accordés par les prédécesseurs ainsi que des fiefs que la ville tenait. Des lettres semblables étaient envoyées à tous les hommes qui, par élection ou succession dynastique, devenaient seigneurs de fiefs tenus par la ville ou membres d’alliances et traités impliquant la ville1.