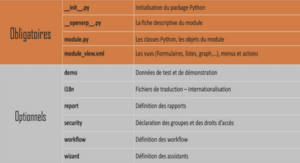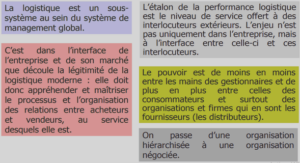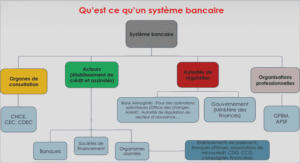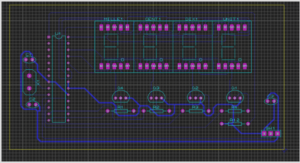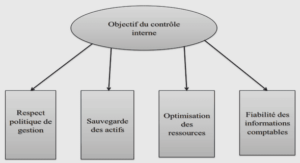Lancement de la mobilisation contre les projets d’incinérateurs et politisation de la lutte.
D’après la sociologue Isabelle Hajek, qui a soutenu en 2008 une thèse sur la mobilisation contre l’incinération à Marseille, la contestation apparaît au moment de l’élaboration par le Conseil Général du schéma départemental d’élimination des déchets ménagers 325. Pourquoi ce moment, avec le Conseil Général et pas avant, avec la ville de Marseille ? Je n’ai pas de certitude à ce sujet mais peux avancer plusieurs éléments. D’après les articles de presse que j’ai pu trouver, le Conseil Général est le premier à communiquer sur la question des déchets.
Il met ainsi en avant son action :
S’il reste encore beaucoup de points à régler, notamment sur le partage du financement entre les différentes collectivités, l’État et la CEE, le problème du traitement des déchets dans ce département semble en bonne voie de résolution. Grâce au vote d’un schéma départemental adopté par le Conseil Général. (…) »Il y a urgence, note Lucien Weygand, le président de l’assemblée, et nous devons manifester à cet égard une solidarité totale » » 326
Or, en 1993, les projets d’incinérateurs de Vigouroux ne sont pas encore rendus publics.
L’action du Conseil Général, quoique postérieure à celle de Vigouroux, l’a donc devancé sur la scène publique et a vraisemblablement contribué à attirer l’attention des journalistes et des associations. « Le débat reste feutré, technique, et financier. Mais que font les écolos ? », demandent en juillet 1993 deux journalistes qui enquêtent sur la décharge de Marseille et l’appel d’offre de Vigouroux. Quatre mois plus tard, les mêmes journalistes publient un article attestant que la contestation a bien été attisée par l’opacité des dossiers que justifie le sceau du secret commercial : Le dossier des déchets est classé confidentiel en mairie. Pas de reportage photo à Entressen, pas de communication sur les propositions en cours. Une procédure contestée par les écologistes. « Même si nous respectons la nécessité de secret industriel, dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres, souligne Robert Fidenti, conseiller régional Génération Écologie, nous pensons que le maire a un devoir de transparence envers ses administrés. Il est plus facile d’obtenir l’adhésion du public s’il a été associé au choix » » 327
Découvrir que le pouvoir tenait secret des projets menaçants est encore la meilleure façon de lancer les machines de guerres. Surtout si l’on tient compte des précédents locaux. La mobilisation contre les projets d’incinérateurs marseillais ressemble en cela au conflit contre le TGV Méditerranée (ligne Valence-Marseille), qui lui est contemporain (1990-1996). Ce dernier a en effet été déclenché en décembre 1989 suite à la fuite d’une carte illustrant le tracé des voies prévues d’ailleurs connectés puisque l’on y retrouvera certains acteurs identiques. En premier lieu desquels Jean-Claude Gaudin, alors président du Conseil Régional PACA et candidat à la mairie de Marseille. Or Jean-Claude Gaudin réservera le même usage politique au TGV Méditerranée qu’aux incinérateurs marseillais. Il en fait un tremplin pour les municipales.
Analysant le débat public organisé pour le TGV Méditerranée, Philippe Subra fait ainsi remarquer que Jean-Claude Gaudin n’a pas hésité « à pratiquer le grand écart, voire le double langage, en soutenant en même temps la réalisation de l’infrastructure (en tant que candidat à la mairie de Marseille) et ceux qui combattent ses nuisances (en tant que patron de la droite régionale) » 329. Du côté des opposants, l’expérience acquise contre le conflit du TGV Méditerranée profitera également contre l’incinérateur par le biais d’un collectif associatif qui se révèlera très présent sur l’un et l’autre dossier. Il s’agit de la Fédération d’actions régionales pour l’environnement (FARE SUD), créée fin 1991 pour organiser la contestation et « éduquer les associations locales à l’intérêt général » 330.
Comment devenir anti-incinérateur
Témoignage de M. Patrick Sibon, ancien président du Comité d’Intérêt de Quartier (CIQ) La Barasse et président de l’association de défense de l’Environnement du 11ème arrondissement à Marseille. M. Sibon s’est battu contre le projet d’incinérateur dans les quartiers est de Marseille, à Saint-Menet.
J’habite à 60m de l’Huveaune, (…) au milieu de la vallée, il y a une colline verte qui appartenait à Pechiney (transformation de la bauxite en alumine), sur laquelle ils voulaient construire l’incinérateur de Marseille. Pechiney n’existe plus, c’est un terrain vague. Notre maison est faite des briques qui appartenaient aux fours de Pechiney.
On a vu arriver le danger incinération. On a fait des réunions. Moi, je n’avais pas d’avis. Le déclic ça a été à Nice, lors d’un congrès d’environnement. J’ai rencontré par hasard un gars qui construisait des incinérateurs. Il m’a parlé de tous les problèmes qu’il avait en construisant des incinérateurs : pour le traitement de fumées, des refioms [suie qui est recueillie par le filtrage des fumées dans la cheminée des incinérateurs] qu’on ne mettait pas directement sous les routes mais qu’il fallait laver à l’eau… Après j’ai rencontré une autre personne. Ça m’a conforté dans l’idée qu’il ne valait mieux pas de ça chez nous, ni ailleurs. Le projet existait sous Vigouroux. Dans le plan à l’époque, il y avait cinq projets d’incinérateurs, et même pas de recyclage. Je suis devenu en plus président du CIQ. J’ai été élu à une voix, à bulletin secret. C’est incroyable le monde qu’on a eu aux premières réunions du CIQ. Un type a commencé par dire « Moi je suis pour l’incinérateur », ça a provoqué un tollé. A la fin il était toujours pour l’incinérateur, mais pas en ville » 331
Autre élément : avec l’entrée en scène du Conseil Général, la lutte est déjà politique. On comprend mieux pourquoi les projets de Vigouroux sont découplés de ceux du Conseil Général et de la préfecture si l’on rappelle que le maire de Marseille est un ex-socialiste, radié du PS, qui a en face de lui un Conseil Général socialiste et la préfecture d’un gouvernement socialiste. Un parti socialiste local qui est devenu acéphale depuis la mort de Defferre, et a été humilié par l’élection de Vigouroux en 1989, puisqu’il n’a eu que cinq élus au conseil municipal sur 105 sièges, alors même qu’il s’était allié au parti communiste. Les élections municipales sont dans deux ans et c’est précisément le président du Conseil Général, M. Lucien Weygand, qui mènera la liste PS aux municipales de Marseille. On peut donc interpréter l’épisode du schéma départemental – et les réserves de Lucien Weygand laissant entendre que le schéma du Conseil Général n’est pas vraiment partisan de l’incinération – comme une manière de se placer en bonne position pour les municipales. Une façon de se mettre en valeur et d’embarrasser son adversaire transfuge dans une période de fortes tensions au sein de la gauche. Par ailleurs, 1993 est l’année des élections législatives. Leur résultat bouleverse l’échiquier politique. La droite rafle 81,8 % des sièges de l’Assemblée. Peu avant les élections, le premier ministre socialiste Bérégovoy se suicide en mars. Le gouvernement passe à droite. Édouard Balladur est nommé premier ministre par Mitterrand. Conséquence probable de l’actualité politique nationale dans les Bouches-du-Rhône : le préfet Claude Bussière, proche des milieux socialistes (il a été directeur de cabinet de Gaston Defferre quand celui-ci était ministre de l’Intérieur) est remplacé en octobre 1993 par Hubert Blanc, plutôt lié aux hommes politiques de droite. On peut donc penser qu’à partir de cette date, le Conseil Général n’a plus tout à fait les mêmes relations avec la préfecture. Il n’y a donc pas que les clivages au sein de la gauche qui rendent, dès 93, le dossier des incinérateurs politique. Forte de son succès aux législatives, la droite marseillaise est aussi en train de batailler contre les projets d’incinérateurs. Comme le rappelle le militant anti-incinération Jean Reynaud : « En 93, je travaillais avec M. Robert Assante dans le même but, pour casser le projet Vigouroux d’incinérateurs à Marseille » 332.
Les élections municipales permettent l’abandon du projet d’incinérateur à Saint-Menet.
Alors qu’il avait été élu triomphalement, Vigouroux ne se représente même pas aux municipales. Son camp est divisé contre lui-même et la gauche marseillaise est elle-même fragmentée. Entre autres raisons, il y a l’irruption de Bernard Tapie aux élections régionales de 1992, face à Jean-Claude Gaudin et Jean-Marie Le Pen. Tapie qui est déclaré inéligible pour les municipales, suite à sa condamnation pour corruption dans une affaire liée au club de football de l’Olympique de Marseille, qu’il dirige. Dans la lignée des législatives de 1993, la droite gagne les deux élections de l’année 95 : au niveau national, Jacques Chirac est élu président de la République et un mois plus tard au niveau local, Jean-Claude Gaudin devient maire de Marseille, mais de justesse. La liste conduite par le socialiste Lucien Weygand obtient 544 voix de plus que celle de Jean-Claude Gaudin, mais le découpage électoral de Marseille est tel que c’est ce dernier qui l’emporte, avec 55 élus au conseil municipal, contre 37 pour la gauche 333. C’est désormais Robert Assante qui va gérer le problème des déchets, tant pour la ville de Marseille que pour la communauté de communes Marseille Provence Métropole, qui comprend désormais 14 communes. Dans la presse, Jean-Claude Gaudin annonce qu’il abandonne le projet d’incinérateur des quartiers Est. Mais au-delà des bénéfices immédiats d’un tel effet d’annonce, il faudra attendre 1997 pour que le projet soit officiellement abandonné en annulant l’appel d’offre, attribué trois ans plus tôt. Revenant sur cet abandon, Robert Assante précise : « A Marseille il y avait deux projets. Celui à l’est, on ne comprenait pas bien pourquoi. C’était dans un milieu un peu naturel » 334. Au bord d’un cours d’eau en effet, ce qui posait – outre la contestation et les promesses électorales – un problème plus ironique relevé par les techniciens des services de l’équipement et de l’environnement : le projet d’incinérateur était en zone inondable. A quoi viennent s’ajouter un taux de recyclage jugé insuffisant par les techniciens (11%), une critique des mouvements écologistes sur la surcapacité de l’installation, mais aussi, un scandale national frappant les incinérateurs, que nous verrons ci-dessous. Quid de l’incinérateur dans les quartiers nord ? Des quartiers traditionnellement communistes, qui n’ont donc pas voté pour l’équipe Gaudin ? Si la droite s’est battue contre les projets d’incinérateurs pendant la campagne électorale, force est de constater qu’elle n’a honoré ses prises de positions qu’à moitié. Le changement de municipalité a plutôt donné un sérieux coup de frein aux projets. « Quand Gaudin a repris la Mairie, c’est resté un certain temps, plusieurs années à mon avis. On savait plus ce que devenait ce projet. Plus rien ne se décidait », explique M. Christian Caroz, ingénieur de l’Ademe spécialiste de la gestion des déchets et conseiller municipal divers gauche (Convention Citoyenne) de Martigues 335. Il faudra effectivement attendre deux ans avant d’en savoir plus.
1996-98. Au niveau national, le lancement du scandale des dioxines conduit à l’abandon de la politique du « tout-incinération », un an après le changement de gouvernement.
En juin 1996, la revue Décision Environnement titre « La dioxine sur le grill » et en septembre, le magazine 60 millions de consommateurs se fait plus explicite : « Alerte aux dioxines dans le lait ». Pour la première fois en France, les dioxines sont liées aux incinérateurs, et plus seulement à l’accident de Seveso 336. C’est le début d’un scandale qui relaie une alerte, lancée dès le mois de mai par des militants de Greenpeace 337. Le législateur a fermé les yeux sur la question des dioxines. Aucun texte de loi national ne réglemente ni ne mentionne explicitement les dioxines. Les directives européennes de 1989, transcrites en 1991, qui préconisaient des mesures de réduction de la pollution atmosphérique des incinérateurs, ne parlent ni des dioxines, ni des oxydes d’azote « alors même que d’autres pays (voir le cas des Pays -Bas) ont déjà établi à cette date des normes sévères concernant ces polluants » 338. Les pouvoirs publics se renseignent, mais discrètement. D’après le rapport Buclet, en 1991, le professeur Jean-François Narbonne, alors président du comité interministériel sur les dioxines, rend un rapport qui n’aurait jamais vu le jour, sous la pression des industriels. Le 16 décembre 1994, une directive européenne préconise de fixer une valeur limite de 0,1 ng de dioxines et furanes par mètre cube de fumée, mais pour les seuls incinérateurs de déchets industriels (article 7.2). Quand cette directive est transcrite en droit français par l’arrêté ministériel du 10 octobre 1996, la valeur limite disparaît. L’unique phrase sur les dioxines est triviale : Pour les mesures de dioxines et furannes, l’inspecteur des installations classées doit s’assurer que la limite de détection pour l’échantillonnage et l’analyse de chaque dioxine et furanne est suffisamment basse pour permettre d’obtenir un résultat significatif en termes d’équivalents toxiques » (article 7)
Même chose le 24 février 1997, quand une circulaire du ministère de l’environnement demande aux préfets d’appliquer aux nouveaux incinérateurs d’ordures ménagères les normes relatives aux incinérateurs de déchets industriels. Aucune mention de valeur limite. En fait, la valeur limite n’apparaîtra en droit français qu’en 2002, dans la foulée d’une directive européenne plus précise et plus exigeante. Aujourd’hui encore, un document sur le site internet du ministère de l’Environnement prétend le contraire. Intitulé « réglementation des installations d’incinération de déchets » et facilement accessible en ligne, cet article affirme que la norme des 0,1 ng/m3 date de 1996 pour les incinérateurs de déchets industriels et de 1997 pour les nouveaux incinérateurs de déchets ménagers, rachetant ainsi à peu de frais six années de frilosité des pouvoirs publics. Quand le scandale des dioxines est lancé, il n’y a donc aucune réglementation spécifique en France. Le 2 juin 1997, le gouvernement change et passe à gauche. Après la dissolution de l’Assemblée Nationale effectuée par Jacques Chirac, qui a eu la mauvaise surprise de voir la gauche remporter les élections législatives anticipées, Lionel Jospin remplace Alain Juppé au poste de Premier Ministre et nomme l’écologiste Dominique Voynet, ministre de l’Environnement. À ce moment, l’État est accusé de laxisme. L’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) vient de classer les dioxines dans la liste des produits cancérigènes. L’affaire des dioxines en rappelle une autre : « Après l’amiante : un nouveau scandale. Alerte aux dioxines », annonce un article du Nouvel Observateur, le 19 juin. Dès lors, la contestation s’intensifie. En juillet, des articles parus dans Le Point, Les Échos, Libération et La Provence dénoncent les conditions de fonctionnement de 40 incinérateurs, jugés hors-la-loi. Le 28 septembre, la lutte contre l’incinération s’organise avec la constitution du CNIID, le Centre National d’Information Indépendante sur les Déchets, fondé par Pierre-Emmanuel Neurhor, un ancien de Greenpeace. Le 31 mars 1998, des dioxines sont trouvées dans le lait de vaches vivant à proximité des incinérateurs de Halluin, Wasquehal et Séquedin dans le Nord. Le ministère de l’environnement ne tarde pas à réagir. Les plans départementaux d’élimination des déchets ménagers lancés par la loi Lalonde-Royal de 1992 étant en pratique trop favorables à l’incinération (78% des investissements prévus 339), la circulaire Voynet du 28 avril 1998 veut rééquilibrer la situation, mettre l’action sur la réduction des déchets à la source et donner plus de place au recyclage. Des consignes sont données en ce sens aux préfets. « Coup d’arrêt à l’incinération », proclame la presse, qui annonce avec enthousiasme « un changement de cap dans la politique de gestion des déchets ». Un enthousiasme qui, avec le recul, est attaqué par l’élu marseillais délégué à la propreté de la ville : « la Directive Voynet dit qu’il faut valoriser 50% des déchets, mais il n’y a jamais eu le moindre moratoire contre les incinérateurs. C’est pendant Voynet qu’il y a eu le plus d’incinérateurs dans ce pays », affirme Robert Assante en 2008 340. Notez que M. Assante emploie le terme « valoriser » et non « recycler », comme le fait la circulaire. Déformation professionnelle, en quelque sorte, car la « valorisation » est, dans le jargon technique, le nom « propre » de l’incinération.
Législatives. Marseille croit avoir trouvé la solution pour ses déchets.
Le 27 janvier 1997, c’est-à-dire à quelques mois des législatives, le Conseil Municipal de Marseille annule les procédures d’appel d’offre lancées par Vigouroux pour les deux incinérateurs, au motif que « l’appel d’offres pour deux incinérateurs aurait donné lieu à une interminable querelle juridique » 341. Les deux entreprises ont en effet été retenues officieusement en avril 1994, mais sans passation de marché. Il n’est pas non plus impossible que tous les changements de noms des sociétés, évoqués ci-dessus dans la partie 1992-1994, n’y soient pas pour quelque chose dans l’annulation des appels d’offres. « L’erreur de Vigouroux a été de ne pas signer l’attribution de marché. La part de valorisation n’était que de 10%, ça a été facile pour nous de l’attaquer », commente Robert Assante 342. Un nouvel appel d’offre est alors publié. Anticipant de peu la circulaire Voynet, Jean-Claude Gaudin présente le 7 avril 1998 son projet à Dominique Voynet 343. Il n’y a plus qu’un incinérateur prévu dans les quartiers nord.
Le point de vue de Dominique Voynet
Répondant aux questions d’un journaliste 344, Dominique Voynet avance une autre lecture de cet épisode : Quand le maire de Marseille dit que je l’ai autorisé à mettre un incinérateur dans les quartiers nord, il abuse. Ne serait-ce que parce qu’il n’a jamais déposé de dossier qui serait venu jusqu’à moi… et que ce n’était pas dans mes attributions.
Pourtant, Jean-Claude Gaudin a évoqué le sujet avec vous a plusieurs reprises…
Effectivement, en quelques occasions, il a cherché une caution écolo. Mais entre évoquer un sujet et obtenir une approbation, il y a plus qu’un gouffre… »
La part d’incinération du nouveau projet a été revue à la baisse. Ce sera 50% d’incinération / 50% de recyclage. « Marseille fait le pari du civisme écologique », annonce un journaliste du Monde dans le même élan d’enthousiasme qui accompagne la publication de la directive Voynet. Relayant les propos des élus, le journaliste témoigne de l’état d’esprit régnant dans ce court laps de temps pendant lequel Marseille pensait résoudre enfin le problème de ses déchets : » Un pari ambitieux « , selon Jean-Claude Gaudin, dans une ville longtemps réputée sale et peu soucieuse d’écologie; aujourd’hui, 5 % seulement des déchets ménagers marseillais sont recyclés. » Je propose aux Marseillais de relever le défi de l’environnement, lance Robert Assante, adjoint au maire, délégué à l’environnement. Et si, dans vingt ans, la construction d’un deuxième incinérateur apparaît indispensable, c’est que les Marseillais n’auront pas joué le jeu » » 345