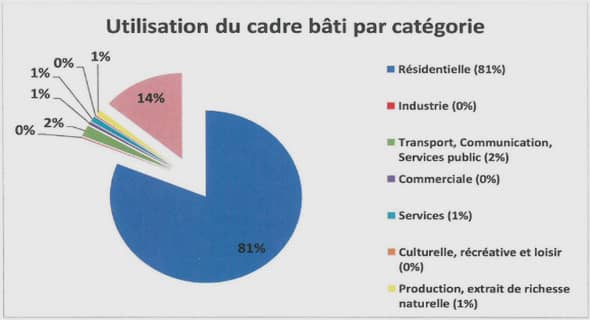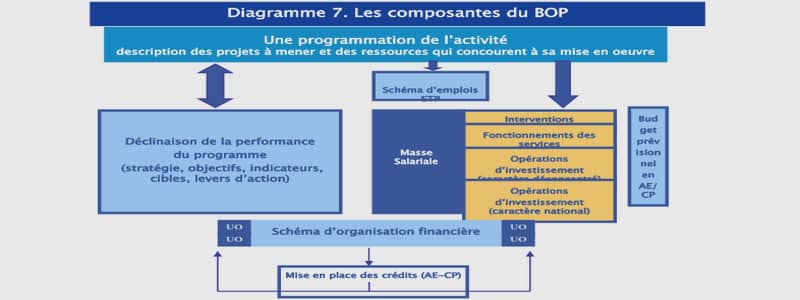Durkheim : à l’origine de la sociologie, la ques tion pédagogique.
Il nous semble pertinent dans le cadre de ce travail d’effectuer un retour sur la pensée d’Emile Durkheim, qui est le père fondateur de la sociologie française. Ce dernier est à la fois sociologue mais aussi pédagogue. Il a écrit trois ivresl essentiels sur l’éducation : « Education et sociologie », « l’éducation morale » et « l’évolution pédagogique en France ». C’est d’ailleurs par le biais de la pédagogie qu’il fera entrer la sociologie comme discipline reconnue à l’université. Comme le précise Jean-Claude Filloux, Emile Durkheim « a pensé l’éducation dans le cadre du projet de construction de ce qu’il voulait être une véritable science sociale. »22. Et d’ajouter, qu’« institutionnellement, la const itution d’une science de l’éducation est ainsi inséparable de la formalisation durkheimienne de la sociologie elle-même. Le « père » fondateur de la sociologie française sera donc le premier sociologue de l’éducation, à l’époque même où, entre 1882 et 1886, le ministre Jules Ferry jette les bases d’une école laïque, obligatoire et égalitaire. » . La pensée de Durkheim sur l’éducation doit s’articuler sur son modèle d’analyse des faits sociaux, afin de comprendre l’éducation tant dans sa nature que dans son évolution. Pour débutercet éclairage théorique sur les questions d’éducation en sociologie, il est nécessaire de rapeler la définition qu’en fait Durkheim : «L’éducation est l’action exercée par les générations adultes sur celles qui ne sont pas encore mûres pour la vie sociale. Elle a pour objet de susciter de développer chez l’enfant un certain nombre d’états physiques, intellectuels et moraux que réclament delui et la société politique dans son ensemble et el milieu spécial auquel il est particulièrement destiné. » .
Durkheim rejette une définition idéale de l’éducation, ou même l’idée qu’il pourrait exister une « éducation universelle ». L’approche historique et comparative des différents systèmes éducatifs qui ont existé ou existent encore démontre que « l’éducation a infiniment varié selon les temps et selon les pays »25. Il insiste sur le fait « qu’un système éducatif n’a rien de réel par lui-même », puisqu’en effet c’est « un système de pratiques et d’institutions qui se sont organisées lentement au cours du temps ». L’apport de Durkheim est essentiel pour introduire cette vision socio-historique à la compréhension des systèmes éducatifs et pédagogiques. Ce qui l’amène à dire que « les hommes de chaque temps l’organisent volontairement pour réaliser une fin déterminée ». Et là où même aujourd’hui encore, nous pouvons entendre dans les médias, dans le débat public ou dans la bouchede certains « spécialistes » dire que le système éducatif d’avant était bien meilleur (« denotre temps…. », « Le niveau baisse », etc.»), Durkheim lui se fait déjà très radical sur cette question, puisque pour lui « les éducations du passé apparaissent comme autant d’erreurs, totales ou partielles. Il n’y a donc pas à en tenir compte […] Les enseignants de l’hist oire peuvent tout au plus servir à nous épargner la récidive des erreurs qui ont été commises. Mais, en fait, chaque société, considérée à un moment déterminé de son développement, a un système d’éducation qui s’impose aux individus avec une force généralement irrésistible… »26. Autrement dit, un système éducatif donné ne peut se comprendre danses objectifs et dans sa rationalité qu’au regard d’une société donnée et historiquement déterminée. Les causes historiques qui déterminent un système éducatif sont indispensablespour comprendre comment a pu se développer celui-ci. Cette étude permet de voir quel’éducation a évolué sous l’influence de la religion, de l’organisation politique, du développement des sciences, du développement de l’industrie, etc. L’individu dans une société donnée « n’est pas en face d’une table rase sur laquelle il peut édifier ce qu’il veut, mais de réalités existantes qu’il ne peut ni créer, ni détruire, ni transformer à volonté. Il ne peut agirsur elles que dans la mesure où il a appris à les connaître, où il sait quelle est leur nature et les conditions dont elles dépendent ; et il ne peut arriver à le savoir que s’il se met à leur éco le, que s’il commence par les observer… »27 .
Cette définition de Durkheim permet d’affirmer le caractère social de l’éducation, puisqu’il s’agit « d’une socialisation méthodique de le jeune génération » . L’éducation doit s’étudier comme un « fait social », c’est-à-dire que les problématiques éducatives doivent se regarder sous le prisme de leurs déterminations sociales et historiques. Le contexte social qui agissait sur un individu qui vivait à l’époque carolingienne, par exemple, n’est plus du tout le même dans une société moderne et capitaliste. Les objectifs et les missions de l’éducation sont donc tout à fait différents, les systèmes éducatifs préparent des individus à des sociétés tout à fait différentes. Mais à chaque époque, malgré ces objectifs différents, l’action d’une génération sur l’autre, elle est toujours effective. Durkheim pense l’éducation dans le cadre d’une dynamique générale pour en comprendre ses évolutions.
Ce caractère social lié à l’éducation que démontreDurkheim ne va pas de soi à son époque. Durkheim s’est battu pour faire de la sociologie une science « positive » et reconnue. Cet apport théorique est indispensable pour comprendre comment a pu émerger et se développer la sociologie. Sa sociologie est dite « objective » à la différence de la sociologie dite compréhensive » de Max Weber, autre « père » fondateur de la Sociologie. Déjà, dans cette opposition théorique commence à se dessiner les futurs lignes de fractures des paradigmes sociologiques (objectiviste/subjectiviste, macro/micro, Qualitatif/quantitatif…). L’analyse de Durkheim se situe dans un « modèle structuro-fonctionnaliste » qui doit expliquer le social par le social. Le primat de la société sur l’individu est l’un des fondements de cette théorie. Dans un autre ordre d’idée, Durkheim décrit le caractère de « spécialisation » que connaît tout type d’éducation. La division du travail joue un rôle central dans ce processus, plus particulièrement dans les sociétés modernes : Chaque profession, en effet, constitue un milieu sui generis qui réclame des aptitudes particulières et des connaissances spéciales, où règnent certaines idées, certains usages, de certaines manières de voir les choses ; et comme l’enfant doit être préparé en vue de la fonction qu’il sera appelé à remplir, l’éducation à partir d’un certain âge, ne peut plus rester la même pour tous les sujets auxquels elle s’applique. »29.
Durkheim précise que malgré la nécessité de spéciisaltion, toute éducation repose avant tout, au primat du moins, sur des bases communes qu’elle tente d’inculquer à l’ensemble des élèves indistinctement.
L’éducation doit s’étudier comme un fait social, c’est-à-dire comme une action qui s’impose aux individus de manière coercitive et auquel on ne peut pas échapper. L’éducation doit s’étudier à une époque et une société donnée pourn ecomprendre ses évolutions. Au regard des préceptes de l’auteur, sa sociologie reste valable, même s’il faut la situer dans son contexte historique. Sa méthode et sa rigueur « scientifique » posent des bases solides à l’analyse sociologique, même si elles doivent êtreadaptées à la situation contemporaine. Durkheim fixe les assises d’une sociologie de l’éducation, et de manière plus générale les bases d’une sociologie reconnue comme une science universitaire et autonome. De plus, les bouleversements sociaux de son époque, liés au développement de l’industrialisation et du capitalisme sont à la genèse des transformations sociales et éducatives encore en cours aujourd’hui. Il me semblait donc indispensable de présenter les bases qui ont permis le développement de la sociologie et plus particulièrement celle de l’éducation, pour introduire en quelque sorte cette partie théorique.
La fin du mythe de l’égalitarisme de l’école Républicaine : La sociologie des années 60-70: Pierre Bourdieu remet en cause les préjugés communssur cette idée que l’école transmettrait une culture légitime, « universelle », au-dessus de toute idéologie. Au contraire, l’école a plutôt vocation à imposer un arbitraire culturel qu i est celui de l’idéologie dominante ou bourgeoise. La culture scolaire ne s’impose pas de manière naturelle chez les familles populaires ce qui explique les difficultés d’apprentissage de ces élèves. De leur côté, Baudelot et Establet s’opposent à l’image commune et « idéale » de l’école républicaine. Leur analyse socio-historique du système éducatif français laisse apparaître une école divisée en deux réseaux de scolarisation bien distincts. Ces deux approches sociologiques montrent une réalité scolaire bien différente de celle de l’école unifiée et égalitaire que l’on nous présente habituellement.
Bourdieu et la reproduction :
Notre étude sur le rapport à la scolarisation ne peut pas faire l’impasse sur un éclairage particulier sur la sociologie de Pierre Bourdieu. Ainsi « le structuro-constructivisme, ou structuralisme génétique, ou encore la praxéologie[… ] Le premier mettant l’accent sur la dimension constructiviste (qui prend toute son ampleur dans le choix des propriétés de positionnement), le deuxième met en exergue l’idée que les structures sociales et les représentations génèrent les dispositions des agents sociaux. Le troisième, enfin, met l’accent sur l’aspect dialectique existant entre les structures sociales et les représentations » . Ces trois aspects de sa théorie en font un véritable paradigme ou une « théorie « totale » . Le but ici n’est pas de faire un compte-rendu exhaustif de toute la richesse de son apport théorique, mais plutôt de présenter certains aspects qui ont très largement marqué les débats sociologiques. Aujourd’hui encore sa pensée ne laisse pas indifférent, même si une distance critique a été prise par les chercheurs en sociologie ces dernières années. Pour cela, nous allons définir et présenter les principaux conceptsde sa théorie en lien avec la compréhension du champ scolaire.
Dans son ouvrage La reproduction, Bourdieu nous présente sa théorie et y définit certains concepts importants. La définition du concept « d’action pédagogique » va nous servir de point de départ pour développer sa conception du système scolaire français :
1. Toute action pédagogique(AP) est objectivement une violence symbolique en tant qu’imposition, par un pouvoir arbitraire, d’un arbitraire culturel . »32.
Cette idée renvoie d’une certaine manière à la sociologie de Durkheim pour qui les faits sociaux, tel que l’éducation, s’imposent de manière coercitive et inéluctable aux individus d’une société donnée, mais pas seulement. L’éducation comme toute forme de domination est le fruit de la classe dominante, nul ne peut y échapper, et comme le souligne Weber toute forme de violence et de domination pour se perpétue et se maintenir doit être « légitime ». De ce fait pour Bourdieu : « dans une formation sociale déterminée, la culture légitime, i.e. la culture de la légitimité dominante, n’est autre chose que l’arbitraire cultu rel dominant, en tant qu’il est méconnu dans sa vérité objective d’arbitraire culturel dominant » .
Ce qui amène Bourdieu à dire que le système d’enseignement : doit les caractéristiques spécifiques de sa structure et de son fonctionnement au fait qu’il faut produire et reproduire, par les moyens propres de l’institution, les conditions institutionnelles dont l’existence et la persistance (autoproduction de l’ institution) sont nécessaires tant à l’exercice de sa fonction propre d’inculcation qu’à l’accomplissemen t de sa fonction de reproduction d’un arbitraire culturel dont il n’est pas le producteur (reproduction culturelle) et dont la reproduction contribue à la reproduction des rapports entre les groupes ou les classes (reproduction sociale). »34
Nous sommes loin d’une vision idyllique du système scolaire qui transmettrait des savoirs de manière généreuse. Le système scolaire permet de maintenir un ordre social et culturel et l’impose de manière irréductible aux individus. C’est pour cela que l’on parle de sociologie de la reproduction. L’idéal républicain, et certaines idéologies scolaires qui défendent le système éducatif comme émancipateur sont largementremises en causes dans ce cadre théorique. Bourdieu est là pour révéler les structures et les objectifs réels du système éducatif. Le but de la sociologie est de dévoiler des faits sociaux tels qu’ils sont, sans en occulter les différentes déterminations. L’école dispense une culture légitime que seuls ceux qui la possèdent préalablement peuvent disposer des meilleures dispositions pour y réussir. Les héritiers » de cette culture vont occuper les meilleures places dans la hiérarchie scolaire, et plus tard vont se situer en haut de l’échiquier social. Et inversement, les classes les plus dominées, qui ne disposent pas de cette culture scolaire légitime occupent le plus souvent les filières les plus défavorisées du système éducatifet plus tard les places subalternes du système de production.
Dès Les Héritiers en 1964, Bourdieu et Passeron posent comme hypothèse centrale pour la sociologie de l’éducation que l’origine sociale est un facteur décisif dans la réussite scolaire. Cette variable n’est pas une variable comme les autres. Même si l’origine sociale n’explique pas tout, elle joue pour beaucoup dans les trajectoires scolaires. Les recherches et les statistiques actuelles mettent toujours en avant cette détermination cruciale dans la hiérarchisation du champ scolaire. Le milieu sociald’origine implique un certain nombre de dispositions et de prédispositions qui vont être unavantage ou un inconvénient dans la trajectoire scolaire. Les catégories favorisées disposent d’un capital culturel supérieur aux catégories sociales « défavorisés ». Les « héritiers » comme les appellent Bourdieu et Passeron possèdent des savoirs et savoir-faire qui leurs permettent de convertir ces avantages en matière de rentabilité scolaire. Les catégoriessupérieures possèdent une culture plus riche », « étendue » qui leur permet de transformer ces différents capitaux en capital scolaire. Ainsi, les classes supérieures (ou « bourgeoises ») disposent de codes comportementaux, linguistiques et intellectuels qui sont directement mobilisables ou transférables dans les stratégies scolaires. A l’inverse les classes « dominées » dans la société ne disposent pas d’une culture légitime qu’ils peuvent mobiliser directement à l’école. En ce sens, le système scolaire est voué à reproduire lesinégalités sociales, favorisant les favorisés, et défavorisant les défavorisés. Il ne faut pas voir là, une volonté consciente du corps enseignant de vouloir maintenir les inégalités sociales à l’école, mais plutôt l’idée d’une école universelle qui s’interdit de penser son arbitraire culturel. La réussite scolaire n’est pas liée à des « dons » naturels que certains posséderaient à la différence d’autres. Le classement scolaire n’est pas une construction neutre. Il s’in scrit dans une logique sociale particulière en forte relation avec la position dans la hiérarchiesociale, même si cela est souvent nié.
Le classement scolaire est un classement social euphémisé, donc naturalisé, absolutisé, un classement social qui a déjà subi une censure, donc une alchimie, une transmutation tendant à transformer les différences de classes en différences d’ « intelligence », de « don », c’est-à-dire en différence de nature. »
La hiérarchie des filières liée à la hiérarchie sociale n’est donc pas pour Bourdieu un « fait de nature », mais est bien le fait de déterminations ociales que le sociologue doit décrypter.
L’habitus
Concept central de la théorie bourdieusienne, il permet de distinguer les classes sociales en se basant sur les variables de positionnement dans l’espace social. Ces positionnements peuvent être associés aux catégories socio-professionnelles.Même si ces variables, que nous pouvons appeler « propriétés premières », jouent un rôle important pour construire le concept de classe, elles n’en sont pas les seules déterminations. A ce stade l’habitus de classe peut être entendu comme un système d’intériorisation/incorporation des conditions objectives d’existence de classes. Mais ces conditions d’exist ence n’expliquent pas à elles-seules l’habitus. C’est là qu’interviennent ce que l’on pe ut appeler les « propriétés secondes ». L’habitus individuel ne peut se lire au seul regard du positionnement social, l’appartenance d’un individu à une classe ne signifie pas pour aut ant que cette individu ne va pas posséder des propriétés singulières.
Ainsi, outre la trajectoire, des propriétés telsque le genre, la taille de la fratrie, sa composition, la place occupée dans cette fratrie, le degré d’engagement politique des parents, la potentielle monoparentalité, etc., sont autant de propriétés condesse qui participent de la production de l’habitus (au même titre que n’importe quelle propriété) maisqui du fait de leur nécessaire singularité, participent du travail de distinction qui fait qu’un individu lambda, membre d’une classe donnée, n’est jamais la reproduction parfaite d’un individu théta, lui aussi membre de cette classe donnée. »36
Pour Bourdieu, l’habitus ne représente pas la réalité en tant que telle, mais il est un outil théorique pour tenter de la comprendre. Ce qu’il appelle l’habitus « est le produit de toute expérience biographique (ce qui fait que, comme il n’y a pas deux histoires individuelles identiques, il n’y pas deux habitus identiques, bien qu’il y ait des classes d’expériences, donc des classes d’habitus –les habitus de classe). » 37
Les critiques souvent faites à Bourdieu sont que sa théorie ne permet pas de penser le changement. Ces critiques sont-elles fondées ? Certes sa pensée peut paraître complexe, lourde et statique. De même, sa théorie remet largement en question une vision euphémisée de la réalité. Bourdieu considérait la sociologie comme un « sport de combat », où le chercheur doit s’engager, défendre ses vues dans un champ scientifique, qui a ses lois et ses règles. La sociologie doit se faire critique, révéler les mécanismes cachés des logiques sociales, mais il doit révéler ces faits dans une démarche scientifique de vérification objective. La légitimité de la sociologie s’oppose donc largement à une sociolo gie spontanée faite d’interprétations gratuites ». Sur la difficulté à penser le changement social dans sa théorie, la question n’est pas simple. Car lorsque nous regardons les différentes évolutions sociales nous pouvons constater que le changement en tant que tel ne se fait jamais aussi rapidement que nous le voudrions. Bourdieu l’explique lui-même dans sa théorie des champs, lorsqu’il pose la question de savoir qui veut véritablement remettre en cause les règles du jeu ou le jeu en lui-même : «Un des facteurs qui met les différents jeuxà l’abri des révolutions totales, de nature détruire non seulement les dominants et la domination, mais le jeu lui-même, c’est précisément l’importance même de l’investissement,en temps, en efforts, etc., que suppose l’entrée dans le jeu et qui, comme les épreuves desrites de passage, contribue à rendre impensable pratiquement la destruction pure et simple du jeu. »38.
Les enjeux sont trop prégnants pour pouvoir imaginer et penser de manière simple le changement. Les différences de temporalité (politique, institutionnelle, sociale) démontrent aussi que « l’Avenir dure longtemps »39. L’exemple de l’institution scolaire illustre bien cette difficulté à modifier certaines dynamiques qui en deviennent presque naturelles comme l’inégalité scolaire qui serait directement liée aux phénomènes des banlieues, des cités et de l’immigration, pour faire court. Le déclin ou la dissolution des idéologies émancipatrices, ainsi que la fin des « grandes théories » telles que le marxisme, nous laisse dans une sorte de «grand désert » Néo-libéral qui serait la seule voie possible pour penser le changement. Quel changement puisque certains nous annoncent déjà la « fin de l’histoire »40 ? De ce fait, il est difficile pour les « penseurs du changement social » de proposer une alternative. D’ailleurs à la fin de sa vie, Bourdieu a voulu s’engager auprès du « mouvement social » et il militait pour un rapprochement des chercheurs, des syndicalistes pour constituer des nouvelles formes d’actions. Il prônait d’ailleurs la constitution d’ un « mouvement social européen » pour contrecarrer les logiques économiques libérales quitouchent tous les pans de la société . Cette posture a pu déranger et ne pas plaire à tout le monde. Mais nul ne peut nier pour autant les logiques de libéralisation qui menacent l’éducation et qui veulent faire de ce secteur un simple marché. Pour conclure, nous ne pouvions pas faire l’impasse sur ce paradigme sociologique lors de cette présentation. Son apport est indispensable pour la compréhension du système éducatif ainsi que sur le rapport à la scolarité qu’il implique. Ses recherches ont d’ailleurs permis d’ouvrir la voie à de nombreuses autres infirmant ou confirmant ses thèses. Le débat est toujours vif à son sujet comme le rappelle François Dubet : Bref la plupart des sociologues de l’éducation sesont éloignés de fait du modèle de la reproduction. Tous ces travaux procèdent aussi des changements de climat politique quand s’éloigne l’horizon de la révolution et quand on se demande surtout comment améliorer le système. Mais il faut bien constater que tous ces travaux ne forment pas une théorie alternative à celle de Pierre Bourdieu et que, de ce point de vue, le paradigme de la reproduction n’est pas « dépassé », il est plus simplement « contourné ». Il est la grande théorie critique dumodèle de l’école républicaine »
Il est temps maintenant de passer à une autre théorie critique de l’école républicaine qui est celle de Baudelot et Establet. Dans une analyse complémentaire à celle de Pierre Bourdieu, nous allons voir que le système scolaire français derrière ses principes tels que l’égalité scolaire ne fait que reproduire les rapports sociaux qui structurent la société capitaliste. L’opposition entre le capital et le travail, c’est-à-dire l’opposition entre prolétaires et bourgeois inscrit sa marque dans le système scolaire. Le double réseau de scolarisation qu’ils dévoilent n’est que la caractéristique d’une domination sociale bien plus large qui prend sa source dans les fondements même du système économique qui structure de manière forte le champ social.