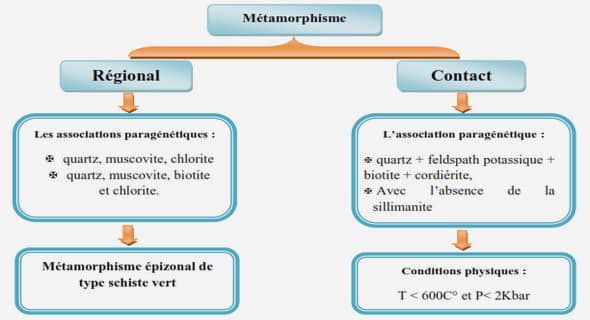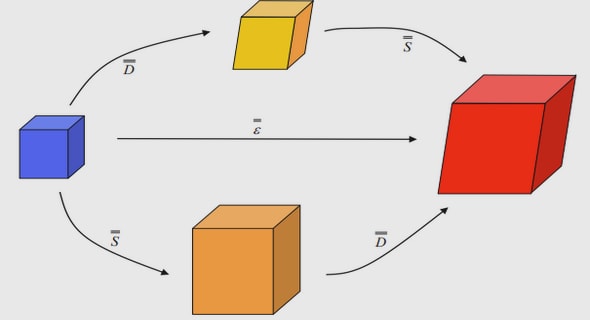Les rapports sociaux dans les modes de production
Les systèmes agricoles polynésiens, et en particulier celui des anciens Tahitiens, sont liés de façon complexe aux rapports sociaux qui régissent la production, notamment en matière de contrôle des terres, d’organisation du travail, et de contrôle et distribution des produits agricoles (Sahlins 1958 : 38-39, Goldman 1970 : 16-17, Kirch 1991 : 126).
La stratification sociale en Polynésie, et dans l’archipel de la Société en particulier, a déjà fait l’objet de nombreux ouvrages (Handy 1930, Williamson 1967, Sahlins 1958, Goldman 1970 notamment). Nous ne nous y étendrons donc pas, sauf pour rappeler quelques éléments essentiels. Il est admis que la société tahitienne, comme celle de l’archipel de la Société en général, était divisée en trois grandes classes : les ari’i, chef coutumiers, les ra’atira, propriétaires terriens ou gestionnaires de la terre des ari’i, et les manahune, le peuple (Handy 1930 : 42, Sahlins 1958 : 166-167, Goldman 1970 : 188-189 et 699, Oliver 1974 : II 1098, Robineau 1985 : II 76-82). Nous n’entrerons pas dans le débat sur l’origine et l’évolution de ces strates sociales, pour les considérer telles qu’elles sont apparues aux yeux des observateurs européens lors des premiers contacts avérés à Tahiti dans le dernier tiers du dix-huitième siècle.
La société de type « aristocratique » comme l’indiquent Irving Goldman (1970 : 4-5) et Michel Panoff173 est basée sur la primogéniture et la patrilinéarité (Sahlins 1958 : 141- 144, Goldman 1970 : 9 et 178-179), bien qu’il semble qu’il puisse y avoir ambilinéarité dans quelques cas (Williamson 1937 : II 2116, Sahlins 1958 : 146). Par opposition aux systèmes dits « unilinéaires », on peut donc parler en Polynésie de système de filiation « indifférenciée » plutôt que de filiation « bilinéaire », comme l’a précisé Claude Lévi-Strauss (1967 : 123). Comme dans tout le Pacifique insulaire, depuis l’Indonésie en passant par la Mélanésie et la Polynésie, le statut est basé sur le mana, le sacré, qualité héritée ainsi que les fonctions correspondantes (Sahlins 1958 : 142, Goldman 1970 : 10-11). Cette structure repose sur les liens de parenté plus ou moins directs liant le chef à ses sujets. D’une façon générale, la terre et la plupart des instruments de production (grands filets, pirogues…) appartiennent à un ramage familial (Robineau 1985 : II 83) ou ‘ati174, groupe de coopération175 (Ottino 1972 : 405-409) formé d’une succession de générations composées de l’ensemble des ‘opu ho’e, groupes de descendance des enfants et petits-enfants vivant au sein d’une même maisonnée, et organisé autour d’un ancêtre commun et d’une terre commune, le fenua, élément essentiel de l’identité commune (Ottino 1972, Baré 1987 : 69).
Les groupes familiaux étaient rattachés par « gestion emboîtée » de la terre ou de la mer, ou « overlapping stewardship » (Sahlins 1958 : 38 et 148), à un niveau supérieur, mata’eina’a ou chefferie, dirigé par un ari’i chef héréditaire des terres. L’ensemble des personnes dépendant d’un ari’i peut donc être appréhendé comme appartenant à une origine commune, symbolisée par le ari’i, avec un conditionnement fort de la résidence et donc de la terre comme facteur de rattachement (Panoff 1970 : 15, Baré 1987 : 54-55, Kirch 1991 : 126-127). Le mata’eina’a englobe ainsi trois notions : la population des hommes et femmes composant la chefferie et synonyme de manahune, la chefferie elle-même à laquelle appartient cette population, et le territoire géographique de cette chefferie (Saura 2005 : 79). A l’intérieur d’un ramage, la règle de la « séniorité » s’applique ensuite (Sahlins 1958 : 141-142) : les aînés (matahiapo) des lignages aînés fournissaient les ari’i, et les cadets des branches cadettes fournissant pour leur part de façon simplifiée les ra’atira et les manahune (Sahlins 1958 : 166, Goldman 1970 : 9-15, Robineau 1985 : II 27).
Les ari’i et leurs biens (mahamehamea selon Davies 1851) étaient particulièrement sacrés (Williamson 1967 : III 79-80), « doués d’une puissance et de vertus miraculeuses », du fait de leur position d’aîné de la branche aînée. En tant que médiateur entre les hommes et les puissances surnaturelles, le mana du chef était censé faire pousser les récoltes (Douaire-Marsaudon 1998 : 123). « La nourriture qu’ils avaient touchée devenait pour tous un poison mortel, excepté pour ceux qui appartenaient au même sang » (Bovis 1978 : 31), et tout ce qu’ils touchaient devenait sacré, d’où l’habitude de les porter à dos d’hommes lors de leurs visites, afin d’éviter qu’ils ne rendent sacrés le sol foulé et ne posent des problèmes de propriété aux familles locales de chefs (Panoff 1970 : 258). Les porteurs de chef, comme les porteurs d’idoles sur les marae, les lieux de culte, étaient également considérés comme sacrés du fait de leur contact soit avec les dieux, ou du moins leurs idoles, soit avec les ari’i, incarnation des dieux sur terre (Williamson 1967 : III 81-82).
De ce fait, tout chef de famille devait être également sacré à un certain niveau, relativement à sa position dans l’emboîtement des familles (Williamson 1967 : III 72).
Les ari’i dominent de façon « implacable » (Williamson 1937 : III 355, Sahlins 1958 : 9-10 et 39-40, Saura 2005 : 78) l’ensemble des personnes qui vivent sur leur sol, les manahune, qui vivent en famille sur la terre dont ils tirent leur principale subsistance terrestre. On distingue deux ordres chez les ari’i : les ari’i rahi ou nui ou encore hui ari’i, les chefs supérieurs, et les ari’i ri’i, qui comprennent également les ‘iato’ai sous-chefs administratifs et militaires (Handy 1930 : 42) recrutés notamment parmi les cadets des ari’i (Panoff 1970 : 266) et les to’ofa (Goldman 1970 : 188-189). Cette abondance de vocabulaire traduit à la fois l’enchevêtrement des degrés d’autorité et l’évolution de la nomenclature (Robineau 1985 : II 78). La caractéristique principale de cette hiérarchie territoriale extrêmement stricte (Saura 1993 : 32) était le contrôle de la production (Sahlins 1958 : xi, Baré 1987 : 54). On peut considérer qu’à la fin du dix-huitième siècle il y avait des ari’i rahi dans chacune des cinq îles principales des Iles de la Société176 (Robineau 1977 : 166).
Des propriétaires ou gestionnaires terriens, les ra’atira, constituaient une catégorie intermédiaire entre ces deux extrêmes, sans doute issus des branches cadettes des ari’i (Babadzan 1993b : 17), pour lesquels la possession de la terre semble faire l’unanimité parmi les sources secondaires (Goldman 1970 : 190-191, Oliver 1974 : II 750-751 et 769-770), possession sans doute inaliénable par le chef (Handy 1930 : 43, Williamson 1967 : III 272, Goldman 1970 : 193-194) contrairement aux ari’i dont la possession de la terre dérivait de la conquête.
La question de la propriété de la terre par les manahune est sujette à caution : certains auteurs leur dénient cette capacité (Morrison 1989 : 137, Bovis : 1978 : 33, Ellis 1972 : 530, Handy 1930 : 42, G. Foster 1777 : II 258-259 cité dans Oliver 1974 : II 765-766, Goldman 1970 : 190-191), d’autres estiment au contraire qu’ils étaient propriétaires terriens de facto (JR Forster cité dans Williamson 1967 : III 276, Henry 2000 : 237, Saura 2005 : 80). On peut penser avec Williamson (1967 : III 229) que le chef d’un groupe, l’aîné de son lignage, devait constituer le propriétaire officiel d’une terre, le gardien de la terre de son groupe (Panoff 1970 : 251), et que la tête d’un de ses sous-groupes était propriétaire de la terre du sous-groupe, quoique soumis à l’autorité supérieure (« superior suzerainty ») du chef de groupe. Dans ce cas, la notion contemporaine de « propriétaire » ne peut donc pas s’appliquer, la propriété n’étant jamais individuelle mais collective, familiale, rattachée à un groupe familial, comme à Samoa et Tonga (Williamson 1967 : III 271, Oliver 1974 : II 767-768). Le manahune possédait une portion de terre, incluse dans un ensemble plus vaste auquel il se rattachait, soumis aux droits, devoirs et interdits imposés par les ra’atira, et par les strates successives de chefs. La frontière entre manahune et ra’atira n’était par conséquent peut-être pas aussi nette en terme de possession de terre, sinon de pouvoir imposer comme les ra’atira certains versements en biens principalement alimentaires et certaines restrictions, pouvoir d’autant plus fort que l’on était proche de la strate hui ari’i.
La question de la propriété des terres est donc à différencier de son exploitation : les terres sont familiales, inaliénables (Panoff 1970 : 45), et gérés par les aînés en tant que chefs des différentes familles. Il existait également des terres d’apanage rattachées à la fonction de ari’i et non à leur famille, les fari’i hau 177 ou patu (Morrison 1989 : 137). Un ari’i pouvait très bien prétendre à la propriété de la terre sur laquelle vivaient ses manahune, mais ne pouvait pratiquement par l’exercer s’il voulait garder son autorité politique, pendant que le manahune ne se voyait pas reconnaître le droit de propriété mais profitait réellement de la terre qu’il occupait (Panoff 1970 : 253). Les titi, hommes « esclaves », non libres, prisonniers, et les teuteu, au service des ari’i, sont inclus dans la catégorie des manahune par Ellis (1972 : II 530), même si la propriété de la terre leur est généralement déniée. Un ari’i ne pouvait jamais devenir ra’atira ou manahune et l’inverse non plus, alors qu’un manahune pouvait devenir ra’atira (Goldman 1970 : 189-190), et sans doute un ra’atira un simple manahune par suite d’une dégradation de la part de son ari’i (Oliver 1974 : II 775). Ravault F. in Toulellan 1987 : 107, fari’i hau signifiant littéralemnt « accueillir le pouvoir ». 85
Cette stratification complexe est à la base de l’organisation des modes de production et distribution, particulièrement développés en Polynésie ancienne. Elle est permise par la constitution d’un « surplus » sous différentes formes (Sahlins 1958 : 4-5, Robineau 1985 : II 22) qui établit la distinction fondamentale dans les Iles de la Société, et plus particulièrement à Tahiti, entre les ari’i, les ra’atira et les manahune.
Chez les anciens Polynésiens, le contrôle sur la terre et sur la production agricole s’exerçait donc fondamentalement au niveau du groupe familial où se prenaient les décisions concernant l’entretien des terres, leur mode de plantation et de récolte, donc de l’utilisation de la force de travail et de la détermination des objectifs économiques, alors que l’unité d’accumulation et de redistribution se situait au niveau supérieur, des mata’eina’a (Sahlins 1958 : 164-165). Le « mode de production domestique » pur centré autour de la maisonnée est selon Marshall Sahlins le mode de production des économies polynésiennes primitives, aux caractéristiques plus autocentrées suivantes : « prédominance de la division sexuelle du travail, production segmentaire à des fins de consommation, accès autonome aux moyens de production, relations centrifuges entre les unités de production » (Sahlins 1976a : 119-120). L’économie domestique « pure » se contente donc de subvenir aux besoins de subsistance de la maisonnée : le mode de production domestique est « un système fondamentalement hostile à la formation de surplus » (Sahlins 1976a : 126). Plus remarquable est l’intensification des moyens de production au cours du temps (Conte 2000 : 147-153) avec la densité des liens de parenté et communautaires. Le groupe familial élargi à plusieurs maisonnées est ainsi selon Bell l’unité élémentaire de production alimentaire, food-producing unit (Bell 1931 : 127).
La combinaison des maisonnées formait des unités plus importantes de type clanique, les mata’eina’a, dont le caractère collectif s’exerçait à travers la coopération pour des travaux communs, des échanges alimentaires intra-communautaires nombreux et des rituels mettant en jeu des quantités importantes de nourriture. L’économie polynésienne était organisée en trois grandes cellules de base de production, les maisonnées, les artisans-spécialistes et les chefs-entrepreneurs (Robineau 1985 : II 29-30, Baré 1987 : 55).
Le dégagement d’un surplus de travail (en autoproduction ou en service rendu) était nécessaire pour alimenter le flux des prestations qui remontaient vers les sommets de la structure sociale tahitienne, et fournir les chefs et leurs serviteurs qui n’étaient que peu producteurs eux-mêmes, vivant en grande partie sur les prestations de leurs sujets. Ce dégagement d’un surplus pouvait aussi se réaliser à travers la participation aux travaux collectifs, dont pouvaient parfois bénéficier directement les personnes sous forme d’un gigantesque festin offert par le donneur d’ordre, ou par une portion du bien collectif obtenu : part de poisson pour la pêche au filet, de vivriers pour l’entretien et la récolte de cultures collectives.