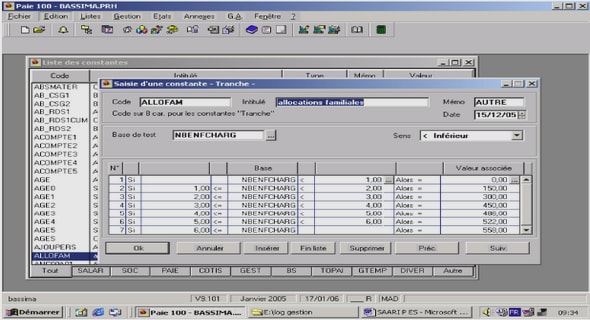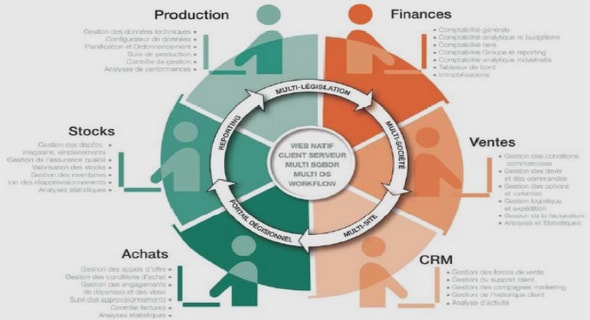L’élaboration du concept : KELLING et WILSON «La théorie de la vitre cassée» .
Le terme «incivilité»renvoie au vocable anglo-saxon«disorders» (désordres) ou encore celui d’ «incivilities». La théorie dite de la vitre cassée (broken windows) défendue par KELLING et WILSON fait un lien entre la dégradation de l’espace public, à travers des actes au départ isolés qui peuvent apparaître anodins et l’émergence en réponse à ces dégradations, de phénomènes plus importants tellesla délinquance ou encore l’insécurité.
KELLING et WILSON ont fait l’observation suivante : «Si la vitre d’un bureau ou d’une usine était cassée et qu’elle n’était pas réparée rapidement, d’autres vitres du bâtiment allaient connaître le même sort, dans la mesure ou les personnes observant la dégradation penseront que personne ne s’en inquiète. Très rapidement, d’autres vitres du bâtiment sont alors cassées et les personnes du quartier considèreront que non seulement personne n’a en charge l’immeuble mais surtout que personne n’a la responsabilité de la rue ou il se trouve». KELLING et WILSON vont alors observer une désertion de l’espace public laissant libre cours aux actes répétés de délinquance et à l’émergence du sentiment d’insécurité. Toutefois, ces auteurs ont mené leurecherche sur la société anglo-saxonne qui dispose de caractéristiques qui lui sont propres.
Loïc WACQUANT, dans «Parias Urbains Ghetto, banlieues, Etat»nous renvoie que la comparaison empirique entre le ghetto de Chicago et les cités de la banlieue parisienne, telle qu’on peut les caractériser à travers le site «exemplaire »de la Courneuve, fait apparaître un certain nombre de parallèles qui semblent au premier abord fonder la thèse de la convergence. WACQUANT nous pointe alors : «l’existence de similarités apparentes dans l’évolution morphologique et le vécu des populations qui pour autant masquent de profondes différences d’échelle, de structure et de fonction28 ». Parmi ces différences, nous pouvons tout d’abord citer la taille de ces ensembles tant au niveau de leur superficie que par rapport au nombre d’habitants qui les compose. Loïc WACQUANT nous dit ce qui suit : « Il faut savoir que nonobstant son dépérissement, leghetto de Chicago compte aujourd’hui autour de quatre cent mille habitants et qu’il s’étend sur plusieurs centaines de kilomètres carrés… Mesurées à cette aune, les cités françaises les plus massives, celles de la petite couronne parisienne, de la périphérie lyonnaise ou des quartiers Nord de Marseille, font bien modeste figure. En 1982, les Quatre mille abritaient 13000 personnes occupant quelque 348000 mètres carrés ; les tours des Minguettes à Vénissieux, l’une des plus grandes densités de logements HLM du pays, en comptaient 35 000 29». Fort de ces observations, il conclut ainsi : « Aucune cité de France n’atteint le dixième de la taille d’un des ghettos américains auxquels le discours sur les cités ghettos les identifie30 ».
L’auteur aborde une deuxième différence fondamental : la question de la division du travail qui dans l’exemple des banlieues françaises permet aux habitants de consommer et travailler à l’extérieur de la cité. De fait, WACQUANT observe que ces derniers «n’ont pas développé de réseau d’institutions parallèlesuiq leur sont propre et qui leur permette de suppléer aux carences des institutions extérieures dont ils ont été écartés». Le ghetto américain dispose, quant à lui, de sa propre division du travail qui lui permet de fonctionner en vase clos, en occultant tous contacts extérieurs : «La majorité d’entre eux (les habitants) n’ont que peu de contacts avec l’ex térieur car leurs relations se déploient essentiellement au sein de l’espace social homogène du ghetto, notamment pour ce qui touche à «l’approvisionnement» et à la «circulation 32».
Troisième distinction, le cloisonnement et l’uniformité raciale qui caractérisent les ghettos étasuniens à la différence des cités françaises renvoyant à davantage de dispersion et d’hétérogénéité ethnique (:… )« les banlieues populaires de l’hexagone sont des zones foncièrement pluriethniques où se côtoien t.-avec les frictions que l’on sait –une multiplicité de nationalités, le ghetto étasunien, lui, est totalement homogène racialement33 ». Lorsqu’il fait référence aux banlieues françaises, WACQUANT évoque : «la fluidité et l’étonnante diversité de leur composition ethnique », que l’on ne retrouve pas outre-Atlantique. Cette homogénéité raciale desgrands ensembles américains s’explique, pour WACQUANT, à travers «les legs historiques de l’ère esclavagiste34 ».
Autres éléments significatifs avancés par WACQUANT,le taux d’emploi relativement bas qui se rapporte aux actifs vivants dans les ghettos étasuniens, mais également les carences du système de protection sociale aux ETATS-UNIS. Il met en exergue les déficits du système américain qui conduisent, selon lui, à une pauvreté inégalée et à une structuration sociale qui laisse notamment apparaître un taux important de familles monoparentales : « On compte 6 pour cent de familles monoparentales à la Courneuve contre 60 à 80 pour cent selon les secteurs dans le ghetto de Chicago 35».
Des différences élémentaires sont aussi perceptibles concernant la criminalité et la dangerosité des territoires.Pour Loïc WACQUANT, les médias français ont contribué à amplifier le phénomène de la violence dans les banlieues en les caractérisant comme : «creusets de la délinquance échappant à l’ordre légal républicain, au point de constituer une menace pour la paix civile36 ». L’auteur oppose à l’amplification du phénomène l’observation empirique qui démontre notamment qu’il n’y a aucune commune mesure entre les réalités françaises et américaines : «Là encore, l’observation empirique montre qu’il y a loin entre la réalité quotidienne des cités et cette représentation médiatique, sans parler de la situation du ghetto noir étasunien où la criminalité violente a atteint des niveaux pandémiques dignes d’une guerre civile larvée qui sont sans parallèle sur le continent européen ». Bien que les médias aient relaté, lors des dernières émeutes à VILLIERS-LE-BEL (26/27/28 novembre 2007), une violence croissante avec notamment l’utilisation d’armes à feu contre les Compagnies Républicaines de Sécurité, il apparaît à travers les écrits de Loïc WACQUANT que la situation en France est loin de pouvoir être comparée à celle présente dans les ghettos noirs américains. A titre d’exemple, selon cet auteur, la criminalité a atteint un niveau tel dans le ghetto étasunien qu’à «HARLEM, l’espérance de vie moyenne d’un noir de 35 ans est inférieure à celle d’un hab itant du BANGLADESH 38».
Un autre élément significatif apparaît : la violence, au sein même des établissements scolaires, favorisée par la libre circulation des armes. Loïc WACQUANT nous décrit que : «Malgré l’installation de portiques de détection demétaux à l’entrée des établissements scolaires (…) : Chaque année plusieurs dizaines d’enfants sont abattus dans la cour ou dans le voisinage immédiat de leurlycée ».
Dernière différence importante pour WACQUANT entre ces deux modèles : le degré d’implication différent des politiques urbaines. A la différence du ghetto noir étasunien, la banlieue française bénéficie depuis ed nombreuses années de l’implication des pouvoirs publics à travers les politiques de la ville.
Malgré ses lourdeurs et les nombreuses critiques dont elles font l’objet, les politiques de la ville, à travers, notamment le pro gramme de D.S.Q40 et l’instauration du RMI,41 ont apporté un soutien aux banlieues.
Il ne peut y avoir véritablement de parallèle faiten ce qui concerne les volontés d’action des pouvoirs publics dans les ghettos noirs américains. Loïc WACQUANT nous renvoie à ces politiques en précisant que : «la plupart des programmes d’aide au ghetto institués sous l’égide de la great society de Lyndo JOHNSON ont été vidés de leur substance ou carrément supprimés ». Les conséquences de ce désengagement des pouvoirs publics conduit alors à un « état de délabrement du parc d’habitations, des infrastructures publiques et du cadre de vie 43». L’observation qu’en fait WACQUANT est que «le tissu urbain de l’inner city américaine est incomparablement plus détérioré que ne l’est la banlieue la plus déshéritée de l’hexagone ». Dans certaines dimensions, notamment celle de l’urbain, il apparaît donc que l e problème des incivilités est avant tout lié à la manière de les catégoriser (configurationdes territoires ; médiatisation des faits…). En ce sens, ces éléments se révèlent des indicateurs permettant de mesurer « le seuil d’acceptation » des communautés confrontées au phénomène des incivilités. Ces derniers permettent ainsi de comprendre, le choix des politiques mises en place pour les traiter.
Maintenant que nous avons pu nous imprégner des diférences traduites par WACQUANT à travers la comparaison empirique qu’il n ous fait du ghetto de CHICAGO et des cités de la banlieue parisienne, nous allons aborder les spécificités du phénomène des incivilités dans le paysage social français.
Pour ce faire, nous comparerons les approches de différents auteurs tels ROCHE, PEYRAT ou encore MUCHIELLI.
Les incivilités dans le paysage social français
Didier PEYRAT, magistrat de formation, écrit dans la gazette du palais «qu’il n’existe aucune définition légale de ce qu’est uneincivilité ». Il nuance néanmoins ses propos en faisant référence à une circulaire du 15juillet 1998 du Garde des sceaux dans laquelle un lien est fait entre déscolarisation, incivilités et fait de délinquance. Pour lui, la définition de l’incivilité ne peut être que proposée à la différence de celle de l’infraction qui est clairement définie dans le code pénal. Le arallèlep que réalise PEYRAT entre ces deux notions est intéressant car incivilité et infraction peuvent dans certaines circonstances se confondent.
Laurent MUCHIELLI46, quant à lui, considère que les incivilités recouvrent à la fois des délits et de simples impolitesses. En ce qui le concerne, la question des frontières est donc difficile à trancher. Sur ce point Sébastian ROCHE dans « la société incivile » précise que «l’incivilité ne fait pas nécessairement de victimed’après les textes de loi et encore moins d’après la pratique pénale, qui ne sait pas par où l’attaquer 47 ». De plus, dans son ouvrage «La société d’hospitalité»48, Sébastian ROCHE relaie les propos de Didier PEYRAT en définissant trois niveaux pour classifier les comportements individuels :
Dans le niveau un, il situe les crimes, les cambriolages, les vols à l’arraché et tous les actes que nous pouvons qualifier de graves et qui sont sanctionnables par la loi. Sébastian ROCHE considère que ces actes, pourtant graves, dérangeraient moins la population que certains autres. Cette analyse peut être mise en parallèle avec celle qui défend que certains actes d’une violence inouïe tels les attentats, nuisent beaucoup moins à la population au quotidien du fait de leur caractère exceptionnel et isolé. Il n’en demeure pas moins que ces actes se révèlent particulièrementraumatisants pour les victimes.
Dans sa classification, ROCHE réuni au sein d’un deuxième niveau les incivilités qu’il caractérise «d’infractionnelles 49». Ces dernières dérangent la population et sont placées sous le coup de la loi. Elles regroupent les insultes, les menaces, les dégradations, le bruit, les tapages qu’ils soient nocturnes ou diurnes. La loi sanctionne ces comportements de manière moins conséquente dans lamesure où ces voix de fait sont moins graves que les précédents. Pour autant, ces ncivilités «infractionnelles » se révèlent beaucoup plus dérangeantes que certains crimes et délits. La fréquence et le rythme auxquels les individus y sont confrontés pourraientune nouvelle fois expliquer la gêne ou les nuisances qu’elles occasionnent. ROCHE soulève les difficultés de traitement par la justice de ces incivilités infractionnelles.
Toutes ces nuisances, bien que répréhensibles, sontrarement poursuivies du fait de l’absence de preuve ou de témoins, nécessaires à laconstitution d’un dépôt de plainte. De plus, leur nombre peut représenter pour les forcesde police et de gendarmerie un frein dans leur traitement, ces dernières concentrant davantage leur action sur les comportements auxquels ROCHE fait référence dans le niveau un.
Le troisième niveau regroupe, quant à lui, les incivilités que Sébastian ROCHE qualifie de «légales ». Il les qualifie comme : «des actes qui dérangent ou qui blessent moralement mais qui ne sont pas réprimés par la loi. ». Il cite le fait par exemple de cracher par terre, de ne pas dire bonjour, de bousculer quelqu’un ou encore de le dépasser dans une file d’attente. Pour Sébastian ROCHE, tous ces actes qu’il regroupe sous le vocable d’incivilités légales conduisent à un climat d’anxiété et de tension. En y étant ainsi confrontées, les populations en viennent à se détester et à s’éviter. Pour l’auteur, la difficulté réside dans leur traitement car ces incivilités légales ne sont pas condamnables pénalement et de fait, favorise d’autant plus «les ruptures de l’ordre dans la vie de tous les jours51 ».
Didier PEYRAT interroge les limites de la classification de Sébastian ROCHE, en nous renvoyant à tous les comportements qui engendr ent certains troubles de la vie en société qui sont parfaitement acceptés ou acceptables, car perçus comme justes.
Il fait alors référence aux grèves ou aux manifestionsa se déroulant sur la voie publique qui occasionnent troubles et nuisances et qui sont pour autant protégées par le droit. Il nous met également en garde sur la tendance qui consisterait, malgré des efforts de catégorisation, à une certaine imprécision dans ladéfinition du concept. Le risque que cela engendrerait, serait de désigner à travers le terme d’incivilité la petite délinquance «impoursuivie52». PEYRAT veut ainsi éviter de réduire les actes qui constituent des incivilités à des «sous-catégorie d’infractions pénales » .
Il nous propose alors la définition suivante : «une incivilité est une action qui engendre un trouble anormal à la tranquillité civile54 ». Pour autant, l’essai d’une définition se complique, selon lui, car incivilitéet infraction peuvent se confondre au sein d’un même comportement. Didier PEYRAT rappelle»qu’une infraction est un acte prévu et réprimé par la loi pénale qui engendre un trouble à l’ordre public 55 ».
Dès lors, certaines infractions peuvent renfermer des incivilités, comme par exemple «inonder ses voisins de décibels ». La loi sanctionne le tapage qu’il soit nocturne ou diurne, l’incivilité réside dans le fait ou l’auteur du tapage ne se préoccupe pas de la personne qui subit ses nuisances. Il y donc là toute une dimension morale qui renvoie aux règles «du vivre ensemble »caractérisant la vie en société. Didier PEYRAT nous renvoie alors à la classification de Sébastian ROCHE, au sein du niveau 3, dont nous rappelons qu’il rassemble les incivilités dites «légales ». Il parle alors : «des incivilités qui ne sont pas des infractions. Des comportements qui constituent une gêne sociale ne sont pas appréhendés par la loi comme des délits ».
Nous touchons alors une définition de ce qu’est une incivilité, sous l’angle des interactions entre les individus. Elle pourrait être définie comme un ensemble d’actes troublants la quiétude civile sans pour autant transgresser la loi pénale. Cette définition synthétique alimente un certain nombre de réflexions dont nous fait part l’auteur.
Ces dernières doivent, selon lui, être appréhendéeslorsque nous nous interrogeons sur la légitimité d’une incivilité ou encore lorsque nous nous questionnons sur l’élaboration d’une méthodologie en réponse au traitement publicdu phénomène.
De fait, selon Didier PEYRAT :
• La tranquillité civile est une interaction. Les incivilités ne sont pas que des actes individuels : il existe des incivilités institutionnelles ou commises par des personnes morales.
• N’étant pas forcément condamnables les incivilités, au sens strict, peuvent être commises dans la mesure où elles ne contribuent pas à une désorganisation sociale de la vie en société et qu’elles n’induisent pas de souffrances individuelles. Cependant, elles interfèrent considérablement sur le lien social. Cela fera l’objet d’un traitement plus approfondi dans un second chapitre.
Après avoir confronté plusieurs définitions de cequ’est une incivilité et de nous être rendus compte que la chose n’était pas aisée,il nous apparaît intéressant de nous questionner sur les dimensions que ces incivilitéspeuvent prendre.
Les dimensions de l’incivilité : l’influence des représentations sociales
Afin de mieux appréhender les dimensions des incivilités, il paraît important de procéder à leur classification. En effet, une étudepubliée par l’école de criminologie de l’université de Montréal démontre que les représentations et les manifestations des incivilités peuvent être regroupées en trois groupes.
Avant de développer cette classification, il nous semble important de définir ce qu’est une représentation sociale, dans la mesure où nous verrons par la suite, l’influence que peuvent avoir nos représentations sur la perception du phénomène.