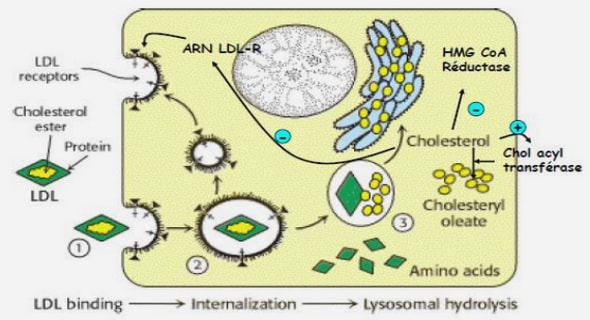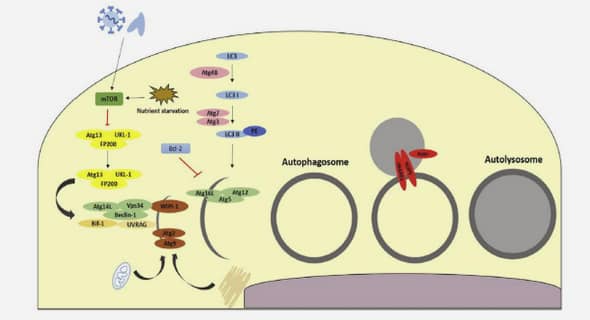Outils de gestion de la pollution phytosanitaire diffuse au niveau d’un territoire
LE TERRITOIRE DE LA MERJA ZERGA : UN SYSTEME AGRICOLE COMPLEXE
Depuis le début du siècle dernier, l’activité agricole apparaît comme l’élément révélateur du de la région du Gharb-Chrarda-Bni-Hssen en général et du territoire de la Merja Zerga en particulier mais aussi l’une des principale source de dégradation de son environnement. Le territoire est convoité pour la richesse et la qualité de son milieu naturel propice à l’agriculture. Les données sur les conditions naturelles et son milieu socio-économique sont essentielles à la compréhension de l’organisation spatiale des activités agricoles. Se pose alors la question de la logique de mise en place et d’organisation des activités agricoles qui doit nous amener à identifier les déterminants actuels de cette organisation territoriale. Comment les conditions naturelles et socio-économiques construisent-elles l’agriculture actuelle du territoire de la Merja Zerga ? De quelle façon ces conditions générales orientent-elles les spécificités de l’agriculture dans chaque partie du territoire de la Merja Zerga, qualitativement, quantitativement et spatialement ? Comment les activités agricoles sont-elles définies, construites par les contraintes naturelles et l’évolution sociale et dans quelle mesure il est possible de définir une « marge de manœuvre » des pratiques phytosanitaires ? Analysées selon trois points de vue sur l’espace (structuré, géré et perçu), les données sur les conditions naturelles et socio-économiques doivent nous permettre de répondre à ces questions. Nous souhaitons à travers ces réflexions, fruits de travail de cartographie et d’échange avec les acteurs locaux (agriculteurs et agents des ORMVA du Gharb et du Loukkos), mettre en exergue les grands traits du territoire et de l’organisation des activités agricoles. Ces grands traits sont en effet autant des facteurs de différenciations spatiales et stratégiques susceptibles d’induire des modes de fonctionnements d’exploitations, et plus précisément des pratiques agricoles et phytosanitaires différentes en fonction de la localisation géographique et de la perception de l’environnement, ils en constituent le cadre. Notre hypothèse est finalement que le bassin versant est l’unité globale porteuse du territoire et que le milieu naturel et socio-économique de l’agriculture de la Merja Zerga conditionnent fortement la répartition des activités agricoles et la propension à polluer, pour trois principales raisons que nous analysons successivement. Dans une première section nous montrerons que le bassin versant est l’unité globale porteuse du territoire, adéquate pour une gestion concertée de la pollution phytosanitaire diffuse. Dans une seconde section, nous montrons dans quelle mesure la structure de l’espace naturel et hydro-agricole génèrent des activités agricoles et phytosanitaire de façon hétérogène sur la surface du bassin versant. Dans la dernière section, nous montrons que ces activités agricoles définies par l’inscription multi-territoriale ont engendré une agriculture duale. Cette situation paradoxale soulève les questions du rapport à l’espace et à l’environnement.
Délimitation du territoire de diagnostic de la pollution phytosanitaire diffuse : le bassin versant ?
La définition de l’unité géographique pertinente par rapport à l’enjeu sur l’eau impose un choix entre le bassin hydrographique (eaux superficielles) et le bassin hydrogéologique (eaux Chapitre VII 108 souterraines) (CORPEN 1996). Dans le cas de notre étude, nous nous intéressons à une masse d’eau de surface à intérêt international, classé patrimoine mondial Ramsar, la lagune de la « Merja Zerga ». De ce fait, nous avons opté pour le bassin versant hydrographique intitulé « bassin versant de la Merja Zerga ». Le choix de ce nom est dû au fait que la lagune constitue l’exutoire drainant le bassin versant situé en amont. Le travail de délimitation a débuté par des investigations d’études hydrologiques et hydrogéologiques et de terrain, ainsi que des consultations auprès des organismes référents (Universités, organismes de recherche, ORMVA, Agence de bassin hydraulique (ABH), DREF,…) et fait des investigations de terrain. Nos études bibliographiques et nos investigations auprès des acteurs de gestion de la Merja Zerga et de l’eau agricole (ORMVA), ont prouvé l’inexistence de carte du tracé de bassin versant hydrographique dont la Merja constitue l’exutoire, d’où notre travail de construction du tracé de ce bassin versant. Afin de disposer d’une base de travail solide, la délimitation du tracé du bassin versant de la Zerga a eu lieu en plusieurs étapes : – Un premier tracé A de la ligne des crêtes est obtenu à partir du modèle numérique de terrain (MNT) de la région biogéographique du Gharb-Chrarda-Bni-Hsin. Ce tracé est projeté en3D sous Arc Scène 10 de ESRI (Figure 22). Ce premier tracé A couvre une surface de l’ordre de 10599 km2 . Figure 22. Tracé A du bassin versant de la Merja Zerga (Réalisation : Ayadi H., 2011) Chapitre VII 109 L’immensité du territoire issue de la première délimitation nous a poussé à approfondir l’analyse spatiale des données. L’analyse 2D et 3D des pentes et des expositions et du réseau hydrographique ont montré que ce tracé A couvre des zones qui ne se drainent pas dans la Merja Zerga. Cette erreur de délimitation est due à la faible résolution du MNT (30 m de résolution horizontale). Il est à préciser que les sens des écoulements dans cette partie basse du Gharb sont déterminés par des dénivelés de l’ordre de 0 à 1 m ; l’oued Sebou fait d’ailleurs beaucoup de méandres, vu le caractère presque plat de la plaine avant de se jeter dans l’océan atlantique à son embouchure près de Kénitra. En se basant sur ces nouvelles informations topographiques et hydrographiques, des modifications ont été fait sur le tracé A pour obtenir un deuxième tracé B (Figure 23). Le tracé B couvre est superficie de 1514 Km2 . Figure 23. Tracé B du bassin versant de la Merja Zerga (Réalisation : Ayadi H., 2011) La construction d’un tracé du bassin versant de la Merja Zerga est un travail qui se réalise pour la première fois. Pour son acceptation, une validation terrain s’est imposée. Pour cette fin un comité de validation a été constitué. Elle a été composée de professeurs de génie rural et de pédologie de IAV Hassan II et d’ingénieurs et techniciens des ORMVA du Gharb et du Loukkos. La présentation du tracé B à ce comité de validation s’est traduite par des demandes de modifications des frontières « est » et « sud » du tracé. La partie sud du bassin versant est caractérisée par une pente très faible. Des aménagements d’assainissements ont été construits pour assurer le drainage artificiel de cette zone du bassin versant dont une station de pompage au niveau de la commune d’Allal Tazi. Cette station permet de drainer une partie artificiellement vers le Sebou. Cette zone fait partie de la zone de grande hydraulique où des fossés de drainages ont été creusés pour drainer le secteur C1, CNT et le moitié du secteur C2 Chapitre VII 110 vers l’oued Sebou. Ces informations fournies et les suggestions des acteurs de terrain et du comité de pilotage, ainsi que les visites des terrains ont permis d’affiner les limites du bassin versant illustré par le tracé B et l’aboutissement à un troisième tracé C du bassin versant de la Merja Zerga. La carte finale de délimitation du bassin versant, obtenue à partir de ces analyses, est présentée ci-dessous (Figure 24). La surface du tracé C du bassin versant calculée est de l’ordre de 914 km². Figure 24. Tracé C du bassin versant de la Merja Zerga (Réalisation : Ayadi H., 2011) En prenant en compte le tracé C du bassin versant de la Merja Zerga, ont été étudiés plus particulièrement : le milieu physique, l’occupation du sol et les motivations des agriculteurs.
Espace structuré par des conditions naturelles et des aménagements hydro-agricoles
L’espace structuré du territoire de la Merja Zerga est caractérisé par une unité spatiale : le bassin versant où se déroulent les processus et interfèrent différents mécanismes de la pollution phytosanitaire diffuse. Cet espace est structuré par la topographie, le réseau hydrographique et géo-hydrographique et les éléments conditionnant les types de sols influençant la variabilité spatiale des cultures et la mobilité des composés phytosanitaires, en influençant la variabilité spatiale des conditions climatiques de la zone, le relief induit par ailleurs une différenciation spatiale des contraintes dues à l’humidité
Caractérisation du milieu naturel
L’étude de la répartition des cultures agricoles et le diagnostic de la contamination du milieu naturel par les produits phytosanitaires nécessite une analyse et des connaissances de : – La topographie de la zone d’étude caractéristique du milieu naturel qui conditionne fortement les écoulements et la mobilité des phytosanitaires ; – Le réseau hydrographique vecteur de transfert des matières actives entre les parcelles culturales et vers la Merja Zerga ; – Les caractéristiques de la nappe ; – Les caractéristiques pédologiques des terrains agricoles, – Les caractéristiques du sous-sol et substrum, des facteurs qui conditionnent les transferts verticaux des phytosanitaires vers les nappes souterraines ; – les caractéristiques du climat et des bioclimats du territoire.
Action directe de la topographie sur les écoulements et la mobilité des phytosanitaires
L’analyse spatiale en 2D du MNT de la région du Gharb-Chrarda Bni-Hssen montre que le bassin versant de la Merja Zerga présente des altitudes au-dessous de 0 m (niveau de l’atlantique) sur une grande partie (Figure 25). Il s’agit des dépressions et des zones desséchées pour la mise en culture. Le reste du bassin présente des altitudes variant de 130 m au point le plus haut sur la commune de Sidi Boubaker El Haj et 0 m sur la plaine centrale. Il présente des terrains très plats dans la partie basse de la zone d’étude. Une légère élévation au niveau de la commune de Sidi Mohamed Lahmar de l’ordre de 60 m subdivise le bassin versant en deux sous bassins versant : le sous bassin versant d’oued Drader (ORMVA du Loukkos) et celui de la partie nord de la plaine du Sebou (ORMVA du Gharb). Figure 25. Altitudes du bassin versant de la Merja Zerga (Réalisation, Ayadi H., 2012) Chapitre VII 112 Les pentes du bassin versant ne sont fortes qu’en de rares endroits : 1 % de la zone seulement concentre des pentes supérieures à 15%. Ces quelques pentes fortes sont concentrées sur les périphéries du bassin versant et au centre au niveau de la commune de Sidi Mohamed Lahmar. L’essentiel du territoire étudié connaît des pentes faibles, de l’ordre de 0 à 3% (Figure 26). Figure 26. Pente du bassin versant de la Merja Zerga (Réalisation : Ayadi H., 2012) Celles-ci conditionnent la circulation de l’eau et exercent un contrôle direct sur le temps de séjour des eaux à la surface du sol ainsi que sur leur infiltration. Elle peut induire des infiltrations préférentielles en certains points ou dans certaines parties de l’espace (notamment dans les bas de pente) (Castany 1982).
Réseau hydrographique favorisant le transfert des phytosanitaires vers la Merja Zerga
Le réseau hydrographique dont la Merja Zerga constitue l’exutoire est issu d’un travail de SIG par digitalisation des cartes topographiques des zones de Kénitra, Sidi Allal Tazi, Souck Larbâa, Moulay Boucelhem, Région du Loukkos, Machra Bel Ksiri, Lalla Mimouna (Direction de la Conservation Foncière et des Travaux Topographiques division de la Cartographie de Rabat, 1996) et d’analyse spatiale en 3D des expositions issues du modèle numérique de terrain (MNT) de la région du Gharb-Chrarda-Bni-Hssen (Figure 27). Il a aussi fait l’objet d’un travail de validation auprès des acteurs de la gestion de l’eau agricole au niveau du bassin versant de la Merja Zerga. Chapitre VII 113 Figure 27. Expositions de surface issues de l’analyse spatiale en 3D du MNT de la région du Gharb-Chrarda-Bni-Hssen (Réalisation : Ayadi H., 2012) À l’issu de ce travail, nous avons constaté que la Merja Zerga reçoit les eaux du bassin versant par deux voies principales : oued Drader au nord et le canal de Nador au sud. L’oued Drader draine un sous-bassin versant de 318 km2 et aboutit dans la Merja Zerga à deux endroits, le premier à l’extrémité du chenal principal alors que le second se termine par un delta dans la partie nord-est de la Merja Zerga. Ces dernières années son débit est fortement affaibli sous l’effet de prélèvement et de pompage d’eau à des fins agricoles (GAM 2008). Le canal de Nador, grand affluent artificiel débouchant dans la partie sud de la Merja, a été creusé en 1953 avec pour objectif le drainage des eaux des marécages de la région agricole du « Gharb ». Le canal de Nador est alimenté par plusieurs groupes d’assainissement en rive droite du Sebou constitués par le groupe de l’oued Mda, les groupes de Madegh et de la Merja Merktane (ORMVAG 2010). Le groupe de l’oued Mda prenant naissance dans les collines au Nord et Nord Est de Souck Larbâa. Il reçoit les eaux des oueds Kerouta et Kebir puis celle de l’oued Akehal. Après leur confluence en limite des secteurs N2 et N9, l’oued est calibré et rectifié. Il franchit le seuil du Segmat, prend le nom de Segmat Haut et traverse les zones non équipées de la zone côtière pour rejoint le canal Nador en assurant la jonction avec la Merja Zerga. Le groupe de Madegh qui collecte les bassins versants des collines situées à l’Est d’une ligne Souk Larbâa Mechra belksiri. Cet oued est calibré sur une partie de son tracé à l’intérieur des secteurs N5 et N4 sous la désignation de canal Harhar puis N3, N2 et N1 ; il est alors désigné par canal Madegh. Il franchit le seuil du Segmat, prend la désignation de Segmat Bas et Chapitre VII 114 traverse les zones non équipées de la zone côtière ; Il rejoint ensuite le canal Nador assurant la jonction à la Merja Zerga. Les canaux Segmat Haut et Segmat Bas sont deux émissaires parallèles mais décalés en altitude. Le Segmat bas assainit des zones plus basses que le Segmat Haut, il est plus profond à l’origine. Le groupe d’assainissement de la Merja Merktane (désigné par groupe CA-CE-CK), est constitué des fossés primaires d’assainissement des secteurs C1, C2, C3 et C4 (Figure 28). Ce réseau a la particularité d’avoir deux exutoires : le premier est le canal du Segmat Bas où se déversent les eaux d’assainissement des secteurs C2, C3, et C4, le deuxième est un rejet à l’oued Sebou à 1,5 km en aval de Sidi Allal Tazi et dont l’exutoire nécessite un pompage : SP d’exhaure Ouled Khalifa située sur la berge RD du Sebou. Le canal CK assaini le secteur C1 et arrive à cette station de pompage. Les canaux CE et CK forment un ouvrage continu permettant d’évacuer les inondations vers le Segmat et en régime normal (pas de crues, pas d’inondation) l’assèchement de la merja Mektane. Il est à noter que plus de la moitié de cette zone est équipée en réseaux rizicoles.
INTRODUCTION GENERALE |