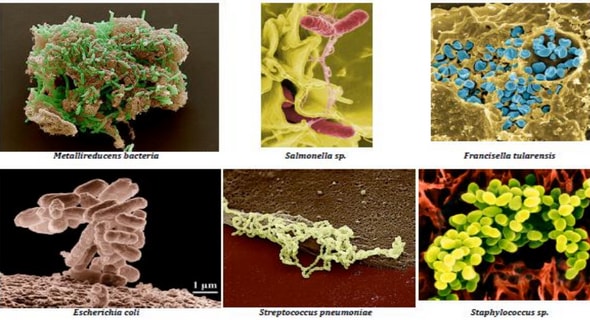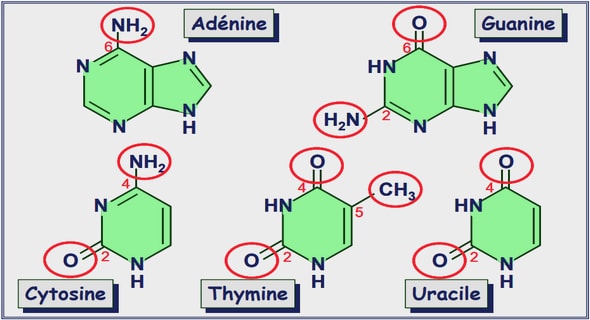Ressources en eau, gestion intégrée et perspectives d’un aménagement du complexe des zones humides
Menaces sur l’écosystème lacustre
L’expansion de l’agriculture Le complexe est une région essentiellement à vocation agricole dont la surface agricole utile représente 47%, allant du maraîchage aux cultures spéculatives qui exigent une forte consommation d’eau d’irrigation. Lorsque l’irrigation est utilisée surtout en été, c’est le plus souvent au dépend des lacs et zones humides sources d’eau facilement accessibles. Plus de 300 hectares, des terres cultivées irrigués à partir des eaux de quelques zones marécageuses du complexe qui produisaient essentiellement des tomates [82%], des pastèques [16%] et 2% de poivrons , soit 1.13 hm 3 , d’eau prélevée au mois de juillet 2016. Fig.51. La superficie irriguée ainsi que le volume d’eau prélevé à partir des lacs de Guerbes-Sanhadja [Juillet.2016] Ainsi que l’utilisation excessive d’engrais et les fertilisants, en effet, 94 % des agriculteurs utilisent les fertilisants azotés [jusqu’à 800 kg/ha de type NPK [15/15] et ces quantités employées n’ont guère diminué, voire ont augmenté [Tab. 36]. L’état actuel d’un nombre des zones marécageuses montre un assèchement [environ 50% sont asséchées en période d’étiage] couplée à une eutrophisation avancée [Fig.52], liée aux rejets d’eaux usées domestiques et agricoles, riches en matière organique. Source : DSA Ben Azzouz. 2016 Donc l’agriculture irriguée à des impacts sur l’environnement du complexe [création de chenaux, rectification de cours, création de fossé pour un écoulement rapide de l’eau, engrais, pompages intensifs] avec une diminution de la recharge de la nappe. Ces pressions affectent fortement l’écosystème lacustre [biodiversité, écoulement des eaux, qualité de l’eau……]. Fig.52.Exemples de menaces des activités agricoles portant sur les ressources en eau du complexe de Guerbes-Sanhadja : a): La pollution organique au niveau d’oued el Maboun ;b) : Trace d’eutrophisation au niveau du Garâat Ain Nechma ;c) : Pompage anarchique et intensifs pour l’irrigation Garâat Hadj Tahar ; d) : Assèchement du Garâat Moussissi. [HEDJAL ; 2017]
. Problèmes des rejets urbains
A l’instar du réseau d’assainissement, celui-ci ne couvre que les agglomérations de chef lieu et quelque agglomération secondaire. Pour le reste du complexe les rejets des eaux usées se font par des fosses septiques. Ce réseau arrive à satisfaire les besoins de 70 % de la population des agglomérations. Les rejets de ces réseaux s’effectuent en 11 points .Aujourd’hui le complexe connait un grave problème des rejets des eaux usées non traités. Environ 4954 m3 /j d’eaux usées domestiques effectués par les agglomérations rurales le long du cours d’eaux principales sans aucun traitement dans les ruisseaux et les affluents constituent une menace évidente de la qualité chimique des eaux du milieu, rejoignant les marais lors des inondations et atteignent ainsi les unités du complexe des zones humides
Menaces sur l’écosystème dunaire
Malgré l’existence d’une loi consacrée au littoral [Loi n° 02-02 du 5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral] et qui protège l’écosystème dunaire où les dunes font l’objet d’un classement en zones critiques ou en aires protégées .Cet écosystème demeure menacé
La surexploitation des ressources
[Les sablières] L’exploitation du sable en tant matériau de construction et/ou le manque de surveillance et de contrôle a constitué une autre forme de dégradation, par l’extension des sablières menaçant ainsi le couvert végétal dont le rôle est la fixation du système dunaire. En creusant les fosses des sablières, les niveaux aquifères de la nappe deviennent plus vulnérables à la pollution. Ces trous béants laissés en l’état permettent l’accumulation de détritus divers surtout qu’ils sont localisés près des habitations. Pouvant servir comme dépotoir, elles constituent une vraie menace supplémentaire pour les eaux souterraines présentent dans les dunes. Le tableau ci-dessous représente les variations de la quantité du sable exploité durant la période [1995-99].Nous signalons que ces données ont été enregistrées dans une période où le seul exploitant était la commune de Ben Azzouz et sur un seul site. Comment peut-on imaginer alors le risque et les conséquences de la surexploitation du sable avec l’installation de trois sablières dans des sites différents sur le cordon dunaire er de façon illégale et sans aucune limite d’exploitation ?
Menaces sur l’écosystème forestier
Devant la nécessité impérative de nos jours de préserver les ressources en eau et de contribuer à la protection de la santé publique, de nombreux travaux de recherches et procédés mentionnent le rôle phyto-épurateur des eaux usées et la rétention des produits toxiques par les plantes. Ces procédés montrent que l’utilisateur d’écosystème dans lesquels les végétaux prennent une place prépondérante. Les formations végétales naturelles des zones humides, tels que celles de Sanhadja sont particulièrement adaptées au rôle d’épuration des eaux usées, malheureusement ces dernières d’années on assiste à la destruction de ce couvert végétal épurateur:
Le défrichement
Le défrichement de milieux boisées se pratique à grande échelle [de l’ordre de 50 ha/an] [Toubal.O et al.2014] pour développer des activités agricoles sur des sols certes productifs pendant une ou deux années mais bien rapidement appauvris car insuffisamment structurés [Fig.55 ; Fig. 56].
Les incendies L
e facteur de dégradation le plus violent de la forêt est sans contester l’incendie. Elle modifie la composition et la structure de la végétation et empêche la régénération de certaines espèces. Parmi ces derniers, la subéraie est très touchée par les dégradations, pour augmenter les surfaces cultivables sur sols accueillants [Fig.57]. D’après Boudy, 1955 in Raachi .2007 une subéraie pourrait résister au passage de trois feux successifs, suite aux quels, la plupart de Superficies défrichées 93 cette formation de chêne liège subit une régression vers l’état de maquis arboré où la densité des arbres diminue. La cause principale étant l’homme, mais devant l’insuffisance des moyens de surveillance et d’interventions, ce problème risque d’échapper au contrôle.
Le surpâturage
Le surpâturage a lourdement contribué dans le compactage des sols et a eu une double action sur : La régénération naturelle de la forêt de chêne liège par le pacage des jeunes plants et des glands. Aussi en présence d’un sol compact, les glands ne peuvent s’enfoncer et germer. Le compactage des sols et notamment les sols argileux et marneux, cause leur imperméabilité or une faible infiltration des roches affleurantes indique qu’une grande quantité d’eau ruisselle, par conséquent, une forte quantité de terre peut être emportée. Les sols marneux lorsqu’ils sont secs, restent non érodables, mais dès qu’ils atteignent une certaine humidité, leur sensibilité à la détachabilité et au ruissellement augmente. [Raachi. 2007]. Pour la réglementation algérienne cette activité est interdite « Le pâturage dans le domaine forestier national est organisé par voie réglementaire. Il est cependant interdit : dans les zones incendiées, dans les aires protégées. [Article 26 Loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portant régime général des fôrets]. [Ministère de l’agriculture et du développement rural. Mars .2011]. Tous ces facteurs contribuent à la réduction des espaces forestiers dans le territoire du complexe de Guerbes-Sanhadja. Il risque à moyen terme d’entraîner la dévalorisation du patrimoine naturel du complexe. La destruction du couvert végétal entraîne aussi d’autres fléaux tels que la déstabilisation du massif, l’érosion éolienne, la sécheresse….. , qui se répercuteront sur la sédimentation des lacs et leurs disparitions.
CHAPITRE 1: LES CARACTERISTIQUES PHYSICO-GEOGRAPHIQUES |