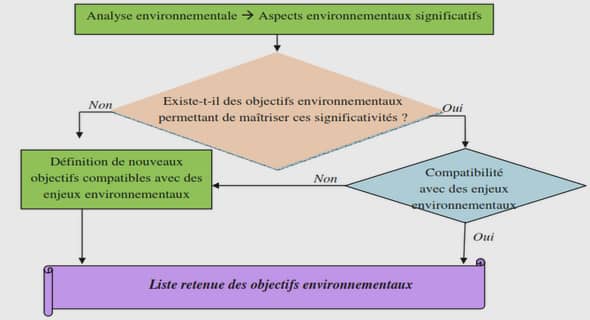Les débuts : la reconstruction (1985-1993)
Création et nomination du directeur du C.A.C
Faisant le bilan des expériences d’un passé récent compliqué et profitant de la nouvelle politique mise en place par le Ministre de la Culture Jack Lang depuis 1981 et l’arrivée de la gauche au pouvoir, l’intercommunalité d’Evry, SANE (regroupant les villes d’Evry, Lisses, Bondoufle et Courcouronnes) négocie avec la Rue de Valois la création d’un CAC, centre d’action culturelle, dès 1984.
Dans une note de service de Pierre Jean-Banuls, directeur général de la Régie de l’Agora datant du 10 juillet 198512, on apprend que les discussions ont abouti. Avec les agréments nécessaires et l’assurance du maintien des subventions, d’un reclassement du personnel, il est décidé de nommer un directeur culturel : Bernard Castera « précédemment directeur du Centre culturel de Saint Cyr l’école (Yvelines) ». Le C.A.C nait officiellement lors du comité du SAN du 9 juillet 1985. La machine administrative et les échanges épistolaires se mettent en route, François Bousquet, président du SAN, confirme à Dominique Wallon, directeur du développement culturel du Ministère, son « accord plein et entier sur la désignation de M. Bernard Castera au poste de Directeur du Centre d’action culturelle de l’Agora d’Évry » et précise que celui-ci sera recruté officiellement au 1er octobre 198513. Le ministère confirme ce choix le 14 octobre 1985 et demande la mise en place d’une convention avant la fin de l’année, la création de l’association qui contrôlera le C.A.C et l’établissement pour « une durée de 3 ou 4 ans d’un projet culturel et artistique global14. ».
Avant cette réponse (arrivée presque un mois après), la présentation de la saison 1985/1986 que Bernard Castera n’a nullement préparé mais dont il hérite s’est déroulé le 5 octobre.
Pour cette journée de présentation, il y a eu 3000 envois d’invitations en direction des collectivités, personnalités, bibliothèques, corps enseignant, documentalistes, professeurs de danse, de musique, conservatoires, adhérents de la Galerie de Prêts, artistes, élus de la Ville Nouvelle, personnel du SAN et de l’Agora, Groupe Central des Villes Nouvelles… 174 retours ont été enregistrés et 30 personnes devaient prendre le bus de Paris. Le 5 octobre, 145 personnes se sont inscrites sur les listes. Celles venues à la présentation représentaient une quarantaine de collectivités, cinq lycées et CES, des adhérents et artistes de la Galerie des Prêts, des artistes et responsables de compagnies ayant joué ou se produisant cette saison à l’Agora, des journalistes, aucun élu du SAN n’était présent. Un seul journaliste national spécialisé en danse était présent, la presse écrite locale était représentée par le Républicain et le Parisien, trois radios locales (Top Essonne, CANAL 102, la radio associative de Saint Michel) ont assisté à la soirée, « Dans l’ensemble cette journée a été positive dans la qualité des échanges et des mises en relations qu’elle a favorisé. Un gros effort reste à faire pour faire venir le public à tous les spectacles de la part de toute l’équipe.15 ».
« Son directeur a tout à rebâtir et il le fait avec le soutien efficace de quelques élus responsables et de caractère qui savent s’imposer dans un environnement peu motivé la fois par une ambition culturelle et par la prise en charge d’équipements relevant d’une intercommunalité dénigrée. 16» Le combat des subventions pour le C.A.C commence dès ce mois d’octobre 1985, le député-maire d’Evry Jacques Guiyard en tant que président de la Régie de l’Agora s’adresse au conseiller général Roland Olivier17, s’offusquant de la différence de traitement entre Evry et le C.A.C. de Corbeil-Essonnes, Pablo Néruda, dirigé par Alain Héril, (comédien, metteur en scène, écrivain « construit, comme ceux de Ris Orangis, de Brétigny et de Saint Michel sur Orge, en réaction à la ville nouvelle par des municipalités voisines, en général communistes, qui voulaient maîtriser la promotion culturelle, la leur. 18», qui pourtant font partie à présent du même réseau national.
En 1985 Pablo Néruda recevra du département au minimum 505 000 Francs quand l’Agora n’obtiendra que 349 800 Francs, le département s’étant engagé a augmenté ses subventions de 5% l’année suivante, la différence de traitement s’accroîtrait « sans qu’aucune analyse sérieuse, ni des productions, ni des programmations, ni des conditions de fonctionnement, ne saurait légitimer pour le C.A.C. du chef lieu de l’Essonne. »
« Le Journal officiel du 9 octobre 1985 publie la déclaration à la préfecture de l’Essonne le 25 septembre 1985 de l’association Centre d’action culturelle de l’Agora d’Evry, dit : Agora actions culturelles. Son objet : promouvoir la création artistique contemporaine ; contrôler la gestion matérielle et financière du centre d’action culturelle. Son président est Pierre-Jean Banuls, par ailleurs directeur de la Régie de l’Agora. Son directeur est Bernard Castera nommé en juin 1985 avec l’agrément du Ministère de la Culture.19
La création de cette structure trouve sa source principale dans la dissolution de la Régie de l’Agora programmée pour décembre 1985.
La lourdeur administrative et financière de la Régie rendait nécessaire la mise en place d’autres structures plus adaptées à la situation. Jusqu’en décembre, le transfert des responsabilités et des financements s’opère du service Agora Actions Culturelles à la nouvelle structure Centre d’Action Culturelle (C.A.C.). Le conseil d’administration provisoire de l’association est remplacé par un conseil structuré selon les normes du Ministère de la Culture : 6 représentants du SAN, 3 représentants de l’Etat, 7 membres associés agréées par le Président du SAN et le Directeur du Développement Culturel (Ministère de la Culture. Le nouveau président est André Holleaux, conseiller d’Etat, ancien directeur du cabinet d’André Malraux, membre associé du Conseil d’administration20 ».
Le fonctionnement : une coopération entre l’Etat et la collectivité territoriale
S’il est annoncé qu’une scène nationale fonctionne sous régime associatif, il faut très vite clarifier cette affirmation. Il s’agit, pour la plupart des scènes nationales, d’associations dites « fermées ». C’est-à-dire que n’en font partie que des membres choisi : on y trouve d’abord des membres « de droit », qui représentent l’Etat et les collectivités qui concourent à leur financements et ensuite des membres « associés », qui sont des personnes dont la candidature présentée par un membre de droit est agréée par le Ministère de la Culture et le maire ou les présidents des instances concernées. Leur nombre doit être inférieur à celui des membres de droit. Compte tenu de cette situation fermée, les assemblées générales pour respecter le statut associatif, ne sont que des formalités nécessaires une fois par an, à l’occasion d’un conseil d’administration, puisque les membres de l’association et ceux du conseil sont les mêmes
Cette curiosité a son histoire : les scènes nationales sont les regroupements de différentes structures telles les CAC (centre d’action culturelle) mais aussi les maisons de la culture inventées par Malraux. Ces dernières étaient des structures ouvertes où la vie associative était à la base de l’institution. Il existe encore quelques scènes nationales à structure associative ouverte dans laquelle peuvent entrer tous les « aficionados » de la vie culturelle mais elles ne sont plus très nombreuses. Le Volcan au Havre fait partie de celle-ci et son association est très attachée à ce principe. Si l’on interroge sur le pourquoi de cette mutation, les directeurs répondent que le système associatif était source de conflits croisés inefficaces et ils se satisfont pleinement de la situation actuelle. Robert Abirached, qui fut à la tête, pendant les années Lang, de la direction des théâtres, explique cette évolution en trois phrases.
Dans le tome 2 de son ouvrage « Le théâtre et le prince » il dit à propos des scènes nationales : cofinancées par l’Etat et les collectivités territoriales, elles sont gérées par un conseil d’administration où leurs deux tutelles sont majoritaires. C’en est donc fini du statut largement associatif qui leur avait été accordé à leur fondation et qui avait donné lieu à tant de crises. Charbonnier est devenu maître chez soi d’autant plus naturellement qu’il détient les cordons de la bourse. 23»
Soit, mais de CAC à scène nationale, on a l’impression qu’il n’y a qu’un changement de nomination. Le directeur doit composer avec des supérieurs étatiques qui tiennent « la bourse », qui a l’argent a le pouvoir, de la à réduire Bernard Castera en simple fonctionnaire ? Nous n’oserons pas, à l’automne 1985 il détient les clefs de la création artistique, il devient la pièce maitresse du dispositif.
Dire que les directeurs relèvent d’un corps culturel de l’Etat serait excessif, puisqu’ils ne sont pas fonctionnaires et sont de ce fait sur des sièges éjectables sans garantie de reclassement24 »
Le premier projet de Bernard Castera et l’affrontement avec la réalité 1986-1990
Dans le jeu de coopération entre Etat, ville et directeur et l’établissement le directeur dispose d’une grande autonomie pour définir sa politique. Son indépendance est inscrite dans les statuts et dans la pratique des villes, mais elle tient aussi aux contradictions et aux oppositions entre attentes des différentes tutelles. Cette liberté d’action ne peut cependant être productive que dans la mesure où les directeurs parviennent à mobiliser des réseaux de partenaires et à empêcher que les collectivités publiques ne se désintéressent du théâtre. Ces stratégies placent les CDN et les scènes nationales en position d’établissements structurants pour les activités culturelles locales25 »
Ecrit entre le 30 octobre et le 3 novembre 1985, le premier projet artistique pour le Centre d’Action Culturel de l’Agora trace les axes de travail qui doivent permettre au nouvel établissement de progresser de septembre 1986 à décembre 1989.
Le projet se fixe sur un double objectif : répondre aux exigences statutaires d’un Centre du réseau national qui doit « s’affirmer comme un lieu de production artistique de référence nationale, organiser la diffusion et la confrontation des formes artistiques en privilégiant la création contemporaine, participer dans son aire d’implantation à un développement culturel favorisant de nouveaux comportement à l’égard de la création artistique. » et « faire du CAC de l’Agora d’Evry un des éléments moteurs de la vie culturelle régionale et participer ainsi au renforcement du pôle que constitue l’Agglomération Nouvelle, selon le Plan d’Action Régionale établi par la DRAC, Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Ile-de-France.
Le projet n’est pas conduit sur un terrain vierge. Le Centre Culturel de l’Agora, puis la Régie de l’Agora, ont mené depuis 10 ans une activité culturelle sur la Ville Nouvelle.
Le projet vit à la fois dans la continuité et en rupture de cette histoire qui a connu ses résultats positifs, ses limites et ses échecs, avec une équipe déjà constituée et un équipement donné.
La rupture se joue dans la place qu’occupera la création, la production artistique. Bernard Castera souhaite « privilégier un axe d’activité, ce qui nécessairement entraine une réduction dans d’autres secteurs26 » et propose un axe principal la danse contemporaine, le projet prenant appui sur les recommandations d’un rapport du Ministère27, mettant en cause la « vocation universaliste » des établissements d’action culturelle qui a eu pour principale conséquence de « les amener à conduire des actions dispersées et trop souvent superficielles28 ».
Les qualités techniques de l’équipement, les compétences d’une partie des professionnels du CAC et le travail mené au cours de ces dernières années rendent possible une action prioritaire dans ce domaine. […] Je propose donc que le Centre d’Action Culturelle de l’Agora mène en priorité une action chorégraphique de création de formation des publics et de diffusion.
Je souhaite que les productions chorégraphiques soient envisagées sous l’angle de l’interdisciplinarité recommandée par le rapport PUAUX. Il me parait en effet intéressant de favoriser la rencontre de la Danse avec d’autres disciplines artistiques, de créer des passerelles lui permettant de rompre un certain isolement, sa marginalité, et de faciliter une approche diversifiée par le public.
L’œuvre créée – sa situation dans les divers courants de la danse contemporaine, son thème, ses formes, les intervenants : compositeur, scénographe, décorateur – la démarche propre du chorégraphe, ses affinités artistiques peuvent être le support d’une telle interdisciplinarité.
Autour de la création, diverses productions ou actions pourraient être engagées. Par exemple, selon les œuvres et les possibilités budgétaires : édition de textes, réalisation vidéo, exposition, concert ou animation musicale, accueil de créateurs invités par le chorégraphe, débat…, la diffusion des productions réalisées à cette occasion devant être envisagée. Il faut noter également que plusieurs secteurs d’activité du CAC étudiés plus loin peuvent trouver ici un prolongement.
Ces actions exigent une plage particulière dans la programmation du CAC. La résidence du créateur et de son équipe est très certainement la forme de travail qui permet le mieux de telles rencontres artistiques et l’établissement de relations plus étroites avec les publics. Elle peut être le temps fort d’un travail de formation : répétitions publiques, stages avec les professeurs et les élèves de certains cours de danse, les AS/danse des lycées et collèges, interventions dans des établissements scolaires … Il va de soi que cette démarche de production ne peut être menée qu’avec des chorégraphes ayant une certaine maturité, possédant le sens du contact et la volonté de rencontre avec les publics. Une à deux créations me paraissent pouvoir être ainsi programmées chaque saison, sous réserve que des producteurs et des financements complémentaires soient trouvés.
Parallèlement à la production et au travail de formation, le CAC peut accueillir en simple diffusion plusieurs spectacles chorégraphiques offrant ainsi au public régional un choix représentatif de la diversité et de la vitalité de la danse contemporaine. La définition de ce projet intervient à un moment où l’Etat, l’Agglomération Nouvelle et la Compagnie Marie-Christine GHEORGHIU ont signé une convention jusque fin 86.
L’implantation d’une Compagnie peut parfaitement converger avec la forme de travail proposée par le projet. Mais l’implantation et les relations de la Compagnie Marie-Christine GHEORGHIU avec le CAC doivent être- établies sur des bases claires : un établissement d’action culturelle ne peut subventionner une compagnie. Son intervention doit se limiter à une assistance technique, à une collaboration dans le cadre de la politique d’animation et à des participations éventuelles à des coproductions sur la base de projets artistiques précis. 29»
Il choisit aussi un soutien à la création, le Théâtre et les Arts Plastiques. Le projet envisage une modification de l’activité musicale et la poursuite de l’action engagée auprès du Jeune Public.
Le directeur est aussi très conscient du contexte et de la conjoncture auxquels il hérite et auxquels il doit faire face, tendance à la baisse de fréquentation des salles de spectacles dont la Régie de l’Agora a pris des longueurs d’avance mais aussi liées au contexte d’une Ville Nouvelle et du lieu, l’Agora « refuge des dealers et des marginaux30 ».
« De plus, un spectacle terminé, ce même spectateur, rejeté brutalement sur la sinistre Grand’Place, va devoir affronter… les parkings. Avec, au bout de l’aventure, l’inconnu : la voiture aura-t’elle encore ses quatre roues, son auto-radio ? Que ceux qui trouvent que j’en rajoute veuillent bien m’excuser : j’ai pu, dès ma première semaine à Evry, vérifier à mes dépens que le lieu est à la hauteur de sa réputation31. »
La dynamique à créer pour lui doit tenir compte des difficultés bien qu’il ne connaisse pas de son propre aveu le contexte local.
En octobre 1985, il n’y a pas ou plus d’abonnés, il a pu constater que contrairement aux Arènes dont l’architecture s’impose les salles de l’Hexagone et du Studio n’ont aucune réalité extérieure « il faut quelque persévérance au spectateur moyen pour trouver ces deux salles ».
Il n’y a pas de fronton et pas de lieu d’accueil avant les spectacles, ça ne peut avoir que des conséquences sur ce qui se passe dans les salles.
La transformation matérielle étant déjà prévue, il souhaite s’attaquer à la transformation de son image, les appellations « Agora Actions Culturelles » et Centre d’Action Culturelle de l’Agora » ne lui plaisent guère, elles ne sont pas attractives pour le public, il souhaite que le lieu se nomme « Théâtre de l’Agora » au moment où naît un véritable théâtre à Evry.
Les statuts définitifs du Centre d’Action Culturelle de l’Agora d’Evry sont adoptés le 9 janvier 1986.
La situation financière laissée au CAC par le directeur de la Régie est saine.
Les dossiers d’aménagement du théâtre sont, pour l’essentiel, bouclés.
La réalisation de ces projets permettra d’améliorer les conditions d’accueil du public et de travail de l’équipe de permanents.
Par contre, la fréquentation du public est catastrophique32.
Deux chiffres en donnent la mesure : à la fin de la saison 1985/86 te CAC. a 26 permanents pour 47 abonnés.
Dans l’introduction d’un rapport sur l’Agora, la directrice des relations publiques d’Agora Actions Culturelles écrivait en juin 1984 :
• Le développement de cette étude sur l’Agora d’Evry part de quelques constats simples :
une désertion des publics de plus en plus importante
une absence d’audience médiatique (locale et nationale)
une absence de politique d’information réelle (concepts et diffusion)
une absence, enfin, de politique d’accueil vers les publics concernés.
Ce constat global justifiait à lui-seul la nécessité du changement de structure qui se produisit l’année suivante.
Le projet artistique du directeur est adopté le 29 janvier 1986. La saison 1986/87 marque le début de l’action du Centre d’Action Culturelle.
Peut-être que, si « les gens » ne viennent plus à 1 ‘AGORA – j’exagère volontairement – peut-être faudra-t’il aller chez eux. Carrément chez eux : dans leur appartement, comme Pierre ASCARIDE et son Théâtre sans Domicile. 33»
Elle est ouverte par une série de représentations d’un spectacle en appartement, Une heure de magie, mis en scène par Ariane Ascaride, sœur de Pierre Ascaride, l’un des inventeurs du théâtre à domicile ; « […] à une transformation de son image ainsi que de celle de l’entreprise qui 1’anime : par des manifestations spectaculaires, comme celle du « Merveilleux Urbain » animé par Ricardo BASUALDO, par exemple. Ricardo BASUALDO « interroge les formes spectaculaire d’événement urbain en terme de création d’une œuvre d’art éphémère. Celle-ci intervient comme un élément qui crée un rapport nouveau, d’ordre sensible dans la relation au lieu coutumier »(in «lieuxpublics » annuel 8434) », et par un événement artistique sur la place des Miroirs dans le quartier des Pyramides, Mirages, conçu et dirigé par Ricardo Basualdo, auquel assistent environ cinq mille personnes. Bernard Castera en écrivant son projet à l’automne 1985 savait donc parfaitement les artistes qu’il embaucherait pour « sa » saison inaugurale.
Au cours de l’exercice 1986, un collectif budgétaire réduit de 5% la subvention du Ministère de ta Culture.
Par une lettre en date du 8 mars 1987, Jacques Guyard, député-maire d’Evry, informe le président Holleaux que, sur recommandation de l’inspection du Ministère des Finances, des décisions de réductions budgétaires qui mettent en cause l’existence du CAC vont être prises. Ces décisions sont motivées par le déficit du SAN évalué à 12 millions de Francs.