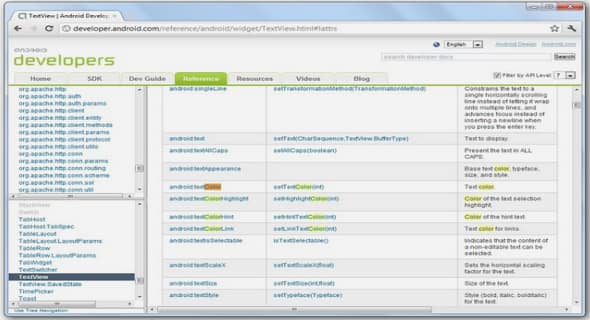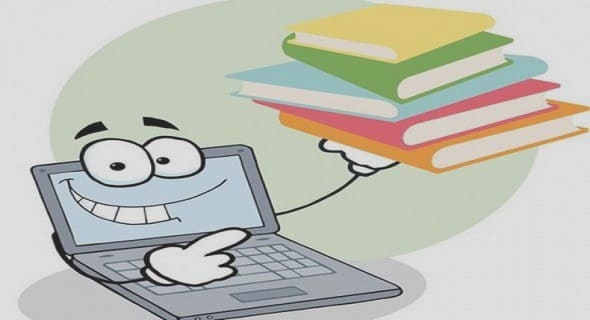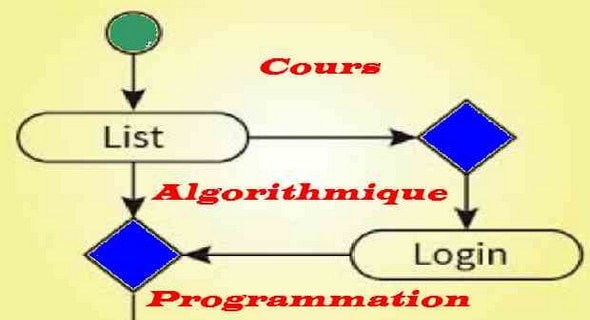Cloisons, rideaux : des instruments permettant de voir ou de cacher
Si l’archéologie repère facilement les structures des bâtiments, dont il ne reste bien souvent que les fondations, elle ne permet pas toujours de comprendre l’agencement interne des bâtiments qui serait en matériaux plus légers, en particulier lors des fouilles les plus anciennes, moins attentives à certaines problématiques que les chantiers plus récents. Néanmoins, ces dispositifs se révèlent importants dans la compréhension de la perception visuelle des bâtiments consacrés aux dieux. Pour comprendre la manière dont ils modifiaient la vision des visiteurs, nous analyserons deux cas de séparation : les cloisons et les rideaux.
L’usage de cloisons
La présence de cloisons permet de modifier de façon plus ou moins temporaire l’espace intérieur d’un édifice et son appréhension par les pèlerins. En effet, ces séparations peu épaisses, qui servaient à isoler un espace, étaient présentes dans les sanctuaires à incubation, comme nous l’avons vu plus haut à l’Asclépieion d’Athènes ou de Cos2. Le but recherché était de donner plus d’intimité pour le sommeil, propice à la rencontre avec le dieu. Les consultants étaient séparés des autres visiteurs, qui ne devaient probablement pas les voir.
Dans d’autres cas, des cloisons isolaient une partie plus sacrée, interdite à la vue des non-initiés par exemple. Ainsi, à Samothrace, l’Anaktoron comptait à l’angle nord une partie plus élevée séparée par un mur de porphyre rouge élevé sur une fondation de pierre. Derrière ce mur, un grand bloc de porphyre rouge a été trouvé in situ. Cette paroi transversale devait porter une partition en bois, peut-être décorée, mais qui n’atteignait pas le plafond ; deux portes permettaient d’y accéder3. La cloison cachait les actes rituels qui se déroulaient dans cette partie sans avoir la fermeture et la solidité d’un mur plein. Elle pouvait être un élément temporaire ou postérieur à la construction.
Les portes pouvaient être utilisées comme cloisons : mobiles, elles pouvaient permettre d’ouvrir ou de fermer, et donc de laisser voir ou de cacher. Elles modifiaient temporairement la vue. Ainsi, Euripide décrit la visite de Créüse et de Xouthos à Delphes dans sa pièce Ion. Quand Xouthos entre dans le temple pour consulter le dieu, les servantes attendent devant le temple. Lorsque Ion arrive et leur demande où se trouve Xouthos, la coryphée lui répond qu’il est toujours dans le temple, mais un bruit de portes (τῶνδε πυλῶν δοῦπον) annonce sa sortie1. Les portes empêchaient de voir ce qui se passait derrière et interdisait de pénétrer dans l’espace qu’elles fermaient.
Mais les portes étaient également une ouverture permettant d’entrer et de voir, c’est ce que montre Lucien à propos de l’Aphrodite de Cnide2. La présence de portes exprime une alternance entre fermeture et ouverture. La présence d’une porte ouverte permet d’accéder et de voir, tandis qu’une porte fermée rend invisible l’intérieur d’un édifice ou d’une partie de celui-ci. Cet élément permettait également de jouer sur des moments d’ouverture et de visibilité et sur des moments de fermeture. Les cloisons temporaires ou mobiles, les portes permettaient de rendre accessibles à la vue ou de cacher ce qui se déroulait à l’intérieur des édifices. Elles complétaient et complexifiaient l’architecture en jouant de façon plus souple sur la vision des visiteurs, tout comme pouvaient le faire des rideaux.
La présence de rideaux
Les rideaux sont des pièces de tissu mobiles qui peuvent être tendues et retirées. La façon dont ces pièces de tissus étaient déployées dans les temples modifiait la vision des Grecs et leur perception de l’édifice. L’usage de rideaux permettait de jouer sur ce que les pèlerins voyaient ou non en cachant temporairement pour mieux rendre visible par la suite, un objet, un espace. Quelques tentures sont mentionnées dans les sources, mais cet élément est bien souvent peu analysé. Les pièces de tissu ainsi utilisées dans les sanctuaires pouvaient, selon leurs dimensions, être de véritables rideaux dans les sanctuaires permettant de montrer ou de cacher de façon temporaire, ou de clore un espace.
Les tentures se définissent comme des objets mobiles utilisés dans les temples ; elles sont parfois mentionnées dans des dédicaces. Des desservants ou des adorants les offraient à une divinité. Ainsi, à Didymes, une inscription présente l’hydrophore d’Artémis, ]-is, fille de Bacchios, dédiant un παραπέτασμα, une tenture à Artémis1. À Lagina, des rideaux ont été dédiés à Hécate au IIe siècle p. C. par le prêtre Aelianos et sa femme Arria2. Cette offrande n’est pas anodine, Diehl et Cousin expliquent que les prêtres d’Hécate étaient recrutés annuellement et se distinguaient par le coût important des dépenses liées au culte de la déesse, mais aussi par des largesses importantes. Il semble que des prêtres particulièrement zélés dans leur sacerdoce, étaient récompensés en étant autorisés à graver sur les murs du temple leur nom et leurs dons3. Sans être dans le cadre des largesses connues par d’autres inscriptions formalisées4, l’offrande de tentures représentait une offrande importante, coûteuse, et vraisemblablement utilisée dans le culte. L. Robert la qualifie d’« actes de générosité exceptionnelle en rapport avec la charge remplie »5.
L’inscription de Lagina apporte une précision, malheureusement fragmentaire, sur le lieu de la dédicace. J. Robert propose la restitution : τὰ ἐν [τῷ ναῷ]6. La définition de l’emplacement τὰ ἐν suivi d’un lieu montre une utilisation cultuelle précise, et non une simple offrande stockée dans l’opisthodome7 ou la réserve des temples, pour laquelle la précision serait inutile. De même, dans l’inscription de Didymes mentionnée, ]-is, fille de Bacchios, indique qu’elle a offert τὸ παραπέτασμα, « le rideau »8. Pour L. Robert qui souligne la présence de l’article τὸ devant le mot παραπέτασμα, l’usage du rideau ne semble pas douteux : il s’agit d’une grande tenture tendue dans la cella devant l’image divine d’Artémis9. Il en est de même en Lydie où offrande gardée dans les réserves1.
Les tentures les plus connues sont celle du temple de Jérusalem, et celle du temple de Zeus à Olympie offerte par Antiochos le Grand2. Pausanias mentionne ces étoffes : ἐν δὲ ᾿Ολυμπίᾳ παραπέτασμα ἑρεοῦν κεκοσμηνένον ὑφάσμασιν ᾿Ασσυρίοις καὶ βαφῇ πορφύρας τῆς Φοινίκων ἀνέθηκεν ᾿Αντίοχος, οὗ δὴ καὶ ὑπὲρ τοῦ θεάτρου τοῦ ᾿Αθήνῃσιν ἡ αἰγὶς ἡ χρυσῆ καὶ ἐπ’ αὐτῆς ἡ Γοργώ ἐστιν ἀναθήματα. Τοῦτο οὐκ ἐς τὸ ἄνω τὸ παραπέτασμα πρὸς τὸν ὄροφον ὥσπερ γε ἐν ᾿Αρτέμιδος τῆς ᾿Εφεσίας ἀνέλκουσι, καλῳδίοις δὲ ἐπιχαλῦντες καθιασιν ἐς τὸ ἔδαφος.
Antiochos a consacré à Olympie un rideau de laine orné de broderies assyriennes et teint de pourpre de Phénicie et c’est de lui qu’au-dessus du théâtre d’Athènes sont les consécrations, l’égide d’or avec la Gorgone dessus. On ne tire pas ce rideau vers le haut comme au temple d’Artémis à Ephèse, mais en le faisant glisser sur des cordelettes on le fait descendre au sol »3.
La description précise de Pausanias permet de comprendre comment ces rideaux étaient actionnés dans les sanctuaires. Les mécanismes étaient de deux types : soit le rideau était levé en dévoilant par le bas, soit il était baissé jusqu’à terre en découvrant par le haut4.
Dans les deux cas, l’étoffe permettait de modifier la vue de l’intérieur du temple, en cachant temporairement une partie de l’édifice, ainsi que son contenu, pour ensuite les dévoiler5.
Le mot παραπέτασμα est issu du verbe παραπετάννυμι, qui a le sens de tendre, étaler, ouvrir en parlant de bras, de tissus, de portes…. Avec le préverbe παρα- il signifie « étendre autour ». Le πέτασμα est un rideau, une tenture, un tapis, une couverture, ce que l’on étend6.
La Souda et Hésychius définissent parapetasma comme παρακάλυμμα, soit une couverture, un voile, ce qui sert à cacher. Hérodote mentionne des parapetasma dans le mobilier que le régent Pausanias découvrit après la fuite de Xerxès de Grèce7. Le commentaire de Legrand suggère des rideaux plutôt que des couvertures, voire la tente de Xerxès8. Des rideaux étaient également offerts aux théâtres, lieux de culte de Dionysos comme l’indique une inscription de la fin de l’époque hellénistique à Pergame1.
Le rideau pouvait être utilisé dans un sens de clôture. Ainsi, Porphyre affirme d’ailleurs que des rideaux étaient tirés dans les temples grecs en milieu de journée2 comme clôture temporaire, comme le confirme le quatrième mime d’Hérondas, rapportant la visite de Cynno et Coccalé à l’Asclépieion de Cos3. Les deux femmes se promenaient dans le sanctuaire en attendant l’ouverture du temple, Cynno décrit ce moment : ἡ θύρη γὰρ ὤικται κἀνεῖθ’ ὁ παστός, « la porte est ouverte, le tissu brodé est déployé »4, puis Coccalé s’extasie devant tous les beaux ouvrages qui s’y trouvent.
Le mot παστός est tiré du verbe πάσσω, signifiant saupoudrer, tisser une décoration dans un tissu5. Il prend le sens de voile dès Hérodote, IV, 56 ; c’est un dais déployé au-dessus de la mariée, une étoffe décorée ou brodée liée à la cérémonie de mariage à l’époque hellénistique6. L’étymologie populaire lie le mot παστός à παστάς, qui est un portique, une colonnade, en relation avec la cérémonie du mariage à partir de l’époque hellénistique, notamment en Egypte (AP VII, 188) : cette construction légère à laquelle était suspendu un παστός s’est progressivement confondu avec le rideau. Ces voiles constituaient une décoration particulière et éphémère devant ou autour du lit nuptial ou dans des cérémonies religieuses. Le pastos était un revêtement ; il symbolisait l’entrée dans un autre moment ou lieu7 et mettait en scène ce passage.
Chez Hérondas, aucune indication n’est donnée pour la distance par rapport à la porte8. Soit la tenture était proche de la porte et devait en quelque sorte la doubler9, comme élément de fermeture, pour mieux solenniser l’ouverture du temple en deux étapes et créer une attente par une ouverture progressive. Soit le rideau était dressé plus loin, il partageait alors l’intérieur du temple10 et isolait le groupe cultuel. Cela créait une attente auprès des pèlerins venus assister aux rites et prier devant les dieux. Cl. Vatin propose d’y voir une sorte de tapisserie spécifiquement utilisée pour les jours de cérémonie11. Cela pouvait être également un rideau ou une tapisserie masquant soit une porte1, soit un espace particulier qui pouvait contenir des objets spécifiques2.
Le Parthénon d’Athènes possédait également des rideaux. C’est une anecdote sur l’impiété de Démétrios qui nous permet de le savoir. En effet, Clément d’Alexandrie rapporte comment Démétrios fut proclamé dieu. Les Athéniens lui préparèrent alors un mariage avec Athéna lors de son second retour en 304-301. Selon Clément d’Alexandrie, Démétrios, plein de dédain pour la déesse, et ne pouvant épouser une statue, monte vers l’Acropole avec la courtisane Lamia, à laquelle il s’unit τῷ τῆς ᾿Αθηνᾶς ἐνεφυρᾶτο παστῷ, « derrière le voile masquant la statue de la déesse »3, exposant aux regards de la déesse les postures impudiques de la courtisane. En dehors du regard critique d’un père de l’Église contre la débauche et le culte des faux dieux – un Athénien ne dirait pas que la déesse n’est qu’une statue –, l’anecdote est intéressante pour la mention de ce pastos et par sa fonction : il cache la déesse aux regards, probablement lors de la fermeture du temple, peut-être pour la protéger.
Un autre tissu est connu sur l’Acropole d’Athènes. En effet, tous les ans, les arrhéphores tissaient un péplos pour Athéna Polias4, qui était remis solennellement à la déesse en une procession le jour de la fête des Panathénées. Ce péplos était tendu au mât d’un bateau sur roue5. La grande dimension du tissu et la petite taille du xoanon d’Athéna Polias font dire l. 19), des serrures (κεκλειδωμένος, l. 19), des statues (ἀγάλματα, l. 20), est cité παστῆον ξύλινον ναοειδές καὶ παστὸν λινοῦν, « un portique (pastas) en bois en forme de naiskos et un rideau en lin »1. Ce rideau semblait utile dans le cadre de ce nouveau culte, peut-être pour l’ornementation du sanctuaire, sans doute pour rendre invisible temporairement les statues.
Des rideaux étaient également attestés dans certains inventaires de temple. À Délos, au milieu du IIe siècle, un inventaire indique la présence d’une πα[ρ]απέτασμα λινοῦν, « tenture de lin »2 dans le temple de Zeus et d’Athéna sur le Cynthe3. R. Vallois qui a trouvé un rideau destiné à un pinax représentant un portrait d’Arsinoé, cité dans un inventaire de 189, explique la présence de la tenture par le besoin de protéger de la lumière les peintures à la détrempe4. Un inventaire antérieur citait un παραπέτασμα dans le temple d’Ilithye5. De même, à Samos, un inventaire du temple d’Héra de 346/345 mentionne παραπετάσματα δύο βαρβαρικὰ ποικίλα, « deux rideaux barbares bariolés », αὐλαῖαι δύο, « deux tentures »6, au milieu d’autres vêtements offerts comme parure à la déesse (l. 12 : κόσμος τῆς θεοῦ). Le fait de trouver des rideaux au milieu de chitons, d’himations, de voiles peut paraître étrange dans la mesure où ils se prêtaient à une utilisation différente. Selon I. Romano, ce rideau était suspendu devant la statue de culte, et servait à cacher la statue de la déesse en dehors des cérémonies officielles de culte7.