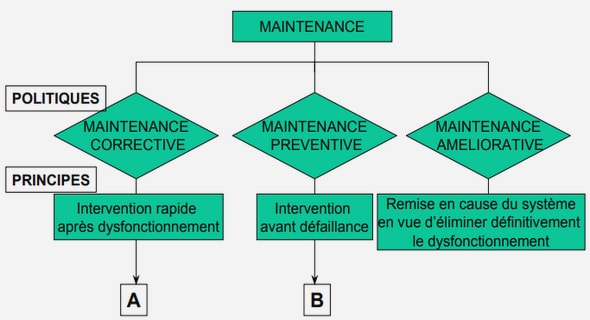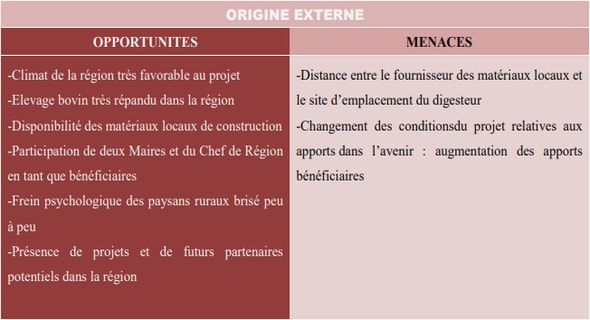Le langage et la société envisagés comme des entités séparées
Dans la première perspective, le langage est défini comme un objet d’intellection ou un instrument de connaissance. Il est, en ce sens, opposé à la pratique. Il y aurait d’un côté la parole, le langage, et de l’autre, l’action. Le langage est appréhendé comme un outil permettant de représenter le monde, et servirait, entre autres choses, à rendre compte de ces mêmes actions. Selon Anni Borseix, membre du réseau Langage et Travail, cette conception envisage le langage comme un reflet. L’auteure expose les conséquences d’un tel présupposé dans le champ de la sociologie, et fait état « d’une conception commode du langage comme un miroir, une trace, comme une réplique du monde à l’échelle des mots [qui] a nourri et continue à nourrir le gros des méthodes d’exploration et d’exploitation des propos recueillis par entretien ». Elle écrit ensuite que c’est « sur [cette conception que] repose le principe même de l’analyse de contenu où c’est précisément le contenu “à extraire” qui compte pour les informations qu’il contient, opération courante qui consiste à traiter les propos recueillis, à les classer, à les thématiser, les catégoriser, les contraster, les coder, les comptabiliser » (Borseix, 2001 : 58-60).
La conception de P. Bourdieu, qui nous aidera infra à préciser la façon dont la sociologie peut introduire la question de la situation et du contexte dans l’étude de langage, ne nous est pas ici d’une grande utilité dans la mesure où il n’a pas cessé d’envisager le langage comme un reflet. François Leimdorfer dans son ouvrage Les sociologues et le langage (2010) montre que P. Bourdieu appartient à une tradition de recherches qui partage « une même posture épistémologique. Celle de considérer la société et les rapports sociaux dans leur généralité, à partir d’un point de vue surplombant, et celle de placer ces rapports à la source de la création et de la production du langage, des idées et des représentations ». (Ibid. : 56). « Chez ces auteurs, langage et société sont des instances séparées dont la première est dépendante et produite par la seconde, bien que ces structures et son fonctionnement soient autonomes ». F. Leimdorfer parle d’une « conception du reflet dans sa version marxiste et durkheimienne » (Ibid.)
Dans le cadre d’une perspective qui définirait le langage comme un instrument de connaissance ou comme un moyen de représenter le monde, le discours des experts serait appréhendé et étudié en tant qu’il permettrait de connaître le prévenu et/ou de nous renseigner sur la “réalité” du crime ou du criminel. Pour prendre un exemple, Véronique Le Goaziou et Laurent Mucchielli, dans le cadre d’une étude sur les viols jugés en cours d’assises, usent ainsi de l’expertise, et écrivent que « parmi les divers facteurs permettant de comprendre ce type de violeurs, on relève dans les expertises psychiatriques une fréquence particulièrement élevée de dysfonctionnements familiaux ayant marqué leur propre enfance (carences affectives précoces, abandons, maltraitances, violences physiques et/ou sexuelles » (2010 : 2). Les expertises leur permettent d’accéder à ce qui s’est passé dans la vie de ces violeurs. Cette posture, qualifiée de psychosociale par les auteurs, est également celle adoptée par P. Mercader, A. Houel et O. Sobota dans leur travail sur les crimes passionnels (2008). Le discours de l’expert ainsi que le dossier judiciaire y sont envisagés comme un vaste réservoir d’informations participant à connaître le social, et, dans ce dernier exemple, à expliquer le passage à l’acte.
D’autres auteurs envisagent ce qu’écrivent ou disent les experts comme le reflet de leurs représentations, de leurs préjugés et plus globalement des représentations sociales. C’est ainsi par exemple que Danielle Laberge, Daphné Morin et Victor Armony procèdent dans leur travail sur l’expertise psychiatrique (1997), dans lequel ils analysent un corpus de quatre-vingt-six expertises réalisées auprès d’hommes et de femmes sur une période de cinq années (1989-1994). Ils situent leur travail dans le courant de la sociologie de la réaction sociale et des représentations, et se basent plus précisément sur l’hypothèse d’une « sexisation » du social. Ils supposent que les experts participent à une domination de type symbolique et à la perpétuation de représentations sexuées (« les experts reproduisent le contenu de nombreuses identités sociales »).
L’idée n’est pas ici de contester cette façon d’étudier le langage et le discours. Le discours de l’expert nous semble effectivement être déterminé par les normes sociales et participer en retour à leur pérennisation. Toutefois, le discours de l’expert n’est pas et ne sert pas qu’à cela ; envisager notre objet d’étude seulement sous cet aspect ne permettrait pas d’étudier les mécanismes de construction sociale de la réalité.
Une autre posture bien que différente – voire opposée –, envisage le social, et plus précisément la culture, comme des produits du langage. F. Leimdorfer35 montre que cette posture se retrouve chez les anthropologues (Benjamin Whorf et Edward Sapir, Franz Boas, Claude Lévi-Strauss). La structure et le lexique d’une langue produiraient des effets sur les façons de percevoir, de penser et d’appréhender le monde.
F. Leimdorfer envisage ces deux perspectives (le langage comme produit du social versus le social comme produit du langage) comme les deux axes opposés d’un premier paradigme qui envisage le langage et le social comme des instances autonomes et séparées. L’inconvénient de cette posture est d’éluder la question de savoir ce qui le (re)lie, et d’encourager les clivages disciplinaires.
Le rapport entre langage et la société : un rapport dialectique
Dans les années 1920, émerge un autre mode d’appréhension du langage, et du rapport entre langue et société. Il ne s’agit plus de penser la langue et la société, mais de penser la langue dans la société. Dans le champ de l’anthropologie B. Malinowski (1884-1942), bien avant J.L. Austin, a d’ailleurs procédé à cette rupture :
• En fait, la fonction principale du langage n’est pas d’exprimer la pensée ni de reproduire l’activité de l’esprit, mais au contraire de jouer un rôle pragmatique actif dans le comportement humain. Ainsi conçu, il compte parmi les grandes forces culturelles, et complète les activités physiques. Pour tout dire, il constitue le rouage indispensable de toute action humaine concertée. »36
Le langage est ici envisagé comme un « rouage indispensable » de l’activité humaine et de la société. B. Lahire fait ce même constat quant au discours. Il n’y a pas, selon lui, d’un côté le discours, et, de l’autre, le contexte, mais intrication, enchevêtrement et interdépendance de ces deux instances :
• Plutôt que d’opérer une partition ferme entre le discursif et le non-discursif, entre le linguistique et le social, et ainsi de suite, il est préférable de considérer qu’aucune pratique, aucune action, aucune forme de vie sociale n’existe en dehors des pratiques langagières qui prennent des formes variées et dont les fonctions sont multiples. On pourrait dire à l’envers, c’est-à-dire en s’adressant aux linguistes plutôt qu’aux sociologues, qu’aucune pratique langagière ou discursive n’est détachable des formes de vie sociales desquelles elle est issue. » (Lahire, 2001 : 295).
Le langage est ainsi au cœur du social ; c’est la raison pour laquelle B. Lahire et P. Achard récusent l’idée d’une “sociologie du langage”, et expliquent que chaque champ d’étude de la sociologie doit l’intégrer dans ses préoccupations. B. Lahire écrit que « le langage étant présent dans toutes pratiques sociales cela n’a aucun sens de le prendre comme un objet d’investigation sociologique particulier. Il est, par contre, un problème de l’investigation sociologique en général » (1990 : 266). En guise de conclusion, citons à nouveau ce dernier : « Les pratiques langagières ne sont ni au dessus, ni à côté du social mais en son sein. Elles sont d’emblée dans toute activité humaine, dans toutes formes de vie sociale (Ibid. : 266). F. Leimdorfer parle d’un « deuxième paradigme de la réflexion sociologique sur le langagier à la fois fonctionnaliste, pragmatique et situationnelle, tout en articulant micro et le macro-sociologique et la linguistique » (2010 : 90). Du côté de la sociologie générale, Philippe Corcuff (1995), à travers l’expression « nouvelles sociologies », désigne un ensemble de travaux qui émergent dans les années 1980 et dans la première moitié des années 1990 dans le champ sociologique, et qui ont pour dénominateur commun de sortir des antinomies classiques comme matériel/idéel, objectif/subjectif, collectif/individuel ou macro/micro. Nous pourrions ajouter à cette liste l’antinomie langage/société.
Peter Berger et Thomas Luckmann (2002), généralement cités comme les instigateurs de cette nouvelle façon d’envisager la réalité sociale, font justement état du rôle du langage dans le processus d’objectivation de la réalité sociale. Après avoir écrit que dans ce processus, « le système de signes décisif est linguistique », ils expliquent que « le langage objective les expériences partagées et les rend disponibles à tous à l’intérieur de la communauté linguistique devenant ainsi à la fois la base et l’instrument du stock collectif de connaissances » (2002 : 96). Si l’on s’en tenait à ne retenir que cet aspect de leur pensée, P. Berger et T. Luckmann pourraient être cités dans la sous-partie précédente, dans la mesure où le langage est envisagé dans cet extrait comme le produit des interactions sociales. Toutefois, ils montrent que le langage ainsi que l’ensemble des actions typifiées et des institutions, structurent en retour les échanges quotidiens. P. Berger et T. Luckmann envisagent l’articulation entre les phénomènes micro et macro-sociaux, ainsi qu’entre le langage et le social comme une dialectique.
P. Corcuff montre que les nouvelles sociologies, appréhendent la réalité sociale non plus comme donnée mais comme construite : « dans une perspective constructiviste, les réalités sociales sont appréhendées comme des constructions historiques et quotidiennes des acteurs individuels et collectifs » (1995 : 17). Dans le champ des recherches en sentencing, F. Vanhamme et K. Beyens font également état de cette posture et d’« approches interprétatives qui se focalisent sur le processus contextualisé plus que sur le résultat » (2007 : 202). Concernant par exemple la discrimination dont les accusés feraient l’objet lors de la phase de jugement, ils écrivent que « la complexité de la discrimination est toujours difficile à tester de façon chiffrée et l’inégalité difficile à lire à partir des statistiques qui se limitent à une série de variables dans une approche statique ». Ils poursuivent en expliquant qu’« en outre, la complexité de la discrimination se construit au niveau individuel des interactions à l’audience, dans des aspects subtils peu appréhendables par les statistiques, comme la conduite, l’argumentation et le vocabulaire respectifs, les perceptions et jugement implicites du style de vie, de l’avenir. » (Ibid. : 2007).
C’est donc bien à une étude de l’expertise et de la justice en train de se faire qu’invite ces travaux.
Les théories de l’énonciation s’inscrivent dans cette perspective dans la mesure où elles prennent pour objet d’étude la mise en fonctionnement de langue. Comme l’énonce Catherine Kerbrat-Orecchioni « le suffixe –tion dénote en français l’acte et le produit de l’acte ». Elle explique alors « qu’à l’origine l’énonciation s’oppose à l’énoncé comme l’acte à son produit » (1980 : 33).
La problématique de l’énonciation cherche ainsi à étudier non pas un produit, mais un processus. Des travaux en sociologie constructiviste des sciences (Latour, 1993, 59-80 ; Latour et Woolgar, 1979, Latour et Fabbri, 1977), même s’ils ne s’y réfèrent pas explicitement, s’en sont largement inspirés37. Lorenza Mondada, linguiste, offre également un exemple de rapprochement entre sociologie constructiviste et problématique de l’énonciation. Elle étudie « la science en train de se dire » – plus précisément l’anthropologie – et identifie les « modalités formelles par lesquelles le texte réussi à rendre évidents ou convaincants ses objets de discours » (Mondada, 1995 : 59). C’est donc ainsi à une étude de l’expertise et de la justice en train de se dire que nous procéderons dans ce travail.
• La champ de l’analyse du discours : un espace pluridisciplinaire permettant de penser l’articulation entre langage et société
Le dépassement de ces oppositions conceptuelles, et la reconnaissance de l’intrication du langage et du social se sont matérialisés dans la création d’espaces et de champs pluridisciplinaires, plus ou moins formalisés et/ou institutionnalisés.
La revue Langage et Société, fondée en 1977 par P. Achard à la suite de la création du Groupe de Travail d’Analyse de Discours, a par exemple pour ambition :
• (…) de problématiser la conjonction qui figure dans son titre. Ce projet est intrinsèquement pluridisciplinaire : il signifie que le langage est social et partie intégrante de la société et, réciproquement, que la société est langage et ne peut être
• Sur l’absence de réflexivité et d’explicitations méthodologiques dans les travaux constructivistes du champ de la sociologie des sciences voir Terry Shinn et Pascal Ragouet (2005 : 117-134). Les travaux constructivistes cités ici ne se réfèrent explicitement à aucun travail linguistique et n’explicitent pas leur méthodologie. Ils se réfèrent cependant à la problématique de l’énonciation. saisie indépendamment de sa dimension langagière ; ou encore que le langage peut et doit être analysé d’un point de vue sociologique et, réciproquement, que la société peut et doit être étudiée d’un point de vue linguistique. »38
C’est également le cas du réseau Langage et Travail, fondé en 1986, qui réunit sociologues, linguistes et psychologues, et dont « l’ambition était aussi de tenter quelques jonctions théoriques entre les sciences du langage d’un côté et les sciences sociales du travail (sociologie, ergonomie, gestion, psychologie du travail) de l’autre » (Borzeix, 2001 : 69). On doit également mentionner un champ de recherche, moins institutionnalisé, qui porte le nom de champ d’analyse du discours. Ce courant de recherche, que Dominique Maingueneau n’estime d’ailleurs pas pouvoir être désigné comme un « champ » de recherche à part entière, c’est-à-dire comme un « territoire compact et homogène », se caractérise plutôt par un « certain mode d’appréhension du langage » partagé par des chercheurs de disciplines différentes (Maingueneau, 1995 : 6). D. Maingueneau trouve toutefois un dénominateur commun dans cette diversité de travaux et écrit que « l’analyse du discours n’a pour objet ni l’organisation textuelle considérée en elle-même, ni la situation de communication, mais l’intrication d’un mode d’énonciation et d’un lieu social déterminé » (Ibid. : 7). C’est cette définition du discours que nous avons adopté. Nous nous référons précisément à celle proprement sociologique de P. Achard : « l’usage du langage en situation pratique, envisagé comme acte effectif, et en relation avec l’ensemble des actes (langagiers ou non) dont il fait partie » (Achard, 1993 : 10). Cette définition permet d’appréhender le discours comme une activité, invite à l’étudier en situation, et à l’envisager du point de vue de ses effets. A. Borzeix précise aussi l’acception de ce terme au sein de réseau Langage et travail :
• Elle comprend le langage des mots, écrit ou oraux, ces énoncés qui disent, qui réalisent le travail ou qui servent à le prescrire, à le formaliser, le formater (…). Elle considère le langage dans ses multiples dimension : instrumentale, cognitive et collective, comme une matière dont le fonctionnement est à observer en contexte, et du double point de vue de ses formes et de ses usages. » (2001 : 68).
Pour résumer, nous citons F. Leimdorfer qui explique qu’il s’agit d’envisager « le discours comme socialement organisé et comme organisant la société. » (2010 : 170).