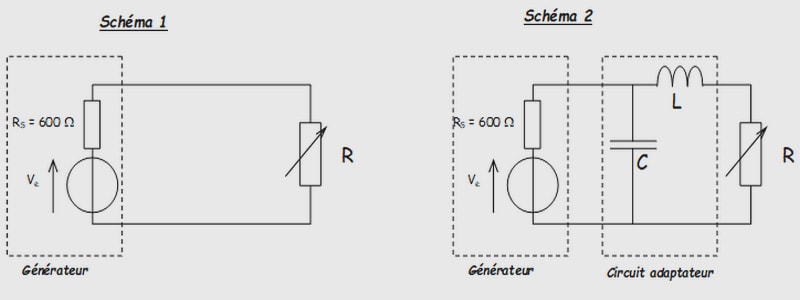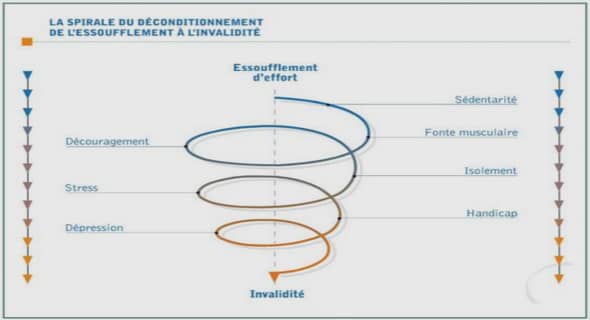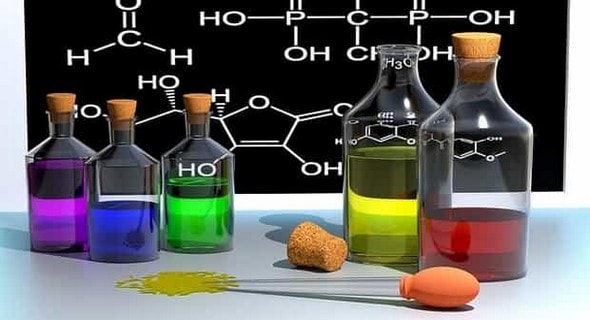Expressions des grands changements paléoclimatiques au Cénozoïque
Les Méthodes géochimiques
Les isotopes stables de l’oxygène
Le rapport isotopique de l’oxygène est utilisé depuis près d’un siècle pour reconstruire les variations de température au cours des temps géologiques (Urey, 1948 ; Epstein et al., 1951). Ce rapport isotopique peut être utilisé aussi bien sur du matériel biogène phosphaté comme des dents de poissons et de mammifères marins (Pucéat et al., 2007 ; Dera et al., 2009) que carbonaté comme les foraminifères (benthiques et planctoniques), les mollusques (bivalves, gastéropodes, céphalopodes), les brachiopodes, les bryozoaires et les coraux pour reconstruire les températures des eaux profondes (BWTs) ou de surface (SSTs). Il peut également être utilisé pour reconstruire les températures atmosphériques (MATs) à partir de spéléothèmes, paléosols, dents et os de mammifères terrestres ou gastéropodes d’eaux douces.
Principe de thermodépendance
Ce marqueur géochimique se base sur le fractionnement thermodynamique qui apparait entre les isotopes de l’oxygène : (16O (99,757 %), 17O (0,038 %) et 18O (0,205 %)) lors de la précipitation d’un carbonate (nous restons focalisés ici sur l’application aux carbonates dans ce travail). La composition isotopique en oxygène d’un carbonate est exprimée par le rapport entre l’isotope le plus lourd (18O) et l’isotope le plus léger et abondant (16O) par rapport à un standard international VPDB (Vienna PeeDee Belemnite, exprimé en ‰). 𝛿 18𝑂(‰) = [ ( 𝑂 18 16𝑂 )𝑒𝑐ℎ ( 18𝑂 16𝑂 ) 𝑠𝑡𝑑 − 1] ∗ 1000 Au cours des dernières années, plusieurs équations de thermodépendance ont été proposées dans la littérature liant le δ 18O du carbonate à la température de l’eau dans laquelle il a précipité (Figure III.4). Ces équations sont basées soit à partir de la calcite inorganique produite en laboratoire (Kim et O’Neil 1997 ; Watkins et al., 2014), soit à partir d’organismes à test ou coquille carbonatés (calcitique / aragonitique) comme les foraminifères benthiques et planctoniques (Shakleton, 1974 ; Erez et Luz, 1983 ; Bemis et al., 1998), les mollusques (Anderson et Arthur, 1983 ; Grossman et Ku, 1986 ; Kobashi et Grossman, 2003) ou les coraux (Weber et Woodhead, 1970 ; Juillet-Leclerc et Schmidt, 2001). Cependant, les équations proposées pour chacun de ces biocarbonates sont utilisables uniquement sur la famille ou l’espèce en question. Par exemple, il existe même plusieurs équations de thermodépendance Chapitre III : Matériels et Méthodes 119 réalisées sur plusieurs espèces de coccolithophoridés. En effet, ces micro-organismes peuvent induire des effets vitaux pouvant impacter le rapport isotopique de l’oxygène (différence entre le δ18O d’un biocarbonate et d’un carbonate de synthèse précipité dans les mêmes conditions physico-chimiques). Ainsi, pour une température donnée, il est possible d’obtenir un fractionnement de l’ordre de 5 ‰ pour deux espèces différentes de coccolithophoridés (Dudley et al., 1986). Hormis les coccolithophoridés d’autres espèces comme les coraux peuvent précipiter en déséquilibre isotopique sous l’influence d’effets cinétiques et/ou métaboliques (McConnaughey, 1989a, 1989b)
La plupart des mollusques et plus spécifiquement des bivalves ne montrent pas d’effets vitaux prononcés pouvant produire un déséquilibre isotopique pour l’oxygène car il peut y en avoir pour le carbone) (Wefer et Berger, 1991 ; Lee et Carpentier, 2001), bien que des effets vitaux aient été mis en évidence sur certaines espèces de rudistes (Steuber, 1999). Il est ainsi largement considéré que les bivalves secrètent, sauf exception, leur coquille proche de Chapitre III : Matériels et Méthodes 120 l’équilibre avec l’eau de mer (Epstein et al., 1953 ; Krantz et al., 1987 ; Surge et al., 2001 ; Elliot et al., 2003). Pour cette étude nous utiliserons l’équation de thermodépendance proposée par Anderson et Arthur (1983) pour les bivalves calcitiques (Équation 1) : 𝑇(°𝐶) = 16 − 4.14 ∗ (δ 18𝑂𝑐 − δ 18𝑂𝑠𝑤) + 0.13 ∗ (δ 18𝑂𝑐 − δ 18𝑂𝑠𝑤) 2 Eq. 1 et l’équation de Kobashi et Grossmann (2003) pour les bivalves aragonitiques (Équation 2): 𝑇(°𝐶) = 20.6 − 4.34 ∗ (δ 18𝑂𝑎 − δ 18𝑂𝑠𝑤) Eq. 2
Le δ18O de l’eau de mer
La composition isotopique d’un biocarbonate dépend donc de la température mais aussi du δ18O de l’eau de mer (δ18Osw) dans laquelle l’organisme a précipité sa coquille. Cependant, dans le cas des reconstitutions de températures marines passées, il peut être difficile de déterminer avec exactitude le δ18Osw dans laquelle le foraminifère ou encore le mollusque a précipité sa coquille. Le δ18Osw exprimé en ‰ par rapport au standard SMOW (Standard Mean Ocean Water) pour l’océan ouvert varie actuellement à la surface du globe entre -3 et 2 ‰ mais aussi au cours des temps géologiques (Figure III.5). Figure III.5 : Représentation de la variation en δ18O de l’eau de mer (‰ SMOW) actuelle à la surface du globe (d’après LeGrande et Schmidt, 2006). La valeur moyenne du δ18O de l’océan dans son ensemble pour une période donnée dépend principalement du volume de glace continentale permanente accumulée au niveau des pôles (calottes polaires). L’effet des glaciations continentales sur la composition isotopique des océans dérive directement du fractionnement isotopique dans le cycle météorologique. Les précipitations aux hautes latitudes sont significativement appauvries en 18O par rapport aux eaux océaniques. Par conséquent, quand les glaciers continentaux se développent et grossissent, le 16O est préférentiellement retiré de l’eau de mer et le δ18O augmente dans les océans résiduels ; la réciproque est également valable quand les calottes polaires fondent. Lors de la dernière période chaude sans glace dite de « greenhouse » le δ18Osw global était proche de -1 ‰ (Kennett et Shackleton, 1975) et à contrario lors de la dernière période froide actuelle dite de « icehouse », le δ18Osw est plus élevé avec des valeurs proches de 0 ‰ (Figure III.6A).
Remerciements |