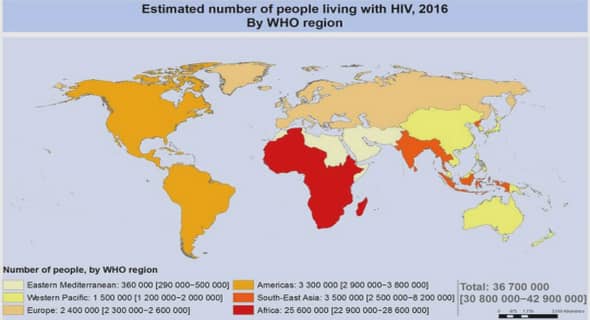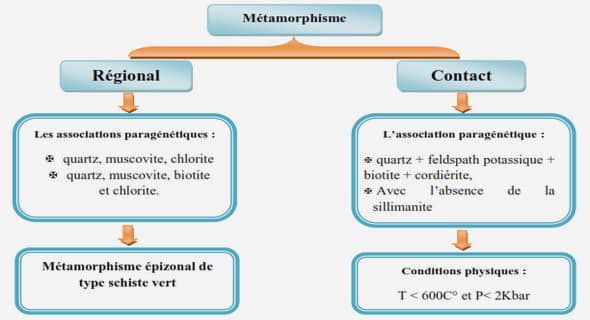La littérature algérienne francophone, rappel historique
Si l’adjectif « francophone » signifie « qui parle français », la définition de la littérature francophone est loin d’être aussi simple que ne le suggère le sens de l’adjectif. Car cette littérature ne se laisse enfermer sous aucune étiquette : « littérature émergente », littérature « maghrébine », « africaine » de « langue » ou « expression » française, etc. Bien que reposant sur une unité linguistique assurée par l’usage de la langue française, elle peut difficilement être située sur le plan spatio-temporel. À quel espace géographique appartiendrait-elle exactement ? Et depuis quand a-t-elle commencé historiquement dans tel ou tel espace ? La notion d’espace est pourtant très importante dans cette catégorisation. En effet, longtemps, l’on a classé les textes francophones selon le pays d’origine de l’auteur. On parlait ainsi de « littérature maghrébine d’expression française », de « littérature d’Afrique noire de langue française. Jusqu’à ce que le terme « francophone », plus générique, et peut-être aussi moins clivant, s’impose ; d’abord au singulier, puis au pluriel, pour signaler la pluralité des écritures rangées sous la même « étiquette ». Il va de soi que cette profusion de définitions ne peut pas être considérée seulement comme une richesse, et n’est pas sans devenir elle-même problématique. Car chaque terme a ses partisans et ses opposants dont les partis pris idéologiques sont souvent aussi inconciliables qu’implicites. Mais ce qu’est vraiment à retenir de ces querelles terminologiques, est qu’elles se font toutes en référence à la problématique du lien entre « ce qui est français et ce qui s’écrit en français », entre la littérature française et la littérature d’expression française. L’originalité esthétique de la littérature francophone se trouve ainsi reléguée au second plan, relevant d’un ordre secondaire allant parfois jusqu’à la déconsidération totale.
En ce qui concerne la littérature algérienne francophone, la confusion est encore accentuée et la définition même de ce qu’est un écrivain algérien francophone reste complexe. Des forces idéologiques s’activent des deux rives de la Méditerranée pour étendre ou restreindre cette appartenance en fonction de critères objectifs (lieu de naissance, nationalité des parents) ou subjectifs, comme le sentiment d’appartenance à l’Algérie ou la France.
En effet, la littérature maghrébine d’expression française telle qu’on la connait de nos jours n’est pas la seule expression littéraire qu’on ait pu observer dans le Maghreb colonial. Une autre littérature a en effet existé dans cette région dès le début de la colonisation française. Depuis 1830, des écrivains, dont Guy de Maupassant, ont visité l’Algérie et y ont produit une littérature dite « exotique » qui s’associait au mouvement de conquête coloniale. Truffée de clichés et de stéréotypes, elle était d’abord l’expression d’un Orient paradoxal, presque plus au Sud qu’à l’Est et qu’on s’efforçait de retrouver en Algérie, comme le notait si bien Pierre Martino59: «chaque voyageur emportera de France son Algérie toute faite». De cette littérature exotique naitra l’algérianisme dont le manifeste fut publié en 1920. Il est notable qu’avec l’algérianisme et son chef de file, Robert Randau, apparaisse pour la première fois une volonté d’émancipation littéraire du Maghreb, d’où l’expression d’« autonomie ». Mais la véritable originalité de la littérature maghrébine ne se confirmera qu’avec le mouvement de l’Ecole d’Alger et des écrivains de renommée internationale comme Albert Camus. Cependant, de tous ces écrivains qu’on assimilait volontiers à l’Ecole d’Alger, rares étaient ceux qui appartenaient aux populations indigènes. C’est, en effet, dans les années 1950 que s’établit une réelle distinction entre ces écrivains, pour des raisons politiques essentiellement. La visée nationaliste séparera les écrivains de l’Ecole d’Alger des écrivains algériens, selon la célèbre phrase de Sénac : Est écrivain algérien, tout écrivain ayant définitivement opté pour la nation algérienne60 ».
En effet, la littérature algérienne francophone est née dans les années 1920 comme un résultat de la politique d’assimilation mise en place par l’administration coloniale. Le système scolaire français s’est ouvert à quelques indigènes et a produit les premiers écrivains algériens francophones. Les premières productions littéraires francophones rédigées par des Algériens remontent d’ailleurs aux années 1920 avec la publication du roman de Mohammed Benchérif : Ahmed ben Mostapha, goumier61. Cet ouvrage est le premier roman publié par un Algérien écrivant en français.
Mais c’est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale que la littérature algérienne francophone prend réellement son envol avec des noms comme Mouloud Feraoun, Mouloud Mammeri, Mohammed Dib, Yacine Kateb et Assia Djebar. Les productions littéraires de ces auteurs, bien qu’en étant pas les premières, marquent la véritable naissance de la littérature algérienne francophone. Or, un élément structurel commun caractérise tous ces textes de la première heure : leur visée politique anticoloniale. Ainsi, la littérature algérienne francophone a-t-elle été d’abord perçue comme un fait politique de résistance, de réaction à l’idéologie coloniale, extrêmement important dans l’élaboration de cette littérature et de son devenir. Jean-Paul Sartre, qui a préfacé le célèbre essai d’Albert Memmi Portrait du colonisé62, a théorisé cette forme de littérature engagée dans son essai Qu’est-ce que la littérature63.
POÉTIQUE DE L’ESPACE FRANCOPHONE
« Cet homme d’un pays qui n’a rien à voir avec les arbres de ma fenêtre, les fleuves de mes quais, les pierres de nos cathédrales, parle avec les mots de Villon et de Péguy ».
Lorsque l’on se demande comment écrire sur Dib, une chose est certaine : quelle que soit la manière, de quelque abord que l’on arrive dans l’univers dibien, l’on est fasciné par le travail du langage, par la mise à l’épreuve de la langue qui témoigne de la pratique intransigeante qu’avait Mohammed Dib de la littérature et de l’approche extrêmement vigilante et responsable qu’il avait du texte et des mots.
Pas un texte de Dib, d’ailleurs, ne dément cette particularité de l’auteur de se retrouver partout dans son œuvre à la fois débiteur d’une littérature à laquelle il doit tout et créancier d’un langage qu’il a poussé dans ses derniers retranchements pour lui soutirer les quelques mots rares, les précieux aveux que la pratique impitoyable d’un auteur peut arracher à une langue jalouse de ses secrets. Et c’est là que se rencontre la préoccupation principale de Dib, car, il s’agit bel bien d’une préoccupation, d’une préoccupation littéraire qui n’est pas une pensée et encore moins une quête mystique, mais une préoccupation tout humaine qui trouve son lieu dans le roman. Sous la plume dibienne, le roman devient lui-même lieu d’une réflexion sur le sens, ou les sens, d’une humanité livrée à elle-même.
Mais la particularité de l’écriture dibienne ne réside pas seulement dans une pratique exigeante de la langue. En effet, de nombreux écrivains francophones mettent en avant une pratique singulière de la langue française pour souligner un certain écart vis-à-vis d’une certaine histoire, à savoir la colonisation. Or, dans l’œuvre de Mohammed Dib, la pratique de la langue dépasse le stade de la mise en scène revendicative du langage et tend à devenir elle-même objet de réflexion en tant que lieu de vie et de sens. La langue, dans l’œuvre de Dib, n’est pas un outil de description, mais un lieu, l’espace du sens et du devenir. Et c’est dans cette optique, que Dib a si ingénieusement interrogée, que la renaissance incessante de l’homme dans toutes les langues devient possible au même titre que la possibilité de mort dans sa propre langue mesure que disparaît ce qu’une fois nous avons vécu dans les mots, des mots comme mémoire de la vie humaine.
Dans l’étude que nous entreprenons, il ne s’agit pas essentiellement de décrire des procédés d’écriture, ni de poser une liste des thématiques de prédilection d’un auteur, mais de mettre en avant une lecture nouvelle de l’œuvre romanesque de Mohammed Dib qui s’appuie sur sa vision particulière de l’espace. Et c’est justement sur ce point de la singularité de l’écriture, de sa pratique surtout, que l’œuvre de Dib se rapproche d’une recherche systémique, un peu comme cela se passe en philosophie. La pensée de l’écriture devient écriture d’une pensée qui s’élabore au fil des textes.
La poétique dibienne ne se limite pas à l’écriture d’un monde, mais tend souvent à le penser, faisant ainsi du texte un lieu de connaissance du monde, d’une initiation au monde. Chaque personnage est en ce sens une interrogation sur le monde, une ouverture sur un univers des possibles qui s’étend aussi loin que le langage pourrait aller, car, la limite, la rive sauvage, le seuil, la grande porte gardée, est toujours de l’ordre du langage chez Dib, d’un langage qui permet mais aussi qui empêche.
Pour cette raison, la poétique de Dib relève à la fois d’une théorie philosophique du langage et d’une recherche ésotérique du sens, sens qui s’accomplit à la frontière du langage. Comme si l’auteur avait posé comme condition d’accomplissement de sa poétique une mise en échec préalable de la parole. Ce n’est qu’une fois dépassé le premier désespoir de l’absence de la parole, qu’il accède à des sens cachés du monde, à des sens indicibles qu’il ne peut qu’entrevoir à travers un texte comme ces fantômes de nomades que l’on entrevoit dans Le Désert sans détour64 ou encore les chants de Menoune dans La Grande maison65 qui sont à la fois les paroles d’une femme impotente et le cri d’une population opprimée qui annonce la révolution à venir.
Les multiples variations de formes qu’a connues l’œuvre de Dib à travers le temps affirment justement cette volonté d’interroger le monde, sous toutes ses facettes, en quelque sorte. A chaque roman, l’écriture prend en charge une grande question (la guerre, la liberté, la mort, l’amour, …) ou
parfois plusieurs à la fois. Et tout en se posant comme interrogation sur le monde, l’écriture devient elle-même objet d’interrogation dans une relation complexe de l’écrivain au monde dans laquelle s’élabore la pensée propre de Mohammed Dib mais aussi dans laquelle se joue sa vie66. Ainsi, l’enjeu principal de cette étude, au-delà de l’analyse, est-il de tenter de déjouer les stratagèmes d’enfouissement, de creusement que l’auteur a mis en place pour garder son secret, afin d’écarter le voile sur cette œuvre réputée insaisissable et obscure et de lire entre les lignes les mots précieux de « cette éternelle voix recluse67 ».
L’héritage sartrien
Dans la première partie de son œuvre, Mohammed Dib a produit une littérature réaliste livrant une description presque documentaire de la vie quotidienne des habitants de Tlemcen sous l’occupation française. Le discours littéraire que produisait Dib à cette époque se trouvait être en adéquation avec le discours idéologique des instances nationalistes sur le quotidien du peuple algérien colonisé. À cette époque la littérature allait de pair avec l’idéologie nationaliste au nom de l’impératif historique et de cette nécessité de signifier que des théoriciens comme Jean-Paul Sartre ont attaché à la littérature. En effet, la littérature algérienne francophone est née en cette période où le monde était à refaire. Elle devait participer à cette « re-fondation » du monde avec la fin de l’aire coloniale et le début des Indépendances. La nécessité de s’appuyer sur un « sens historique » s’est imposée alors à la littérature francophone au même titre que les idéologies qui produisaient ce sens. Et ce même si, relisant son essai, Sartre constatera cinq ans plus tard : « Contre la menace de guerre et contre ce piège je me débats comme un rat dans une ratière. J’ai pensé contre moi dans Qu’est-ce que la littérature68 ? ». Sartre usa de son énergie légendaire pour lui offrir une vocation et engager la littérature francophone sur Les Chemins de la liberté69.
Sartre a d’abord inculqué aux littérateurs francophones le souci du sens. Cette primauté de la signification que le philosophe attribuait à la littérature et qu’il a si ardemment défendue dans Qu’est-ce que la littérature70 ? : c’est une chose que de travailler sur des couleurs et des sons, c’en est une autre de s’exprimer par des mots. Les notes, les couleurs, les formes ne sont pas des signes, elles ne renvoient à rien qui leur soient extérieur. […] le peintre ne veut pas tracer des signes sur sa toile, il veut créer une chose ; et s’il met ensemble du rouge, du jaune et du vert, il n’y a aucune raison pour que leur assemblage possède une signification définissable, c’est-à-dire renvoie nommément à un autre objet. […] Et pareillement la signification d’une mélodie – si on peut encore parler de signification – n’est rien en dehors de la mélodie même, à la différence des idées qu’on peut rendre adéquatement de plusieurs manières71.
Mais comment reconnaître qu’une couleur porte en elle-même une signification « légère » de gaieté ou de tristesse qui « tremble autour d’elle » et affirmer par la suite qu’elle n’est que couleur ? Et si l’on veut adopter ce raisonnement, l’on admettrait conséquemment que les couleurs, les sons et les formes ont besoin de l’intervention d’un artiste pour être créés et acquérir une valeur significative ou imaginaire Mais le peintre, direz-vous, s’il fait des maisons ? Eh bien, précisément, il en fait, c’est-à-dire qu’il crée une maison imaginaire sur la toile et non un signe de maison. Et la maison ainsi apparue conserve toute l’ambiguité des maisons réelles. L’écrivain peut vous guider et s’il vous décrit un taudis, y faire voir le symbole des injustices sociales, provoquer votre indignation. Le peintre est muet : il vous présente un taudis, c’est tout ; libre à vous d’y voir ce que vous voulez. Cette mansarde ne sera jamais le symbole de la misère ; il faudrait pour cela qu’elle fût signe, alors qu’elle est chose72.
Encore faut-il que cette valeur soit reconnue, car, selon Sartre, « Le peintre est muet » tout autant que son œuvre qui ne porte guère de signification qui découlerait d’elle-même. Ainsi, un observateur mal avisé pourrait-il voir dans La Liberté guidant le peuple73 une représentation de festivité populaire ou entendre dans l’Adagio d’Albinoni74 un hymne à la joie. Or, de tels quiproquos sont presque impossibles.
De plus, Sartre n’engage pas la poésie, qu’il a rangée du côté de la sculpture et de la musique puisque n’appartenant pas à « l’empire des signes75 ». Elle n’aurait pas de projet utilitaire et ne serait par là qu’une pure activité désintéressée. Sans nier que la poésie se fasse dans et par le langage, Sartre affirme néanmoins que les poètes ne se soucient guère de la recherche de la vérité, qu’ils sont une espèce d’artisans du langage, avides et jaloux de la performance linguistique sans pour autant vouloir nommer où dire quoi que ce soit. Ce sont pour lui des dilettantes, des peintres, et des sculpteurs du verbe.
Ils traitent le langage en matériau et non point en instrument. Ils le manient, le façonnent, le travaillent sans jamais l’utiliser.