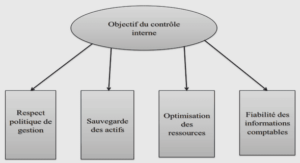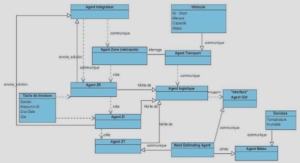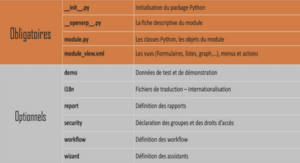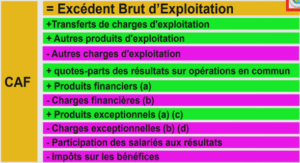La théorie des systèmes de famille
Ce mémoire utilise deux sources de la théorie des systèmes de famille : Family Evaluation de Michael Kerr et Murray Bowen, écrit en 1988, et le site Web « The Bowen Center », développé par Kerr en 2000. La théorie des systèmes de famille est développée dans les années 1970 par le docteur Murray Bowen et cherche à expliquer la conduite humaine en déchiffrant les structures de famille et les interactions entre ses membres (Kerr et Bowen viii). La théorie est composée par huit concepts qui rendent visible ces structures et leurs conséquences pour les individus dans la famille : les triangles, la différenciation de soi, le processus émotionnel des familles nucléaires, le processus de projection dans la famille, le processus de transmission multigénérationelle, la coupure émotionnelle, la position de frère et sœur, et le processus sociétal émotionnel. Il vaut la peine de garder à l’esprit que la démarcation entre ces concepts est des fois assez vague et qu’ils se chevauchent souvent. En plus, bien que le site Web et Family Evaluation idéntifient les mêmes huit structures comportementales présentées ci-dessus, le nombre exact des concepts se diffère. Par exemple, le processus de projection dans la famille est traité comme une catégorie « indépendante » dans le site Web, et comme une sous-catégorie du processus émotionnel des familles nucléaires dans le livre. Ce mémoire utilise Family Evaluation comme la source primaire, mais l’éclairissement des concepts qui suit vient du « The Bowen Center ».
Les triangles sont considérés comme les systèmes relationnels stables les plus petits. Cette assertion est basée sur la préconception qu’un système entre deux personnes ne tient pas la capacité d’endurer de la tension avant de devenir instable. Les triangles sont composés par une dyade, c’est-à-dire une relation entre deux personnes, et une personne isolée, et montrent comment la tension dans la dyade pousse une des personnes à s’éloigner des autres ; par exemple, la mère focalise son enfant ou son travail au lieu du problème avec l’époux, et forme un nouveau triangle avec cette personne ou « activité », tandis que l’époux, qui est devenu la personne isolée, cherche à reprendre sa place dans la dyade.
La différenciation de soi (DS) focalise la dynamique entre l’identité individuelle et l’identité de famille, et l’importance du développement de ce premier.
Le processus émotionnel des familles nucléaires (PEFN) est composé par trois modèles comportementaux qui signalent où se développent des problèmes et de la tension dans la famille : le conflit conjugal, la défiance de l’époux ou l’épouse, et la défiance d’un ou plusieurs enfants. Selon PEFN, la tension peut donc être identifiée entre les deux époux, dans un des deux, ou dans un ou plusieurs des enfants.
Le processus de projections dans la famille (PPF) décrit la façon dont les parents transmettent leur angoisse aux enfants sans s’en apercevoir et commencent à traiter l’enfant à partir de la mauvaise compréhension qu’il y aurait un problème avec l’enfant. Ce concept et celui de la DS figurent souvent simultanément.
Le processus de transmission multigénérationelle focalise les conduites et les modèles comportementaux qui ont été transmises à travers plusieurs générations, et la façon dont de petites différences de comportement entre les parents et leurs enfants peuvent changer le niveau de différenciation entre les membres des familles dans des générations futures.
La coupure émotionnelle focalise l’éloignement d’un membre de la famille des autres suivant des troubles de famille non résolus, et les conséquences de cette conduite dans des relations futures.
La position de frère et sœur montre la signification de cette position sur le développement et la conduite des enfants.
Finalement, le processus émotionnel sociétal donne une plus grande image des systèmes de famille et décrit comment ces systèmes peuvent aussi être identifiés au niveau sociétal.
Méthode
La lecture des deux romans a produit une délimitation des concepts qui constituent les deux théories présentées ci-dessus. Dans le cas de la théorie d’attachement, cette analyse se concentre sur deux styles d’attachement : l’attachement insécure évitant et l’attachement désorganisé, puisque ces deux styles ont été identifiés pendant la lecture. En ce qui concerne la théorie des systèmes de famille, quatre concepts sont utilisés : les triangles, la différenciation de soi (DS), le processus émotionnel des familles nucléaires (PEFN), et la coupure émotionnelle. Les trois premiers viennent de Family Evaluation (Kerr et Bowen), tandis qu’on retrouve la coupure émotionnelle sur The Bowen Center (Kerr, ch. 6). En plus, le PEFN est composé par trois modèles comportementaux dont un est pertinent pour cette étude : la défiance d’un ou de plusieurs enfants (DPE). Cette délimitation est basée sur la présence et la pertinence des concepts à partir du rapprochement et de l’éloignement entre Momo et « je » et leurs mères respectives. Le processus de transmission multigénérationelle, par exemple, n’est pas applicable puisque les grands-parents ne figurent dans aucun des livres.
Analyse
L’analyse est divisée en trois sections. La première traite la relation parent-enfant entre Momo et « je » et leurs figures maternelles respectives, et la manière dont ces relations les influencent selon la théorie d’attachement. La discussion est suivie par une comparaison. Les deux sections suivantes se consacrent à jeter la lumière sur la structure des familles des protagonistes à partir du rapprochement entre Momo et « je » et leurs mères respectives dans la première partie et l’éloignement dans la deuxième partie. La théorie des systèmes de famille fonctionne comme le point de départ pour ces discussions. Chaque partie est suivie d’une comparaison des deux récits.
La relation parent-enfant
Cette première section de l’analyse se consacre à la relation que tiennent Momo et la protagoniste de L’Amant avec leurs figures maternelles respectives. La théorie d’attachement est utilisée pour discuter les rapports entre la conduite des mères et celles des adolescents, surtout l’attachement insécure évitant dans le cas de Momo, et les styles insécure évitant et désorganisé dans le cas de « je ». En plus, le processus de parentification, c’est-à-dire quand l’enfant adopte le rôle du parent (Hooper 217), est employée dans les deux discussions.
La vie devant soi
La théorie d’attachement explique l’importance des premières relations que crée l’enfant avec les personnes qui l’entourent. Pour Momo, la personne à qui il s’attache et qui, par conséquent, devient sa figure d’attachement, est Madame Rosa. La relation entre Momo et Madame Rosa contient sans doute beaucoup d’amour, mais elle porte aussi des aspects destructeurs qui signalent un attachement insécure évitant. Ce style d’attachement est caractérisé par un comportement parental détaché (Vrai, sec. 2). Dans le cas de Madame Rosa, ce détachement est visible dans des absences mentales du présent : « J’ai vite regardé son visage et j’ai vu qu’elle n’y était pas du tout » (Gary 164). À cause de cette fragilité de Madame Rosa, Momo est obligé de prendre beaucoup de responsabilité dans la maison. Il s’occupe de Madame Rosa et des autres enfants, et il fait le marché (Gary 74). Il devient comme un parent substitut, un rôle auquel il n’est pas préparé. En plus, il est très isolé. Quand il arrive des problèmes, il n’y a personne à qui il peut demander de l’aide : « Je pensais à la pancarte que Monsieur Reza le cordonnier mettait pour dire qu’en cas d’absence, il fallait s’adresser ailleurs, mais je n’ai jamais su à qui je pouvais m’adresser » (Gary 151). S’occuper des tâches domestiques normalement réservées aux adultes fait partie de la parentification instrumentale et, si bien appréciée par le parent, cette responsabilité n’est pas nécessairement mauvaise ou débilitante pour l’enfant (Hooper 217). Madame Rosa montre son appréciation à tout ce que fait Momo plusieurs fois ; par contre, quand il essaie de gagner de l’argent en se prostituant, comme a fait Madame Rosa quand elle était jeune, la vieille dame juive lui fait jurer de ne jamais faire cela, en lui disant : « c’est pas pour ça que je t’ai élevé » (Gary 82). Bien qu’elle dépend de lui de plus en plus, il est évident qu’elle cherche à le protéger. Il y a pourtant une autre catégorie de parentification plus nocive : la parentification émotionnelle. Si prolongée, ce type de parentification peut interrompre le développement d’une identité individuelle chez l’enfant, puisqu’il passe ses journées à s’occuper des besoins des autres (Hooper 218). C’est ce type de parentification qu’exerce Momo quand il focalise les besoins de Madame Rosa devant les siens. Quand il s’amuse, il se sent coupable : « je m’étais donné du bon temps sans Madame Rosa et j’avais des remords » (Gary 129). Il n’a pas beaucoup d’experience de penser à lui-même, comme l’on voit dans le cas de Nadine, à qui Momo veut s’attacher mais ne s’en permet pas par la loyauté ou l’obligation qu’il tient pour Madame Rosa. Il renonce tout confort pour lui-même et néglige ses propres besoins en faveur de ceux de Madame Rosa. La conséquence est qu’il n’apprend jamais comment vivre pour lui-même.
En principe, cette structure relationnelle entre Momo et Madame Rosa, remplie de peur et de la responsabilité du bien-être d’un autre, va se retrouver dans la structure des relations que crée Momo dans sa vie. À l’âge adulte, les individus qui tiennent un attachement insécure évitant avec sa figure d’attachement ont « une confiance en soi mais pas en les autres, ce qui les fait réagir par une certaine distance et un évitement dans les relations intimes » (Vrai, sec. 2). Cette distance dans les relations intimes peut être aperçue dans l’interaction entre Momo et Nadine. Il accepte des glaces et aime bien passer du temps dans sa compagnie, mais quand Nadine commence à parler de l’avenir qu’il pourrait avoir chez elle et sa famille, il fuit, sachant qu’elle a déjà d’autres enfants et que, donc, il n’y a pas de place pour lui (Gary 127). Un autre résultat d’un comportement parental détaché et une parentification émotionnelle est que l’enfant insecure évitant devient atteint d’une anxiété étouffée. En apparence, il « se détache, manifeste peu d’émotions, se tourne davantage vers l’exploration et se voit contraint d’adopter une autonomie précoce comme stratégie de survie » (Vrai, sec. 2). L’enfant a appris qu’il ne peut pas compter sur sa figure d’attachement, parce qu’elle n’est pas toujours là. Bien sûr, en fin de compte, cette angoisse étouffée va se manifester dans des façons internes/passives ou externes/actives. Momo admet que : « d’habitude j’ai une peur bleue sans aucune raison, comme on respire » (Gary 109) et suivant sa rencontre avec Nadine, il se jette devant des voitures pour faire peur aux automobilistes : « En courant parmi les voitures … j’avais beaucoup d’importance » (128). Il reconnaît qu’il ne peut jamais être la priorité de Nadine et cette réalisation lui fait du mal, mais dans cette situation, au moins, il est important pour quelqu’un. En plus, il se sent en contrôle, ce qui lui manque dans la plupart de sa vie.
L’Amant
La relation entre la protagoniste et sa mère est remplie de sentiments turbulents et une absence de stabilité, typique pour un attachement désorganisé. Dans ce style d’attachement, le parent donne l’impression d’être quelqu’un d’instable, un symbole de la protection aussi bien que de la peur, et l’enfant n’apprend jamais à interagir avec ses propres sentiments (Granhag 80). Le comportement de la mère dans L’Amant passe de l’indifférence à la violence. Elle ne porte aucun respect pour sa fille ou la vertu de celle-ci, en la permettant de sortir de la maison habillée dans une « tenue d’enfant prostituée » (Duras 32). Selon elle, les regards des hommes sont quelque chose dont on devrait être fier : « Tous, dit la mère. Ils tournent autour d’elle, tous les hommes du poste, mariés ou non, ils tournent autour de ça, ils veulent de cette petite, de cette chose-là » (108-109). Bien qu’elle soit mineur et la plus jeune dans la famille, la mère compte sur elle pour gagner de l’argent, et, ce faisant, la pousse envers la parentification instrumentale. Elle n’exprime jamais de gratitude ; toutes les conversations entre mère et fille traitent le sujet d’argent ou de l’apparence et l’habillement de la fille. Naturellement, si ce sont ces choses-là que focalise la mère, c’est ce que va apprendre la fille : « c’est pour cela aussi que l’enfant sait bien y faire déjà, pour détourner l’attention qu’on lui porte à elle vers celle que, elle, elle porte à l’argent. Ça fait sourire la mère » (33). La fille s’engage aux comportements qui lui donnent de l’attention de la mère. Il est peu surprenant que, à la fin, elle se jette dans une relation avec un homme riche puisque c’est sa seule valeur dans les yeux de sa mère : sa capacité de gagner d’argent. Pourtant, quand la mère soupçonne que la relation entre sa fille et le Chinois est devenue sexuelle, elle la punie :
Dans des crises ma mère se jette sur moi, elle m’enferme dans la chambre, elle me bat à coups de poing, elle me gifle, elle me déshabille, elle s’approche de moi, elle sent mon corps … elle hurle, la ville à l’entendre, que sa fille est une prostituée, qu’elle va la jeter dehors, qu’elle désire la voir crever et que personne ne voudra plus d’elle, qu’elle est déshonorée, une chienne vaut davantage. (71)
Ce manque de structure dans des modèles comportementaux, c’est-à-dire cette conduite labile de la mère, marque un attachement désorganisé. La fille n’a aucune « base sécurisante » à laquelle elle peut retourner quand elle se trouve dans des situations gênantes ou dangereuses, puisque la mère semble soit encourager ces situations, soit punir sa fille quand elle s’y retrouve. Elle évite la maison, même si elle cherche aussi l’attention de sa mère. La mère, à son tour, se comporte avec un air détaché, et ne semble pas être très engagée dans la vie de sa fille. Dans cet environnment volatil et peu réglementé, il est peu étonnant que la fille finit par chercher de l’attention ailleurs. Pour la protagoniste de L’Amant, une relation intime équivaut à une relation violente et labile. Une des notions les plus fondamentales de la théorie d’attachement est la conviction que les interactions entre l’enfant et sa figure d’attachement forment la base des « modèles émotionnels » après lesquels l’enfant apprend comment interagir avec les autres et construire des relations (Vrai, sec. 1). Donc, la relation et le style d’attachement ne concerne pas que la relation parent-enfant, mais devient pour ainsi dire le « prototype » de toutes les relations futures de l’enfant. Il est sûr que, dans un certain sens, la conduite du Chinois évoque celle de la mère. Il est atteint des sentiment forts et contradictoires, et vacille entre une passion qui s’avoisine à la violence : « Il devient brutal, son sentiment devient désespéré, il se jette sur moi, il mange les seins d’enfant, il crie, il insulte » (Duras 53) et une forte peur : « Il pleure souvent parce qu’il ne trouve pas la force d’aimer au-delà de la peur » (61). La protagoniste est habituée à cette dichotomie émotionnelle, et peut-être qu’elle la cherche même. En effet, elle devient comme un enfant de son amant : « J’étais devenue son enfant. C’était avec son enfant qu’il faisait amour chaque soir » (118). Par opposition au Chinois, la protagoniste maintient un air détaché, peu émotionnel, dans leur relation, ce qui est typique dans un attachement insécure évitant. Avant leur première rencontre sexuelle, elle demande qu’il ne lui parle pas, et qu’il fasse « comme d’habitude il fait avec les femmes » (47). Elle semble seulement être intéressée au plaisir charnel, peut-être parce qu’elle a appris par sa mère qu’elle ne peut pas compter sur d’autres personnes pour répondre à ses besoins émotionnels, ce qui laisse seulement les besoins physiques. Focaliser les besoins physiques au lieu des besoins émotionnels est un autre charactéristique d’un attachement insécure évitant (Granhag 77). Puisque sa relation avec sa mère est composée d’un certain niveau d’évitement, il est possible qu’elle cherche un substitut à qui elle peut s’attacher.