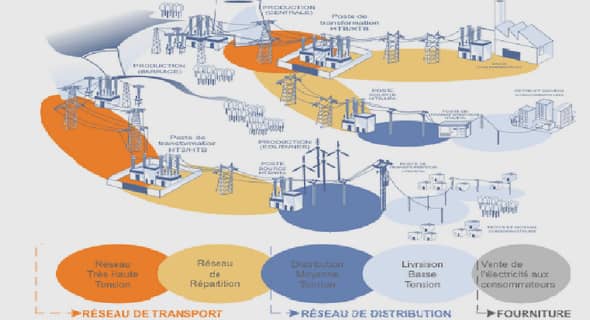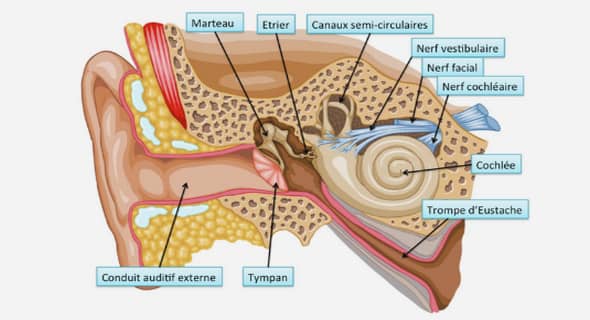RAPPELS SUR LE FOIE
ANATOMIE : Situation du foie : il est situé sous le diaphragme, dans l’hypochondre droit, la partie supérieure de l’épigastre et l’hypochondre gauche.
Couleur et consistance : le foie est de couleur rouge brun, il est ferme et de friabilité très marquée. Poids : chez l’homme, le foie pèse 1,900 g, chez la femme, 1,880g. Dimension : la longueur du foie est de 28cm environ dans le sens transversal et de 16cm environ 1/34è du poids total du corps et chez l’enfant à la naissance 1/23è. Dans le sens antéropostérieur, il a 8cm d’épaisseur maximale. Moyen de fixité : c’est un organe fixe, maintenu en place par : pression des viscères environnants, ses différentes attaches vasculaires : les veines sus- hépatiques l’amarrent à la veine cave inférieure, le petit omentum, et trois ligaments principaux : le ligament triangulaire droit : il prolonge le ligament coronaire. le ligament triangulaire gauche : il prolonge le ligament coronaire également. le ligament suspenseur ou falciforme : il fixe le foie au diaphragme tout en le divisant en lobes gauche et droit anatomiques.
ROLE IMMUNOLOGIE
Le foie est considéré comme un organe lymphoïde capable de générer et d’activer des cellules lymphocytaires très hétérogènes. Ces cellules, en particulier les cellules de
Kupffer ont le pouvoir phagocytaire spécifique. Le foie contient aussi des cellules de l’immunité naturelle qui lui permettent d’assurer son rôle de première ligne de défense vis-à-vis des molécules du tube digestif véhiculées par le système porte. Les cellules de Kupffer et les cellules endothéliales localisées à la périphérie du lobule sont des cellules protectrices du foie et de notre organisme vis-à-vis des agressions des germes.
La particularité de la circulation du foie donne davantage un atout aux systèmes de protection. Des nombreux systèmes enzymatiques et des capacités de synthèse des nombreuses substances sont des moyens non négligeables à la protection. Enfin, le foie par ses fonctions de détoxication participe significativement à la protection de notre organisme.
RAPPELS SUR LE PERITOINE
C’est une membrane tapissant la cavité abdomino-pelvienne et recouvrant partiellement ou totalement les organes de cette cavité.
ANATOMIE : Le péritoine est divisé en péritoine pariétal et viscéral et délimite une cavité virtuelle, la cavité péritonéale.
Péritoine pariétal : c’est la partie du péritoine recouvrant les parois internes de la cavité abdomino-pelvienne.
Péritoine pariétal antérieur : c’est le péritoine tapissant la face interne de la paroi abdominale antérieure. Dans sa partie infra abdominale, il présente trois plis divergents de l’ombilic : les plis ombilicaux médians et latéraux. Ceux-ci délimitent les fosses supra-vésicales, inguinales médianes et inguinales latérales Péritoine uro-génital : c’est le péritoine recouvrant les organes urogénitaux. Prolongement du péritoine pariétal abdominal, il recouvre tous les organes pelviens, excepté l’ovaire et la face axiale des franges tubaires chez la femme. Il est caractérisé par l’existence de cul de sac, des fosses, de plis et ligaments : dans la région médiane : chez l’homme, le cul de sac rétro vésical ; chez la femme, le cul de sac retro-utérin. dans les régions latérales : chez l’homme, la fosse para-vésicale ; chez la femme, la fosse para-vésicale, le ligament large, le ligament suspenseur de l’ovaire, la fosse ovarique et le pli retro-utérin.
Péritoine viscéral : partie du péritoine couvrant partiellement ou totalement les viscères abdomino-pelviens.
ROLE IMMUNOLOGIQUE
Le péritoine se défend : d’une part, avec une activité de base fondée sur des agents cellulaires, surtout polynucléaires et macrophages, assurant l’asepsie de la cavité péritonéale.
d’autre part, en cas d’agression par la mise en œuvre de nombreux processus : sécrétions d’un épanchement liquidien, dotées de pouvoir bactéricide, chargé de fibrine et d’éléments cellulaires, cloisonnement de la cavité péritonéale et circonscription du foyer lésionnel par l’inflammation qui entraîne une hyperhémie et un œdème de la trame conjonctive du péritoine, et l’hypersécrétion fibrinoïde qui engendre une agglutination des surfaces péritonéales autour des foyers septiques, immobilisation et repos fonctionnel aboutissant à une paralysie intestinale avec occlusion fonctionnelle ; formation d’adhérences inflammatoires étendues qui limitent la diffusion de l’infection et contrarient encore la reprise du péristaltisme, modification de la distribution intrapéritonéale des épanchements par des courants intrapéritonéaux actifs transitant par les gouttières pariéto-coliques et tendant à les collecter en 4 sites majeurs : espace inter-hépato-diaphragmatique, espaces sous-phréniques droit et gauche, cul-de-sac de Douglas, mobilisation de diverses formations intrinsèques de la cavité péritonéale. Ainsi, le mésentère, l’intestin et surtout le grand épiploon participent à la réaction inflammatoire du péritoine qui vise la limitation du foyer septique.
RAPPELS SUR LE COLON
ANATOMIE : Le colon est une partie du tube digestif et il fait suite à l’intestin grêle qui joue un rôle d’absorption.
Le colon présente plusieurs portions : colon droit, colon transverse, colon gauche et le sigmoïde prolongé par le rectum.
Longueur : en moyenne de 150 cm, mais elle varie beaucoup d’un individu à l’autre et décrit un trajet « en cadre ».
Le colon droit (colon ascendant) est formé par le coecum qui est en fait le début du gros intestin (un sac de 6 cm environ) et qui présente l’abouchement de l’appendice sur la face interne. Et il est normalement situé dans la fosse iliaque droite.
L’appendice est de 8 cm environ mais il peut être beaucoup plus long, dépassant 15 cm. Normalement situé en dedans du coecum, il est coudé vers le bas près de sa base.
Le côlon ascendant qui fait suite au coecum est de 8 à15 cm de long, il longe la paroi abdominale vers le haut et tourne au niveau de l’angle hépatique pour se poursuivre dans le côlon transverse. Il est complètement rétropéritonéal. Le côlon transverse : Il s’étend de l’hypochondre droit à l’hypochondre gauche.
Avec le sigmoïde, c’est la seule portion du côlon qui est complètement entourée de péritoine. Il est recouvert et fixé par le grand épiploon. Sa longueur est de 40-80cm environ.
Le côlon gauche ou colon descendant : long de 12 cm environ ; verticale, Il va de l’angle splénique jusqu’au sigmoïde en suivant la paroi abdominale. Il est rétro- péritonéal dans tout son trajet. Le sigmoïde: Il est en forme de S, mobile, intra péritonéal et suspendu par son mésocôlon. Sa longueur est assez variable, allant de 15 à 80 cm, mais il mesure en moyenne 30 cm. Il se continue dans le rectum au niveau du promontoire sacré.
Vascularisation et innervation : deux territoires vasculaires peuvent être distingués pour le cadre recto colique: le territoire mésentérique supérieur pour le côlon droit et les deux tiers droits du transverse et le territoire mésentérique inférieur pour le tiers gauche du transverse, le côlon descendant, le sigmoïde et le haut rectum.
Table des matières
INTRODUCTION
PREMIERE PARTIE
I- Rappels sur le foie
A- Anatomie
B- Histologie
C- Physiologie
D- Rôle immunologique
II- Rappels sur le péritoine
A- Anatomie
B- Histologie
C- Physiologie
D- Rôle immunologique
III- Rappels sur le colon
A- Anatomie
B- Histologie
C- Physiologie
D- Rôle immunologique
IV- Rappels sur les colites infectieuses
A- Définition
B- Classification des colites infectieuses selon les bactéries
C- Classification des antibiotiques
V- Coproculture et antibiogramme
A- Coproculture
B- Antibiogramme
VI- Relation entre maladies du foie et celles du colon
A- Impact de la maladie du foie sur le colon
B- Impact de la maladie du colon sur le foie
C- Impact de l’hémorragie digestive par rupture de varices sur la flore colique
DEUXIEME PARTIE
I- METHODOLOGIE ET PATIENTS
II- RESULTATS
TROISIEME PARTIE
DISCUSSION
I- sur la méthodologie et effectif
II- sur l’épidémiologie
III- sur les antécédents
IV- sur l’impact de l’état du foie sur le colon
V- sur les indications et les résultats de la coproculture
VI- sur les complications et les résultats de la coproculture
VII- sur les étiologies des hépatopathies et les résultats de la coproculture
VIII- sur le traitement
SUGGESTIONS
CONCLUSION
REFERENCES