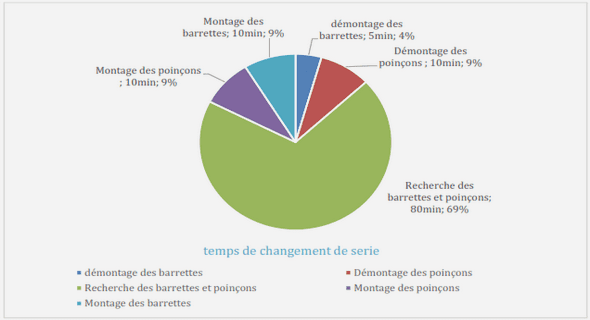Du sexe unique à la dichotomie des sexes
En Occident, comme dans la majeure partie des sociétés, les populations perçoivent et tiennent pour acquise l’existence de différences fondamentales entre les sexes, ces différences pouvant être d’ordre biologique, morphologique et/ou psychologique. Mais ces distinctions n’ont pas toujours été évidentes dans la pensée occidentale : on n’a pas toujours différencié un sexe masculin et un sexe féminin spécifiques.
De l’Antiquité classique jusqu’à la fin du 18ème siècle, le modèle « un seul sexe/une seule chair » a largement dominé la réflexion sur la différence des sexes en Occident. Jusqu’à cette période demeurait l’idée que le sexe féminin était tout simplement le symétrique du sexe masculin, à la différence que l’appareil génital de la femme était à « l’intérieur » du corps et non l’extérieur comme l’homme1. L’historien Thomas Laqueur nomme ainsi « modèle unisexe » cette perception des sexes, modèle hérité des théories de Galien. Dans cette conception, homme et femme étaient classés suivant leur chaleur vitale, la différence des sexes étant alors, selon les termes de M-C. Pouchelle, une « différence de cuisson » (2000 : 65)2. Ainsi la femme est froide et humide (principe de mort) et l’homme est chaud et sec (principe de vie) ; dans le « combat » de ces deux principes, c’est par un défaut de chaleur qu’arrive un enfant de sexe féminin : ainsi la femme naît d’un manque. L’homme et la femme sont dans un rapport d’inversion dans lequel la femme est présentée comme un être imparfait et l’homme un être parfait. Ainsi pour Aristote, « la première déviation [de la nature] c’est d’abord la production d’une femelle au lieu d’un mâle […] mais cette déviation est indispensable à la nature [pour les nécessités de la reproduction] »1. Les savants des Lumières en tirent deux conclusions : d’une part, les comportements de genre » qu’ils identifient dérivent directement du sexe, et d’autre part le corps féminin n’est formé que pour servir la maternité. Néanmoins, Thomas Laqueur nous rappelle que dans les textes antérieurs aux Lumières, le sexe était plus considéré comme une catégorie sociologique qu’ontologique. Etre un homme ou être une femme c’était avant tout avoir un certain rang dans la société, une place, assumer un rôle culturel et non pas « être organiquement l’un ou l’autre des deux sexes incommensurables » (Laqueur, 1992 : 21).
A ce modèle « un seul sexe/une seule chair » succède un « modèle à deux sexes », élaboré au début du 19ème par les savants qui vont sexualiser le corps humain. Selon les propos de Thomas Laqueur, « […] ils résolurent de fonder les différences qu’ils jugeaient capitales entre sexe masculin et sexe féminin et donc entre homme et femme » (Laqueur, 1992 : 18). Ces distinctions se basent sur des différences biologiques visibles. Ainsi, pour le médecin ou pour le naturaliste, le rapport de la femme à l’homme se présente par une série d’oppositions et de contrastes. Les appareils génitaux masculin et féminin apparaissent désormais comme radicalement spécifiques et selon les termes de T. Laqueur, « des organes qui avaient partagé le même nom – les ovaires et les testicules – se trouvèrent désormais distingués au niveau linguistique […] : on inventa deux sexes » (Ibidem : 171). Après une « différence de cuisson » pour reprendre les termes de M-C. Pouchelle, la différence sexuelle se base désormais sur une différence d’espèce : « l’espèce » mâle et « l’espèce » femelle, fondée sur des différences d’ordre biologique. L’homme et la femme se distinguent désormais non plus par un rapport d’inversion ou par un degré de chaleur mais par le corps et plus précisément, selon I. Théry, « par ce qui dans le corps fonde l’incommensurable de la différence du mâle et de la femelle humains : la reproduction sexuée. Sur cette inégalité fondamentale, s’érigera partout l’inégalité des droits » (2001 : 21).
Ainsi, à partir du 19ème siècle, la compréhension du sexe sera basée sur l’existence de deux entités biologiques, catégorisées comme des sexes donnés par la nature : mâle et femelle. A ces deux entités biologiques correspondent deux natures, la nature masculine et la nature féminine. Cette conception de deux sexes comme des données naturelles était largement répandue par les théories de la sexologie biomédicale. En effet, pour les sexologues, le « mâle » et la « femelle » sont des structures innées et l’hétérosexualité est la forme la plus achevée de l’évolution sexuelle. C’est d’ailleurs à la même période, au début du 19ème siècle, qu’apparaît le terme de « sexualité » et qu’il est attesté dans le lexique. D’après Michel Foucault, la catégorie de sexualité va se structurer au fil d’une lente maturation et l’usage même du mot « sexualité » s’établira en relation avec d’autres phénomènes : le développement de domaines de connaissances diverses, la mise en place d’un ensemble de règles et de normes, en partie traditionnelles, en partie modernes et, pour finir, « des changements dans la manière dont les individus sont amenés à prêter sens et valeur à leur conduite, à leurs devoirs, à leurs plaisirs, à leurs sentiments » (Foucault, 1984 : 9-10). Dans cette maturation de la notion de sexualité, la psychanalyse joua un rôle important avec le développement du désir chez l’individu. Ainsi, pour le psychanalyste Daniel Welzer-Lang, il était important aussi que le sujet se reconnaisse comme sujet désirant. Notons par ailleurs que c’est Michel Foucault qui suggère la notion de désir dans les années 1980.
Dans le domaine anthropologique, la place de la sexualité est centrale, comme le rappellent L. Bazin, R. Mendès-Leite et C. Quiminal, coordinateurs d’un ouvrage collectif sur L’anthropologie des sexualités ». Elle est centrale car elle se retrouve constamment dans des domaines classiques de l’anthropologie comme la parenté ou l’économie. Selon les auteurs, « à ses origines ethnographiques, la sexualité a été appréhendée très « naturellement » dans un discours sur l’altérité comme l’une des marques les plus évidentes de l’« exotisme », ce dernier s’inscrivait dans l’univers fantasmatique de la promiscuité » (Bazin et al, 2000 : 9). Entre les années 1920 et 1940, l’anthropologie fournit une contribution importante aux réflexions sur la sexualité avec notamment Malinowski ou Mead1. Par ailleurs, la thématique de la sexualité et de la société primitive s’élabore dans le dialogue entre anthropologie et psychanalyse. En anthropologie, les recherches contemporaines prennent appui sur d’autres disciplines, comme l’histoire et sur certains courants comme ceux des féministes ou encore sur les travaux à propos des homosexuels et des lesbiennes, lesquelles recherches contribuent à l’émergence de la sexualité comme objet d’étude.
Sur cette toile de fond qu’est la notion de sexualité, apparue dès le 19ème siècle, vont se dessiner des « catégories » de sexualité, des spécifications en quelque sorte : l’homosexualité, la bisexualité et par conséquent l’hétérosexualité.
Les catégories pour penser les sexualités
Il est important dans cette recherche de traiter des catégories pour penser les sexualités dans la mesure où la définition même de ces catégories peut varier d’une société à l’autre. Ce que nous pouvons percevoir comme de la déviance dans nos sociétés, en matière de sexualité, peut ne faire l’objet d’aucune stigmatisation et de mise à l’écart dans d’autres sociétés. Chaque société appréhende différemment les catégories de sexualité. Par exemple, en Occident, l’homosexualité masculine a toujours été difficile à prendre en compte alors que dans d’autres sociétés, les pratiques homosexuelles peuvent être ritualisées, institutionnalisées comme en Mélanésie lors des rituels initiatiques1.
Les catégories de sexualité relèvent avant tout d’une construction culturelle et donc historique. Comme pour les deux sexes, homme et femme, ces catégories ne sont pas non plus comprises de la même manière à toutes les époques. De même, elles n’ont pas nécessairement la même signification pour tous les individus. Comme on le verra ultérieurement, l’orientation sexuelle tout comme l’attrait pour le même sexe, ne sont pas les critères déterminants pour être classé dans la catégorie problématique appelée « troisième sexe ». Pourtant on a longtemps défini les individus dits de « troisième sexe » en fonction de leurs choix sexuels, bien souvent conçus comme homosexuels.
En Occident, avant le 19ème siècle, ceux que nous considérons comme homosexuels en raison de leur orientation sexuelle, n’étaient pas considérés comme des types spécifiques. Selon Michel Foucault, « l’homosexualité est apparue comme une des figures de la sexualité lorsqu’elle a été rabattue de la pratique de la sodomie sur une sorte d’androgynie intérieure, un hermaphrodisme de l’âme. La sodomie était un relaps, l’homosexuel est maintenant une espèce » (1976 : 59). En d’autres mots, on est passé de l’homosexualité caractérisée comme relation sexuelle (déviante) à l’homosexualité en tant que manière « d’intervertir en soi le masculin et le féminin » (Ibidem). Notons par ailleurs qu’avec l’émergence de la notion d’homosexualité, apparaît celle d’hétérosexualité.
C’est vers 1870 que les termes « homosexuel » et « homosexualité » se retrouvent dans le lexique mais ils sont cantonnés au domaine de la psychopathologie. A cette époque, les pratiques homosexuelles sont le plus souvent appréhendées avec aversion, répulsion, voire haine, de la part des médecins. Les homosexuels sont « médicalisés » mais comme le précise R. Mendès-Leite, il faut néanmoins différencier l’inversion [la vraie homosexualité] et la perversion [criminalisée] » (2000 : 40). Ainsi, on passe d’une prohibition des pratiques à une stigmatisation de l’individu. Ce n’est qu’à la fin du 19ème siècle que, selon R. Mendès-Leite, « les cadres (style de vie, auto-définition de l’identité) de l’homosexualité contemporaine se mettent définitivement en place »1. Le terme d’homosexualité est alors utilisé pour définir les rapports entre individus d’un même sexe biologique. Dès la seconde moitié du 19ème siècle on assistera à une profusion de recherches sur l’origine de l’homosexualité. En 1897, l’ouvrage de Havelock Ellis, Sexual inversion, est le premier écrit en langue anglaise qui traite de l’homosexualité sans la lier à la maladie ou à la criminalité. Il la considère comme innée et immuable.
Cependant en Occident, aujourd’hui encore, on est loin de l’unanimité quant à la définition de la catégorie « homosexualité » et celle de l’homosexuel(le). Certaines personnes que l’on qualifierait d’homosexuelles ne se définissent pas elles-mêmes de la même manière. Et avoir des pratiques homosexuelles ne signifie pas nécessairement que l’on se range dans la catégorie « homosexuel(le) ». Au cours d’enquêtes réalisées sur l’homophobie, le psychanalyste Daniel Welzer-Lang conclut que les personnes considérées comme homosexuelles ne le sont ainsi qu’en raison d’un aspect physique, d’un comportement et de manières qui rappellent celles des femmes. Il ajoute que certains hommes, ayant des relations sexuelles occasionnelles avec des homosexuels ou des transsexuels et étant parfois mariés à une femme, ne se considèrent pas comme homosexuels (D. Welzer-Lang, 2000 : 234).
Ainsi, on ne peut pas définir les catégories pour penser les sexualités en se fondant sur le seul point de vue biologique ou anatomique ou même morphologique mais plutôt selon l’identité que chaque individu se construit et selon le genre auquel il s’identifie. Par exemple, si deux personnes de même sexe biologique ont des rapports sexuels entre elles, cela ne signifie pas qu’elles se considèrent elles-mêmes comme homosexuelles. On verra que pour certains individus qui sont rangés dans la catégorie du « troisième sexe », ils ont le sentiment d’appartenir à un genre qui ne correspond pas à leur sexe biologique ; si on ne prend en compte que leur sexe biologique pour définir leur sexualité ces personnes seront considérées comme homosexuelles lors de rapports avec le même sexe qu’elles. Mais si on prend en compte le genre auquel elles pensent appartenir, l’identité de sexe qu’elles revendiquent, alors elles seront hétérosexuelles.
LES GENDER STUDIES OU L’ANTHROPOLOGIE AU FEMININ
A partir des années soixante un gros changement dans les recherches sur les rapports sociaux de sexes fut entrepris : il s’agissait de réinventer les catégories d’investigation qui servaient jusqu’ici. Par une critique systématique, on remit en cause les rapports sociaux de sexes et donc les notions même d’ « homme » et de « femme ». Il apparaît que dès les années 1930, l’anthropologue Margaret Mead anticipe ces mouvements et reconsidère le déterminisme biologique qui avait cours pour traiter les sexes masculin et féminin : il y avait deux sexes et donc deux natures, l’une masculine et l’autre féminine. Elle démontra par exemple que la division sexuelle du travail relevait plus de la culture que de la nature1.
A la fin des années soixante en Occident, se développe, dans le domaine des sciences humaines, un courant de recherches inter – voire pluri – disciplinaires dénommé women’s studies ou études « par/sur les femmes » (N-C Mathieu, 2000 : 275). Ces travaux vont notamment critiquer le biais sexiste et le point de vue androcentriste de la science. Ainsi dans les années 1970 se pose le problème d’une discipline dominée par les hommes et donc d’analyses influencées par leur regard, leur point de vue sur les sociétés. On remarque, par exemple, que les femmes des sociétés étudiées par les anthropologues sont représentées de manière réductrice et que dans certains domaines, comme les rituels, elles étaient absentes des descriptions en tant qu’actrices sociales. Les mouvements féministes s’interrogèrent aussi sur l’origine de la domination masculine et sur la question de son universalité. Leurs travaux remettent en cause l’opposition binaire entre deux pôles identitaires, l’un masculin lié à la sphère publique et relevant de la culture et l’autre féminin appartenant à la sphère privée et relevant de la nature (Membrado ; Rieu, 2000 : 13). Dans ce mouvement contestataire des classifications des sexes masculin et féminin, l’anthropologie sociale n’est pas en reste.
Entre la fin des années 70 et le début de 1980, se développa un intérêt croissant pour les catégories sociales de sexes, ce sont les études de genre ou gender studies. La notion de genre ou gender dans sa version anglo-saxonne s’est seulement généralisée dans les années 1980 et surtout dans le domaine des sciences humaines. Elle désigne « une construction sociale qui contraste avec l’idée de sexe [biologique] » (Barraud, 2001 : 28). Ce type d’analyse dite du « genre », à la mode dans les pays anglo-saxons s’est réalisée sous la principale impulsion de la critique littéraire aux Etats-Unis ainsi que sous l’influence des mouvements de minorités nord-américaines (gays, travestis, transsexuels) : ces derniers revendiquent de façon personnelle les choix (sexuels) multiples, espérant ainsi « transcender » des catégorisations sociales qu’ils jugent oppressives. De même, au cours des années 1980 un mouvement appelé Transgenderist émerge aux Etats-Unis et en Europe de l’Ouest, il se caractérise par l’idée que l’existence d’un système figé de genre est oppressant. Selon les propos de Sabrina Petra Ramet, le principe de ce mouvement est que « les gens devraient être libres de changer, temporairement ou définitivement, leur type de sexe auquel ils sont assignés depuis la naissance ». Pour ce mouvement, l’existence d’une culture de deux genres est un « apartheid de sexe » (Ramet, 1996 : 14).
La problématique du genre se propose de rendre compte de la division sociale des sexes mais aussi de la production et reproduction de l’identité sexuelle. Notons que la recherche française fut lente à s’emparer de cette problématique. N-C Mathieu précise ainsi que les études sur la construction des sexes/genres sont toujours assez peu développées et celles qui existent depuis les mouvements féministes des années 70 ne sont pas vraiment reconnues comme faisant partie intégrante de l’anthropologie (N-C. Mathieu, 2000). Le concept de genre est par ailleurs souvent cantonné à la littérature scientifique féminine. Les gender studies ont ouvert tout un champ de questions sur le rapport au biologique et à la reproduction, et ont permis une critique des idées occidentales sur l’identité de sexe et sur la différence. Elles permettent aussi d’introduire le point de vue des femmes sur leur société. Ainsi, un cas célèbre dénonçant la minorisation des femmes est l’étude d’A. Weiner à la fin des années 70, qui montra le pouvoir considérable des femmes au sein de la société trobriandaise, notamment lors des rituels, alors que Malinowski ne leur avait manifestement donné aucune place majeure. L’ethnologue pose un autre regard sur les productions féminines et fait apparaître la place qu’elles ont dans un univers plus large que celui du domaine économique1.
Ce qui est aussi contesté c’est le système dissymétrique et inégal dans lequel sont impliqués les hommes et les femmes : les hommes sont toujours, dans les rapports sociaux, en position de domination, incontestée, ou non, et l’homme sert de référence unique pour penser l’univers humain. Selon Françoise Héritier, c’est la différence des sexes qui a servi en premier à penser et à organiser le monde. Dès l’émergence de la pensée, la réflexion des hommes n’a pu se porter que sur l’objet le plus proche : le corps humain. Or « le corps humain présente un trait remarquable qui est la différence sexuée et le rôle différent des sexes dans la reproduction » (Héritier, 1996 : 19). Cependant, il y aurait non seulement une différence entre les sexes mais aussi une hiérarchie : c’est ce que F. Héritier nomme « la valence différentielle des sexes ». Cette valence « traduit la place différente qui est faite universellement aux deux sexes sur une table des valeurs et signe la dominance du principe masculin sur le principe féminin […] et cette dominance est universelle »1. Par ailleurs, l’idéologie fondée sur la différence entre les sexes et leur hiérarchisation, s’exprime dans leur caractérisation en chaud et sec d’une part, en froid et humide d’autre part, voir en droite et gauche, supérieur et inférieur : « la différence des sexes est, toujours et dans toutes les sociétés, idéologiquement traduite dans un langage dualiste et hiérarchisé » (F. Héritier, 1996 : 206). Et dans ce langage dualiste il y a toujours un sexe mineur, la femme et un sexe majeur, l’homme. D’après F. Héritier, la raison pour laquelle les femmes sont, universellement, dominées, réside dans leur pouvoir de fécondité.
L’objectif de ce travail étant principalement d’étudier et de comprendre un cas de troisième sexe » associé à une société de Polynésie. Il est alors intéressant de voir la manière dont les études de genre se sont développées dans le Pacifique. C’est vers le milieu des années 1970 que les chercheurs reconnaissent la stérilité des propos dévalorisant la place de la femme dans le domaine de la parenté, de l’économie, du religieux. L’intérêt porté aux femmes dans cette région débuta vraiment vers la fin des années 1970 mais ne concernait que les femmes blanches, occidentales comme les femmes de missionnaires par exemple (Ralston, 1992 : 166). Lorsque les femmes polynésiennes apparaissaient dans les rapports, elles étaient souvent présentées comme impures, soumises aux hommes ou même sans vertu. Ainsi la Tahitienne fut-elle constamment décrite par les voyageurs comme une femme à la sexualité débridée. Parmi les travaux les plus importants qui ont permis de dissiper certains malentendus, notamment sur la réalité des rapports homme-femme et sur l’image de la femme polynésienne, citons ceux de B. Shore (Samoa), S-B. Ortner, A. Weiner, J. Linekin (Hawaï), C. Langevin (Polynésie Française), K. James, F. Douaire-Marsaudon et C. Ralston (Tonga). Depuis ces dernières années les gender studies dans le Pacifique ont pris en compte le phénomène dit du « troisième sexe », très présent en Polynésie sous la forme d’hommes qui effectuent le travail des femmes et s’habillent souvent comme elles (Mageo : 1992 ; James : 1994 ; Shore : 1994 ; Besnier : 1994).
A partir de l’essor des gender studies, un certain nombre d’anthropologues se sont focalisés sur la distinction entre sexe et genre. L’observation des rapports entre hommes et femmes a poussé les chercheurs, de tous domaines, à dépasser les sexes anatomiques et à observer la place que chacun occupait dans la société et son rôle dans la reproduction sociale. Cette dichotomie sexe/genre introduit un nouveau débat dans les sciences humaines aujourd’hui : Doit-on utiliser systématiquement le concept de genre et ignorer celui de sexe ?