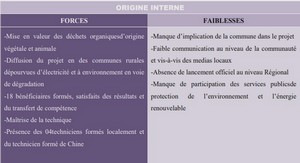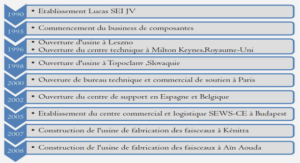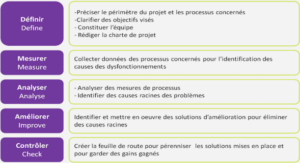LA GÉNÉALOGIE D’UN SOUPÇON
Les contours de la notion étant tracés, et notre position établie par rapport à la tradition, il est possible maintenant de se pencher sur la métaphore à l’heure du soupçon. Aussi incroyable que cela puisse paraître, la métaphore a en effet été accusée, dans la seconde moitié du XXe siècle, sinon de tous les maux, du moins de beaucoup de travers qui ne lui appartiennent pas en propre, voire pas du tout : non seulement de compliquer considérablement la communication, ou de tirer la couverture rhétorique à elle, mais aussi de travestir le réel, de dissimuler, de manipuler ou de reposer sur le mensonge. Il s’agit donc ici de reconstituer cette argumentation, dans un premier temps, puis d’en rechercher les causes, pour que du nouveau soit enfin possible, pour que la théorie de la métaphore ne soit pas éternellement handicapée par les mêmes griefs mal fondés. Il est frappant de constater combien certains malentendus perdurent, en effet, combien de travaux théoriques, même les plus avancés sur certains points, comme Les Métaphores dans la vie quotidienne de Lakoff et Johnson par exemple, reproduisent et confortent des préjugés par ailleurs. 2.1. Le procès de la métaphore : les linéaments du soupçon Rarement déclaré, le procès de la métaphore couve en effet dans quantité d’écrits sur la rhétorique ou sur la poétique, depuis les années 1960 : les soupçons se multiplient, se confortent mutuellement, et se transforment autour de 1970 en accusation. Tout se passe comme si ce procès avait enfin lieu, après avoir été instruit, souvent involontairement, notamment au cours du XXe siècle. Il serait difficile, et parfois un peu artificiel, de distinguer « juges d’instruction », « procureurs » et « avocats » dans cette affaire, mais à l’heure du soupçon, alors que les « autorités » sont remises en question par le structuralisme ou le nouveau roman et, ce faisant, que la notion de sujet est contestée, comme en littérature les notions d’auteur, de personnage ou d’histoire, une certaine ligne a été franchie dans le domaine de la rhétorique et de la poétique aussi, qu’il semble bon de mettre en évidence. Les pages qui suivent exposent donc les grands points d’articulation de ce discours critique à l’égard de la métaphore. Elles tâchent de reconstituer une argumentation qui n’existe souvent qu’à l’état lacunaire, qu’à l’état de fragments – mais dont la puissance et l’efficacité ne sont pas moins grandes, au contraire. Le problème, c’est que ce procès n’a pas été perçu comme ayant lieu à proprement parler, et qu’il n’est toujours pas perçu comme ayant eu lieu. Les ouvrages les plus récents sur la métaphore n’omettent pas de mentionner les travaux d’Albert Henry, de Michel Le Guern ou du groupe µ pourtant, ils évoquent aussi les textes de T. Todorov ou G. Genette par exemple, notamment l’article de ce dernier intitulé « La rhétorique restreinte », et souvent de façon très allusive : la violence de la charge s’en trouve atténuée. De même, La Métaphore vive est aujourd’hui salué comme un grand livre, mais les clarifications décisives qu’il apporte sont encore peu reprises, comme si on ne l’avait pas vraiment lu : on semble parfois oublier qu’il s’agit d’un ouvrage de défense de la métaphore ; sa dimension violemment polémique passe largement inaperçue et, quand elle est identifiée, elle est trop facilement disqualifiée en invoquant les options religieuses de leur auteur.2 Aussi le procès de la figure trouve-t-il de nombreux avatars, de nombreux prolongements – qui s’ignorent, parfois – et les malentendus persistent. Certes, le livre de Ricœur semble contemporain d’un certain ralentissement des travaux de la néo-rhétorique. Ce n’est probablement pas une coïncidence. Mais les réserves extrêmement fines qu’il émet à l’encontre d’un certain nombre de théories n’ont pas eu l’impact qu’on pouvait en escompter. Pour pouvoir sortir de cette nasse, il convient donc de faire en sorte que le procès ait lieu, de mettre en évidence l’acte d’accusation, les charges les plus sévères. Cette partie ne prétend évidemment pas à l’exhaustivité. Elle ne cherche pas non plus à « régler des comptes », surtout quelques décennies après. J’ai soigneusement essayé d’éviter ce piège, dans lequel il est facile de tomber : celui qui consiste, sous couvert de corriger un excès, à céder à un excès inverse, comme pour venger… une notion. Il s’agit surtout d’exposer une argumentation qui semble avoir été très prégnante et dont on trouve de nombreuses traces encore aujourd’hui. C’est pourquoi il est préférable, je crois, de s’attarder sur l’étude précise de quelques accusations plutôt que de les multiplier.
La métaphore, reine des figures
C’est probablement dans l’article de Gérard Genette, « La rhétorique restreinte », publié le second semestre de l’année 1970 dans la revue Communications, que s’exprime le plus clairement l’idée d’un procès de la métaphore.3 Ce texte marque indéniablement un tournant : la charge contre la figure d’analogie y est quasiment frontale. L’ensemble du texte, sous couvert de dénoncer une conception étroite de la rhétorique, s’en prend en fait à la « reine des figures ». On peut penser d’ailleurs que le succès de cet article, souvent cité mais rarement discuté, tient à ce double objet, à cette façon d’avancer une thèse sous une autre. Le groupe de Liège ne s’y est pas trompé, qui indique dans sa postface à Rhétorique générale que Gérard Genette « a fait justice » d’un certain « métaphorocentrisme ».4 Survivance d’une couronne Le point de départ de « La rhétorique restreinte » est très intéressant, pourtant. Genette relève d’abord une convergence entre les titres de trois travaux différents, Rhétorique générale du groupe de Liège, « Pour une théorie de la figure généralisée » de Michel Deguy et « La métaphore généralisée » de Jacques Sojcher. Cette « généralisation pseudo-einsteinienne » lui apparaît surtout « compensatoire », lui semble dissimuler le rétrécissement « comme peau de chagrin » du champ d’action voire de compétence de la rhétorique : « La Rhétorique d’Aristote ne se voulait pas “générale” (encore moins “généralisée”) : elle l’était ». Gérard Genette esquisse alors une histoire de cette discipline, pour défendre la thèse d’une réduction continuelle de son objet, de l’Antiquité jusqu’à nos jours. Il signale d’abord la rupture de l’équilibre entre les trois genres, le délibératif, le judiciaire et l’épidictique, acquis au Moyen Âge, mais entamé avec « la mort des institutions républicaines », premier déclin de l’éloquence déjà signalé par Tacite. Il relève par ailleurs la dissolution de l’équilibre entre les principales parties de la rhétorique (inventio, dispositio et elocutio) au profit de l’elocutio, voire de la seule étude des figures du discours. Genette souligne à cette occasion que le corpus littéraire, et spécialement poétique, prend une place prépondérante sur l’oratoire, dans un mouvement d’hégémonie qui ne cessera pas. Puis, au sein des figures du discours, ce sont les tropes qui se développent inconsidérément, au XVIIIe et XIXe siècles, avec Dumarsais et Fontanier. Selon Genette, les tropes subissent à leur tour une réduction aux seules métaphores et métonymies, elles-mêmes conçues de façon étroite, d’une façon plus « spatiale » que logique, rabattant toute métonymie et synecdoque sur la relation de contiguïté, les réduisant « à un effet de contact ou de proximité spatiale », alors que les figures de similitude seraient réduites à la métaphore. C’est ainsi que Genette distingue « une sorte de coup de force » dans la promotion de la métaphore « au rang de figure d’analogie par excellence », alors qu’elle n’en est « qu’une forme parmi bien d’autres ». Et d’annoncer « un dernier mouvement réducteur, par lequel la même métaphore, absorbant son ultime adversaire [la métonymie], va se faire “trope des tropes” (Sojcher), “figure des figures” (Deguy), le noyau, le cœur et finalement l’essence et presque le tout de la rhétorique. » Ce tableau historique, « cette vue plus que cavalière » comme le reconnaît Genette pour les premières étapes du panorama, possède un évident pouvoir de séduction. Ce qui se donne comme un constat sera pourtant à nuancer sérieusement : la plupart des aspects exposés ici, présentés comme le résultat d’une évolution, existaient déjà, dès l’origine donc, chez Aristote ou d’autres auteurs de l’Antiquité. En revanche, Genette emporte notre adhésion quand il s’inquiète que l’on place toute figure sous le signe de la métaphore : la notion perd de sa précision si elle acquiert une telle extension. Il rappelle que « Proust baptisait métaphore toute figure d’analogie » et même davantage, puisque « un grand nombre des “métaphores” proustiennes sont en fait des métonymies, du moins des métaphores à fondement métonymique », comme « faire cattleya » (employé pour « faire l’amour »). Nous tombons d’accord avec lui aussi quand il dénonce Jean Cohen qui « ne veut voir dans le bleus angélus de Mallarmé qu’une synesthésie analogique ». Notons seulement que cet usage excessivement large du mot métaphore existe depuis Aristote, chez qui « métaphore », on l’a vu, possède une grande polysémie, puisque le nom désigne d’abord le nom générique de toutes les figures du mot mais aussi, plus particulièrement, le rapport de proportionnalité qui ressemble à la comparaison. De ce point de vue, d’ailleurs, si les poéticiens du XXe siècle sont parfois tentés d’élargir le sens du mot métaphore, ce n’est pas pour l’étendre à celui de toute figure vraiment, mais plutôt à la notion de trope, comme Aristote. Quoi qu’il en soit, il est intéressant de noter qu’à l’époque de Proust et Mallarmé, « au début du XX e siècle, métaphore est un des rares termes survivant du grand naufrage de la rhétorique ».
Détrôner la métaphore
la comparaison sous le chapeau Dans cet étrange procès intenté à la métaphore, Genette apporte néanmoins quelques arguments : tout ne repose pas sur cette réputation de « reine des figures », sur la dénonciation de son autorité. L’une des principales pièces à conviction concerne la comparaison : l’article tente de montrer que les figures d’analogie, notamment, ne sauraient se réduire à la métaphore.7 En observant que la distinction traditionnelle est mal effectuée, puisque la présence du comparé ne suffit pas à faire la comparaison, comme dans « pâtre promontoire » ou « soleil cou coupé », Genette introduit les deux autres critères suivants : « la présence ou l’absence » de l’outil de comparaison (le « modalisateur comparatif »), d’une part, et du « motif » de la comparaison d’autre part, le premier étant considéré, dans les faits, comme le bon. Commence alors un redécoupage autoritaire des deux figures, le cas de « soleil cou coupé » n’étant d’ailleurs pas tranché, mais maintenu dans une espèce d’entre-deux. Pour prouver le « coup de force » qui élève la métaphore au rang de « figure d’analogie par excellence », l’article présente alors un tableau résultant de la combinaison des critères avancés : présence ou absence du comparé, du comparant, du modalisateur comparatif et du motif de la comparaison. Genette distingue alors six espèces de figures d’analogie avérées, et quatre autres purement hypothétiques : « comparaisons motivées ou non avec ellipse du comparant […] ou du comparé ». Sur les dix figures ainsi obtenues, il réserve alors le nom de métaphore à la seule métaphore in absentia traditionnelle (« ma flamme »), nommée ici « assimilation non motivée sans comparé ». Le cas de l’« assimilation motivée sans comparé » (« mon ardente flamme ») n’y a déjà plus le droit. Les métaphores in praesentia se contentent ainsi de l’appellation d’ « assimilation motivée » ou « non motivée ». Le coup de force est particulièrement manifeste : là où la plupart des rhétoriciens auraient décelé deux ou quatre métaphores, il n’en trouve qu’une. En revanche, il donne le nom de comparaison aux six autres formes, dans lesquelles, rappelons-le, il inclut quatre « formes non canoniques » de comparaisons, hautement hypothétiques… L’absence délibérée de symétrie saute aux yeux, ne serait-ce qu’entre les deux « comparaisons canoniques », l’une « motivée », l’autre « non motivée », placées au début du tableau, et les deux métaphores in absentia placées à la fin, les « assimilations sans comparés », « motivée » pour l’une et « non motivée » pour l’autre. Quel rhétoricien aurait dénié le nom de métaphore à « mon ardente flamme » ? La mauvaise foi est patente. C’est en jouant sur les mots, en découpant arbitrairement les figures, que Genette peut conclure comme il le fait : « on voit donc que la métaphore n’est ici qu’une forme parmi bien d’autres ». Sans compter qu’il s’abstient de faire l’hypothèse d’autres formes de métaphores ou d’« assimilations » : on ne trouvera évidemment pas ici de métaphore in absentia sans comparant, par exemple, alors que ce cas aurait dû lui être suggéré par son hypothèse d’une comparaison sans comparant, qui me semble par ailleurs beaucoup plus difficile à admettre. Il semble enfin ranger dans une même catégorie la métaphore in praesentia traditionnelle « mon amour est une flamme » et les « assimilations » du type « pâtre promontoire » ou « soleil cou coupé » qu’il avait mises en avant. Les deux exemples qu’il donne encadrent en effet le verbe être par des parenthèses : « mon amour (est) une flamme ardente ». En suivant la logique de son tableau, les deux cas d’assimilation donnés, avec ou sans motif, auraient pourtant dû être dédoublés, en fonction de la présence ou non du verbe être, même s’il ne s’agit pas à proprement parler d’un modalisateur. Il y avait aussi la forme « le feu de mon cœur », etc. C’est donc au prix de nombreuses omissions que les apparences peuvent lui donner raison : dans cet étrange match arbitré par Genette, le score s’élève ainsi à 6 contre 1 en faveur de la comparaison et, si quelque autre arbitre voulait engager la discussion sur les même bases, il ne pourrait remonter le score de la métaphore qu’à 6 contre 2, ou 6 contre 4. Grâce à ces différentes astuces, la comparaison est assurée de la victoire.