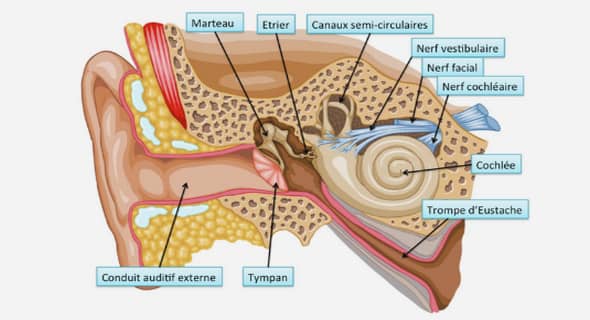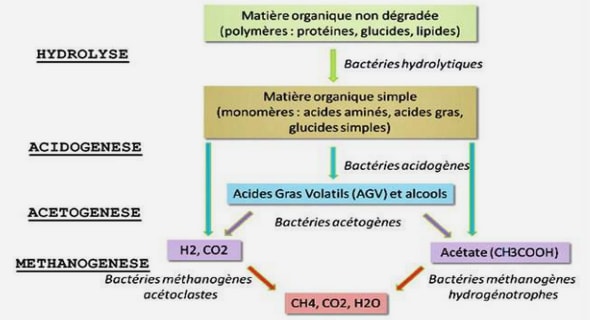Études antérieures
Dans son livre What’s a woman (Moi, 1999), Toril Moi présente d’une manière nette le développement historique et les différences entre les notions de détermination biologique, de genre sexué et de sexe. Pour exemplifier, elle se sert des idées de Beauvoir et de Freud, entre autres. Je me servirai aussi de l’oeuvre de Beauvoir Le Deuxième Sexe, où l’auteur défend l’idée de la femme comme un produit de la civilisation plutôt qu’une victime d’un état biologique. Beauvoir nous présente son féminisme de la liberté en exposant comment la femme éprouve sa ‘condition’ dans le mariage, dans la maternité, et comment ses expériences d’une ‘condition’ la guide dans son existence. Destin de femmes, désir d’absolu de Micheline Hermine et La femme dans les romans de Flaubert de Lucette Czyba seront mes sources d’information principales pour la question du contexte socio-historique d’Emma et de Charles Bovary. Le premier livre est une étude comparative avec l’accent mis sur l’aspect mystique de deux personnes si différentes qu’ Emma Bovary, l’adultère et sainte Thérèse de Lisieux. L’autre livre apporte une contribution indispensable à l’étude de l’idéologie de la femme à l’époque de Flaubert et aux mythes qui sont le véhicule et l’expression de cette idéologie. A l’opposé de cette approche, et conformément à mon but, j’ai choisi d’utiliser Flaubert Writing the Masculine de Mary Orr. Ce livre présente en effet une lecture unique et différente dans ce sens que son auteur propose une lecture où elle défend et explique la situation de l’homme en focalisant les conséquences du Code Napoléon et de la révolution industrielle pour les hommes. Un autre critique littéraire, dont je me suis servie, Michael Danahy, expose dans son livre The Feminization of the Novel, des aspects intéressants sur les transgressions de genre dans le roman français. Pour lui, Emma “lacks a unified narrative voice from which the story gets told. It is the bizarre androgyn, not Flaubert who lacks unity and not Emma, but the book itself for it is the locus of the confrontation, as well as the interpenetration of animus and anima”(Danahy, 1991, p 158).
Théorie
La détermination biologique et les idées de Freud
En 1924, le psychanalyste Sigmund Freud publia son essai ”La dissolution du complexe d’Oedipe”, où il formula la phrase bien connue: “Anatomy is Destiny” (Moi, 1999, p 381). Freud y analyse les frustrations de la petite fille et son envie du pénis. Il dit que même la fille peut développer psychologiquement le complexe d’Oedipe, et que ce développement est lié directement à l’anatomie féminine. Autrement dit, les différences biologiques créent des différences psychologiques. Mais ensuite il écrit cette phrase problématique dans le contexte féministe: “But these things cannot be the same as they are in boys. Here the feminist demand for equal rights for the sexes does not take us far, for the morphological distinction is bound to find expression in differences of psychological development. ‘Anatomy is Destiny,’ to vary a saying of Napoleon’s” (Freud cité par Moi, 1999, p 383). La question est de savoir pourquoi Freud implique dans cette théorie des différences sexuelles (the morphological distinction), le féminisme, qui exige l’égalité sociale entre l’homme et la femme? Selon Toril Moi, il y a deux explications plausibles. Soit Freud n’a pas voulu provoquer les féministes avec sa théorie des différences sexuelles, ayant peur d’être accusé d’un anti-féminisme réactionnaire: “Perhaps Freud chose to address the issue of feminism because he wanted to fend off accusations of social conservatism”(Moi, 1999, p 383). Soit il a voulu rejeter la condition biologique comme fondement des normes sociales: “Compressed and unclear as it is, Freud’s reference to feminism could then be read as an attempt to deny that biological facts ground social norms”(Moi, 1999, p 383).
Le rejet beauvoirien de la détermination biologique
On ne naît pas femme : on le devient. Aucun destin biologique, psychique, économique ne définit la figure que revêt au sein de la société la femelle humaine ; c’est l’ensemble de la civilisation qui élabore ce produit intermédiaire entre le mâle et le castrat qu’on qualifie le féminin. Seule la médiation d’autrui peut constituer un individu comme un Autre. Chez les filles et les garçons [. . . ] : c’est à travers les yeux, les mains, non par les parties sexuelles qu’ils appréhendent l’univers (Beauvoir, 1976, vol.2, p 13).
Beauvoir ne rejette donc pas l’idée des différences sexuelles, mais cela n’implique pas que la vie sociale serait réduite à ces faits biologiques. Ce n’est donc pas le corps féminin qui définit la femme ; c’est plutôt les aspects extérieurs qui la définient. Dans le deuxième volume de son livre Le Deuxième Sexe, Beauvoir nous présente, entre autres, comment la femme fait l’expérience de sa ‘condition’ et les obstacles qui l’empêchent de choisir et de former son existence. Beauvoir propose surtout un féminisme de la liberté (Moi, 1999, p 388). Parfois accusée d’être idéaliste (Moi, 1999, p 198), Beauvoir prétend que la femme est ce qu’elle se fait, mais les choix qu’elle fait trouvent leur origine dans la société, dans sa ‘condition’. Beauvoir analyse la situation de la femme mariée et de la mère. Quant au mariage, elle écrit : “Jamais les femmes n’ont constitué une caste établissant avec la caste mâle sur un pied d’égalité des échanges et des contrats. Socialement l’homme est un individu autonome et complet” (Beauvoir, 1976, vol.2, p 222). Au contraire de l’homme, la femme n’a jamais été autonome, mais elle a toujours été esclave et vassale “aux groupes familiaux qui dominent pères et frères” (op. cit., p 223). L’auteur parle des asymétries dans la relation entre l’homme et la femme car l’homme a pu choisir le célibat ou le mariage, tandis que pour la femme le mariage a été une nécéssité essentielle. Quant à la maternité, Beauvoir focalise l’avortement, ses conditions et ses conséquences. Ici aussi, la liberté de l’homme est toujours venue à la première place. L’extrait suivant dénonce en même temps le code moral des hommes à ce sujet: Les hommes ont tendance à prendre l’avortement à la légère ; ils le regardent comme un de ces nombreux accidents auxquels la malignité de la nature a voué les femmes [. . .] pour la femme, tout son avenir moral en est ébranlé. En effet, on répète à la femme depuis son enfance qu’elle est faite pour engendrer [. . .] Et voilà que l’homme pour garder sa liberté, pour ne pas handicaper son avenir demande à la femme de renoncer à son triomphe (op. cit., p 341).
Beauvoir continue à décrire la relation entre la mère et l’enfant comme un double et néfaste oppression (op. cit., p 389), une carence sociale, même s’il n’y a pas de loi inscrite au ciel qui exige que la mère et l’enfant s’appartiennent exclusivement l’un à l’autre. Le problème, c’est que la femme, influencée par sa ’condition’, ne peut pas créer sa propre existence comme elle le veut , et elle ”n’a pas de moyens de s’affirmer dans sa singularité” (op. cit. p 390).
Le contexte socio-historique du roman de Flaubert
La madone et l’adultère, le mariage comme prison
L’action de Madame Bovary se passe sous Louis-Philippe, car on date la mort d’Emma à 1847 juste avant la révolution de 1848. Le roman fut publié en 1857, sous la Monarchie de Juillet et le Second Empire, une époque où la condition de la femme fut subalterne. Dans l’institution du mariage, les sorties de la femme furent l’objet d’une stricte réglementation et condamnées comme des infractions dès que la femme rompit avec les conditions fixées par le Code qui régit la conduite féminine (Czyba, 1983, p 90). L’aventure lui est interdite, car dans ce monde, c’est l’ordre moral qui prédomine, et c’est la femme qui est responsable de le maintenir. La femme est “l’ange dont la beauté est réhaussée par les qualités morales”(op. cit., p 16). En plus, on la demande en mariage et il va de soi que la femme fut la propriété de l’homme. L’amour se fonda sur la possession de la même manière que la jalousie de l’homme fut considérée comme la preuve ultime de son amour pour sa femme. “Aimer, c’est se sentir propriétaire de l’autre”(op. cit., p 27), fut une des mythologies amoureuses créée par et pour les hommes et quasi complètement assimilée par les femmes. Micheline Hermine décrit comment “les filles passent à l’état d’épouse comme un objet d’échange” (Hermine, 1997, p 177). Czyba parle de la transgression de “la sacro-sainte loi de la propriété” qui consiste à ‘prendre’ une femme à son ‘légitime’ propriétaire, conformément à la description de Beauvoir, qui parle de la femme “qui a toujours été intégrée en tant qu’esclave et vassale aux groupes familiaux qui dominent pères et frères” (Beauvoir, 1976, p 223).
Non seulement le mariage mais aussi l’image de la madone représente l’horreur d’être femme. L’idéologie de la propriété et du pouvoir a évidemment des conséquences pour la maternité et la conception que les femmes en ont. Czyba écrit comment les femmes “insatisfaites de leur propre sort, ne peuvent désirer avoir une fille dont l’existence serait, à leur avis, la replique de la leur” (Czyba, 1983, p 56). Hermine enchaîne sur les théorie de Beauvoir, qui elle aussi décrit comment la femme n’a pas la liberté de “procréer” (Hermine, 1997, p 180) quand elle le veut (Beauvoir, 1976, p 330). Ceci implique que la maternité ne peut pas être “naturelle”, car “le hasard fait parfois mal les choses” (Hermine, 1997, p 181). Autrement dit, on ne peut pas compter sur la nature pour être une bonne mère.
Alors, pour que la famille ‘idéale’ fonctionne selon le principe du patrimoine, et pour que ce dernier ne fût pas menacé de la dilapidation, il fut absolument inacceptable que la femme eût un amant. Les enfants adultérins risquèrent de se partager l’héritage familiale avec les héritiers légitimes et un tel partage de la fortune familiale signifia un appauvrissement pour tous les membres de la famille. Comme le dit Czyba : “la peur et la condamnation de l’adultère furent en relation directe avec le système social fondé sur la propriété” (Czyba, 1983, p 26). Mais pour la femme, l’acte adultère eut aussi “la fonction de substitut”, de “complément nécessaire au mariage”, puisque l’amour dans le mariage n’existait pas était par définition exclus. Ainsi la femme adultère alla à la recherche de l’amant qui fait figure d’anti-mari (op. cit., p 88). Le dilemme fut que l’acte adultère fut en même temps le seul moyen pour la femme au XIXe siècle de faire l’expérience de la liberté, et la faute morale par excellence.
Obligées de porter leur intérêt à un seul homme, à celui dont elles furent dépendantes, les femmes s’appauvrissèrent aussi intellectuellement par nécéssité. Czyba se réfère à une “atrophie intellectuelle“ (op. cit., p 34), introduite dans la vie de la jeune fille au couvent, lieu clos de la somnolence et loin du monde réel où les filles reçurent une éducation du faire-semblant loin d’une pratique sociale authentique. Hermine parle des couvents comme “des fabriques de futures religieuses ou de futures épouses strictements limitées à leur fonction procréatrice et conservatrice” (Hermine, 1997, p 175).
La naissance du nouvel homme
En France, l’institutionnalisation des normes sociales fut introduite par Napoléon I dans le Code Civil de 1804, catégorisant officiellement l’homme comme le sujet (opposé à l’objet, représenté par la femme) et comme le citoyen priviligié (opposé à la citoyenne du second degré, la femme). Ce fut la première fois que la France obtint une législation de droit civil, valable pour le pays entier. En 1816, le droit de divorce, attribué à la femme en 1792, qui aurait pu la libérer de l’institution du mariage, fut suspendu, remettant la femme, cette fois-ci officiellement, à sa place inférieure.
Or, cette législation eut aussi des conséquences considérables pour l’homme et créa un ”new man” (Orr, 2000, p 14), qui connut ses équivalents aux Etats-Unis et en Angleterre victorienne. Cependant ce ne fut qu’en France que la dichotomie masculin/ féminin fut institutionnalisée dans un Code dans lequel on retrouva nettement la division entre les aspects “typiques” de la féminité opposés aux aspects ”typiques” de la masculinité et où les deux catégories ne se superposèrent jamais, une division qui dès lors ne signifia plus seulement un problème pour les femmes. Au cas où l’homme ne fut pas capable de représenter les valeurs du côté masculin, il ne lui resta que la position féminine. En plus, dans la lutte pour le pouvoir qui prédomina dans le cadre d’une expansion industrielle, le mâle ne fut à son tour considéré que comme une pièce utilitaire, comme un outil. Dans son livre L’Éternal Masculin: Traité de chevalerie à l’usage des hommes d’aujourd’hui (1994), J. Kelen écrit:
Ce n’est point hasard si l’homme de l’époque industrielle et technologique a été standardisé à l’égal de ses machines; si l’homme a été considéré comme utile, comme utilitaire et donc fabiqué en série; l’homme utile est remplaçable, tandis que l’individu libre, l’homme de gratuité, l’homme créatif est unique et irremplaçable. (Kelen cité par Orr, p 13)
Ceci impliqua qu’il y avait plusieurs systèmes de paternité, dominés par différents types d’hommes, qui agirent simultanément, qui se firent concurrence, et ces systèmes patriarcaux influencèrent l’homme autant que la femme. Mais toujours la masculinité fut séparée de la fémininité. Orr écrit qu’en effet “the global problem is that any social reformations or reorganizations are but a shifting of the deckchairs of masculinity on the Titanic of evolving patriarchy” (Orr, 2000, p 19). Elle nous montre aussi comment l’homme éprouvait le danger, risquait de tomber en dehors du système et de perdre ses droits institutionnels. Ceci était le cas par exemple pour le fils illégitime, l’orphelin, l’homosexuel. (op. cit., p 21). Il existait même un nombre de livres consacré à l’homme affaibli comme Conseil aux hommes affaiblis de Jean-Alexis Bellois de 1829. Dans son livre L’Identité masculine en crise du tournant du siècle(1987), Annalise Maugue résume toutes ces idées ainsi : ”La révolution de 1789 et la révolution industrielle ont transformé les status et les rôles, bouleversé les valeurs, remodelé les identités. . . Contraint de se re- situer relativement à une femme en mouvement qui bouscule les plus anciens repères, l’homme se voit contraint de confronter sa propre praxis à la liste supposée de ses mérites et de s’interroger sur sa place dans le monde. . . ”(Maugue cité par Orr, p 15)
Analyse de Madame Bovary de Flaubert
Ce qui m’intéresse concrètement dans mon analyse, c’est d’étudier où et comment le personnage féminin dans Madame Bovary rompt avec le modèle de la famille nucléaire, imposée par le Code Napoléon, et se décide à ”s’affirmer dans sa singularité” (Beauvoir, 1976, vol.2, p 390), comme le fait la nouvelle femme5? Quant à l’homme, comment Flaubert a-t-il traité le côté masculin de la ’romance familiale’, prescrite par le Code. Comment est-ce qu’un fils devient amant, père, époux, homo economicus, celui qui représente le côté public, légal et masculin en même temps qu’il développe ses émotions, c.-à-d. le côté privé, féminin?
Ou encore, comment l’homme ’affaibli’, ou le nouvel homme de Mary Orr6, se manifeste-il dans Madame Bovary? Je me concentrerai pour ce mémoire sur Emma et Charles Bovary.
La notion de destin
Par analogie avec l’expression de Freud ’Anatomy is Destiny’, je vais examiner dans quelle mesure l’anatomie est en effet le destin de la femme et de l’homme respectivement dans Madame Bovary? Une brève analyse sémantique des mots ‘destin’, ‘sort’ et ‘fatalité’ nous apprend qu’à première vue, ces mots ont une connotation négative; on n’échappe par exemple pas à son destin, on n’abandonne pas non plus quelqu’un à son sort. Il y a ici l’idée de la négativité, de la passivité, de la subordination. Autrement dit, dans le domaine structuraliste des oppositions binaires, le destin serait, par définition, associé à la femme. En conséquence, toujours suivant les idées de Cixous, on pourrait croire que l’homme, qui se situe évidemment de l’autre côté de cette opposition, serait toujours capable d’intervenir activement, ne pourrait jamais être la victime passive du destin. Dans Madame Bovary, ce raisonnement ne se maintient plus.
Dans son livre Flaubert : writing the masculine, Mary Orr compare d’une manière, à mon avis appropriée mais assez vague, le destin d’Emma et de Charles Bovary avec celui de Roméo et Juliette : “Charles and Emma fulfil the dual destiny of post-Shakespearian tragedy : “poisoned romance and failed medical, rather than heroic, intervention in the other’s suicide attempt cause the double death“ (Orr, 2000, p 39). Comme point de départ pour la discussion du destin dans Madame Bovary, j’aimerais élaborer un peu cette comparaison en examinant deux notions dont la critique littéraire se sert généralement en analysant le destin de Romeo et Juliette. Il y a d’abord la vision du courant tragique (tragic flow), aussi appelé le ‘hamartia’7. Dans cette vision, un des personnages, souvent le protagoniste, fonctionne comme une espèce de catalyseur, souffre d’une faiblesse quelconque, et prend activement une décision, qui finalement déclenche un événement tragique comme le suicide, par exemple. Ensuite, il y a la vision de la roue cosmique du destin (wheel of fate) qui commence à tourner sans qu’il n’y ait rien qui puisse l’arrêter. C’est ce que nous comprenons en règle par, ‘le destin’ tout court.