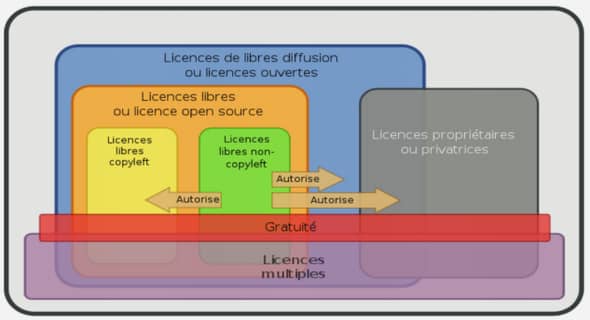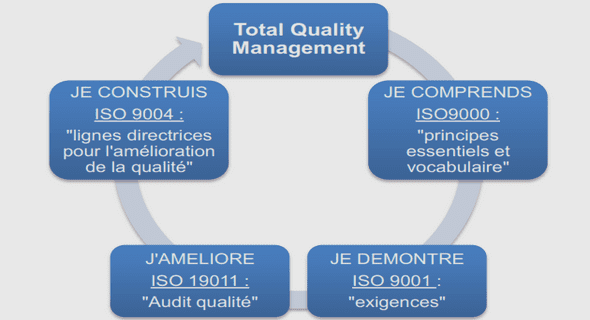Biographie d’Aimé Césaire
Aimé Césaire est né le 25 juin 1913 à Basse-Pointe en Martinique. Il était élève au lycée Louis-le Grand (voir Senghor, 2011 : 55). Pour ses études universitaires il est parti à la Sorbonne à Paris. C’était à la Sorbonne qu’il a fait la connaissance de Senghor. Les années d’études avaient une grande importance dans la vie d’Aimé Césaire. Il a commencé à écrire le Cahier d’un retour au pays natal dès 1932. Le texte a été publié en 1939 dans une revue nommée Volontés, mais aussi plus tard en 1941 dans la revue Tropiques qui était éditée par Aimé Césaire lui-même et ses amis (voir Chevrier, 2008 : 27). Aimé Césaire est retourné à la Martinique pendant la seconde guerre mondiale où il a fondé la revue Tropiques. Il a continué sa lutte pour revaloriser la culture de l’homme noire (voir Kesteloot, 1988 : 19).
Aimé Césaire était une voix importante pour l’émancipation des jeunes étudiants noirs. Il a aussi contribué au mouvement de la négritude avec son expression poétique dans Cahier d’un retour au pays natal (voir Chevrier, 2008 : 10). Pour lui, la revalorisation des valeurs, idées et expressions des noirs constituaient une action de l’homme noir pour sa propre libération, une action de déplacement: Representing such revolarization as a process of movement, Césaire uses an ability-charged rhetoric that implores the race nègre (…) to stand and thus to move into being free » (Flaugh, 2010 : 292).
Les jeunes écrivains, comme Aimé Césaire, ont constitué une nouvelle forme de littérature en opposition avec la littérature occidentale. Cette nouvelle littérature a donné une autre image de l’homme noir que celle de la littérature occidentale. Elle a aussi modifié la langue française avec le but de pouvoir exprimer l’expérience de l’homme noir (voir Chevrier, 2008 : 19).
Avec ce nouveau champ littéraire, les intellectuels comme Jean-Paul Sartre, s’engageait dans le débat autour du mouvement littéraire de la négritude avec des textes tels Orphée noir, la préface d’Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache de langue française, écrit par Léopold Sédar Senghor. Le contenu d’Orphée noir va être expliqué plus en détail ci-dessous dans le chapitre 6 où la poésie comme moyen pour exprimer la négritude sera examinée.
Les caractéristiques de la négritude
Dans cette partie quelques conditions et attributs spécifiques de la négritude seront explorés. Ensemble ils forment des conditions dans lesquelles les idées du mouvement littéraire ont grandi. La littérature étudiée a été écrite en français. Les fondateurs sont tous noirs venant des pays qui ont été colonisés.
Esprit critique
Les jeunes intellectuels d’Afrique et des Caraïbes déménageaient en France. Ils avaient acquis un esprit critique pendant leurs études. Ils se rendaient compte des traditions africaines qui étaient absentes dans la culture dominante occidentale. Ils voyaient l’ignorance des gens sans éducation, qui n’admiraient que des valeurs de la culture dominante, celle de la civilisation occidentale. Cette culture dominante se répandrait comme une sous-culture européenne en Afrique. Par exemple, dans des villes africaines, les films de cow-boys ou les romans policiers remplaçaient l’importance du griot, les épopées, les contes et les proverbes comme expression des traditions africaines. Pour ces jeunes intellectuels, il était important d’attirer l’attention de leur peuple sur la situation et de leur rendre leur pensée critique pour sentir la fierté de leur histoire et culture, l’histoire des peuples noirs (voir Kesteloot, 1988 : 10). La relation entre le colonisé et le maître est au centre de ce mouvement. Les intellectuels engagés dans la critique de l’Occident voulaient aussi donner, par leur critique, une vue nuancée : Critique de l’Occident et revalorisations des cultures indigènes se renforcent pour rendre aux intellectuels colonisés leur dignité. Car c’est bien là le but recherché. Ils estiment qu’ils n’ont pas à devenir semblables aux colonisateurs : ils sont ses égaux, et cependant différents. (Kesteloot, 1988 : 11).
Les jeunes étudiants luttaient pour l’émancipation de l’homme noir. La question d’assimilation dans la nouvelle société où ils se trouvaient n’était pas si intéressante pour eux. (voir Chevrier, 2008 : 9). D’après Kesteloot, l’assimilation pour l’homme qui a été colonisé est la même chose que « l’abandon de la culture traditionnelle » (Kesteloot, 1988 : 20) de leur pays natal. Peut-être fallait-il rejeter l’assimilation en faveur d’une renaissance culturelle de la civilisation des hommes noirs.
Écriture en français
Aimé Césaire a écrit ses œuvres en français. Cela a posé un problème, celui de l’inaccessibilité de la littérature et de la poésie pour les gens illettrés dans leur pays natal. C’était seulement l’élite noire qui pouvait lire les œuvres qui exprimaient les idées de la négritude. Ces idées étaient propagées dans d’autres régions dans le monde avec une histoire de colonisation. Les idées sont aussi utilisées par les dirigeants politiques comme messages politiques (voir Kesteloot, 1988 : 15). Comme l’écrit Kestelroot :
L’emploi d’une langue européenne permettait à l’écrivain de remplir auprès du public occidental son rôle majeur de témoin et d’exprimer les malheurs, les angoisses et les exigences des peuples noirs. Face au monde blanc il s’agissait de revendiquer pour l’homme de couleur la reconnaissance de sa dignité et, pour sa race, la libération totale, politique et culturelle. (Kesteloot, 1988 : 16).
Les attributs physiques
Parmi les écrivains noirs de cette époque, il y avait des voix qui ont exprimé un message de reconquête de l’humanité des noirs. La parole de reconquête était, entre autres choses, une réaction contre l’humiliation de longue durée de la couleur de la peau noire. Selon Kesteloot, les titres des œuvres indiquent cette importance de la pigmentation. L’expérience de l’homme noir, de l’homme colonisé se basait sur un fondement racial. La réaction contre cette base parmi plusieurs écrivains était « la création d’un nouveau régime » (Kesteloot, 1988 : 80), le néo-racisme. Le poids de la culpabilité était mis sur tous les blancs. Mais il existait une autre perspective, celle de la revalorisation de l’être noir comme un être « beau et bon et légitime » (Kesteloot, 1988 : 81) qui était un signe qu’on avait rejeté la hiérarchie de couleur inventée par le blanc (voir Kesteloot, 1988 : 81). Le but général du mouvement de la négritude était la création de l’humanisme universel. L’idée n’était pas quand même de renverser totalement les contributions de l’Occident ou le retour de l’Afrique à l’existence précoloniale » (Kesteloot, 1988 : 83), mais de récréer un monde de compréhension entre les hommes. Cité dans le livre de Kesteloot, Aimé Césaire a dit : « Au fond, la négritude qu’est-ce donc, sinon la postulation agressive de la fraternité ? » (voir Kesteloot, 1988 : 84).
La poésie comme moyen d’émancipation des noirs
Dans cette partie nous étudions la poésie comme expression littéraire et le message principal de la poésie d’Aimé Césaire. Comment a-t-il exploré la négritude dans son œuvre et comment est-elle exprimée ? Nous étudions particulièrement Sartre qui a écrit une réflexion approfondie concernant l’œuvre Cahier d’un retour au pays natal et la négritude.
L’expression poétique d’Aimé Césaire
Dans Orphée noir, Sartre a fait sa propre analyse de la poésie de la négritude. Il a examiné en particulier l’expression poétique d’Aimé Césaire : « …les mots de Césaire sont pressés les uns contre les autres et cimentés par sa furieuse passion » (voir Senghor, 2011 : XXVII).
Selon Sartre, la poésie d’Aimé Césaire peut être décrite comme « la négritude qui se définit contre l’Europe et la colonisation » (voir Senghor, 2011 : XXVII). Sartre pense qu’Aimé Césaire ruine la culture des hommes blancs par son message révolutionnaire qui appartient selon Sartre à « un nègre opprimé » (voir Senghor, 2011 : XXVII). Les mots dans l’expression poétique d’Aimé Césaire expriment, selon Sartre, une « …obsession torride » (voir Senghor ; 2011 : XXVII). Sartre pense qu’Aimé Césaire utilise la subjectivité comme méthode pour créer la négritude dans ses poèmes. Plus précisément, il forme la négritude avec ses mots. D’après Sartre, la négritude, c’est le son des tam-tam dans une rue d’Afrique, le masque congolais et le poème d’Aimé Césaire : « La négritude…c’est l’être-dans-le-monde du Nègre » (voir Senghor : 2011 : XXVIII). Aimé Césaire décrit un homme noir qui se découvre en même temps qu’il devient ce qu’il est : « Il s’agit donc pour le noir de mourir à la culture blanche pour renaître à l’âme noire, comme le philosophe platonicien meurt à son corps pour renaître à la vérité » (voir Senghor, 2011 : XXIII).
Le choix d’exprimer la négritude par la poésie est d’après Sartre une chose nécessaire parce que c’est le poème lui-même qui constitue la négritude. Le poème exprime la subjectivité, « c’est le poète lui-même » (voir Senghor, 2011 : XLIII). Un autre aspect de l’expression poétique d’Aimé Césaire est la signification double du mot noir. Il existe une contradiction dans l’emploi des mots : Ainsi le mot de noir se trouve contenir à la fois tout le Mal et le Bien, il recouvre une tension presque insoutenable entre deux classifications contradictoires : la hiérarchie solaire et la hiérarchie raciale. Il y gagne une poésie extraordinaire… (voir Senghor, 2011 : XXII).