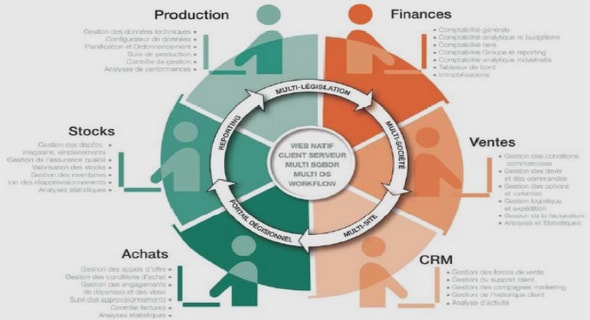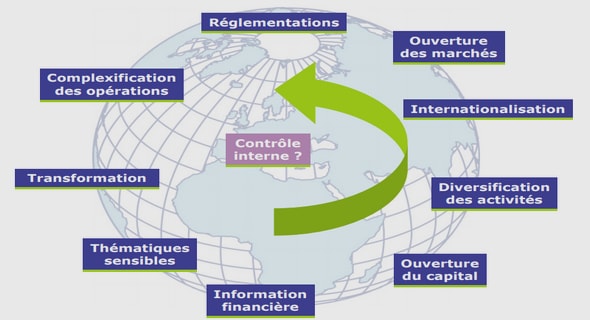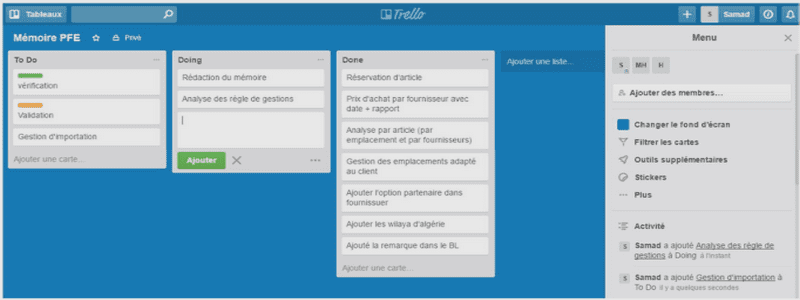Sur la nation et sa « modernité »
Le concept – ou plutôt l’idée protéiforme – de nation est au cœur de ce travail. Non pas pour écrire un « roman national » de plus qui aurait pour seule originalité d’utiliser l’école comme porte d’entrée ; mais parce que la nation a été l’objet de tensions incessantes, un défi pour les gouvernements qui se sont succédé depuis l’extension des frontières, à la fin du XIXe siècle, au-delà des hauts-plateaux. Ce processus a renforcé la diversité d’un royaume déjà hétérogène8. Comment faire « tenir » cet ensemble ? Sur quelle matérialité et quel imaginaire appuyer son existence ? Sous Haylä Sellasé, être Éthiopien signifiait parler amharique, adopter la religion orthodoxe et se reconnaître dans les mythes de l’Éthiopie du nord. Le Därg a assoupli les critères culturels d’appartenance à la nation en affirmant vouloir mettre un terme « l’oppression des nationalités ». Se revendiquant du marxisme-léninisme, il a redéfini la nation de manière égalitaire. La langue, la religion, la culture et la « nationalité » n’étaient plus, en théorie, des facteurs discriminants. La nation devait prendre corps dans les masses unies par la solidarité de classe et la lutte contre les ennemis intérieurs et extérieurs de la « mère-patrie révolutionnaire ». Les deux régimes ont utilisé deux stratégies différentes pour cimenter horizontalement la population et l’agréger verticalement à l’État. Tout en partageant un souci commun d’unité nationale, ils ont appuyé leur pouvoir sur des définitions distinctes de la nation. Dans ce mouvement, si la centralisation est allée croissante, le mode de domination politique, économique et culturelle du centre sur les périphéries a changé de nature.
Les historiens qui ont tenté de théoriser la nation se sont heurtés au caractère évanescent du concept qui échappe à toute tentative de définition qui en épuiserait la signification. Comme le dit Eric Hobsbawm, « on n’a trouvé aucun critère satisfaisant qui permette de décider lesquelles des nombreuses collectivités humaines pourraient porter le titre de nation9». Il est impossible de donner une définition universelle, fondée sur des critères objectifs » tels que la langue, le territoire commun, l’histoire commune ou les traits culturels10. En eux-mêmes « flous », « mouvants » et « ambigus »11, ces critères ne se recoupent jamais intégralement. À défaut de définition, il s’est donc agi d’élaborer des outils qui permettent l’interprétation. Les approches subjectives fondées sur les représentations sont apparues comme les plus opératoires. La plus célèbre, et la plus usitée, est celle proposée par Benedict Anderson : les nations sont des « communautés imaginées », « parce que même les membres de la plus petite des nations ne connaîtront jamais la plupart de leurs concitoyens […] bien que dans l’esprit de chacun vive l’image de leur communion12».
Cette perspective invite à penser les nations comme des entités en perpétuelle construction. Comment les imaginaires nationaux se forment et se reproduisent-ils ? Devant être vivante dans les esprits des membres qui la compose, prendre corps dans les individus, la nation fait l’objet d’une pédagogie politique constante. Celle-ci peut provenir, dans le cas d’un groupe aspirant à son propre État, de l’action délibérée « de pionniers et de militants de l’idée nationale et par le début d’une campagne politique autour de cette idée13 ». Construire la nation est, par ailleurs, le fait des États déjà constitués qui œuvrent à ce que « l’unité politique et l’unité nationale se recouvrent14», c’est-à-dire à devenir des États-nations. C’est pourquoi les nationalistes et les États cherchent à fonder la nation sur des critères objectifs et/ou à l’affirmer comme une donnée primitive, à la fois a-temporelle (elle est naturelle) et ultra-temporelle (elle existe depuis toujours). Une approche de la nation en terme de construction et de pédagogie politique implique, de plus, une histoire sociale consacrée à l’étude de l’interpénétration du quotidien et du national comme […] processus d’incorporation et [de] production d’un sentiment d’appartenance15». C’est ce que fait brillamment Benedict Anderson lorsqu’il analyse l’élaboration de l’imaginaire national à travers la littérature, la presse – dont la large diffusion est permise par ce qu’il nomme le « capitalisme de l’imprimé » –, les monuments et les musées.
L’histoire de l’éducation dans la Wolaita proposée ici s’inscrit résolument dans la perspective de Benedict Anderson lorsqu’il s’agit de comprendre les ressorts de l’imaginaire national. En revanche, deux réserves doivent lui être préalablement adressées, ainsi qu’à Eric Hobsbawm. Une manière de concevoir la nation comme éminemment « moderne » – sans que le lecteur ne sache jamais réellement ce que signifie « moderne » – pousse ces auteurs à situer sa naissance dans le berceau de la « modernité » : l’Europe, à laquelle Benedict Anderson ajoute les « États créoles » d’Amérique. Le point de départ de ce dernier est que « l’état de nation […] aussi bien que le nationalisme sont des artefact culturels »
qui « deviennent »modulaires », susceptibles d’être transplantés16». De son côté, Eric Hobsbawm avance que « la nation moderne, en tant qu’État ou en tant qu’ensemble de gens aspirant à le devenir, diffère en nombre, en étendue et en nature des communautés auxquelles les êtres humains se sont identifiés au fil de la quasi-totalité des temps historiques17», sa caractéristique fondamentale […] est justement sa modernité18». Ici, l’apprenti-chercheur formé au début du XXIe siècle en travaillant sur un terrain non-européen plonge dans une certaine perplexité. Deux points attirent tout particulièrement son attention : le premier est la perspective strictement européocentrée de ces affirmations ; le second est l’utilisation, rapide et confuse, du terme « modernité », dont on ne sait trop s’il qualifie une période historique – l’époque contemporaine – ou si elle est une catégorie d’analyse – dans ce cas, que veut dire moderne » et pourquoi la nation serait-elle « moderne »19?
Il est, tout d’abord, salutaire de rappeler la réserve adressée par Partha Chatterjee (un continuateur aussi redevable que critique) à Benedict Anderson : Si les nationalismes dans le reste du monde ont à choisir leur communauté imaginée à partir de certaines formes »modulaires » déjà mises à dispositions par l’Europe et les Amériques, que leur reste-il à imaginer ? L’Histoire, il semblerait, a décrété que nous, dans le monde postcolonial, devons être de simple consommateurs de modernité20».
L’historien britannique Christopher Bayly ajoute une remarque fondamentale qui invite, elle aussi, à déplacer le regard : l’éveil vigoureux des nationalités au XIXe siècle fut un phénomène mondial. Il se manifesta simultanément dans une grande partie de l’Asie, de l’Afrique et du continent américain, et non pas d’abord en Europe en attendant d’être exporté »outremer ». […] À l’avenir, les théoriciens du nationalisme vont donc devoir mettre le monde extra-européen au centre de leur analyse, plutôt qu’y voir seulement un »bonus supplémentaire » 21».
Qui travaille sur l’Éthiopie ne peut que souscrire au constat et à la suggestion de Christopher Bayly. Le cas éthiopien permet même d’aller plus loin. Non seulement le XIXe siècle éthiopien a vu un sursaut de nationalisme en réaction à l’impérialisme européen, mais le sentiment national fondé sur un imaginaire commun était préexistant. Marie-Laure Derat a montré comment, dès le XVe siècle, le pouvoir utilisait le réseau des églises pour homogénéiser la population sous son autorité en créant, cimentant et renouvelant un imaginaire collectif22. Deux personnes vivant à l’opposé des limites du royaume avaient conscience d’avoir le même souverain, de partager les mêmes mythes, le même sens d’une continuité historique qui participaient à la « conscience et à la légitimation d’un »nous » national23 » ; en un mot, d’appartenir à la même communauté politique24. Si Perry Anderson a remarqué « qu’aucun État médiéval européen n’a été fondé sur la nationalité25», le spécialiste de l’Éthiopie Donald Doham rappelle que « quoique l’on puisse dire de la société abyssine, elle était fondée sur une nationalité26». Fondée sur une nationalité car la correspondance entre un gouvernement, un territoire et une population était établie ; car un imaginaire national, au sens où l’entend Benedict Anderson, existait. Cet imaginaire national prenait racine dans l’histoire éthiopienne et ne devait rien à la « modernité » européenne. Dès lors, la nation sera abordée ici comme une communauté imaginée, mais non en tant qu’ensemble d’ « artefacts modulaires » transplantés.
Il est cependant vrai que, dès le début du XXe siècle et plus particulièrement à partir de 1941, les écoles ouvertes par le gouvernement éthiopien ont été des lieux d’importation de savoirs européens à des fins de centralisation, présentée comme une « modernisation », une politique progressiste qui serait une première étape vers le « développement ». Jusqu’à 1974, le monde capitaliste occidental – les États-Unis était le principal soutien du gouvernement de Haylä Sellasé – était une inspiration pour les élites éthiopiennes. Après la révolution de 1974, le Därg s’est tourné vers le bloc de l’Est. L’URSS, la RDA et, dans une moindre mesure, Cuba, sont devenus les principaux alliés du régime. Les finalités et les programmes scolaires ont été modifiés en conséquence. Tour à tour, capitalisme et socialisme sous sa forme soviétique ont été présentés comme des modèles pour entrer dans la « modernité » et permettre le développement. Si elle ne peut en aucun cas être utilisée comme une catégorie d’analyse, la modernité, et son corollaire la modernisation, ont été au XXe siècle des cadres puissants de lecture du monde qui ont déterminé l’action des acteurs. L’État s’est légitimé en se prétendant dépositaire du « moderne » et donc de l’avenir de la nation. Les gouvernés, à l’échelle nationale comme dans le Wolaita, ont investi ce concept comme une aspiration à un mieux-être. L’opposition au régime de Haylä Sellasé dans les années 1960 et la révolution de 1974 ont été menées au nom du progrès et conceptualisés par des discours qui opposaient l’arriération à la modernité. Ce dernier terme devra donc être entendu comme un ensemble de représentations, que les acteurs ont saisi de manières plurielles en raison même de son flou conceptuel et de la prolifération des sens qui lui sont attribués.
Tout comme l’idée de « modernité », celle de nation n’a pas été investie seulement par l’État. Le mouvement étudiant éthiopien, qui s’est développé dans les années 1960, a opposé, en s’appuyant sur la théorie des nationalités de Staline, l’idée d’une nation multi-culturelle, multi-lingue et multi-confessionnelle à la vision homogénéisatrice de Haylä Sellasé. De leur côté, toujours à partir des années 1960, de nombreux Wolaita protestants éduqués dans des institutions scolaires gouvernementales et/ou missionnaires aspiraient à une meilleure intégration sans abandonner leur religion. Ils désiraient entrer pleinement dans la nation sans, pour autant, adopter le christianisme de ceux qui avaient soumis leurs pères. La définition de la nation, de ses critères d’inclusion et d’exclusion, a été au cœur de tensions ayant pour enjeux la légitimation ou la contestation du pouvoir, l’appartenance à la communauté politique nationale ou la marginalisation. Il ne s’agit donc pas d’étudier la formation de la « nation éthiopienne » à partir d’une étude de cas, mais d’interroger les relations multiples et changeantes des habitants d’une région avec l’ensemble national. Ceci implique de se pencher sur les diverses manières dont l’idée de nation a été interprétée, interrogée, négociée, contestée et redéfinie. Dans le Wolaita, ce processus a été profondément ancré dans l’expérience vécue de l’intégration à l’Éthiopie et s’est particulièrement incarné dans l’éducation scolaire.
Si le concept de nation se dérobe aux tentatives de définition objective, la manière dont chaque État la définit délimite un espace symbolique de légitimité politique, impose des critères d’appartenance auxquels il est impératif de répondre, sous peine de marginalisation et de discrimination. Qui ne les remplit pas, ou trop partiellement, est un être politique – un citoyen ou un sujet – carencé. Cependant, s’ils sont à bien des égards exclusifs, ces critères peuvent être dotés d’une plasticité plus ou moins relative selon le niveau de consensus qu’ils parviennent à fédérer. Définis officiellement par l’État, ils peuvent, d’une part, faire l’objet de débats voire de conflits d’interprétation et, d’autre part, survivre à de nouvelles définitions officielles s’ils sont sédimentés dans le corps social27.
Bien entendu, une histoire de l’éducation qui s’intéresse aux dynamiques scolaires en regard des définitions normatives de la nation et des réalités de l’imaginaire national ne peut se contenter d’une analyse des discours et des représentations. Ces derniers sont inextricablement liés, par des effets de retours réciproques constants, aux modes et rapports de production, ainsi qu’à la distribution et aux pratiques de pouvoir. L’historien de l’éducation Carl Kaestle rappelle ici deux points méthodologiques indispensables : la structure sociale et ses transformations sont un point de départ essentiel pour expliquer les dynamiques éducatives et les trajectoires des systèmes scolaires ; la confrontation entre l’idéologie dominante et celles portées par des sous-groupes offre un support conceptuel qui permet de comprendre comment les processus éducatifs fonctionnent28.
L’école : imaginaire et matérialité de la nation
Si le milieu scolaire du Wolaita a été prompt à contester le WoGaGoDa, c’est parce que les élèves et les enseignants étaient parmi les premiers concernés par la réforme, mais aussi car l’école est un lieu de contact entre la société et l’État. Les acteurs scolaires se situent à l’articulation, au point de confluence entre des dynamiques locales, nationales, internationales – pour ne citer que trois niveaux des cercles concentriques dans lesquels l’activité sociale des individus et des groupes est insérée. L’éducation scolaire gouvernementale est un instrument emblématique des pratiques politiques et culturelles d’un gouvernement vis-à-vis de ses administrés, en même temps qu’un lieu de négociations où les aspirations symboliques et matérielles des gouvernants et des gouvernés, leurs interprétations respectives de ce qu’est et devrait être le monde social, se rencontrent, se confrontent, se transforment.
L’école, en tant qu’instrument de légitimation du pouvoir et de normalisation qui s’applique à modeler des manières de penser et des façons d’être, est utilisée par l’État pour assurer la matérialisation de sa conception de la nation. D’abord, comme l’a souligné Pierre Bourdieu, « les institutions scolaires ont pour mission majeure de construire la nation comme population dotée des mêmes »catégories », donc du même sens commun29». Ensuite, l’éducation scolaire impose des critères linguistiques, religieux et culturels qui attribuent une identité délimitée à la nation, à travers la langue (ou les langues) d’enseignement, l’histoire, la géographie, l’éducation civique et, de manière plus allusive, la littérature. Enfin, l’école veille ce que les élèves deviennent de futurs gouvernés habitant « le temps de la nation » : elle enseigne un passé commun réorganisé ou inventé pour inscrire la communauté politique dans la longue durée ; en véhiculant le mythe du progrès, elle s’attache à inculquer l’idée d’une communauté de destin. Comme le résume Partha Chatterjee en s’appuyant sur Homi Bhabha : dans le premier temps, le peuple est objet de pédagogie nationale parce qu’il est toujours dans une phase de fabrication, dans un processus de progrès historique qui reste à parachever pour que la nation réalise son destin ; dans le second, l’unité du peuple, son identification permanente à la nation, doivent être continuellement signifiées, répétées, performées30».
Unie, la nation doit être placée sur la voie du progrès, étiqueté sous les rubriques de modernisation » et de « développement »31. En somme, le rôle de l’école est de créer un imaginaire national et, dans le même mouvement, de porter l’idée du progrès. Dans cette perspective, recevoir une éducation scolaire signifie à bien des égard avoir reçu le baptême de la modernité. L’école porte en elle la division binaire entre tradition et modernité et, dès lors, celle de la nation en deux parties, dont l’une est « moderne » et l’autre « à moderniser ». Moderne et traditionnel polarisent des discordances sur ce que doit être la nation en tant que communauté en devenir.
Après avoir expliqué que la nation procède d’un acte d’imagination, Benedict Anderson ajoute « [qu’] au-delà des villages primordiaux où le face-à-face est de règle (et encore…), il n’est de communauté qu’imaginée32». L’histoire de l’éducation invite à retenir cette idée tout en lui apportant quelques remaniements ou, pour le moins, d’atténuer l’exclusivité accordée à l’imagination. Christine Chivallon a remarqué que, si Benedict Anderson démontre de manière remarquable que la création de l’imaginaire s’appuie sur une série de supports matériels – des livres, des journaux, des musées, des monuments etc. –, il n’inclut pas la matérialité de la nation à son élaboration théorique33. Or, s’intéresser au lien entre l’institution scolaire et la construction de la nation implique de ne pas dissocier imaginaire et matérialité. L’école est un instrument de façonnement de l’imaginaire à travers l’histoire, les mythes, les savoirs enseignés en général. Elle est, aussi, doté d’une forte matérialité à travers ses livres, ses classes, son enceinte close, ses heures d’entrée et de sortie34. Elle exerce une action pédagogique et des contraintes – bien loin d’être imaginaires – sur les esprits et les corps des élèves. Ses bâtiments, inscrits dans le paysage, marquent la présence physique de l’État et de la nation en des points dispersés du territoire administré. Enfin, si le sentiment d’appartenance commune repose sur l’imagination, l’entrée dans la nation n’est pas un acte purement imaginaire, situé dans les nuées de l’univers discursif. Pour les Wolaita dominés, elle signifie, très concrètement, une émancipation de rapports de production fondés sur l’exploitation et un affranchissement de relations de pouvoir oppressives. Le rapport à la nation et à l’école s’inscrit profondément dans la réalité sociale concrète, psychologiquement et physiquement vécue, des rapports de pouvoir. « Réel » et imaginaire ne sont pas dissociables. C’est à travers l’école que les Wolaita sont partis, de plus en plus nombreux, « à l’assaut de la nation ». L’école est un des instruments de pouvoir du centre sur ses périphéries, mais aussi un outil grâce auquel les dominés peuvent atténuer les aspects les plus criants de la domination qu’ils subissent, en s’adaptant aux structures qui leurs sont imposées. L’école est alors un espace de « tactique », définie par Michel de Certeau comme une « action calculée que détermine l’absence d’un propre. […] La tactique n’a pour lieu que celui de l’autre. Aussi doit-elle jouer avec le terrain qui lui est imposé tel que l’organise la loi d’une force étrangère35». La culture transmise par l’école donne la capacité aux populations marginalisées de se mouvoir dans ce « monde de l’autre » qu’est la nation. Les savoirs, valeurs et comportements qu’elle véhicule donnent connaissance des codes qui régissent ce monde, même s’ils ne sont pas forcément intégralement acceptés.
L’objectif du « progrès » – en dépit du fait que ses contenus manquent très souvent de précision – vise à agréger la population à l’État. Toutefois, les grands projets de l’État n’ont pas le même sens au centre que dans le contexte d’une localité ; les perceptions changent lorsque l’on change d’échelle. Il en va de même des catégories polysémiques qui soutiennent ces projets – la nation, le progrès, le développement, la civilisation etc. –, que les acteurs investissent et font fonctionner sur des registres pluriels qui leur sont propres. L’écart peut ainsi être grand entre l’homogénéité d’une politique scolaire et l’hétérogénéité des usages qu’en font les acteurs sociaux, entre les grands projets de l’un et les « politiques du quotidien » des autres. Pour l’État, par exemple, le progrès se conçoit à un niveau macro : il pourra signifier une administration centralisée et efficace, une augmentation des richesses nationales etc. Pour un individu, sa famille ou son groupe social, le progrès pourra signifier l’accès au salariat, la sortie d’une vie agricole misérable et d’un statut de dominé. D’autres pourront embrasser des projets collectifs à plus grande échelle, qui peuvent être ou ne pas être ceux de l’État. Les relations qu’une société entretient avec le pouvoir central et la communauté politique nationale se comprennent dans ces décalages dont l’école est un lieu privilégié d’observation. Les réceptions et interprétations des discours et des pratiques scolaires doivent donc être questionnés et analysés en détail, car elles témoignent des manières diverses et évolutives dont les populations investissent les politiques étatiques.
Les dynamiques scolaires dans le Wolaita à l’aune des relations de pouvoir
En s’appuyant sur les travaux de l’historien Maurizio Gribaudi, un des principaux représentants de la micro-histoire, Jean-Hervé Jézéquel a montré que, sous la colonisation en Afrique Occidentale Française, les logiques de scolarisation échappaient aux explications linéaires et que les approches en terme de macro-variables étaient insuffisantes à en rendre compte. C’est pourquoi il s’est attaché à « restituer le rôle des configurations locales – c’est-à-dire la trame locale des relations et des appartenances sociales – dans l’explication des processus historiques globaux36». Ces « relations » sont, pour beaucoup, des relations de pouvoir et les « appartenances sociales » des positions dans la distribution de ce dernier. Dans sa thèse d’histoire sur la formation de l’élite kényane, Hélène Charton a montré comment la scolarisation a été une forme de résistance qui a permis à certains Kényans de « s’approprier des outils de la domination » et, partant, de prendre pied dans le nouvel espace social et politique imposé par la colonisation britannique37. Ces deux perspectives invitent à considérer les modes d’investissement de l’école à partir des structures sociales et des rapports de pouvoir.
Les places occupées dans la distribution du pouvoir, qui signifient des distances variées par rapport à la culture scolaire, dessinent un « espace social » que Pierre Bourdieu défini comme une « structure de juxtapositions de positions sociales »38. Elles tracent des lignes de partage à partir desquelles les dynamiques scolaires du Wolaita doivent être analysées, même si une part d’incertitude doit être maintenue pour permettre des surprises. Comment les différentes positions dans la distribution du pouvoir ont-elles contribué à déterminer les pratiques scolaires des différents individus et groupes sociaux ? Comment ces individus et groupes percevaient-ils les communautés politiques locales et nationales dans lesquelles ils vivaient ? La place qu’ils y occupaient ? Le rapport à l’école informe sur la manière dont les actrices et les acteurs questionnent les structures sociales et la position qu’ils y occupent pour, bon gré mal gré, les accepter ou les remettre en cause scolaire. La culture scolaire – un ensemble de normes qui définissent des savoirs à enseigner et des conduites à inculquer et un ensemble de pratiques qui permettent la transmission de ces savoirs et l’incorporation de ces pratiques, selon Dominique Julia40 –, tend à se répandre hors de ses murs. L’espace scolaire est, certes, un espace spécifique mais il n’est pas un isolat et les échanges qu’il entretient avec son environnement social se font dans les deux sens. Les hiérarchies sociales et les pratiques de pouvoir de la société environnante se répercutent dans l’école ; inversement, « les formes [scolaires] de pouvoir – y compris les plus microscopiques – génèrent le social 41». D’autre part, les attitudes vis-à-vis de la culture scolaire s’inscrivent dans, et donc dévoilent, les relations de pouvoir qui prévalent dans l’environnement social. « L’analyse précise des rapports conflictuels ou pacifiques que [la culture scolaire] entretien, à chaque période de son histoire, avec l’ensemble des cultures qui lui sont contemporaines : culture religieuse, culture politique ou culture populaire42», est alors une porte d’entrée vers la compréhension de phénomènes plus larges. Dans les deux perspectives, l’histoire de l’éducation permet de comprendre comment les individus et les groupes vivent les relations de pouvoir, se situent à leur égard et, sciemment ou non, les transforment.
Les réalités politiques, sociales, économiques et culturelles du Wolaita au XXe siècle justifient une telle approche. Il s’agit d’une région carrefour située à 300 kilomètres au sud d’Addis-Abeba, conquise par l’empereur Menilek II en 1894. Il s’agissait alors d’un royaume puissant entouré d’États vassaux, en position d’hégémonie régionale, qui dominait politiquement, économiquement et culturellement la zone délimitée par la vallée du Rift à l’est, le royaume Hadiya au nord, le royaume de Kafa à l’ouest, jusqu’au lac Chamo au sud43. Intégré de force à l’Éthiopie, il a perdu sa souveraineté pour déchoir d’une position centrale à une situation périphérique. La résistance opposée à l’armée éthiopienne a été sévèrement punie. Le territoire du Wolaita a été mis à sac et son roi, Tona, fait prisonnier avant d’être transporté enchaîné à Addis-Abeba accompagné de milliers d’esclaves razziés44. D’après Bahru Zewde, « en 1894, […] le puissant royaume du Wolaita a été incorporé après une des campagnes les plus sanglantes de tout le processus d’expansion45». Les territoires soumis sans résistance, comme les régions oromo du Wälläga et de Jimma à l’ouest et au sud-ouest, sont devenus tributaires. Leurs souverains sont demeurés à la tête de leurs anciens royaumes devenus régions éthiopiennes et les terres n’ont pas fait l’objet d’expropriations massives46. Les élites politiques locales n’en sont pas moins passées sous le contrôle de l’État éthiopien et la lourdeur des tributs a fortement pesé sur l’économie paysanne. Elles sont devenues des enclaves semi-indépendantes47». Ceux qui ont résisté, comme le Kaffa et le Wolaita, sont en revanche passés sous contrôle direct de l’administration éthiopienne48.
Dans le Wolaita, les terres ont été distribuées aux soldats de Menilek II avec le droit de lever des taxes et de profiter du travail servile des paysans. Dotés de pouvoirs politiques et judiciaires étendus, ils exerçaient le pouvoir au nom du gouvernement. Des colons armés envoyés du nord les secondaient pour assurer le contrôle des populations conquises. Les vaincus sont devenus des paysans tributaires, astreints aux ponctions et aux corvées, sur lesquels s’exerçait un pouvoir arbitraire. Au groupe des nouveaux maîtres, se sont agrégés des Wolaita auxiliaires du pouvoir aux échelons subalternes de l’administration. Ils étaient chargés, sous le contrôle étroits des conquérants, de lever les taxes, d’assurer l’exercice de la justice et de la police au niveau des villages. Enfin, le nouveau système a rapidement intégré de grandes familles locales, dont la famille royale, qui disposaient, comme les vainqueurs, de droits sur d’immenses domaines fonciers49.