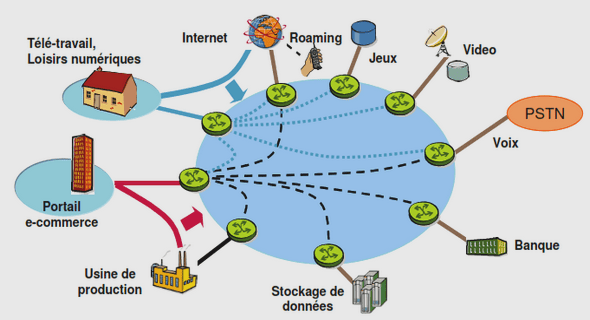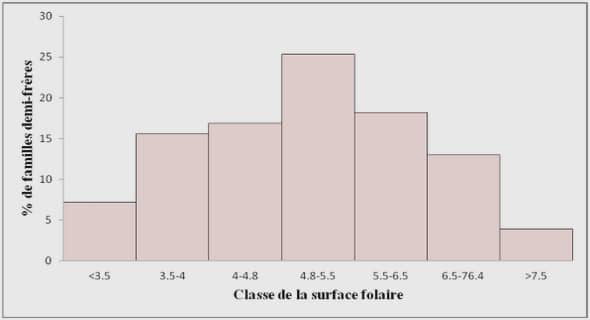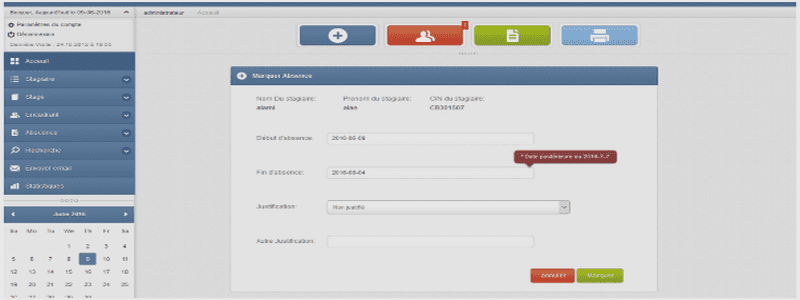Présentation de la problématique : la réception comme objet énigmatique
La brève présentation qui précède, quoiqu’elle fournisse un aperçu des données de l’étude, ne propose aucune définition à même de satisfaire la rigueur d’une approche scientifique ou, plus modestement, descriptive. Or, l’étude d’un objet donné appelle généralement à définir cet objet avant, ou après, avoir exposé la méthode adoptée pour en rendre compte. On distingue en ce sens une étape ontologique d’une étape épistémologique. Cependant, dans le cas qui nous occupe, la définition de l’objet et la définition de la méthode se heurtent conjointement à un certain nombre de difficultés. Ces obstacles tiennent notamment au fait que la définition de l’objet de l’étude est étroitement dépendante de la méthode retenue, compliquant la possibilité d’une distinction claire entre une étape ontologique et une étape épistémologique. Pour rendre compte de ces difficultés, il convient de montrer en quoi la réception de l’œuvre de Ronald Dworkin en France suppose une problématique empirique (a), inséparable d’une énigme conceptuelle (b).
On compte 4 thèses soutenues en France et comportant le nom de l’auteur dans leur intitulé : Tortolero Cervantes F., Majorité politique, opposition et cours constitutionnelles : essai sur l’applicabilité du principe d’intégrité de Ronald Dworkin en Europe occidentale, thèse de Sciences politiques, Paris I, 2005 ; Chalanouli C., Kant et Dworkin : philosophes du droit : de l’autonomie individuelle à l’autonomie privée et publique, thèse en Histoire du droit, Paris II, 2007 ; Solignac P., La justice comme sollicitude : de Ronald Dworkin à la question de l’éducation, thèse de Philosophie, Paris IV, 2008 ; Tortollero, Nama J.B., Neutralité axiologique en droit : Hans Kelsen et Ronald Dworkin, thèse de Philosophie, Paris VIII, 2013.
Comparativement, ils apparaissent significativement plus nombreux en Espagne ou en Italie par exemple.
A cet égard le colloque de 2015, « Ronald Dworkin, l’empire des valeurs », rassemblant des juristes et des philosophes, fait figure d’exception.
Une problématique empirique
La construction d’un objet scientifique suppose de circonscrire ontologiquement le champ de l’étude, c’est-à-dire l’ensemble des données empiriques pertinentes pour une recherche donnée. S’agissant de la réception de l’œuvre de Ronald Dworkin en France, cela implique de délimiter deux ensembles empiriques. Premièrement, un ensemble empirique caractéristique de la réception, permettant de la délimiter (i), deuxièmement, un ensemble empirique déterminant et déterminé par la réception, permettant de l’expliquer (ii).
Délimiter la réception
La problématique empirique qui s’impose d’emblée est celle de la définition de la réception de l’œuvre de Ronald Dworkin en France. En effet, le préalable à l’analyse au fond de la réception réside dans la délimitation formelle de celle-ci. Comment établir, dès lors, une telle base empirique ? Intuitivement, nous serions bien sûr tentés de nous en remettre à une analyse documentaire méticuleuse de diverses ressources bibliographiques aux fins d’établir un corpus de discours qui constituera dès lors l’objet de l’analyse. Mais la question qui survient immanquablement est celle de la manière dont doit être établi un tel corpus. Quant à la manière, le protocole de recherche ne fait que peu de doute, il s’agit de compulser les bases de données numériques et les fonds de recherche des bibliothèques en vue d’identifier les discours pertinents. C’est en revanche le processus de discrimination parmi ces discours qui pose question. En effet, la question cruciale est celle des propriétés typiques de l’objet, des critères à partir desquels on doit intégrer, ou au contraire exclure, un discours de la réception.
Là encore, une réponse intuitive vient à l’esprit. La réception serait assimilable à la référence à l’œuvre de Ronald Dworkin et le corpus serait en ce sens constitué par l’ensemble des discours citant explicitement soit l’œuvre, soit l’auteur. Une telle solution ne laisse toutefois d’emporter quelques conséquences insatisfaisantes, aussi bien pratiques que théoriques. En effet, sur le plan pratique, l’identification d’un tel corpus apparaît particulièrement laborieuse, pour ne pas dire impossible. La recherche numérique étant, pour des raisons compréhensibles, inapte à satisfaire pleinement cette ambition, il faudrait se livrer à une recherche au cas par cas d’une bibliographie faramineuse pour espérer établir exhaustivement la réception, et quand bien même, on risquerait alors de voir échapper certains discours lorsqu’ils ont été perdus, mal rangés ou n’ont pas été publiés. Sur le plan théorique, cette solution révèle également des faiblesses, en effet, elle tend à niveler les discours de réception à partir du seul critère de la citation explicite et, ce faisant, conduit à exclure du champ certains discours pertinents, autant qu’elle amalgame tous les discours de réception en dépit de fortes disparités. Concernant les exclusions, tout d’abord, il convient d’insister sur le fait que l’on peut comprendre certains discours comme appartenant à la réception en dépit de toute référence explicite. Il en va ainsi par exemple de discours qui mobiliseraient certaines distinctions ou métaphores dworkiniennes, comme la différence entre règles et principes, ou l’image du juge Hercule, sans pour autant renvoyer expressément à l’œuvre dworkinienne. A propos de l’amalgame, ensuite, il apparaît que les discours faisant référence à l’œuvre de Dworkin présentent des formes et des finalités très diverses, de la simple référence dans le cadre d’une recension bibliographique aux argumentations substantielles destinées à discuter les thèses dworkiniennes. La définition de l’objet nous semble devoir intégrer tous ces discours, en même temps qu’elle doit permettre, au sein même du corpus de la réception, de les distinguer.
Pour surmonter ces difficultés, notre étude a retenu une voie médiane, entre la bibliographie exhaustive et l’analyse sélective. Elle implique une recherche bibliographique approfondie des discours faisant référence à l’œuvre de Ronald Dworkin en vue de constituer le corpus le plus large possible. Ce dernier ne prétend cependant pas à l’exhaustivité compte tenu de la somme des discours envisagés comme de la relative inaccessibilité de certains d’entre eux. Parallèlement, l’ambition n’est pas de dresser une simple bibliographie systématique de la réception de l’œuvre en France, mais bien d’offrir une analyse de cette dernière, une étude du contenu mais aussi des causes et des effets de ces discours.
Expliquer la réception
Opter pour une analyse substantielle des discours de la réception suppose de ne pas se limiter à l’étude des discours eux-mêmes mais de rechercher, au-delà, les causes qui les façonnent et les effets qu’ils engendrent. Naît dès lors une seconde problématique empirique relative à la détermination de ces causes et de ces effets.
Concernant les premières, tout d’abord, il convient de mettre en lumière la spécificité de la réception de l’œuvre de Ronald Dworkin en France au regard des autres réceptions, qu’il s’agisse de la réception nationale aux États-Unis ou d’autres réceptions étrangères. Il nous faut dès lors mettre en évidence un ensemble de facteurs susceptibles d’expliquer les écarts entre ces différentes manières de recevoir une œuvre. Certains éléments viennent naturellement à l’esprit, les différences linguistiques, bien sûr, mais également les oppositions entre les systèmes juridiques, voire entre les institutions doctrinales. Il conviendra d’exposer plus avant ces différents éléments pour justifier de la singularité de la réception en France.
En outre, il nous faut expliquer les tensions internes à la réception de l’œuvre de Ronald Dworkin en France. Rendre compte des clivages disciplinaires, de polarisations dans la réception de l’œuvre, des choix éditoriaux de traduction ou de l’absence notable de certaines formes de réception. Une telle analyse implique une étude qui dépasse la sphère de l’analyse juridique et requiert de se plonger notamment dans les déterminants de l’entreprise doctrinale. Quoique nous ne disposions pas toujours des outils méthodologiques et empiriques adéquats en vue de mener une telle étude, c’est bien la voie qui a été retenue.
Enfin, l’explication de la réception requiert de décrire les effets de cette dernière, non seulement sur l’œuvre mais sur son auditoire. Il apparaît en effet que la compréhension de l’œuvre est toujours médiée par la réception qui en est faite. Envisager qu’il puisse exister une réception directe ou pure de l’œuvre repose sur l’idée d’un rapport binaire idéal entre un auteur et un receveur, or, une telle situation ne se retrouve guère en pratique. La nature du jeu doctrinal fait que la compréhension d’une œuvre, même lorsqu’elle découle de sa lecture exhaustive, est toujours confrontée à un ensemble de conceptions parallèles qui portent soit directement sur l’œuvre, soit sur les thèmes qu’elle expose. Cette immersion de l’œuvre dans un processus collectif d’interprétations et de revendications justifie qu’il soit possible de dégager des effets rétroactifs générés par les discours de réception sur l’œuvre. Or, à leur tour, de tels effets sont susceptibles influencer diversement l’auditoire, dans le cas qui nous occupe, la pratique juridique ou l’entreprise doctrinale comprise plus globalement. Nous chercherons identifier la nature et la mesure de tels effets à propos de la réception de l’œuvre de Ronald Dworkin en France.
Une énigme conceptuelle
La problématique empirique met au jour une problématique conceptuelle. En effet, la difficulté à circonscrire la réception de l’œuvre de Ronald Dworkin en France ne tient pas seulement aux obstacles empiriques posés par l’identification du corpus discursif, mais dépend étroitement de la définition du concept de réception lui-même. Or, ce concept apparaît largement indéterminé (i), alors même que l’œuvre de Ronald Dworkin suppose, quant à sa détermination, un ensemble de contraintes supplémentaires (ii).
Le concept de réception : un objet indéfini et impensé
En cherchant à déterminer plus avant le concept de réception doctrinal, l’on sera tenté de proclamer son indétermination, en ce qu’il est à la fois indéfini et impensé, le second constat étant probablement la cause du premier. La doctrine, et tout particulièrement la doctrine juridique, s’occupe assez peu de développer réflexivement des études qui la prennent pour objet. Lorsqu’elle le fait, elle s’attache plus volontiers à l’entreprise doctrinale dans son ensemble165, à certains débats doctrinaux166 ou à l’histoire de la doctrine167, qu’aux outils mobilisés par la doctrine pour parvenir à ses fins168. Les recherches en droit font bien un usage abondant du concept de réception169. Un grand nombre portent sur des œuvres juridiques, la réception de ces œuvres et leur héritage170. On note également des travaux traitant de la notion d’influence doctrinale171 ou du caractère politisé des réceptions172. Mais aucun ne soulève la question de l’imbrication conceptuelle et définitionnelle impliquée par le rapport entre une œuvre et sa réception.
Si le concept de réception témoigne d’un impensé doctrinal, il est également largement indéfini. Le dictionnaire recense bien un sens général de réception comme « Action de recevoir quelque chose ; résultat de cette action »173 qui correspond indubitablement à la réception d’une œuvre. Pour autant, aucune des acceptions plus spécifique ou plus précise du terme « réception » ne correspond à l’idée de réception doctrinale. Le vague qui caractérise le sens général du terme est clairement inapte à satisfaire les besoins opératoires d’une définition scientifique, il ne permet pas de caractériser la réception doctrinale. L’indétermination terminologique et conceptuelle nous conduit à nous tourner vers d’autres champs du savoir en vue d’envisager, le cas échéant, une définition par analogie. A cet égard, les théories de la réception littéraire méritent d’être soulignées. Ainsi de la théorie de la réception littéraire de Hans Robert Jauss174 qui conçoit l’auteur de la réception comme un lecteur actif, participant à la production du sens de l’œuvre reçue, justifiant une approche herméneutique éclairée par l’histoire de la pratique littéraire175. On peut comprendre dans le même sens l’approche de Gérard Genette lorsqu’il caractérise l’écriture palimpseste comme la création d’œuvres en propre (les hypertextes) à partir d’œuvres antérieures (les hypotextes) par voie de transformation ou d’imitation176. Ces théories de la réception littéraire suscitent l’intérêt en ce qu’elles confèrent une place centrale aux discours de réception et notamment à leur capacité créative. Pour autant, leur domaine d’application, l’esthétique littéraire, nous apparaît difficilement transposable au droit : les finalités poursuivies par les discours de réception en littérature apparaissant fort éloignées de celles des réceptions doctrinales. En outre, si ces théories font à raison une place de choix aux discours de réception – ou aux hypertextes –, elles ne laissent d’entretenir un doute quant à la nature de la relation qui les unit aux discours de l’œuvre – ou à l’hypotexte. En effet, le texte reçu y apparaît comme une forme de donné, quasiment une matière brute dont la réception disposerait comme d’une ressource ductile à l’envi pour ses fins propres. Or, si nous n’entendons pas contester l’idée d’une liberté indéniable de l’auteur de la réception dans l’appréhension de l’œuvre, sa mobilisation et son interprétation, il nous apparaît que l’œuvre suppose par sa forme même et son contexte un certain nombre de contraintes qui pèsent sur la liberté de la réception. De plus, il apparaît que la notion d’œuvre dépasse l’analyse qui est faite, notamment par Genette, des rapports intertextuels ou paratextuels. Ainsi, on peut bien identifier un texte de l’œuvre qui serait transformé ou imité par des discours de réception, mais cette perspective réduirait considérablement la problématique qui est la nôtre. L’œuvre peut se comprendre, en effet, comme un ensemble de textes écrits par un auteur donné, en même temps que la notion d’œuvre semble transcender cette collection empirique. Par œuvre on entend donc non seulement une collection de textes, mais également un ensemble de représentations qu’on impute à ces discours. Suivant cette conception, il n’est pas possible de concevoir le rapport de l’œuvre à la réception de manière statique, d’un donné vers un construit qui s’en saisirait. Les discours de l’œuvre et de la réception n’entretiennent pas des relations de succession placides et clairement circonscrites, ils impliquent au rebours des rapports d’interdépendance marquée. Il existe une interpénétration de l’œuvre et de la réception : si la réception est indubitablement nourrie de l’œuvre, l’œuvre se comprend aussi au travers de la réception, l’une et l’autre étant interdéterminées au terme d’une relation dynamique.
De tels constats suggèrent de se départir des analyses théoriques antérieures en ce qu’elles ne répondent pas, en dépit des éclairages qu’elles apportent, de manière satisfaisante à la question posée par les rapports de l’œuvre et de sa réception.
La réception de l’œuvre de Ronald Dworkin : entre indétermination ontologique et surdétermination épistémologique
La difficulté posée par la compréhension de la relation entre l’œuvre et la réception est redoublée dans le cas de la réception de l’œuvre de Ronald Dworkin, puisque à l’indétermination ontologique s’ajoute une surdétermination épistémologique. En étudiant la relation dynamique entre l’œuvre et la réception, on se demande logiquement quelle méthode est propice à l’élucidation d’une telle relation. Or, l’œuvre de Ronald Dworkin fournit précisément une réponse à cette question, et une réponse radicale, qui plus est. En effet, les concepts d’œuvre et de réception, par l’indétermination ontologique qu’ils emportent, entre dans la catégorie dworkinienne des concepts interprétatifs, et tombent en conséquence sous le coup de l’impératif interprétatif formulé par ce dernier : ils doivent faire l’objet d’une analyse interprétative visant à faire apparaître les pratiques discursives de l’œuvre et de sa réception sous leur meilleur jour. Quoiqu’une telle invitation délivre d’une angoissante recherche épistémologique, elle emporte avec elle son lot de complications. Elle engage en effet l’étude à un dilemme apparent. Ou bien l’on considère que l’épistémologie dworkinienne fait foi, et on la retient comme cadre de la recherche. Néanmoins, on se prive dans ce cas d’interroger la validité de la posture épistémologique dworkinienne, tout en dévaluant considérablement, a priori et sans justification, la portée de certains discours critiques de la réception. Ou bien l’on rejette au contraire cette option épistémologique en privilégiant une approche alternative. Mais on tombe alors dans le travers opposé en excluant a priori la pertinence de l’approche de Dworkin et en minorant la validité des discours de réception qui lui sont sympathiques.
S’il semble difficile de trouver une solution satisfaisante à ce dilemme, il nous est apparu qu’une partie des difficultés pouvait être surmontée par le biais d’une interrogation préalable, prenant la forme de prolégomènes dédiés aux questions de méthodes et à l’épistémologie, notamment dworkinienne. C’est cette perspective qui justifie une forme de renversement dans l’approche de l’objet. Celui-ci n’est pas premier dans l’analyse, il n’est ni un donné ni une stipulation auxquels on appliquerait une méthode à même de dégager des résultats. Au contraire, l’objet apparaît comme l’aboutissement d’une enquête méthodologique, qui conditionne la possibilité même de son étude au fond.
Présentation et justification du déroulement de l’étude : La réception de l’œuvre de Ronald Dworkin en France
Le caractère énigmatique de l’objet « la réception de l’œuvre de Ronald Dworkin en France » nous a conduit à identifier la nécessité d’une enquête méthodologique préalable comme condition de possibilité d’une analyse substantielle de l’objet. Conformément à cette logique, nous verrons en premier lieu cette question de méthode (a), avant d’analyser, de prendre au sérieux la réception de l’œuvre de Ronald Dworkin en France (b).
Une question de méthode : recevoir l’œuvre de Ronald Dworkin en France : la construction d’un instrument d’analyse du discours doctrinal (Première Partie)
L’enquête méthodologique qui ouvre cette étude vise à dissiper plusieurs interrogations visant la définition de l’objet et de la méthode à même d’en rendre compte. La satisfaction d’une telle ambition passe par l’analyse circonstanciée des contraintes pesant sur ces opérations de définition (i), alors que leur identification conduira à la défense d’une méthodologie positiviste pour rendre compte de l’objet (ii).
La présentation de la problématique a révélé que l’objet de notre étude se trouvait à la croisée d’un réseau de contraintes dont il convient de démêler l’écheveau. Tout d’abord, il convient d’identifier une problématique inhérente à la forme des contraintes, en ce qu’elles pèsent, pour certaines, indifféremment sur le discours de la réception (M2Ld) et sur notre propre discours sur la réception (M3Ld). A partir de ce constat, une première distinction peut être établie entre des contraintes générales, pesant sur toute réception transnationale d’une œuvre, et des contraintes spécifiques, typiques de la réception de l’œuvre de Ronald Dworkin.
Parmi les contraintes générales, on distinguera les contraintes qui affectent toute forme de réception d’une œuvre, de celles qui caractérisent la réception d’une œuvre étrangère dans un milieu national, et qui sont donc spécifiques aux réceptions transnationales d’une œuvre. Les premières se comprennent comme des contraintes conceptuelles, manifestées par l’indétermination des concepts d’œuvre et de réception. Nous étudierons les différentes formes d’indétermination et identifierons la forme d’indétermination symptomatique que revêtent les concepts d’œuvre et de réception. Le second ordre de contrainte découle du caractère transnational de la réception de l’œuvre, il se résume à des contraintes institutionnelles, découlant de la différence entre les institutions, américaines, de l’œuvre, et les institutions, françaises, de sa réception. Nous distinguerons alors les contraintes découlant de l’opposition entre les institutions linguistiques, de celles impliquées par les différences entre les institutions juridiques américaines et françaises.
Il conviendra ensuite d’insister sur l’existence de contraintes typiques, attachées à la réception de l’œuvre de Ronald Dworkin en France. Celles-tiennent d’abord à l’œuvre de Ronald Dworkin elle-même, et posent, d’une part, la question de sa portée transnationale, et d’autre part, une problématique épistémologique propre. Elles découlent ensuite de la réception de cette œuvre en France, qui emporte des contraintes relatives à sa circonscription disciplinaire ou géographique, comme à la forme, partielle et plurielle, de la réception opérée.
Une méthodologie positiviste est-elle possible ici ? Une méthode descriptive pour construire un objet pluriel (Titre II)
Le réseau de contraintes identifié conduit à l’élaboration d’une méthode en vue de la construction de l’objet « la réception de l’œuvre de Ronald Dworkin en France ». Les problématiques mises en évidence conduisent notre étude à favoriser une approche descriptive, d’inspiration positiviste, en vue d’appréhender l’objet réception. En effet, retenir une approche prescriptive ou évaluative, qu’elle soit herméneutique ou interprétative, au sens de Dworkin, conduirait à négliger certains aspects de la réception, en minorant les dimensions stratégiques et rhétoriques des usages de l’œuvre. Seule une approche descriptive paraît à même de restituer la complexité du phénomène de réception tant dans son rapport à l’œuvre, que dans sa relation avec le droit et l’entreprise doctrinale entendus de manière générale. Si une telle approche est souhaitable, elle ne laisse d’être compliquée par la dimension interprétative des discours étudiés. Cette propriété engendre typiquement des controverses interprétatives semblant privilégier une méthodologie idoine, ouvertement non descriptive.
Nous montrerons qu’un tel raisonnement, bien qu’il soit perçu avec sympathie, dans les sciences humaines en général et dans la théorie dworkinienne en particulier, mérite d’être combattu. Nous défendrons la possibilité d’une approche descriptive des controverses interprétatives en supposant, d’une part, une sémantique basée sur une conception relativiste de la vérité et, d’autre part, une compréhension plurielle de notre objet.
La conception sémantique défendue se voudra, avant tout, une justification de l’approche descriptive comme métadiscours. En effet, contra Dworkin, nous chercherons à montrer que l’étude d’un objet interprétatif n’emporte pas nécessairement, sur le plan épistémologique, l’adoption d’une méthode interprétative. Au contraire, en exploitant divers outils conceptuels développés en philosophie du langage, nous ferons voir en quoi la description de tels phénomènes est non seulement possible, mais également heuristiquement fertile.
La méthodologie descriptive adoptée nous conduira à mener une enquête sur la manière de définir, et donc de décrire, les concepts d’œuvre et de réception. L’indétermination sémantique dont ils souffrent n’emportant pas l’impossibilité de les décrire, on cherchera dès lors à comprendre comment s’articule la description de tels concepts. Pour ce faire, nous confronterons notre démarche aux problématiques interprétatives traditionnelles, et notamment à la question du principe de charité, avant d’exposer les concepts d’œuvre et de réception aux notions de concept essentiellement contesté ou de concept épais. Cette enquête méthodologique aboutira à la construction d’un objet pluriel, répondant aux contraintes interprétatives identifiées, mais apte à satisfaire l’ambition descriptive retenue par l’étude.
Prendre au sérieux la réception : les réceptions de l’œuvre de Ronald Dworkin en France : l’analyse des usages doctrinaux d’un instrument rhétorique (Deuxième partie)
Une fois surmontée la problématique méthodologique emportée par le sujet, nous nous livrerons l’analyse en propre de la réception de l’œuvre de Ronald Dworkin en France. Le caractère pluriel de l’objet suppose que celle-ci puisse se conduire à partir de perspectives diverses. Aux fins d’en rendre compte, nous déterminerons en premier lieu le territoire de la réception (i), avant d’étudier ses effets, et de conclure à l’existence d’une réception sans dieu (ii).
Le territoire de la réception : l’analyse statique des usages doctrinaux : formes et contenu des discours de réception (Titre I)
Décrire la réception de l’œuvre de Ronald Dworkin en France suppose premièrement de cartographier cette réception en offrant une classification des discours qui la composent. Là encore, diverses approches peuvent être retenues au gré des critères saillants de la classification. En vue de présenter la classification la plus aboutie possible, nous présenterons une classification formelle de la réception, d’une part, et une classification matérielle de celle-ci, d’autre part.
La classification formelle repose sur le positionnement que les discours de réception adoptent l’égard de l’œuvre. En effet, alors que certains discours ont vocation à restituer ou présenter l’œuvre de manière neutre, d’autres au contraire adoptent une démarche ouvertement constructive à son encontre. Parmi les discours se voulant inertes à l’égard de l’œuvre, on recensera bien sûr la traduction, qui poursuit cette ambition par définition, de même que les mentions, qui s’attachent à indiquer l’œuvre comme donnée objective. Les discours à vocation constructive comportent aussi bien les discours d’application qui utilisent l’œuvre comme un moyen en vue de diverses finalités rhétoriques, que les discours critiques, qui discutent l’œuvre pour elle-même, en appréciant les qualités et les défauts.