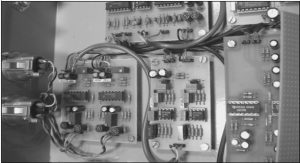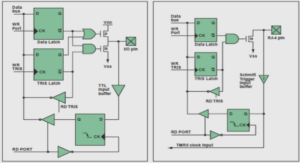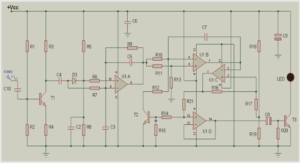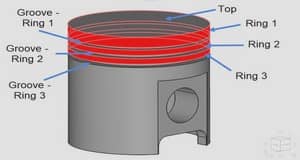Télécharger le fichier original (Mémoire de fin d’études)
Un objet : les hypersensibilités environnementales
Cet objet, nous l’avons découvert au hasard de pérégrinations sur Internet : il s’agit des épidémies d’hypersensibilités environnementales [HSE]. Celles-ci se manifestent par des symptômes somatiques variés comme des migraines, des douleurs multiples, des troubles du sommeil, une fatigue persistante ou des troubles cognitifs, qui sont attribués à des facteurs environnementaux spécifiques :
Les produits chimiques de synthèse, comme les cosmétiques ou les détergents, pour l’hypersensibilité chimique multiple [MCS]7 ;
Selon l’acronyme anglais (« multiple chemical sensitivity ») qu’utilisent communément les acteurs concernés.
Les champs électromagnétiques artificiels, générés notamment par les appareils de télécommunication (combinés et antennes-relais de téléphonie mobile, box Inter-net, etc.) pour l’électro-hypersensibilité [EHS].
Autant qu’il est possible de l’établir, les épidémies d’HSE sont très récentes. Elles sont apparues dans les années 1980, la MCS aux États-Unis et l’EHS en Scandinavie, et ont atteint la France dans les années 2000. Elles sont donc parfois qualifiées de « maladies envi-ronnementales émergentes » ou de « nouvelles maladies de l’environnement ». Elles sont aujourd’hui répandues dans le monde anglo-saxon, en Europe du Nord et de l’Ouest, ainsi que dans plusieurs pays d’Europe centrale et au Japon. Leur prévalence est difficile à estimer mais paraît assez faible.
En partie à cause de leur nouveauté, les HSE ne sont pas reconnues à ce jour comme de véritables maladies : elles n’apparaissent pas dans les nosographies officielles, ne sont pas diagnostiquées par les médecins, ne permettent pas une prise en charge par la col-lectivité et sont souvent stigmatisées. C’est une situation problématique pour les personnes hypersensibles8, qui se mobilisent pour y remédier. Elles suscitent ainsi des controverses et des disputes assez violentes, qui accompagnent les épidémies d’HSE et en accroissent la visibilité. Mais avant de se mobiliser, il faut que ces personnes se reconnaissent hypersen-sibles, qu’elles se diagnostiquent comme telles, puisque nul autre acteur n’est en capacité de le faire. Cette opération n’a rien d’évident. Surtout, elle est lourde de conséquences. Pour les personnes concernées, elle implique une transformation radicale de leurs représentations d’elles-mêmes, de leur environnement et de la société : les milieux les plus anodins leur paraissent soudainement dangereux, il leur devient inconcevable de les fréquenter, et ce, dans l’indifférence de leurs concitoyens et des pouvoirs publics. C’est une expérience verti-gineuse, qui s’accompagne d’une altération significative de l’existence quotidienne et des comportements. Le cas le plus médiatisé concerne deux personnes EHS qui ont vécu pen-dant plusieurs années dans une grotte afin de se protéger des CEM (cf. annexe B.1).
Ce phénomène s’apparente à une conversion, telle que la définissent SNOW & MACHALEK [1983]. Ces auteurs distinguent en effet la conversion d’un simple changement de croyance ou de pratique religieuses, en montrant qu’elle affecte plutôt l’« univers de dis-cours » – c’est-à-dire, selon MEAD [1934], le cadre interprétatif élémentaire à partir duquel les acteurs conçoivent et organisent leur existence, qui structure leur perception de la réalité au niveau le plus fondamental. La conversion apparaît alors comme un processus au cours duquel un nouvel univers de discours s’impose à une personne, devient la matrice de ses représentations et en arrive à gouverner tous les aspects de son existence. Ainsi définie, elle s’avère déborder largement du champ religieux : Snow & Machalek l’observent également dans les champs politique, professionnel, thérapeutique, etc. Ils présentent donc les conver-tis comme un « type social » général, dont les personnes hypersensibles constituent à l’évi-dence un avatar. Empiriquement, ils suggèrent de les reconnaître à plusieurs « traits rhéto-riques » de leurs discours :
La « reconstruction biographique » (les convertis considèrent leur compréhension passée de leur existence et de leur situation comme erronée) ;
L’« adoption d’un schème attributif dominant » (qui oriente leurs interprétations de l’en-semble des événements et des comportements qu’ils observent autour d’eux) ;
L’« endossement d’un maître-rôle » (les convertis appliquent et promeuvent leurs nou-veaux préceptes dans toutes les situations sociales).
Au point de vue cognitif, la conversion affecte les croyances que CLÉMENT [1999, p.400-1] situe au niveau intermédiaire de sa typologie. Elles constituent des « stéréotypes » permettant d’accélérer le traitement cognitif des informations et d’améliorer la réactivité des réponses comportementales. Elles sont généralement acquises par socialisation et opèrent hors du champ de la conscience. Elles peuvent cependant le réintégrer, et se modifier, dans certaines circonstances : des « chocs culturels » – ou les crises personnelles qui interviennent souvent de façon décisive dans les trajectoires des convertis [RAMBO, 1993]. Elles struc-turent les croyances de niveau supérieur. Celles-ci sont pleinement conscientes et délibéré-ment révisables, et admettent en conséquence des degrés d’adhésion et de certitude variables. Elles recèlent les informations que les acteurs savent posséder sur le monde, et sont capables de se représenter. Elles correspondent aux croyances dans le sens le plus étroit du terme. C’est à leur niveau que les conversions sont d’abord observables. Quant aux croyances de niveau inférieur, elles sont foncièrement inaccessibles à la conscience et à la révision. Elles se rapportent au traitement modulaire et spontané des nombreux stimulus parvenant constamment au cerveau, et en particulier à la sélection de ceux dont la percep – tion devient consciente. Elles ne constituent des croyances qu’au sens large d’« état informa-tionnel codé dans le cerveau » : en pratique, elles fonctionnent plutôt comme des « attentes intui-tives ».
Il nous semble inutile à ce stade de définir plus spécifiquement la notion de croyance, notamment en cherchant à la distinguer de la connaissance, comme s’y astreint BRONNER [2003]. Leur séparation implique de raisonner en termes de (probabilité de) vérité et de fausseté. Mais ces dernières sont impossibles à définir absolument dans une société qui ne reconnaît plus de vérité révélée. Les connaissances scientifiques sont souvent employées comme référence, mais elles n’en fournissent qu’une approximation instable en raison de leur caractère évolutif et révisable. Par conséquent, dans les travaux séparant les croyances et les connaissances, les critères de distinction effectivement employés se révèlent moins ontologiques que sociaux : les connaissances qui y sont présentées comme vraies (ou probablement vraies) correspondent en pratique à des croyances normales ou légi-times dans les groupes d’appartenance de leurs auteurs. Même parmi ceux qui revendiquent une approche rationaliste et compréhensive, le choix des exemples est significatif : ce sont toujours des croyances étrangères qu’il s’agit d’expliquer.
Ainsi, raisonner en termes de vérité conduit souvent à introduire ses préjugés en fraude, pour un bénéfice incertain sur l’analyse. Il n’y a guère de raison, par exemple, que des représentations mentales déterminent différemment l’action selon qu’elles sont vraies ou fausses. En conséquence, certains suggèrent d’abandonner la notion même de croyance9 – la difficulté étant alors d’en inventer un substitut adéquat. Faute de solution pleinement satisfaisante, nous continuerons à l’employer par la suite, dans un sens large et dépourvu de toute connotation péjorative10. Précisons pour finir que nous ne prêchons pas ici un quelconque relativisme, du moins hors de la pratique de la sociologie cognitive. Nous souhaitons seulement nous prémunir de certaines tentations conceptuelles, contre les-quelles la meilleure défense est sans doute l’exercice d’une ethnographie soigneuse, scrupu-leusement attentive à n’attribuer aux acteurs étudiés ni des croyances, ni des rapports à leurs croyances, qui ne soient pas les leurs.
Revenons-en maintenant aux épidémies d’HSE. Elles se rapportent en définitive à un phénomène qui convient particulièrement à notre projet : la « conversion » des personnes hypersensibles. Son actualité permet de l’observer directement, comme le requiert une approche empirique. La gravité de ses conséquences garantit qu’il ne consiste pas en un simple jeu de représentations, en cohérence avec une démarche écologique. Son caractère progressif favorise une vision processuelle. D’autres sciences de l’esprit s’y sont intéressées,
À l’instar de LENCLUD [1990], qui dénonce le « jugement dogmatique sur le psychisme d’autrui » qu’elle recèle et la tendance à surestimer la conviction des croyants qu’elle induit ce qui facilite la mobilisation de leurs acquis. Enfin, il se distingue du phénomène étudié par SAUVAYRE [2012] – l’adhésion aux croyances sectaires – par l’autonomie apparente des acteurs concernés : au contraire des anciens adeptes, à en juger par les témoignages dispo-nibles publiquement, les personnes hypersensibles se reconnaissent comme telles en toute indépendance, sans que d’autres « acteurs de l’adhésion » n’interviennent (comparables aux membres des sectes jouant le rôle de « coapteurs »). Leurs trajectoires n’en sont que plus fas-cinantes à observer. Quand les médecins, les experts, les institutions, mais aussi leurs proches, leurs collègues ou leurs voisins considèrent que les produits chimiques ou les CEM n’ont rien à voir avec leurs problèmes de santé – comment peuvent-elles être suffi-samment persuadées du contraire pour abandonner, parfois du jour au lendemain, leur domicile, leur famille et leur emploi, et se réfugier dans une grotte ou dans les bois ? Com-ment peuvent-elles en rester convaincues face aux innombrables difficultés qui en résultent ? Il y a là un sérieux commencement d’énigme.
Les épidémies d’HSE méritent enfin d’être étudiées pour deux raisons supplémen-taires, indépendantes de notre projet de sociologie cognitive. La première concerne l’incer-titude scientifique qui les entoure, et les situations parfois dramatiques dans lesquelles se trouvent les personnes hypersensibles : il est essentiel de parvenir à une meilleure compré-hension de leurs troubles, afin de pouvoir inventer des prises en charge efficaces et satisfai-santes. La seconde se rapporte aux controverses et aux disputes qui entourent les HSE. Elles tendent à les constituer en problèmes sociaux et politiques, qui intéressent aussi bien la santé publique que la gestion des risques et l’aménagement du territoire. Il est donc important d’en proposer une intelligibilité sociologique qui puisse éclairer l’action publique, notamment par le biais de l’expertise.
Par conséquent, bien que notre projet soit cognitif, nous n’allons pas y réduire d’emblée les épidémies d’HSE. Nous allons plutôt les aborder comme telles, c’est-à-dire comme des maladies, dans leurs dimensions organiques et environnementales, mais aussi historiques, culturelles et sociales. Cela nous exposera à quelques difficultés supplémen-taires, mais nous permettra d’atteindre à une meilleure compréhension. En particulier, nous pourrons ainsi donner toute son importance à un fait qui singularise les personnes hyper-sensibles parmi les acteurs étudiés jusqu’à présent en sociologie cognitive : leurs croyances étant relatives à des perceptions sensorielles, des sensations morbides et des symptômes somatiques, elles s’enracinent dans leur expérience corporelle. Elles sont bien moins « désin-carnées » que les représentations mentales ayant pour l’instant retenu l’attention. Or, il est fort probable que leurs significations subjectives et sociales s’en ressentent, et les différen-cient nettement, par exemple, des croyances religieuses ou superstitieuses. Enfin, appréhen-der les HSE comme des maladies nous permettra d’exploiter plus facilement les travaux qui leur ont été consacrés en sciences sociales, car ils se rattachent à la sociologie de la santé davantage qu’à la sociologie cognitive.
Méthode : deux traditions dans l’étude sociologique des maladies
Commençons par poser quelques repères en observant comment cette sociologie problématise habituellement de tels phénomènes. En particulier, comment les convertit-elle en objets d’investigation sociologique ? Quelle cohérence, nécessairement théorique11, leur donne-t-elle ? Les démarches possibles sont en réalité peu nombreuses. S’étant posé le pro-blème une trentaine d’années auparavant, Claudine Herzlich n’en avait identifié que deux. Présentons-les chacune sous leurs formes contemporaines, puisqu’elles sont encore employées aujourd’hui, avant de montrer qu’elles sont à la fois inconciliables et les seules possibles.
Une tradition réaliste
La première tradition est présentée par Herzlich en ces termes :
Ses membres « ont étudié la maladie comme conduite sociale. Le statut social et le rôle du malade dans notre société, les variables qui déterminent sa conduite, et les normes qui lui donnent forme, ses relations avec l’institution médicale ont constitué les objets par excellence des centaines d’études qui, depuis trente ans, se réclament de la “sociologie médicale”. […] Pour les sociologues se rattachant à cette conception, le “comportement de maladie” identifié au recours aux soins médicaux a été un domaine d’étude préférentiel. » [HERZLICH, 1983, p.192-4]
Elle la rattache à la figure de Talcott Parsons, considérant qu’elle a été initiée par sa célèbre analyse du « sick role » – qui consiste effectivement en une description précise, et très normative, des comportements attendus de la part des personnes malades. Être recon-nues comme telles leur ouvre deux droits et les soumet à deux obligations : elles sont auto-risées à déroger à leurs obligations sociales habituelles, et à ne pas être tenues pour respon-sables de leur état (par exemple, elles peuvent cesser de travailler tout en conservant un revenu, sans être stigmatisées pour cela) ; mais doivent également manifester le désir de se soigner, et rechercher une aide compétente (c’est-à-dire se soumettre au contrôle exercé par la profession médicale) [PARSONS, 1951]. Lorsqu’un tel raisonnement est transcrit empiri-quement, la construction de l’objet se trouve subordonnée au verdict médical : pour obser-ver comment des individus (malades, proches, soignants, etc.) réagissent à une maladie, il faut pouvoir attester qu’ils sont bien affectés par le même trouble, ce qui impose d’en accepter la réalité (même à titre provisoire) et de partir des diagnostics posés par le corps médical. Si l’intérêt porte sur d’autres types d’acteurs (groupes sociaux, institutions, pou-voirs publics, etc.), un critère médical est également indispensable pour garantir qu’ils réagissent au même phénomène. L’élaboration de l’objet est ainsi dépendante de jugements médicaux, puisque eux seuls en garantissent l’homogénéité (c’est-à-dire la comparabilité des phénomènes qui y sont inclus) – et se trouvent en conséquence exclus du champ de l’inves-tigation. HERZLICH [1983, p.192] avait d’ailleurs constaté que « les sociologues […] n’ont, jusqu’à une date récente, pas remis en cause le cadre des entités cliniques reconnues par la pensée médicale et n’ont pas développé de conception proprement sociologique de l’étiologie. » Elle désigne cette approche comme « parsonienne » ; nous préférons la qualifier de « réaliste », car c’est précisément la reconnaissance de la réalité des « entités cliniques » qui la distingue. En pratique elle est géné-ralement contemporaine (par rapport au chercheur) et micro-sociale.
On trouve une incarnation récente de cette tradition dans l’ouvrage consacré par Muriel Darmon à l’anorexie. S’étant proposé de démontrer la capacité de la sociologie à rendre compte de cette maladie, elle a réalisé une enquête auprès de personnes hospitalisées avec un diagnostic d’anorexie. Dans ses propres termes : « le diagnostic médical d’anorexie a constitué un outil de recrutement » [DARMON, 2003, p.36] en fonction duquel elle a identifié les personnes à solliciter. L’élaboration de son échantillon s’est donc trouvée déléguée à des médecins, dont elle a seulement pu constater qu’ils utilisaient des critères diagnostics diffé-rents (selon que leur orientation était plutôt psychiatrique ou psychanalytique), et qui de surcroît ne l’ont pas autorisée à rencontrer tous les patients de leur service. Elle s’est alors attachée à décrire l’anorexie comme un ensemble de pratiques, travaillant à lui donner une réalité sous l’angle comportemental. Elle la dépeint comme une carrière aboutissant à une prise en main complète de soi, décomposée en quatre étapes :
Le commencement, qui est habituellement scandé par un régime, ainsi que par une multiplication des pratiques sportives, et s’accompagne parfois d’un changement radical d’apparence (vêtements, coiffure, maquillage) et d’attitude scolaire (application ostensible). Il signifie l’entrée dans une démarche active de transformation de soi.
La continuation I, qui correspond à une rationalisation systématique de cette démarche. Elle recouvre notamment un engagement sur l’avenir, dont témoigne la formation volontariste d’habitudes, ainsi qu’une requalification des goûts, associant les effets positifs amenés par la transformation de soi à l’acte de jeûner.
La continuation II, qui est caractérisée par une évolution des stratégies mises en œuvre par les anorexiques. Les conséquences de leurs nouvelles pratiques devenant manifestes, une surveillance est instaurée par les médecins et les proches, qu’elles s’efforcent de déjouer en passant de la discrétion à la dissimulation (mensonge, simulation, évitement).
La prise en charge par l’institution hospitalière, conséquente à l’échec des stratégies de dissimulation. Les soignants s’y efforcent d’inverser la transformation de soi accomplie par les anorexiques, les invitant à se déprendre en charge, au prix d’une remise en question de leur identité.
L’auteur s’applique ensuite à expliciter la signification de cet ensemble de pratiques : elles participent de la recherche d’une excellence culturelle, dont elles constituent le « front corporel » articulé à un « front scolaire » non moins important. Elles s’inscrivent dans le contexte social particulier d’adolescentes entretenant un rapport dominé à la culture sco-laire, et dont les familles valorisent particulièrement l’apparence corporelle féminine. L’of-fensive sociologique de Darmon, parce qu’elle ne procède pas d’une remise en cause fonda-mentale de l’entité nosographique « anorexie », conduit donc seulement à en diversifier le contenu (des pratiques s’ajoutent aux signes cliniques).
Une tradition constructiviste
La seconde tradition de recherche en sociologie des maladies est ainsi décrite par Herzlich : Face à cette lignée d’études, un second courant s’est cependant affirmé que l’on peut désigner sous le terme d’approche de la médecine comme productrice des catégories sociales de santé et de maladie. Pour les tenant de cette conception, on ne doit pas confondre la réalité organique de la maladie et sa réalité sociale c’est-à-dire l’état organique en lui-même et l’état organique défini comme maladie par la médecine et le médecin. L’une et l’autre n’entretiennent pas des rapports de simple décalquage ou de continuité. […] Ce type d’analyse a pu s’appliquer avec succès aux aspects des phénomènes organiques apparemment les plus difficiles à traiter socio-logiquement, comme par exemple la douleur. » [HERZLICH, 1983, p.195-6]
Elle la rattache à la figure d’Eliot Freidson, pour avoir le premier distingué systéma-tiquement entre la maladie comme rôle social et la pathologie comme état organique, et fait porter l’interrogation sociologique sur la manière dont elles sont reliées12. Selon ses propres termes, « the problem to manage is the idea of illness itself―how signs and symptoms get to be labeled or diagnosed as illness in the first place, how an individual gets to be labeled sick » [FREIDSON, 1970, p.212]. C’est précisément le travail auquel se livrent les médecins en consultation, à l’aide de raisonnements pratiques qu’il a entrepris de mettre à jour. Sa démarche relève ainsi d’une
étude de la connaissance appliquée » (selon le sous-titre de l’ouvrage cité). Elle a préludé à l’ana-lyse de la connaissance médicale sur son autre versant : abstrait ou théorique, recoupant les développements parallèles des science studies (l’émergence du Programme Fort notamment). Différents travaux se sont en effet attachés, à partir des années 1980, à exhumer les mul-tiples décisions et négociations ayant permis à la communauté médicale de reconnaître der-rière des manifestations cliniques disparates telles entités nosographiques homogènes, c’est-à-dire le processus de « fabrication » de ces dernières (ils s’intitulent typiquement « the making of a disease »). Il nous paraît donc plus explicite de les rattacher à une tradition « constructi-viste » plutôt que « freidsonienne » comme Herzlich13. En pratique elle est plutôt historique et macro-sociale ; l’investigation y porte sur les jugements médicaux.
Un exemple de recherche incarnant ces deux dimensions de la tradition constructi-viste est l’ouvrage consacré par Allan Young au syndrome de stress post-traumatique [SSPT] [YOUNG, 1995]. Sa première moitié est consacrée au processus à l’issue duquel le SSPT s’est imposé comme une catégorie légitime de la nosographie psychiatrique. Il a débuté au tournant des années 1960 et 1970, par l’observation de comportements « anti-so-ciaux » de la part de nombreux vétérans du Vietnam, puis la formation d’un réseau de psy-chiatres convaincus que les traumatismes vécus à l’occasion de ce conflit en étaient respon-sables. Ceux-ci définirent un trouble idoine et militèrent pour qu’il soit intégré dans le DSM-III alors en cours de préparation. Ils s’attachèrent à fournir des preuves de sa validité, la fois contemporaines (principalement des études de cas) et historiques (en se réclamant de la tradition de recherche inaugurée dans les années 1860 par le chirurgien britannique CONRAD & BARKER [2010] identifient trois autres « racines » de l’approche constructiviste de la maladie : la sociologie de la déviance, pour avoir constaté que la médicalisation des comportements est l’un des res-sorts des entreprises de morale ; l’interactionnisme symbolique et la phénoménologie, pour avoir distin-gué entre l’expérience subjective de la maladie et sa réalité organique ; et les analyses foucaldiennes de l’influence des discours médicaux.
C’est aussi une manière de rendre justice à des travaux précurseurs réalisés en épistémologie médicale, notamment ceux de Ludwik Fleck sur la syphilis (Genèse et développement d’un fait scientifique, 1934), qui ont été redécouverts tardivement mais constituent sans doute la première tentative aboutie de raisonner de cette manière.
John Erichsen, qui avait observé chez les rescapés d’accidents ferroviaires des troubles du comportement manifestement dépourvus de cause organique). Ils rencontrèrent deux résis-tances principales. La première émanait de l’équipe coordonnant la préparation du DSM-III, qui défendait le principe d’une classification strictement séméiologique, tandis que le fondement du SSPT est clairement étiologique14. La seconde provint d’autres psy-chiatres, considérant que les troubles rattachés à cette nouvelle entité s’intégraient déjà par-faitement dans les catégories psychiatriques (les obsessions par exemple, étant caractéris-tiques des troubles de l’humeur, nul besoin de les reconcevoir comme des « ré-expériences du trauma »).
C’est finalement sur le terrain politique que le SSPT l’emporta, parce qu’il partici-pait de la reconnaissance des vétérans du Vietnam (il était clair qu’il leur permettrait d’être indemnisés et pris en charge en tant qu’anciens combattants blessés en service). Il intégra le DSM-III dès sa parution, en 1980 – ce qui lui permit, à défaut de cesser d’être contesté, de pouvoir être mis en œuvre légitimement par les psychiatres qui le souhaitaient, et de façon-ner en retour l’expérience de leurs patients. Allan Young s’attache à démontrer comment dans la seconde partie de son ouvrage, en s’appuyant sur des observations réalisées dans un centre de traitement des vétérans. Il souligne par exemple à quel point les « technologies diag-nostiques » utilisées par les psychiatres pour repérer, parmi les vétérans qui les consultent, ceux dont les symptômes leur paraissent relever du SSPT, favorisent la production de récits cohérents et organisés autour d’un événement traumatique. Il montre également comment les thérapies employées, qui reposent toutes sur une prise de conscience de cet événement (passé) et de ses effets (présents), s’efforcent d’obtenir des patients qu’ils adhèrent à ces récits et réorganisent leur soi en conséquence. Le SSPT apparaît ainsi non seulement comme une élaboration historique, mais aussi comme une réalisation [« achievement »] quoti-dienne : il est doublement construit.
Cette démarche est profondément subversive pour la connaissance médicale, mais dans la mesure où elle provient d’une discipline scientifiquement moins légitime que la médecine, elle se cantonne le plus souvent à ses frontières. HERZLICH [1983, p.197] avait bien remarqué que « les chercheurs ont eu tendance à éviter les cas les plus “lourds” de maladie claire – ment organique et grave pour s’en tenir aux terrains, plus faciles dans leur perspective mais aussi moins féconds, de la maladie mentale ou des phénomènes de médicalisation. » Ce constat demeure valable aujourd’hui. Des travaux ambitieux ont certes été réalisés, et peut-être plus nombreux qu’avant. Mais la majorité des recherches inscrites dans cette tradition concerne toujours des maladies dont les causes sont incertaines, sur lesquelles il est difficile d’agir médicale-ment, et qui se situent hors du cœur de compétence de la médecine. C’est dire si la sociolo-gie demeure soumise à cette dernière, et n’ose contester les savoirs médicaux que dans les domaines où elle reconnaît elle-même leur faiblesse.
Des objets différents
Ces deux démarches concernent en définitive des aspects différents de la maladie, constituant autant d’objets singuliers. Leur distinction a été proposée par EISENBERG [1977] et popularisée par KLEINMAN [1988] ; ils sont aujourd’hui couramment désignés à l’aide des substantifs anglais illness et disease15.
Le premier renvoie à la maladie telle qu’elle est vécue par les malades et leur entou-rage. L’illness consiste en un trouble affectant une personne, enraciné dans ses perceptions somatiques, et dont les conséquences et les significations sont irréductiblement sociales, car leur étalon est la perturbation de sa vie quotidienne. Les recherches utilisant cette défini-tion, qui appartiennent donc à la tradition réaliste, se préoccupent essentiellement de la per-ception et de la gestion de la maladie. Dans les termes de Kleinman :
Illness refers to how the sick person and the members of the family or wider social network perceive, live with, and respond to symptoms and disability. Illness is the lived experience of monitoring bodily processes such as respiratory wheezes, abdominal cramps, stuffed sinuses, or painful joints. Illness involves the appraisal of those processes as expectable, serious, or re-quiring treatment. The illness experience includes categorizing and explaining, in common-sense ways accessible to all lay persons in the social group, the forms of distress caused by those pathophysiological processes. » [KLEINMAN, 1988, p.3-4]
Le terme disease renvoie à la maladie telle qu’elle est appréhendée par les médecins, et plus généralement par la communauté scientifique. La disease est conçue comme une sub-stance, transcendant la diversité de ses manières d’affecter les malades, qu’il s’agit précisé-ment de reconnaître derrière la diversité des plaintes et des signes cliniques présentés par ceux-ci – c’est-à-dire de diagnostiquer, autant pour la comprendre que pour la soigner. Les recherches utilisant cette définition s’inscrivent logiquement dans la tradition constructiviste. Elles s’intéressent à la production et à l’application de connaissances sur la maladie, dont Kleinman souligne les effets contrastés :
Disease is the problem from the practitioner’s perspective. In the narrow biological terms of the biomedical model, this means that disease is reconfigured only as an alteration in biologi-cal structure or functioning. When chest pain can be reduced to a treatable acute lobar pneu – monia, this biological reductionism is an enormous success. When chest pain is reduced to chronic coronary artery disease for which calcium blockers and nitroglycerine are prescribed, while the patient’s fear, the family’s frustration, the job conflict, the sexual impotence, and the financial crisis go undiagnosed and undressed, it is a failure. » [KLEINMAN, 1988, p.5-6]
Est-il possible d’analyser une maladie dans ces deux aspects à la fois ? Vraisembla-blement non, car l’étude de chacun implique un usage opposé des jugements médicaux qui la définissent : versant illness ces jugements constituent le point de départ du raisonnement, le critère permettant de circonscrire le champ de l’investigation ; versant disease ils consti-tuent son point d’arrivée, le phénomène dont il s’agit de rendre compte – ce qui signifie qu’analyser simultanément les aspects illness et disease d’une maladie impliquerait de dévelop-per un raisonnement circulaire16. Admettons plutôt l’impossibilité de les réunir. Considé-rons, avec Charles Rosenberg, que la maladie est un phénomène dont les frontières sont insaisissables, évoluant à l’intersection de trop d’univers sociaux, pour être embrassé d’un seul tenant :
“Disease” is an elusive entity. It is not simply a less than optimum physiological state. The reality is obviously a good deal more complex; disease is at once a biological event, a genera – tion-specific repertoire of verbal constructs reflecting medicine’s intellectual an institutional his-tory, an occasion of and potential legitimation for public policy, an aspect of social role and individual―intrapsychic―identity, a sanction for cultural values, and a structuring element in doctor and patient interactions. » [ROSENBERG, 1992, p.xiii]
État de l’art : les approches sociologiques des HSE
Nous devrons choisir l’approche que nous utiliserons pour étudier les épidémies d’HSE à l’exclusion définitive de l’autre. Tâchons alors d’identifier la plus adaptée à notre projet de sociologie cognitive, en nous tournant d’abord vers les travaux consacrés aux HSE en sciences sociales.
Cet usage antinomique du diagnostic avait déjà été repéré par STRAUS [1957], qui l’avait placé au fonde-ment de sa distinction classique entre la « sociology in health » (qui se repère à l’aide des théories consen-suelles dans les sciences médicales) et la « sociology of health » (qui prend la science médicale pour objet). Il faudrait donc faire une sociologie qui soit à la fois « dans » et « de » la maladie.
Recherches consacrées à la MCS
Dans le monde anglo-saxon, la MCS a suscité un intérêt certain de la part des sciences sociales. La première chercheuse à s’y être intéressée est la psychologue Pamela Gibson, qui lui a consacré une quinzaine d’articles depuis 1996. Le premier s’appuie sur une enquête réalisée au milieu des années 1990 auprès de 268 personnes considérant souffrir de maladie environnementale », de « blessure chimique » ou de MCS, recrutées au sein de plusieurs réseaux associatifs et interrogées à l’aide d’un questionnaire administré en deux vagues [GIBSON et al., 1996]. Gibson souligne qu’il est impossible de déterminer de quelle popula-tion cet échantillon est représentatif, en l’absence de définition consensuelle des troubles considérés. Elle décrit point par point leurs répercussions sur la vie quotidienne de leurs victimes, évoquant une dégradation de leur situation professionnelle et financière, des com-plications de leurs relations personnelles, des difficultés pour accéder aux soins médicaux, ainsi qu’à l’espace et au services publics, dont la conjonction suscite une détresse psycholo-gique significative. L’approche de Gibson est donc réaliste, comme le confirme l’examen de ses articles ultérieurs où elle examine de plus près certaines de ces répercussions. Elle y développe épisodiquement un raisonnement constructiviste, dont l’orientation critique est patente : il procède d’une dénonciation de la faiblesse de la reconnaissance sociale de la MCS. Partant du constat que les personnes chimico-sensibles sont en majorité de sexe féminin, Gibson les présente comme les victimes contemporaines d’une médecine qui mal-traite traditionnellement les femmes – au sens propre comme au figuré, leur non-représen-tation dans les études de toxicité actuelles devenant par exemple équivalente aux ovariecto-mies pratiquées à la fin du XIXe siècle sur les hystériques [GIBSON, 1997].
Aux États-Unis, Steve Kroll-Smith et Hugh Floyd analysent les quelque 150 réponses qu’ils ont reçues après avoir sollicité des témoignages écrits de personnes MCS par l’intermédiaire d’un réseau associatif. Ils s’intéressent particulièrement à la structure de leurs récits de maladie17 et à la fonction cognitive qu’exercent ceux-ci, interprétant la MCS comme « a practical epistemology―a strategy for knowing the world that works to reduce or make man – ageable a human trouble » [KROLL-SMITH & FLOYD, 1997, p.11]. Ils travaillent cependant peu cette notion d’« épistémologie pratique » (empruntée à Clifford Geertz) : ils ne précisent pas ce qui l’a rendue nécessaire, comment elle s’est imposée, etc. Ils décrivent davantage ses effets, et montrent qu’elle sous-tend une réorganisation profonde de l’existence quotidienne des personnes MCS, en particulier au travers des stratégies inégalement efficaces qu’elles développent pour adapter leur environnement (à défaut de pouvoir s’y adapter). Ils présentent enfin ses conséquences économiques et politiques, qu’ils estiment considérables, au motif que la MCS conteste la distinction communément admise entre environnements sains et malsains, ainsi que le monopole de la médecine sur la définition des états pathologiques. Ils accordent une grande attention aux corps des personnes chimico-sensibles18 : considérant qu’eux ne sauraient s’abuser ni mentir, ils présentent les réactions décrites par celles-ci comme une preuve irréfutable de la nature environnementale de la MCS. Ils dénoncent alors les résistances que suscite sa reconnaissance, sans analyser la controverse scientifique qui l’entoure19. Ils ont initié un courant de recherche qui se poursuit aujourd’hui au sein du Contested Illnesses Research Group de la Brown University [BROWN, 2007 ; BROWN et al., 2011].
LIPSON [2004] et LIPSON & DOIRON [2006] rapportent les résultats d’une enquête eth-nographique conduite auprès de personnes MCS habitant la côte Ouest des États-Unis (36 entretiens et des observations au sein de plusieurs groupes de soutien). Elles analysent le retentissement de leur hypersensibilité sur leur vie quotidienne, insistant sur l’incompréhen-sion que l’invisibilité de leurs symptômes suscite chez leurs proches, et le scepticisme que sa nature controversée provoque parmi les médecins qu’elles consultent. Elles ne précisent cependant pas comment ces personnes sont parvenues à se reconnaître hypersensibles. De surcroît, elles prennent explicitement partie dans la controverse scientifique entourant la MCS20. DOIRON [2007] a par la suite consacré une courte thèse aux personnes chimico-sen-sibles. Elle s’appuie sur 16 entretiens réalisés dans la région de Toronto, qu’elle analyse dans une perspective « éco-féministe » pour mettre en évidence les multiples « pertes » [« losses »] dont souffrent ces personnes – avec les mêmes limites que précédemment.
Table des matières
INTRODUCTION
1. Un projet de sociologie cognitive
2. Un objet : les hypersensibilités environnementales
3. Méthode : deux traditions dans l’étude sociologique des maladies
4. État de l’art : les approches sociologiques des HSE
PREMIÈRE PARTIE. OÙ RÉSIDE LE SOCIAL ? LES HYPERSENSIBILITÉS ENVIRONNEMENTALES COMME OBJET D’INVESTIGATION SOCIOLOGIQUE
CHAPITRE 1. L’introuvable définition médicale des HSE
1. Démarches
2. Les HSE : d’insaisissables définitions médicales
3. Les troubles somatoformes : une définition médicale alternative des HSE ?
Conclusion
CHAPITRE 2. Disputes autour des HSE
1. Démarche
2. La MCS : la réussite mitigée de l’importation d’un diagnostic
3. L’EHS : une apparition épisodique dans une controverse plus large
Conclusion
CHAPITRE 3. L’enquête
1. Préparation
2. Recueil des matériaux
3. Analyse
Conclusion
DEUXIÈME PARTIE. L’EXPÉRIENCE DES PERSONNES HYPERSENSIBLES : UN REGARD ETHNOGRAPHIQUE
CHAPITRE 4. Être hypersensible
1. Sociologie de l’expérience de la maladie et des HSE
2. Quatre portraits de personnes hypersensibles
Conclusion
CHAPITRE 5. Devenir hypersensible
1. Le processus d’attribution dans la littérature scientifique
2. Devenir EHS
3. Devenir MCS
Conclusion
CHAPITRE 6. Vivre en hypersensible
1. Les pratiques des personnes hypersensibles
2. Les situations
3. Les trajectoires
Conclusion
TROISIÈME PARTIE. COMPRENDRE L’APPARITION ET LE MAINTIEN DE LA CONVICTION D’ÊTRE HYPERSENSIBLE
CHAPITRE 7. Un modèle utilitariste
1. Avantages liés à la conviction d’être hypersensible
2. Coûts induits par la conviction d’être hypersensible
3. Analyse du fonctionnement de la balance coûts-avantages
Conclusion
CHAPITRE 8. Des effets de disposition ?
1. Perceptions corporelles
2. Attributions
3. Conduites de maladie
4. Interactions avec les médecins
5. Synthèse : genre et symptômes somatiques
Conclusion
CHAPITRE 9. Éléments pour une analyse socio-cognitive
1. Vers une épistémologie profane
2. Émotions et cognition
3. De l’utilitarisme cognitif à l’adhésion distanciée
Conclusion
CONCLUSION
1. De la contagion mentale au marché cognitif
2. Un regard socio-historique sur les épidémies d’HSE
Épilogue
RÉFÉRENCES
Bibliographie
Webographie
ANNEXES
A. Littérature généraliste sur les HSE et la pollution électromagnétique
B. Illustrations