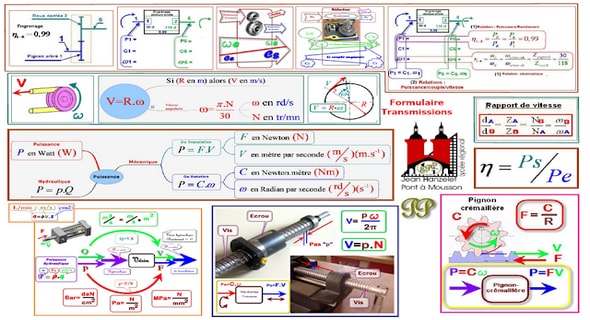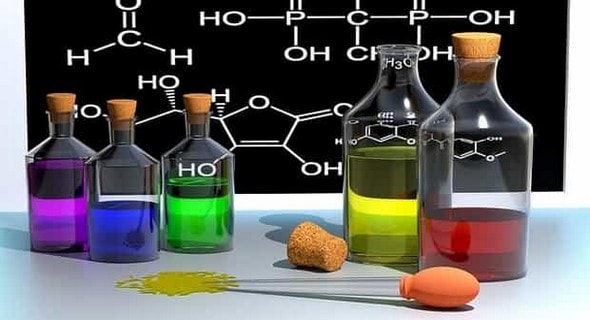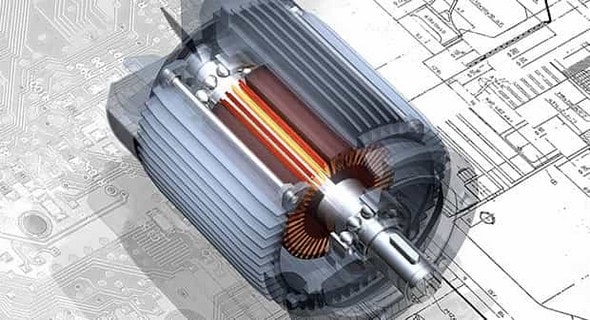Aborder le poids de l’héritage : histoire du service militaire
Le service s’inscrit dans l’imaginaire collectif dans la durée depuis Valmy même s’il est surtout présent au XXe siècle, créant un attachement fort à ce rite républicain et le rendant difficilement supprimable.
Ce chapitre a pour vocation de mettre en évidence l’attachement des français au service militaire, marquant le passage à l’âge d’adulte et le départ du domicile familial. Celui-ci s’appuie sur des mythes fondateurs allant de la bataille de Valmy en 1792 au putsch en Algérie d’avril 1961, stoppé par les appelés, en passant par Verdun. Même si la réalité historique de ces évènements est à nuancer, le service militaire, à travers ces batailles, s’est ancré positivement dans l’imaginaire collectif de la République.
Comme évoqué, trois types de ruptures ont cependant eu lieu au début des années 1990 et elles ont eu une forte incidence sur le service militaire :
Au niveau international, avec l’effondrement du Pacte de Varsovie qui a supprimé la crainte d’un débouché de chars soviétiques sur la trouée de Fulda et l’hypothèse d’une guerre massive, destructrice, nécessitant de nombreux engagés. Les armées françaises ont dû se réorganiser au niveau humain et matériel. La guerre du Golfe en 1991, avec la demande de non-engagement d’appelés prise par le président François Mitterrand avec le général Schmitt comme CEMA, a interrogé quant à l’utilité des appelés en contexte post-guerre froide.
Au niveau national, avec la mise en œuvre de la loi Joxe et de son corollaire, le service national à 10 mois qui vise à sauvegarder la conscription dans une armée mixte, devient un défi pour la logique opérationnelle. Les unités étaient supposées travailler sur un cycle opérationnel de 10 mois, appelé disponibilité opérationnelle différenciée (DOD), avec une mise en sommeil des compagnies 2 mois par an avec toutefois une possibilité de rappel des appelés. Les unités se retrouvent déstructurées et la logique opérationnelle en pâtit.
Au niveau démographique enfin, l’arrivée de classes d’âges nombreuses rend le service plus inégalitaire suite à l’effet ciseau de la diminution des places d’appelés et de l’accroissement des candidats.
Un ancrage historique dans le mythe
En France, tout citoyen doit être soldat, tout soldat doit être citoyen. Le service militaire obligatoire a été l’expression la plus haute de la citoyenneté, le pilier du modèle républicain et a été perçu comme une exception française. Pour toutes ces raisons, il a été mythifié et ont été oubliées sa lente genèse et les difficultés de la transformation de la conscription universelle – l’obligation de se faire inscrire – en service militaire universel et l’obligation de servir en personne dans les rangs de l’armée française. Ont été oubliées aussi les résistances auxquelles se heurta la conscription et les réticences envers le service militaire qui ressurgirent avec force partir des années soixante du XXe siècle. Celles-ci expliquent d’ailleurs le consensus au sein de l’opinion publique au sujet de la loi de 1997 qui en théorie suspendait, mais en réalité supprimait le service militaire.
Les citoyens et plus spécifiquement les militaires, ont été marqués par l’imaginaire du service national et ont eu l’impression de défendre une partie de l’histoire de la France.
Après un service national présent tout au long du 20e siècle, il serait possible de penser que la conscription a toujours fait partie du paysage français. Or ce point ne va pas de soi : elle a duré 2 ans au 18e siècle, 96 ans au 19e, en continu au 20e siècle et 2 ans au 21e. Les Français sont restés dès lors sur la dernière impression sans se questionner. Cette partie vise à déconstruire cette fausse impression.
Nous passerons assez rapidement sur l’aspect historique du service qui a connu de nombreuses évolutions depuis la loi Dubois Crancé même si ce rappel demeure essentiel pour comprendre les débats contemporains sur la conscription.
En termes de définition, la conscription a comme vocation la levée des troupes destinées aux guerres. Celle-ci se caractérise comme un système de recrutement militaire fondé sur l’appel annuel du contingent10. La conscription ou service militaire obligatoire est dès lors la réquisition par un État d’une partie de sa population afin de servir ses forces armées. Elle se distingue en cela d’un enrôlement volontaire et est fondée sur l’appel annuel du contingent.
Bref rappel historique
Durant l’Antiquité11, une prémisse de conscription est présente dans de nombreuses cités helléniques. Elle est cependant dépourvue d’un caractère de masse et elle est limitée à la classe des citoyens qui ne formait qu’un dixième de la population tout comme le système en vigueur à Préface d’Annie Crépin, le service national, deux siècles d’histoire française, de la conscription au Rome où seuls les patriciens avaient le droit de participer. Par la suite, tous les citoyens romains purent participer à l’effort militaire.
L’armée ne devint permanente que sous Auguste et même si tout Romain avait l’obligation théorique d’en faire partie, elle était principalement constituée de volontaires issus des campagnes. La conscription romaine, inspirée de cet idéal égalitaire ancestral a, dès lors, inspiré les dirigeants dans la mise en œuvre de la conscription moderne.
La thématique et la finalité guerrière accompagneront toujours la construction du service que cela soit dans les succès fondateurs comme la bataille de Valmy en 1792 ou dans ses difficiles lendemains comme la guerre d’Algérie, marqueur d’une génération ne comprenant pas le sens de leur engagement et le positionnement des appelés durant le putsch.
La notion essentielle de Dubois-Crancé
Dans le détail, la notion de conscription prend forme en 1789 avec le député Dubois-Crancé. J’établis pour axiome qu’en France tout citoyen doit être soldat et tout soldat citoyen, ou nous n’aurons jamais de constitution. » Ce discours de Dubois-Crancé le 12 décembre 1789 à l’Assemblée inspire de ce qui deviendra le service militaire. L’ancien officier de l’armée royale se montre intransigeant envers les troupes de métier : « l’homme sans aveu, dont la paresse a fait la vocation, souvent s’est fait soldat pour éviter les punitions civiles, enfin a vendu sa liberté ». Son projet ne vise toutefois pas une conscription générale. Il est certes favorable au service personnel, mais n’est pas partisan « d’arracher aux travaux de l’agriculture et du commerce, ni aux autres fonctions utiles que ce vaste empire offre à l’industrie, des bras essentiels. »
Il propose trois types de forces :
Un front de 150 000 hommes de « troupes réglées, destinées à couvrir nos frontières et à se porter partout où l’exige la défense » composées de volontaires assemblés trois mois l’an pour des exercices ;
En deuxième ligne, 150 000 membres de « milices provinciales, destinées à doubler l’armée d’active » entrainées un jour par semaine ;
En troisième ligne, 1 200 000 citoyens mobilisables « tout homme en état de porter les armes, ayant droit d’électeur (…) inscrit au rôle de sa municipalité. »
Cette première inspiration de la notion de conscription formulée par Dubois-Crancé est cependant rejetée par l’Assemblée constituante, car attentatoire à la liberté. Le volontariat est privilégié pour lever des troupes. Les 52 000 hommes français participant à la bataille de Valmy le 20 septembre 1792 contre les troupes austro-prussiennes sont ainsi principalement des soldats de métier accompagnés de volontaires levés en hâte et mal équipés. Cet épisode restera cependant dans l’imaginaire comme un des mythes des soldats du peuple luttant et gagnant pour la liberté de la patrie. La Convention établira la levée de masse en 1793, mais il s’agira d’obligation temporaire avec des effectifs importants puisque l’enrôlement de février 1793 portait sur environ 300 000 hommes.
Napoléon ou l’utilisation massive de la conscription
La loi Jourdan de 1798 va réellement induire ce qui est la base de tout système de conscription avec la mise en place du recensement et l’inscription sur un registre de tous les citoyens susceptibles d’être mobilisés par la loi. Mais il ne s’agit pas d’un service national, la finalité étant de bénéficier d’un réservoir de troupes pour les levées de masse des armées impériales.
La France ne connaît que deux années de paix de 1799 à 1815 et Napoléon va se servir massivement de la loi Jourdan : ainsi de 1800 à 1814, face aux différentes coalitions, Napoléon appelle sous les drapeaux plus de 2 millions de conscrits pour une population de 29 à 30 millions de Français. Sous l’Empire, le recrutement dans l’armée repose sur la conscription, c’est-à-dire le service militaire obligatoire pour les hommes de 20 à 25 ans. La bataille d’Eylau, le 8 février 1807, comportera ainsi une majorité de conscrits sur les 65 000 Français combattants. Elle se déroule de la façon suivante :
La répartition du contingent, arrêtée par sénatus-consulte, est fixée pour chaque département puis par arrondissement et par canton. Le maire de chaque commune dresse une liste générale des conscrits et l’envoie à la sous-préfecture.
Un tirage au sort est alors réalisé au chef-lieu du canton, une proportion variable d’hommes étant effectivement appelée sous les drapeaux.
Enfin, le conseil de recrutement, qui se tient en public, se prononce sur les cas de réforme et sur les dispenses. Il est également possible d’échapper à la conscription en payant un remplaçant. Après les pertes subies pendant la campagne de Russie de 1812, Napoléon reconstitue une Grande Armée pour la campagne d’Allemagne en 1813 et la campagne de France en 1814. Les classes d’âge de conscrits de 1814 et 1815 sont appelées en avance, notamment par un décret de septembre 1813 signée par l’épouse de Napoléon, l’impératrice Marie-Louise, alors régente.
Ces 120 000 jeunes conscrits inexpérimentés sont appelés les « Marie-Louise ». Ce système perdurera jusqu’en 1814.
Pendant les Cent-Jours, Napoléon ne lève pas de classes de conscrits, mais fait uniquement appel aux anciens de la Grande Armée.
Un service toujours inégalitaire
Les systèmes successifs avec les lois Gouvion Saint-Cyr du 18 mars 1818 et Soult du 21 mars 1832, mêleront volontariat et incorporation d’office par tirage au sort avec une possibilité d’exonération en échange d’une prime versée. Il ne s’agit toutefois pas de service obligatoire et universel. En effet, à l’issue de l’abolition de la conscription par la Restauration, la loi Gouvion Saint-Cyr le rétablit sous le terme « d’appel obligé ». Est alors appelé sous les drapeaux, pour six ans, un contingent annuel de 40 000 Français qui tirent un « mauvais numéro ». L’appelé peut se faire remplacer par un tiers s’il le rémunère. Un système inégalitaire se met alors en place et une professionnalisation des remplaçants avec la création d’agences de remplacement. L’esprit du citoyen-soldat s’étiole dès lors. Pour pallier le manque d’engagement dans l’armée, la loi Soult établit quant à elle un service de sept ans, tout en maintenant le système de remplacement. Concernant le cas particulier des marins, l’inscription maritime, plus égalitaire puisqu’elle ne prévoit pas de remplacement, est maintenue selon les principes déterminés par la loi de 1795. En 1835, la monarchie de juillet restreint cependant le service dans la Marine royale aux hommes âgés de 20 à 40 ans, sans renoncer à la mobilisation de tous les gens de mer de moins de 50 ans en cas de guerre.
En 1855, le remplacement laisse place à un système d’exonération avec l’impôt physique qui est remplacé par une taxe qui alimente une caisse publique, destinée à financer le prolongement de service d’anciens militaires. Ce système, qui favorise le vieillissement des effectifs, aboutit un déficit de conscrits de près de 20 000 hommes pour la seule année 1859. La loi Niel du 1er février 1868 autorise quant à elle de nouveau le remplacement et fixe la durée du service à cinq ans pour une moitié du contingent et à six mois pour l’autre. Elle instaure aussi la création d’une garde nationale mobile, constituée de tous les hommes échappant au service dans l’armée d’active, sans possibilité de remplacement.
Napoléon III essaie sans succès, à la fin de son règne, d’imposer le système prussien fondé sur le service universel et sur des réserves opérationnelles.
La défaite de 1870 contre les armées prussiennes, où les Français furent vaincus par le nombre de leurs adversaires et plus particulièrement à Sedan le 1er septembre 1870, entraîna une forte réflexion sur le besoin de disposer en permanence d’effectifs militaires nombreux, entraînés et pouvant être rappelés si besoin. Le principe du service militaire universel et obligatoire est ainsi institué par la loi du 27 juillet 1872. Les services de réserve sont créés et s’effectuent après le service militaire. Le temps de service dans la réserve d’active est de quatre ans. Le conscrit est ensuite affecté en armée territoriale d’active pour cinq ans et pour six ans dans l’armée territoriale de réserve. Le remplacement est supprimé.
La loi Freycinet du 15 juillet 1889 voit la durée du service militaire passer de cinq ans à trois ans pour ceux tirant le mauvais numéro et la suppression des dispenses au profit de temps de service adaptés pour certaines catégories comme les enseignants, les élèves des grandes écoles ou les séminaristes.
La loi Berteaux, fondatrice de l’universalité du service
La loi Berteaux du 21 mars 1905 est la loi considérée comme fondatrice du service militaire. Elle supprime le tirage au sort et toutes les exemptions. Tous les hommes français sont appelés sous les drapeaux pour deux ans. Le service national devient dès lors personnel, obligatoire et universel. Le sursis est cependant possible pour un conscrit.
La loi Barthou de 1913, face à la menace que représente l’Allemagne, fixe de nouvelles obligations pour l’armée française : la durée du service passe de deux à trois ans, suivie d’une part de onze années dans la réserve d’unité d’active, et d’autre part de quatorze années dans les unités dites de territoriale (unités affectées uniquement à la défense d’un territoire).
Le service s’affirme sous la IIIe République et les suivantes en développant le principe républicain d’égalité avec peu d’exceptions à ce principe, ce qui constituera sa force. Cette obligation de servir s’applique à toutes les classes sociales, riches ou pauvres. Le service militaire comporte également une part sociale avec la correction d’inégalité comme l’accès aux soins lors des visites médicales et des soins apportés lors des épreuves de sélection et de formation initiale.
Cette conscription vise également à fédérer une nation ce qui l’inscrira fortement dans l’imaginaire collectif.
Comme le présente Annie Crépin dans son ouvrage12, le service militaire a permis de fédérer une nation alors régionalisée « Mais dans certains départements qui appartiennent à la France depuis plus longtemps que ceux de la Lorraine voire de l’Alsace, le processus ne s’enclenche pas encore sous la Restauration, les populations apparaissent comme « étrangères » à l’institution. »
Elle précise ce point dans un autre ouvrage13 « L’enracinement de l’institution est un processus long. Il commence sous le Directoire (mais les réactions devant les levées d’hommes de la Révolution en sont la préfiguration), et il s’achève sous la troisième République. C’est aussi un processus complexe même s’il ne connaît pas de retour en arrière. Il révèle la diversité et la pluralité de la France et des Français face à cet instrument de centralisation. L’unité nationale et la volonté de l’instaurer en sont tout à la fois l’origine et la conséquence. »
Le dispositif ne sera jamais figé au travers, notamment, de la durée des obligations militaires. Son principe n’étant jamais remis en cause de 1905 à 1995, l’évolution de sa durée servira de variable d’ajustement. La durée sera de 5 ans en 1872 puis diminuée à 2 ans en 1905 pour s’établir aux alentours des 18 mois à la veille de la guerre d’Algérie en 1950. Le principe du service étant d’avoir des hommes rappelables en cas de conflit majeur, des périodes de réserve sont obligatoires à l’issue avec des hommes rapidement mobilisables en cas de conflit. Ces réserves induiront un lien fort entre l’appelé et l’armée puisqu’il pourra être rappelé pendant 15 ans une fois son service effectué en 1872 voire 26 ans après son service en 1950.
Concernant l’attitude des décideurs militaires et comme l’a confirmé Annie Crépin14, les officiers d’active des III et IVe République souhaitaient plutôt une armée de métier, un entre-soi des affaires militaires avec une finalité combattante.
En filigrane, le service militaire reste le marqueur de générations pour le passage à l’âge adulte avec une forte culture populaire autour de cet évènement. Jaurès reprenait la phrase d’un député radical et affirmait ainsi : « Monsieur Bersot disait : en France, on fait sa première communion pour en finir avec la religion, on prend son baccalauréat pour en finir avec les études et on se marie pour en finir avec l’amour. Il aurait pu ajouter : et on fait son service pour en finir avec le devoir militaire. »15
Des conscrits indispensables, un service qui s’inscrit dans l’imaginaire collectif au XXe siècle
Le service militaire s’est inscrit dans la durée puisqu’il est réalisé lors de quatre siècles différents (18e, 19e, 20e et 21e siècle) de 1798 à 2002, mais a été plus spécialement présent au vingtième siècle, ce qui a pu faire croire, lors de sa suspension en 1996, qu’il faisait partie de l’héritage français. Au niveau global et comme le synthétise l’annexe 3, le service militaire est peu présent et s’inscrit dans le paysage historique français au 20e siècle. Il est ainsi réalisé 2 ans au 18e siècle, 96 ans au 19e, en continu au 20e et 2 ans au 21e.
Au 18e siècle, il est effectué 2 ans sous des formes non universelles puisqu’il s’effectuait par tirage au sort avec des remplacements possibles par la loi Jourdan, promulguée en 1798.
Au 19e siècle, il dure 96 ans, aboli seulement par l’article 12 de la Restauration de 1814 à 1818. Il est non universel avec le principe d’un tirage au sort lié au besoin qui sera maintenu par les lois successives : loi Gouvion Saint-Cyr, loi Niel ou loi Cissey.
Au 20e siècle, le service national ne sera jamais aboli ni suspendu. Les guerres de masse nécessitent l’emploi de contingents nombreux en hommes. L’évolution se fait davantage sur la durée ou sur les formes de service avec notamment la loi Messmer qui fait passer le service de militaire à national avec la création d’un service de défense, d’un service de coopération ou d’aide technique.
Le rôle des deux guerres mondiales
Les deux guerres mondiales participeront à inscrire le service dans l’imaginaire. Jean Jaurès le conceptualisera en 1910 dans l’ouvrage L’armée nouvelle (cité supra) « en France tout citoyen doit être soldat, tout soldat doit être citoyen » reprenant les mots du député Dubois-Crancé de 1790.
Ce concept prend toute sa réalité à l’été 1914, lorsque la France déclenche pour la première fois la mobilisation générale :
Le 1er août, la mobilisation générale est décrétée ;
Le 2 août, l’ordre de mobilisation est rendu public.
l’été 1914, 3 780 000 hommes sont mobilisés. Près de 8 410 000 soldats et marins français le seront pendant la Première Guerre mondiale dont 7 % originaires de l’empire colonial français. Un lien charnel se crée entre la nation et les conscrits à cette occasion.
L’entre-deux-guerres est marqué quant à lui par quatre lois qui correspondent au réarmement allemand et à la montée du nazisme :
La loi du 1er avril 1923 : service de dix-huit mois puis deux ans et demi de réserve et vingt- quatre ans de territoriale ;
La loi du 31 mars 1928 : service de douze mois, puis trois ans et un quart de réserve et vingt-cinq ans de territoriale. L’armée de métier est, en outre, renforcée de 100 000 hommes ;
La loi du 13 décembre 1932 : service de deux ans, puis trois de disponibilité, suivi de deux périodes de réserve pour les inscrits maritimes ;
La loi du 17 mars 1935 : deux ans de service, puis trois ans et un quart de réserve et vingt-quatre ans de territoriale.
La Seconde Guerre mondiale est synonyme de deuxième mobilisation générale le 2 septembre 1939, au lendemain de l’invasion de la Pologne par l’armée allemande. Cinq millions d’hommes sont mobilisés, mais seulement la moitié sert dans les unités combattantes : 700 000 sont affectés dans l’industrie, 250 000 dans l’agriculture, 650 000 aux services d’intendance et d’administration et 150 000 à des postes divers. Après la défaite française, les effectifs théoriques de l’armée d’armistice sont ramenés à 100 000 hommes et le système de conscription est abandonné par le régime de Vichy.