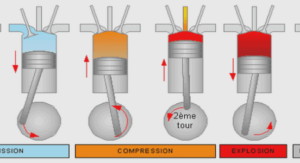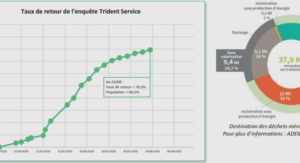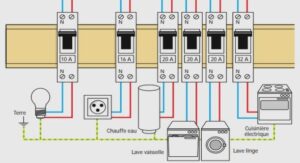AU CROISEMENT DE LA DIMENSION SPATIALE ET DE L’INCERTITUDE : UNE DEMARCHE EXPERIMENTALE ET EXPLORATOIRE
Rester ouvert à l’émergence : l’Exploratory Spatial Data Analysis (ESDA)
On peut, à partir des considérations précédentes, affirmer qu’ « il ne s’agit plus simplement de représenter le monde mais également de mieux faire émerger des phénomènes non directement visibles ou mal perçus et de mieux réfléchir aux structures spatiales qui s’y organisent » (Antoni et al., 2004). La démarche exploratoire qui est au cœur de la géoprospective constitue selon nous une approche très appropriée aux questionnements archéologiques qui nous occupent, et peut constituer une réponse originale au fixisme des modèles, et au conditionnement des analyses par des hypothèses fortes et préconçues. Nous rejoignons en cela la philosophie de la Grounded Theory qui consiste à « rechercher des points de vue inédits par l’exploration de l’objet d’étude, sans postulat sous-tendant d’analyse ni idée préconçue mais en étant « à l’écoute» des données, dans une posture d’ouverture à l’émergence » (Strauss, Corbin, 1998 ; Glaser, 2012). Ainsi, l’analyste doit certes avoir un objectif lui permettant d’interpréter « les signes qui jalonnent son itinéraire », mais également être « ouvert à toute autre possibilité : obsédé par ce qu’il s’attend à trouver – et dont il ne peut avoir qu’une idée très vague, puisqu’il explore – il risque fort de passer à côté de merveilles qu’il n’attendait pas » (Banos, 2001). La démarche exploratoire renvoie ainsi à la « capacité du scientifique à se mettre en position d’étonnement, à se laisser guider par la recherche de l’inattendu et plus généralement à laisser libre cours à sa créativité » (Banos, 2013), et ainsi, selon Marcel Roncayolo, à « réussir » à ne pas savoir ce qu’il cherche ! » (Roncayolo, Chesneau, 2011). Cette démarche favorise l’esprit de l’expérimentation, que Daniel S. Milo (1992) définit comme le fait de « laisser une grande liberté à l’arbitraire du chercheur –et que les résultats tranchent. Un état d’esprit expérimental signifie qu’on « ne se laisse pas intimider » par la réalité étudiée, qu’on ne cherche pas à tout prix à motiver réalistiquement les questions qu’on lui pose ». Nous nous inscrivons ainsi dans la philosophie et les techniques de l’Exploratory Spatial Data Analysis (ESDA) (Anselin, 1994), définie par Luc Anselin (1999) comme : « the collection of techniques to describe and visualise spatial distributions, identify atypical locations (spatial outliers), discover patterns of spatial association (spatial clusters), and suggest different spatial regimes and other forms of spatial instability or spatial non-stationarity ». Dans le même article, l’auteur propose un large état de l’art concernant les applications de l’Exploratory Data Analysis (EDA) et de l’ESDA. Ce champ de recherche est particulièrement intéressant dans la manipulation de bases de données archéologiques en ce qu’il aide à prendre en compte et à modéliser la complexité, notamment si la réalité que l’on interroge est décrite par un grand nombre de données (Antoni et al., 2004). L’EDA et l’ESDA sont ainsi « une démarche, voire une philosophie, d’analyse des données qui utilise de nombreuses techniques (dont la plupart sont graphiques) de manière à maximiser la prise en compte de ces données, découvrir leur structure sous-jacente, extraire les variables importantes, mettre en lumière leurs anomalies, tester des hypothèses, etc. » (Antoni et al., 2004).
Tirer parti de la diversité, plutôt que niveler par le bas
Daniel S. Milo (1991) évoque une attitude classique vis-à-vis des données –dans son cas, temporelles-, consistant à leur imposer de « rentrer dans le moule », faute de quoi on les élimine purement et simplement des analyses : « Simple outil de travail, la période finit par nous être extrêmement précieuse- car elle produit de la cohérence. Trop. Ses usagers (…) sont constamment confrontés aux trop nombreuses données qui échappent à la cohérence de la tranche de temps par eux isolée. Pour la sauver, on utilise toute une gamme de techniques qui ont pour but soit d’intégrer ces brebis égarées coûte que coûte, soit carrément de les éliminer ». Faire parler les données permet à la fois de leur redonner tout leur sens et leur substance, et de s’intéresser à toutes leurs dimensions (notamment en termes de précision et de fiabilité) mais aussi de prendre toute la distance nécessaire vis-à-vis des structures qu’elles expriment et que l’on détecte, en étant attentif non seulement aux grandes structures, que l’on s’attendait (ou non) à trouver, mais également aux signaux faibles, aux structures et aux changements « inattendus, extraordinaires, voire contreintuitifs, au regard des valeurs des variables modélisées – accélération-ralentissement d’une dynamique – ou de la morphologie spatiale – apparitiondisparition d’une structure » (Voiron-Canicio, 2012). Cela suppose en amont de ne pas tenter de lisser ou d’homogénéiser à outrance les données, mais d’intégrer toute leur diversité dans les analyses. Cet état d’esprit peut se rapprocher de ce qu’Edgar Morin (1986) et Claude Lévi-Strauss (1962) appellent le « bricolage » et dont ils soulignent l’importance, consistant, selon ce dernier, à « élaborer des ensembles structurés, non pas directement avec d’autres ensembles structurés, mais en utilisant des résidus et des débris d’événements […], témoins fossiles de l’histoire d’un individu ou d’une société ». Cette attitude implique également de conserver toute la donnée disponible, et de s’affranchir de la logique binaire d’une conservation de la donnée estimée comme « fiable », et de l’élimination de la donnée « non fiable », que l’on estime contre-productive : en plus de nous faire perdre de la donnée, celle-ci pourrait pousser l’analyste à surestimer la qualité et la certitude de ses données considérées comme fiables, et à se penser à l’abri d’une estimation de l’incertitude de ses analyses. Nous pensons qu’attribuer des poids différents à ses données reflétant la qualité de celles-ci, et les intégrer directement dans les analyses et les modèles, serait une option bien plus pertinente et porteuse.
« Déconstruire les représentations que véhiculent les catégories » (Roncayolo, Chesneau, 2011) pour une étude du changement spatial.
Nous avons vu dans le premier chapitre qu’une source majeure d’incertitude mais aussi de conditionnement des études en archéologie résidait dans la manipulation des échelles spatiotemporelles. Dans le cadre d’une analyse exploratoire, il convient de préciser que le choix des échelles n’est pas anodin : il « suppose l’existence d’un point de vue, d’une intention et d’autre part, d’un référent. (…) Il est donc par définition, hypothèse » (Roncayolo, Chesneau, 2011). En outre, le même auteur suggère une distinction entre échelles d’analyse et niveaux d’organisation du territoire, des « rigidités qui relèvent en partie du droit », qui « figent plus ou moins la réalité », et sont une « construction acquise, d’origine sociale et historique » (Roncayolo, Chesneau, 2011). Cette discussion sur les échelles spatiales rejoint en quelque sorte celle sur la périodisation en histoire et en archéologie (cf. chapitre 1). Bien que les structures spatiales des sociétés étudiées ne relèvent Chapitre 2 : « Faire science avec l’incertitude » : pour une démarche flexible et exploratoire s’inspirant du cadre théorique et méthodologique de la géoprospective. 54 pas des niveaux d’organisation administratifs tels qu’on les expérimente aujourd’hui, il convient de garder à l’esprit que l’expérience de terrain menée par les missions archéologiques ayant recueilli les données, en dépend quant à elle fortement. Ainsi, celles-ci peuvent agir comme un paramètre explicatif de la répartition des données, et donc des structures spatio-temporelles détectées. Ainsi, Marcel Roncayolo nous avertit : « Si vous vous cantonnez dans des échelles habituelles ou des niveaux définis institutionnellement, vous risquez de prédéterminer votre étude, de passer à côté de véritables problèmes » (Roncayolo, Chesneau, 2011). Celui-ci préconise, par le zoom et la perspective, qui favorisent la découverte de par leur nature heuristique, de « circuler entre les échelles et pouvoir choisir, tout bien considéré, non pas les représentations habituées, mais celles qui permettent de répondre à la thématique ou même de la corriger ou de l’inspirer » (Roncayolo, Chesneau, 2011). Ce serait donc en déconstruisant les échelles et les catégories habituelles, que l’on construit l’objet d’étude. Car les catégories auxquelles nous sommes confrontés ne relèvent pas que d’une analyse à un temps t (ou à une succession de temps t). Il s’agit de comprendre la musicalité, c’est-à-dire les rythmes, les « tempos », des systèmes spatio-temporels : « À ces rythmes intégrés aux phénomènes ou aux usages sont associées des périodicités variées, entrecoupées de rupture, que l’on ne peut observer toutes à la même échelle. Autrement dit, la complexité (…) dérive de temporalités fort différentes, le rythme fait partie des choses, il n’est pas un découpage historique que l’on impose : il faut bien se résoudre à abandonner dans la chronologie – un simulacre de cohérence –, qui octroie le même rythme à toute chose». Ainsi, « Il convient plutôt d’étudier les phénomènes, sur le plan temporel, à des échelles correspondant à leur nature. Simultanéité et synchronie ne vont pas nécessairement de pair » (Roncayolo, Chesneau, 2011).