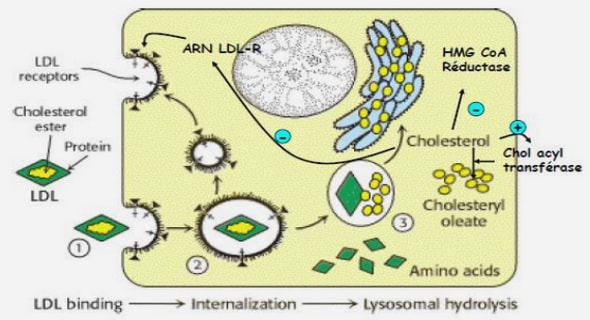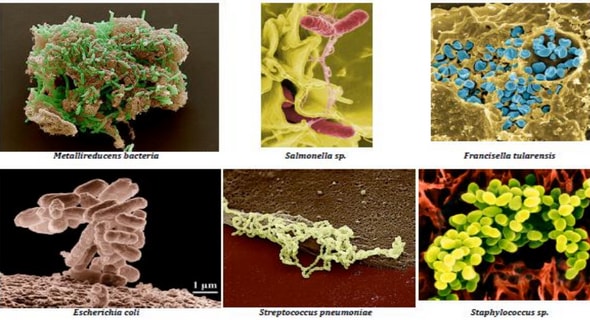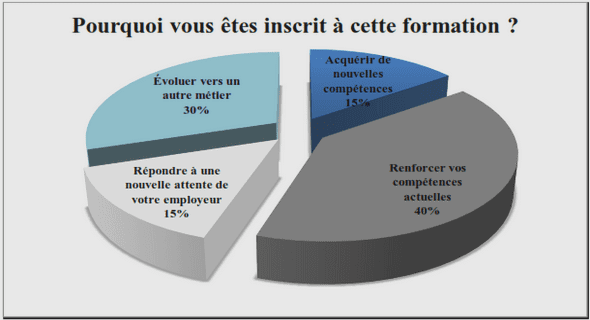L’article « La Burrinha africaine made in Brazil »
Il sera question ensuite de l’article « La Burrinha africaine made in Brazil » publié originalement en 1971. Si, d’une part, regarder les Brésiliens et plus spécifiquement la bourian comme un objet qui touche à la fois l’ensemble francophone Dahomey-Togo et le Nigeria anglophone peut éclairer certains de ces aspects communs – surtout en ce qui concerne le passé plus lointain – d’autre part, une telle démarche risque de brouiller certaines pistes de compréhension. Nous l’avons vu avec « la combativité » lors des défilés Agudàs, qui semble n’être applicable qu’au Nigeria et pas à l’ensemble des trois pays comme les mots de Bastide pourraient le laisser comprendre.
Dans le texte de 1971, Bastide mentionne des « « Brésiliens » qui habitent des quartiers périphériques [qui] pensent même que la coutume [de la bourian] a disparu ; ils se sont noyés dans la race noire ». Bastide prévient que cette information vient de l’ouvrage d’Olinto (1964), ancien attaché culturel du Brésil à Lagos (Lira 2008 : 113107). Il me semble donc qu’il s’agit d’une remarque qui concerne surtout le Nigeria (même si Olinto a effectivement visité le Dahomey). Contrairement à cela, l’ensemble des Agudàs avec qui j’ai pu entrer en contact au Bénin étaient au courant de l’existence de la bourian, indépendamment du fait de participer ou non aux fêtes. Quant au Togo, je n’ai pas eu de données suffisantes pour l’affirmer ou l’infirmer108. Si l’on reprend le paragraphe complet, Bastide résume l’articulation entre l’identité de groupe des Brésiliens et la Bourian :
La maintenance de ce ballet populaire est due d’abord à la séparation du groupe de « Brésiliens » et des groupes des « Africains », comme si le Brésil s’était ici transformé en une nouvelle » ethnie » ou « lignage » endogame (à tel point que la fête ne peut avoir lieu que dans les villes ou les quartiers à forte densité de descendants de Brésiliens ; les « Brésiliens » qui habitent des quartiers périphériques pensent même que la coutume a disparu ; il se sont noyés dans la démarche d’un seul « entrepreneur ». Les « patrons » des deux bourians en question sont d’ailleurs des non-Agudàs.
Et pas ambassadeur du Brésil à Lagos, comme écrit Bastide dans ce texte.
D’abord parce qu’au Togo j’ai eu un échantillonnage plus réduit et aussi parce que j’ai eu des contacts essentiellement avec les noyaux des grandes familles, qui étaient pour la plupart conscients de l’existence des bourians au Bénin qui venaient de temps en temps jouer au Togo. Dans ce pays, j’ai eu relativement peu de contacts avec des « Brésiliens pauvres (issus de la couche populaire) », soit des descendants des branches des serviteurs « africains » attachés aux Brésiliens plus aisés. L’exception fut dans le village reculé d’Atouéta (là où « tous se revendiquent être des Brésiliens ») où la bourian prend une place centrale dans la communauté. Postérieurement, Guran (1999) arrivera à peu près à la même conclusion au sujet de ce que « le Brésil s’était ici transformé en une nouvelle ethnie110 ». On y reviendra, mais je peux avancer qu’effectivement dans certains aspects, « Brésilien » est utilisé de nos jours comme une ethnie, mais dans d’autres la dénomination est une catégorie toute particulière, car superposables aux « ethnies » courantes dans les pays. En tout cas, il s’agit d’une référence d’origine, d’ancestralité mais aussi d’un certain « attachement culturel ».
Treize ans après le premier texte sur la bourian, Bastide réaffirme subtilement son écart avec le regard de Verger sur les références au religieux présentes dans la manifestation. Dans une note au tout début du texte il définit :
Boi : le bœuf. Burrinha : l’ânesse. Les deux principaux personnages animaux de la Crèche de Noël. Nous ne savons pas à partir de quelle époque la Burrinha a existé sur la Côte des Esclaves, les plus anciens voyageurs ne nous en parlent pas. Le premier texte est celui de l’Abbé Pierre Bouche (…) 1883 (…)111 ».
Ensuite l’auteur résume l’état de l’art et sa problématique :
Ceux qui ont déjà décrit ou parlé de cette danse, comme P. Verger et Antonio Olinto (…) y on vu la continuation (…) d’une « danse dramatique » connue un peu partout au Brésil, mais surtout dans le Nord-Est, particulièrement dans la région de Pernambuco, le Bumba-meu-Boi.
Nous voudrions, dans cet article, reprendre le problème des origines probables de la Burrinha, en même temps que celui des rapports entre les danses animales du Brésil et le totémisme africain112(…) ».
Dans cette recherche, je ne reprends que partiellement l’intérêt pour les possibles origines de la bourian. Je me penche préférentiellement sur les circulations des éléments qui lui sont liés, car la question de la « recherche ultime des origines » me paraît quelque peu dépassée dans le champ anthropologique actuel. Plus dépassée encore me semble la question du totémisme, à laquelle ce travail ne s’intéresse pas.
En ce qui concerne la description des détails de la bourian, Bastide note que deux personnes se trouvent à l’intérieur de l’armure de l’animal. De mon côté, j’ai rencontré ce masque au Bénin et au Togo « habité » en deux versions : avec deux danseurs, comme chez les De Souza, mais aussi avec un seul danseur, comme par exemple à Porto-Novo et Atouéta113. Bastide ensuite transcrit, sans les traduire en français, dix extraits de textes de chansons de la bourian du « cahier de Quêtin », selon lui inédits par rapport à celles que Verger avait transcrites auparavant. Malheureusement, Bastide ne renseigne pas à quelle bourian ou famille ce Quêtin se rattache, ni même la ville concernée114. Au moins la moitié de ces chansons n’est plus chantée de nos jours. La plus intéressante, cependant, vient du onzième extrait (non traduit), la seule qu’il a reprise à un tiers115 et que je n’ai pas entendue sur le terrain. Je la reproduis ici, avec une traduction que je propose. Des chansons avec cette thématique du retour à la terre de naissance, nous fournissent des éléments pour croire qu’elles n’ont pas été « ramenées du Brésil », mais ont été écrites en Afrique, fruits d’une nostalgie du Brésil lointain. Sauf si elles ont été reprises de chansons faites par des Portugais « expatriés » au Brésil, chose qui me semble peu probable. Il faut aussi prendre en compte la possibilité qu’il pourrait s’agir de chansons où un Brésilien ayant émigré à l’intérieur du Brésil lui-même chante son foyer de naissance. Nous aurons ainsi deux catégories de texte de chansons bourian en portugais : celles ramenées du Brésil et celles écrites en Afrique.
En reprenant le texte de Bastide, l’auteur note que la bourian comporte le « défilé » et l’« ambassade », deux parties caractéristiques de plusieurs danses dramatiques du Brésil. Dans le défilé, le cortège va de maison en maison pour annoncer la fête et recevoir soit de l’argent, soit des boissons ou de quoi manger. L’ambassade qui suit « constitue la partie dramatique, qui se joue sur une place publique, en général devant l’église ». De nos jours, la plupart des représentations de la bourian se donnent sur une cour, soit, en se restreignant à l’« ambassade ». À Porto-Novo nonobstant, pendant la fête du Bonfim il y a le défilé festif en fin de l’après-midi de la veille (samedi), appelé simplement « le carnaval » par les acteurs. Le lendemain matin (dimanche), il y a la messe à l’église, mais l’« ambassade » – que j’appelle « bourian de cour » – se réalise l’après-midi sur la place devant l’Assemblée nationale, une place d’un style colonial français, républicain, où il n’y a pas d’église. Dans les commentaires sur les masques, on trouve la référence à Mami Watà (ou Mammy Watta selon la graphie du texte) que Bastide suggère être « le seul élément masqué qui ne vienne pas du Brésil, mais très probablement des Antilles anglo-saxonnes ». Il note que la danse la plus belle à laquelle il a assisté était celle du conducteur du bœuf autour de l’animal. Dans la bourian de nos jours, le conducteur du bœuf souvent ne porte pas de déguisement. En général, il ne danse pas, se limitant à son rôle d’organisateur de performance, receveur des donations et conducteur du masque ; dans la plupart des cas, il n’est pas un personnage. On peut quand même trouver des situations où c’est un ambra116 déjà sur la « scène » qui reprend ce rôle de conducteur et receveur des donations, sans pour autant réaliser de danse, à proprement parler, avec le bœuf. Bastide ensuite reprend les idées de l’article de 1958, mais y ajoute une importante référence aux Ranchos, surtout ceux de Bahia.
On a tout de suite pensé que la Burrinha africaine ne serait qu’une variante du Bumba-Meu-Boi brésilien. Mais le Bumba-Meu-Boi constitue un ballet dramatique extrêmement complexe (…) Au cours du cycle de Noël, et autour de la crèche, l’Église catholique a institué deux fêtes, parallèles mais qui n’interfèrent pas, les Pastorales, réservés aux Blancs et à l’aristocratie, et les Ranchos, réservés exclusivement au petit peuple de couleur117 ».
Bastide cite Nina Rodrigues (1933) au sujet de la musique des Ranchos : « Leurs danses consistent en un lundu avec battement de pieds ». Le lundu est, selon Cascudo (1954 : « une danse et un chant d’origine africaine, amenés par les esclaves Bantus, spécialement de l’Angola, vers le Brésil118 ». Il y a, à ma connaissance, très peu de choses écrites sur les Ranchos de Bahia. On trouve notamment de références à propos de leurs différences par rapport aux groupes de Ternos, qui peu à peu prennent la place des Ranchos dans la fête de Rois à Salvador de Bahia. Malgré un fort déclin dans les dernières années, les Ternos existent encore aujourd’hui et j’ai pu assister à leur représentation lors du samedi de la fête du Bonfim en janvier 2017119.
Enfin Bastide fait son autocritique et en ajoute trois justificatifs :
Si l’on n’a pas pensé aux Ranchos, c’est que ceux-ci se sont actuellement complètement transformés pour devenir des blocs [groupes] de Carnaval, alors que le Bumba-Meu-Boi a conservé son caractère archaïque. Mais le Rancho nous apparaît personnellement, comme vraie source de la Burrinha africaine, d’abord parce qu’il est un divertissement des Noirs, alors que le Bumba-Meu-Boi est surtout un divertissement de Cabocles [métis d’Amérindien] (…) en second lieu parce que nous trouvons le Nègre ridiculisé dans le Bumba-Meu-Boi, sous la forme de deux ivrognes, [les personnages] Mateus et Catirina ; enfin parce que, sous d’autres formes, la danse du boeuf se retrouve chez les Indiens, colonisés par les Espagnols, du Mexique (…) au Paraguay (…) malgré son origine catholique, le Rancho contient d’incontestables éléments africains qui devaient forcément inciter le Noir à le perpétuer120».
Bastide prend ses distances avec les réinterprétations du totémisme africain faites par les auteurs brésiliens Nina Rodrigues et Arthur Ramos : « il suffit de dire que le totem n’est jamais un masque, encore moins un masque qui fait rire. Ce n’est pas de ce côté qu’il faut chercher ». D’autre part, on voit dans le prochain extrait que Bastide a, quelque part, généralisé l’Afrique :
Le point culminant de la danse du Rancho, la lutte du chasseur contre l’animal, se retrouve dans d’autres parties de l’Amérique Noire, par exemple au Honduras, et son prototype est une pièce de théâtre qui se joue dans certaines parties d’Afrique. Le Noir brésilien a certainement profité du cadre que lui fournissait le catholicisme pour inclure dans l’Épiphanie des scènes qu’il aurait jouées ou vu jouer au pays de ses ancêtres121».
Dans une note de bas de page, Bastide renvoie à une « pièce de théâtre qui se joue dans certaines parties d’Afrique » à Bakary Traoré (1958) Le théâtre africain et ses fonctions sociales, mais le lien que Bastide propose me semble un peu rapide, car il manque des éléments pour lui donner plus de poids. L’auteur nonobstant insiste sur le point que les Agudàs, une fois en Afrique, auraient enlevé ou oublié des éléments des spectacles qui avaient une forme plus complexe au Brésil. En paraphrasant Verger : « or, s’il y a eu flux, il n’y a pas eu reflux. Le Brésilien, de retour à sa terre, y a bien porté le cadre catholique de la fête de l’âne et du bœuf – mais non les éléments africains qu’il avait parfois incorporés122 ». La raison serait un changement de fonction de la fête, soutien Bastide en s’appuyant sur le regard de deux auteurs brésiliens sur le Bumba-Meu-Boï. Marlyse Meyer y voit une résistance populaire contre les membres de la classe supérieure tel le personnage du propriétaire des terres (la figure du cheval-jupon). D’autre part, Pereira de Queirós défend que « le rôle de la pièce est de contrôler le groupe paysan (…) en lui rappelant les valeurs sans lesquelles ce groupe ne peut pas fonctionner ». Selon Bastide, la bourian africaine ne pouvait pas prendre une fonction de contrôle social : « Quel que soit donc son origine, Bumba-Meu-Boï ou Rancho, la Burrinha ne pouvait pas avoir ici [en Afrique] (…) qu’une fonction symbolique : celle de désigner un groupe à un statut social différent de celui des Africains, et supérieur (…) ». Dans la citation suivante, Bastide se base encore une fois sur l’extrait déjà commenté de Laotan sur les bagarres et le jet de cailloux lors des anciennes sorties de bourians à Lagos (et je rappelle qu’il s’agit de la seule allusion à une agressivité contre le cortège). En outre, nous n’avons pas d’éléments pour étendre le phénomène au Bénin et au Togo.
Les masques signifiaient que, malgré la couleur de leur peau, les Brésiliens constituaient une autre race, qu’ils formaient la première bourgeoisie de couleur qui ait peut-être existé en Afrique (à côté de celle, de même origine, des « Créoles » de Sierra Leone) ; les deux animaux pacifiques par excellence, l’ânesse tendre et le bœuf veillant sur le petit Jésus, devenaient les deux représentants de l’agressivité d’une classe sociale sur une autre. Il n’y a plus aujourd’hui de lutte de prestige entre Africains et Brésiliens, mais les sambas qui l’accompagnent manifestent encore cette fonction polémique de la fête123(…)».
Et les Brésiliens qui l’acclament par ce qu’Antonio Olinto a appelé, très justement, un cri de guerre :
Olá ! La ! la ! Brasileiro está na rua [Brésilien est dans la rue124] »
Pour ce dernier extrait, il me semble que Bastide a pris à tort une expression brésilienne à la lettre, car « cri de guerre » peut être –outre un cri de combat belliqueux – juste un slogan de cohésion d’un groupe ludique, sportif ou en train de constituer une formation quelconque, et c’est dans cette acception qu’Olinto me semble l’avoir utilisée ; bref, aucun des trois exemples donnés ne semble valable comme exemple d’une agressivité. Par contre Bastide remarque que si les éléments africains et dramatiques luso-brésiliens du rancho et du Bumba-Meu-Boï sont « tombés », le défilé dans les rues et le pique-nique « manifestation de la solidarité et de l’endogamie du groupe » se sont maintenus. L’auteur différencie aussi le Bumba-Meu-Boï qui « tend vers la revue de fin d’année et par conséquent va multiplier les scènes » et la version africaine où « la création se fait sur le terrain de la seule chorégraphie », en oubliant – peut-être parce qu’il n’a pas accompagné un même groupe dans la longue durée – les innovations créatives dans les accoutrements et les masques.
Enfin, l’auteur aborde les changements de répertoire. En citant l’avis de M. Da Rocha, La musique de samba la plus pure, c’est-à-dire la plus proche de ses origines brésiliennes archaïques qui a existé sur la côte des esclaves (…) a été celle de Lomé ». Je ne peux manquer de lier cette information à l’existence de ce que j’appelle « le cahier togolais », le seul recueil de chansons écrites trouvé au sein du groupe de bourian de la famille De Souza. C’est à Lomé aussi que l’ancien ministre brésilien des Affaires étrangères, Celso Amorim, a été ému aux larmes par des chanteurs Togolais Brésiliens qui chantaient alors un air de son enfance au Brésil. « Mais avec la mort de Olympio, président de la République, l’école de samba de Lomé a disparu », continue l’article. Ici, il y a deux remarques à faire. Premièrement, je rappelle que quelques familles brésiliennes du Togo importantes sont « originaires » d’Agoué, dans l’actuel Bénin, une ville frontalière avec le Togo, où elles ont leurs maisons familiales, comme c’est le cas des Olympio125. Deuxièmement, l’utilisation de la désignation d’école de samba me semble inappropriée. Or, la désignation « école de samba » a été créée à Rio de Janeiro en 1928 ; il s’agit donc, d’un anachronisme126. Rien n’empêcherait pourtant que la désignation ait été reprise au milieu du XXe siècle au Togo à partir de la radio, du cinéma, etc. néanmoins je n’ai pas eu d’information selon laquelle les bourians de Lomé aient été désignées comme des « écoles de samba ». Bastide mentionne avec une surprenante vision idyllique que « actuellement (…) une influence – extérieure – est en train de se faire jour : celle de la radio, et par conséquent celle de la samba, inventée dans les villes et musicalement de plus en plus éloignée des airs traditionnels ». Ce à quoi je peux répondre que la bourian a toujours été urbaine – et de surcroît issue des principales villes des pays concernés – les « airs traditionnels » de la bourian ne viennent donc pas de la campagne africaine. Pour clore, Bastide craint une tendance à l’homogénéité sous l’influence des « airs de la radio [qui] traversent l’Atlantique ». Il mentionne, sans donner de détails, que lors de sa seconde visite au Dahomey127, « l’influence de la radio et son américanisation était beaucoup plus prononcée dans la Burrinha qu’à mon premier voyage ». Enfin, je transcris les beaux mots de Bastide qui clôturent l’article au sujet des possibles nouvelles influences dans la fête des Brésiliens : L’avenir le dira, car la Burrinha, n’est pas chose morte, elle continue à vivre et qui dit vie, dit changement ».
Dans l’ouvrage de Guran (2010 [1999]), la bourian est principalement traitée dans le chapitre III, « L’identité en action ». L’auteur approche le sujet de la bourian par le biais de l’ethnographie de la fête du Bonfim de Porto-Novo et des festivités liées à l’intronisation du Chef de la famille De Souza, le Chacha VIII, à Ouidah. Guran l’introduit avec une observation importante, en disant qu’il y a un mouvement de réaffirmation des « origines brésiliennes » au début des années 1990 au Bénin (ce qui coïncide avec la fin du gouvernement Kérékou, en 1990 et le renforcement du prestige des chefferies traditionnelles). En 1989, le gouvernement brésilien missionne un premier consul honoraire du Brésil à Porto-Novo129. Le drapeau brésilien n’aurait été incorporé à la fête qu’après cette mission, soit vers le milieu des années 1990 (de nos jours, on voit aisément des drapeaux brésiliens dans cette fête). Les mots suivants résument la vision de Guran sur la place de la bourian dans le contexte identitaire : C’est lors de ces moments – la célébration du Bonfim, la présentation de la bourian et l’intronisation du Chacha – que l’identité ethnique est à la fois la plus affichée, la plus revendiquée, (…) et en quelque sorte, « mise à jour », c’est à dire mise en action. Le reste du temps on peut considérer qu’elle est résiduelle130 ».
Même en considérant l’ouvrage de Guran comme base et « source d’inspiration » pour ce travail131, je ne peux m’abstenir de critiquer certains de ces détails. Différemment de Guran qui se sert des expressions telles que « l’identité en action » ou identité « mise en action », je préfère me servir des expressions comme « les moments durant lesquels les Agudàs expriment leur identité », car « l’identité en action » peut prêter à confusion. Cela peut « culturaliser » la notion d’identité et, surtout pourrait laisser croire que l’identité réalise des actions par elle-même, comme si celle-ci serait animée d’une volonté propre. Pour ma part, je préfère laisser en évidence que ce sont les acteurs qui font des actions au niveau identitaire, ou bien que ce sont des actions qui peuvent être interprétées de cette façon. Je ne peux pas non plus être totalement d’accord avec l’affirmation que « le reste du temps on peut considérer qu’elle est résiduelle ». Effectivement, certaines familles ou branches de familles vivent plus fortement l’univers des références brésiliennes des Agudàs que d’autres, mais un nom de famille Agudà est un marqueur indélébile, plus encore lorsqu’il est associé à une branche familiale aisée. Plusieurs Agudàs, notamment ceux issus de ces branches, affichent leur créolité non seulement culturelle, mais aussi au niveau des traits physiques métissés, même quand ceux-ci restent assez subtils à voir.
Une première reconstitution de la trajectoire historique de la bourian de Porto-Novo
Guran reconstitue la trajectoire historique de la bourian de Porto-Novo, dont il est le premier à la faire de manière systématique132. Selon une interview de Mme Patterson (née De Medeiros), Simplice Gonzalo a été l’initiateur de la fête du Bonfim et de la bourian à Porto-Novo133. Il était un ancien esclave revenu du Brésil et a aussi fondé la confrérie du Bom Jésus du Bonfim à Porto-Novo, qui « rassemblait alors tous les « Brésiliens » de la ville. Les musulmans « brésiliens », sans assister à la messe, fêtaient aussi le Bonfim avec les Catholiques ». C’est ici qu’apparaît le nom de Casimir D’Almeida. La confrérie était encore active en 1960 et était présidée par lui. Avec Marcelino D’Almeida, les deux étaient « les plus grands animateurs de la fête Brésilienne ». Les répétitions se faisaient chez Marcelino. Venu de Ouidah en 1901, le maçon Édouard Amaral (père de l’actuel chef du groupe, Auguste) musicien lui aussi, fabriquait les déguisements et accoutrements134. Après la mort de cette génération d’animateurs, la veuve de Casimir invite son neveu, l’homme d’affaires Karim Urbain da Silva, « le plus riche Agudà de Porto-Novo », à assurer la direction du groupe135. Les enjeux liés à la figure de Karim Da Silva et sa quête de pouvoir et de prestige autour de l’Association de Ressortissants Brésiliens et de la bourian – sujet auquel nous reviendrons plusieurs fois tout au long de ce travail – sont présentés par Guran, qui demeure le premier à les avoir décrits. Da Silva, bien que musulman, est resté fidèle aux traditions et « a toujours soutenu la célébration du Bonfim et la bourian136 ». Guran continue : « L’appartenance ethnique prend donc nettement le pas sur l’appartenance religieuse137 ». Selon Guran, les Agudàs formeraient donc aujourd’hui un « groupe ethnique ». De ma part, je préfère les voir comme un « groupe d’appartenance », un groupe d’origine », un groupe qui renvoie à une origine commune et qui, à plusieurs occasions, et selon la situation, est perçu – et éventuellement désigné – comme un groupe ethnique. Ce groupe présente effectivement quelques aspects similaires à ceux des « ethnies », pour utiliser les termes locaux courants. Néanmoins, selon la situation, le groupe Agudà fonctionne d’après ses caractéristiques particulières.
En reprenant le propos de Guran : « Da Silva entretient financièrement le groupe bourian et reçoit des délégations de Brésiliens [citoyens du Brésil] qui transitent par le Bénin ». Mais suite à des conflits où « les catholiques avec les trois enfants d’Édouard Amaral par tête de file, ont donc décidé de créer leur propre association (…) Association des ressortissants brésiliens – bourian. La présidence était assurée, en 1995, par M.Jean Amaral, et par Mme. [Thérèse] Domingo née Santos138 (…)». On se penchera un peu plus sur ce conflit, car ses déploiements sont perceptibles jusqu’à nos jours.
Les deux principaux acteurs du conflit de Porto-Novo sont M. Karim Urbain da Silva et M. Jean Amaral, l’un puissant homme d’affaires, et l’autre menuisier (…) le premier se fait nommer en 1992, par le gouvernement brésilien, consul honoraire du Brésil au Bénin139, l’autre est le représentant140 du quartier d’Oganla, connu comme le quartier des « Brésiliens », auprès de la mairie de Porto-Novo141 ».
Pour résumer l’énoncé du conflit – et ici je croise les informations de Guran avec ma connaissance personnelle de l’affaire – Da Silva a été choisi pour présider l’Association, qui en ce temps-là fonctionnait sur la base de cotisations venues des différentes familles Agudàs. Cependant, le riche Da Silva ouvrait son portefeuille avec de grosses sommes, de telle façon que les modestes contributions des familles sont devenues sans importance. Cela lui confère un grand pouvoir représentatif dans le milieu agudà, ce qui a été perçu comme gênant. Les Amaral ainsi que des individus issus d’autres familles, comme les Campos, trouvent que ce processus a désengagé les familles Agudàs, qui se sentaient alors moins concernées, puisqu’elles ne contribuaient pas ou que leur contribution n’était plus fondamentale pour la réalisation de la fête.
Avant la fête, on allait voir les gens qui sont ici avec leur nom dans le cahier. Et on allait, Jean [Amaral] et moi, leur rendre visite pour leur dire : « voilà la fête s’approche, il nous faut votre participation, et ils donnaient142 » ». D’autre part, Karim Da Silva soutient que les Amaral « voulaient avoir le machin pour eux pour pouvoir recevoir de l’argent quand il y avait une cérémonie143 ». Je ne peux qu’être d’accord avec l’analyse de Guran : « La cotisation sert donc à entretenir le réseau de relations personnelles et sociales qui constitue la base de la célébration du Bonfim et qui reste l’un des aspects les plus importants pour ces participants144 ». Guran comprend que Jean Amaral « (…) intervient sans doute, par nécessité de maintenir vivante la célébration du Bonfim, en tant que patrimoine de sa famille, et/ou parce qu’il a l’intention d’en tirer un profit Guran (2010 : 149). Ces noms reviendront plusieurs fois au long de ce travail.
Il n’est pas clair, dans l’ouvrage, de vérifier si Da Silva est le deuxième consul, suite à un premier non identifié, ou si Guran entre en contradiction avec ce que lui-même écrit p. 145, citée plus haut, où il informe qu’un consul honoraire fut commissionné en 1989.
Je connais Jean Amaral comme étant dans la fonction appelée « chef de quartier ». commercial, comme l’en accuse M. Da Silva145 ». Par ailleurs, certains accusent Da Silva « d’avoir voulu être président de l’association pour acquérir la légitimité qui lui aura permis d’être nommé consul146 ». La séparation se produit, et depuis 1990, donc pendant la période dont Guran a fait son terrain, il y avait deux associations de ressortissants Brésiliens à Porto-Novo, celle de Karim Da Silva (qui réunit essentiellement des branches de familles musulmanes proches de lui, mais en incluant quand même quelques chrétiens147) et celle où les Amaral étaient les responsables de la partie musicale et, pour ainsi dire, de la « mise en scène » de la bourian. Comme on verra le plus loin, Da Silva essaie de constituer un autre groupe bourian qui n’aura pas de continuité. Aujourd’hui, l’association de Da Silva n’existe plus, mais le cortège de la bourian sous la direction d’Auguste Amaral passe chez Da Silva pour lui rendre hommage (il est désormais un des Agudàs les plus âgés de la ville) et pour recevoir des donations. On peut dire que Da Silva est devenu un « bon contributeur », quelqu’un qui ajoute du prestige à l’évènement, mais qui n’a pas d’autorité sur le groupe.
Guran est donc le premier à décrire la bourian non seulement dans ses aspects plastiques, musicaux, festifs, mais en la dévoilant comme la scène d’enjeux de prestige et de pouvoir internes à la communauté agudà. Comme nous l’avons vu, Laotan et Bastide avaient abordé auparavant ces mêmes aspects, mais en termes de contrastes entre Agudàs et non Agudàs et pas entre les Agudàs eux-mêmes. Cela est certainement le fruit d’une méthodologie de terrain de plus longue durée, qui a permis à Guran de dévoiler les aspects au-delà de la seule impression laissée par la performance (que je pourrais appeler un « impressionnisme de la performance » soit, ne se pencher que sur l’expression performative elle-même, sans se soucier vraiment des enjeux de son entretien et des rapports de pouvoir qui lui sont liés).
Guran a assisté aux célébrations du Bonfim en 1995 et 1996. Il remarque que les membres de la confrérie du N. S. du Bonfim, lors de la messe du dimanche matin, s’habillent en blanc « comme les adeptes d’Oxalá à Bahia148 ». Je rajoute que, selon ce que j’ai pu recueillir auprès de deux de ces Agudàs « habillés en blanc », il n’y a pas de mention à une telle divinité de la part des Agudàs lors de cette festivité (ce qui n’empêche pas qu’ils auraient pu n’avoir repris que cet aspect plastique de la fête qui a lieu au Brésil). Auguste Amaral et Mme Yannick Domingo laissent entendre clairement qu’il s’agit d’une fête chrétienne. La bourian, par contre, est une fête de tous les Agudàs, indépendamment de leur foi religieuse.
En reprenant le sujet de l’incorporation des drapeaux du Brésil à la fête, Jean Amaral raconte qu’ils l’ont fabriqué « d’après un modèle trouvé dans un magazine », pour afficher notre condition de Brésiliens ». Selon Guran, cela serait « une réaction au fait que M. Da Silva, consule honoraire du Brésil, maintienne le pavillon brésilien hissé en permanence devant sa résidence149 ». De nos jours, Da Silva n’a plus aucun lien officiel avec le Brésil – au contraire, il est mal vu par l’ambassade brésilienne à Cotonou pour n’avoir pas respecté certains protocoles diplomatiques. Le drapeau brésilien, néanmoins, semble désormais incorporé à la fête du Bonfim150.
La fête du Bonfim
Guran décrit le cortège festif du samedi soir, qui inclut plusieurs personnages de la bourian. À cette occasion, les trois frères Amaral – Jean, Adolphe et Auguste – organisent (encore) le défilé ; lors de mes terrains les autres deux frères s’étaient déjà retirés et l’organisation du groupe est revenue à la charge exclusive d’Auguste. Guran remarque que, bien que le défilé rappelle le carnaval brésilien, la différence est qu’on n’y trouve pas de boissons alcoolisées. Il note aussi que, parmi un répertoire de sambas et de marchas (styles musicaux) en portugais, on chante une chanson d’appel à la fête composée en 1992 par Mme Amégan (née Campos), en nago (yorouba), qui, selon lui, est la langue la plus répandue chez les Agudàs151 ». Une autre différence avec ce que j’ai vu en 2015 est que, dans les deux ans où Guran a été présent, le défilé du samedi de Moi-même j’ai offert un drapeau à un ami Agudà qui a participé au défilé – qui a eu lieu plusieurs mois plus tard – enroulé avec. Je me suis permis de le faire car il y avait déjà d’autres drapeaux – bien plus grands d’ailleurs – incorporés à la fête. À propos des cadeaux offerts aux Agudàs, parfois spontanés, d’autres en réponse à des demandes insistantes (souvent pour des objets non spécifiés – comme par exemple la demande pour « des bons cadeaux » tout simplement) ; par précaution j’essaie d’éviter des cadeaux « innovateurs », en me restreignant à offrir plus au moins des objets de même nature que ceux déjà présents dans leurs fêtes la veille du Bonfim, appelé le « carnaval », a commencé le soir, avec la nuit déjà tombée, une fois de 20h à 23h et l’année suivante de 20h30 jusqu’à trois heures du matin. Par contre, en 2015, le cortège est sorti vers 17h environ (toujours du même endroit, le siège de la bourian, la maison de feu Édouard Amaral), et a parcouru la moitié du chemin sous un ciel encore éclairé. Parmi d’autres maisons visitées, le cortège s’est arrêté chez Karim Da Silva les trois fois. En 1995, Da Silva n’était pas chez lui ; par contre en 1996 il y est, ouvre le grand portail en fer et reçoit le cortège dans sa grande cour, où il distribue des billets de 500 francs CFA aux participants et 10.000 francs CFA à l’association. En 2015, j’ai assisté à peu près à la même dynamique chez Da Silva. Ces fois-ci le cortège s’est aussi arrêté chez Mme Patterson (née De Medeiros), actuellement la doyenne la plus âgée parmi les Agudàs de la ville. Mais en 1996, Guran décrit et photographie la station chez Mme. Télégan, – qui n’a pas eu lieu la fois où j’étais présent – qui habitait alors chez le feu Marcelin (ou Marcelino) D’Almeida (1880-1972) où, « pendant la majeure partie de ce siècle [le XXe] les « Brésiliens » de Porto-Novo se sont réunis pour jouer la bourian. C’est dans cette maison, nous informe Jean Amaral, qu’ils ont tous appris à chanter, à jouer et à danser la « samba » ». Le cortège montre son respect devant son portrait exposé dans la cour152. Le cortège suivi par Guran s’arrête aussi chez les familles Francisco, Campbell, Dosou153 et devant la maison du général Kourjamè, alors commandant de la gendarmerie nationale, avant de rentrer chez les Amaral vers trois heures du matin environ. En 2015 aucune de ses visites n’a eu lieu.
Concernant la messe du lendemain, le dimanche matin, la description de Guran n’est pas très différente de ce à quoi j’ai pu assister en 2010 et 2015. La messe est une messe non exclusive pour la communauté brésilienne, c’est-à-dire qu’ il y a d’autres intentions énoncées par le prêtre et les non-Agudàs sont présents en nombre. Les membres de l’« Irmandade [confrérie] brasileira Bom Jesus do Bonfim de Porto-Novo » sont vêtus de blanc avec une bande vert et jaune qui croise la poitrine en diagonale, où l’on peut lire « N.S. do Bonfim ». C’est immédiatement après le service religieux que se produit la partie qui nous intéresse le plus : la sortie de messe dans un genre de procession festive avec la présence du drapeau brésilien, mis bien en évidence. Une fanfare qui
Guran (2010 : 160-161).
Il s’agit probablement de la famille Dossou attendait dehors fait l’animation du cortège. Chez Guran, la fanfare ne joue que lors de cette petite procession autour de l’église, mais j’ai pu accompagner la sortie de messe en 2010 où la fanfare continuait à animer le groupe d’Agudàs qui chantaient des chansons de la bourian tout au long d’un parcours dans les quartiers voisins, où l’on s’est arrêté pour visiter plusieurs maisons où habitaient des familles brésiliennes.