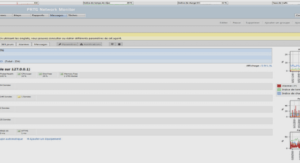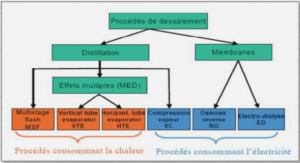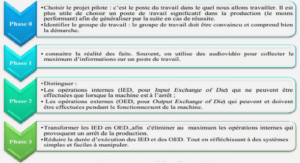Télécharger le fichier original (Mémoire de fin d’études)
Réflexivité, imaginaire et production des savoirs
Je pourrais maintenant faire un pas de plus, et passer, comme Alice, de l’autre côté du miroir des textes en vous montrant d’où peuvent bien venir toutes ces inscriptions. Nous déboucherions alors sur les instruments de laboratoire. »
Bruno Latour, Cogitamus. Six lettres sur les humanités scientifiques
Continuons à nous intéresser à cette fiction que nous avons commencé à écrire, mais abandonnons Alice au profit des géographes qu’elle représente : plutôt que de réécrire ses aventures, essayons de poser de nouvelles bases pour appréhender le travail des géographes et tâchons d’explorer conjointement, comme nous y invite l’expérience du miroir, la géographie en train de se faire et l’imaginaire scientifique des géographes et efforçons nous d’envisager les liens qu’ils entretiennent. Que se passerait-il si c’était les géographes qui étaient invités, en même temps qu’ils cherchent, à se regarder dans le miroir ? Où cette fiction nous mènerait-elle ? Aboutirait-elle à une remise en cause de nos certitudes d’une aussi grande ampleur que les aventures d’Alice ? Pour donner corps à cette fiction, le terrain semble un levier heuristique opératoire pour interroger simultanément le travail des géographes et les représentations qui les animent, c’est-à-dire à la fois leurs pratiques scientifiques et leur imaginaire disciplinaire. En effet, si le terme terrain est fréquemment utilisé par les géographes pour désigner aussi bien l’objet de la recherche, que l’ensemble de pratiques mobilisées à des fins heuristiques ou que l’espace ou celles-ci se déploient (Volvey, 2003b), le flou le plus complet entoure sa définition, son statut scientifique ou les règles méthodologiques pour le mener à bien. Voire : alors qu’il joue un rôle décisif dans la formation, dans la production des savoirs et leur évaluation, bref dans la structuration de discipline, le terrain reste associé à un imaginaire puissant qui a longtemps empêché les géographes de le penser collectivement et de se l’approprier comme l’un des outils à part entière de leur discipline, ce qui brouille ainsi toute visée analytique qui permettrait d’élucider la fonction que joue cette instance dans la production des faits scientifiques. Les géographes n’ont pas eu à cœur d’interroger frontalement cette pratique en tant que principale instance de construction et de validation des savoirs et un consensus se dégage pour ne pas l’interroger. Le terrain est devenu une sorte d’impensé disciplinaire tenace. Ce déni pour la fonction heuristique du terrain est occulté par sa survalorisation dans les représentations partagées par la communauté. Dans cette perspective, pour une discipline toujours soucieuse de son unité et de son efficience, faire du terrain mais ne jamais interroger ce qu’il implique et induit peut apparaître comme un modus vivendi acceptable.
Un imaginaire à explorer
Notre tâche est difficile : comprendre la place que joue le terrain dans les pratiques scientifiques des géographes implique au préalable de dissiper l’écran de fumée qui le dissimule dans un imaginaire tenace. C’est d’autant plus nécessaire que le terrain est soumis à une pluralité de voix pour le penser. Le recours aux dictionnaires spécialisés permet de comprendre comment la discipline a pensé et dit le terrain, et quelle(s) chose(s) se cache(nt) derrière le mot.
Selon l’adage bien connu, « la géographie, ça sert d’abord à faire la guerre » (Lacoste, 1976c) : c’est d’ailleurs aux militaires que revient l’invention du terme terrain. Le Dictionnaire historique de la langue française (Rey, 1998 : 3 799) rappelle qu’il désigne avant tout le « lieu où se déroule un combat », ce que l’on appelle aujourd’hui le théâtre des opérations, c’est-à-dire le champ de bataille. Le préalable à tout affrontement demeure la reconnaissance du terrain, de sa topographie et de ses configurations (Boulanger, 2006 ; Régnier, 2008) ; il faut donc, pour reprendre une expression venue de l’équitation, tâter le terrain. Depuis le XVIIe siècle, terrain désigne également la surface de terre considérée par rapport à sa nature, à sa composition » ; c’est l’origine de l’acception géologique que l’on continue d’utiliser aujourd’hui. Le lien entre ces deux acceptions apparaît au mitan du XIXe siècle, au moment où, sous la conduite d’Elie de Beaumont (1798-1874) et d’Armand Dufrénoy (1792-1857), des géologues font les levés de la carte géologique de la France. C’est la première étape d’un glissement sémantique qui va conduire à utiliser le même terme pour désigner à la fois un objet (le terrain entendu selon son acception géologique) et la pratique pour l’étudier (faire du terrain). En 1970 dans son Dictionnaire de la géographie, Pierre George ne reconnaît que le sens géologique pour son entrée terrain : « Terme général désignant tout ensemble de roche qui affleure à la surface du globe et constitue un relief » (George et Verger, 2000 : 456). Ce qui se lit en creux, c’est que la géographie classique, alors sous le feu des critiques, ne dispose d’aucun mot pour dire la pratique qui consiste à recueillir des données au contact direct avec la réalité : le géographe classique ne fait pas de terrain et lui préfère l’excursion12 ou l’enquête que Pierre George définit longuement13. Alors que la pratique de terrain est ancienne14 et qu’elle constitue même l’une des innovations15 proposées par Vidal de La Blache, ce vide lexical étonne et renvoie aux mécanismes d’enfouissement à l’œuvre dans l’imaginaire disciplinaire et traduit la faiblesse de la réflexion sur ce thème au moment même où la discipline est en crise et que ses attaques reposent principalement sur des questions méthodologiques.
Cette situation évolue : pendant la vingtaine d’année qui sépare la publication du dictionnaire de Pierre George et celui de Roger Brunet, la discipline a investi ce champ de réflexion. La définition proposée par Roger Brunet dans ses Mots de la géographie (Brunet et alii, 1992 : 478) est substantiellement plus riche que la précédente et prend désormais en compte la polysémie du terme. L’acception géologique est toujours présente mais n’est plus première, au profit d’autres acceptions immobilières, topographiques sans oublier bien sûr « le concret, la pratique, l’espace que l’on parcourt pour une étude de terrain en étant ‘sur les lieux’, par opposition aux livres, documents, statistiques, au ‘bureau’ ». La définition proposée – « Morceau de terre, mais avec de nombreux sens différents » – prend en compte les nouveaux objets de la géographie (au détriment de la seule géomorphologie auparavant largement dominante) et les nouvelles pratiques de la discipline. Roger Brunet insiste surtout sur le contexte nouveau des études géographiques : dans le contexte de la mondialisation et de la généralisation du slogan small is beautiful, tout ce qui s’attache à des espaces de faible étendue (qui rend justement possible la pratique du terrain) et donc au terrain est connoté positivement. Le terrain et sa pratique apparaissent donc comme un gage de qualité (la comparaison avec le politicien qui doit se rendre sur le terrain est révélatrice), et l’auteur va même jusqu’à proposer un renvoi vers le terme vérité en rappelant que le terrain permet la vérification des hypothèses. Roger Brunet envisage donc ici le terrain comme un élément important dans le processus de construction des données et de vérification des hypothèses. Surtout, il inscrit le chercheur et les recherches qu’il mène dans leur contexte politique et social. Si cette contribution marque une étape importante vers la socialisation de la construction des savoirs géographiques, elle n’envisage pas du tout la relation que le géographe entretient à son terrain et à ses pratiques. La contribution d’Yves Lacoste dans son dictionnaire De la géopolitique au paysage (Lacoste, 2003 :378) revient longuement sur l’histoire du mot et insiste sur le rôle des géologues dans le glissement sémantique qui s’est opéré de l’espace vers la pratique16 ; c’est cette acception qu’ont empruntée les sociologues et les ethnologues17 pour désigner le lieu et la population qu’ils étudient. Le terrain y apparaît aussi comme une nécessité (l’allusion à la politique est une nouvelle fois mobilisée) dans la mesure où « le terrain devient synonyme de contact direct avec la réalité ». Cette définition renforce elle aussi, et pour les mêmes raisons, l’imaginaire disciplinaire : elle pose la nécessité de faire du terrain sans pour autant interroger cette nécessité. En dépit des efforts de clarification de la polysémie du terme, la fonction du terrain comme instance de construction des savoirs n’est pas abordée.
Il faut attendre les travaux d’Anne Volvey pour que la question du terrain soit posée dans des termes renouvelés qui prennent en compte les avancées des géographies étrangères et interrogent la place du terrain dans la construction des savoirs scientifiques et dans l’imaginaire des géographes (Volvey, 2003b). Dans l’article qu’elle rédige dans le Dictionnaire de la géographie et de l’espace des sociétés (Lévy et Lussault, 2003a), elle souligne la polysémie du terme tout en restreignant son analyse à la seule fabrique des savoirs (aucune allusion n’est faite à la géologie ou à la politique) : le terrain désigne à la fois l’espace étudié, l’espace d’une pratique scientifique, l’échelle de référence ou l’objet étudié dans un espace. Elle le rapproche de l’enquête et de l’observation et pose les bases d’une approche spatiale du terrain que la géographie a toute légitimité pour conduire. Elle pose également des jalons d’une histoire de la discipline qui nuance l’impact de la crise de la géographie sur le terrain et sa pratique. Au contraire : elle formule l’hypothèse selon laquelle la crise des années 1950 aux années 1970 n’a pas entraîné – contrairement à ce qu’a retenu l’imaginaire disciplinaire – une remise en cause du terrain, mais plutôt à la redéfinition de sa place dans le protocole heuristique, dans le cadre plus large du passage d’une géographie inductive à une géographie déductive. Elle définit enfin les axes d’un programme de recherche nourri par sa thèse et enrichi depuis (Volvey, 2000, 2003a, 2004) qui met l’accent sur le sujet épistémique (et pas seulement des questionnements méthodologiques), ses projets, et notamment le plaisir que procure la pratique du terrain. Cette contribution décisive et pionnière ouvre un champ de recherche inédit que ma thèse prétend enrichir et s’inscrit dans un contexte éditorial spécifique, ancré dans le paradigme actoriel, qui vise à faire de la géographie une science sociale. Dans ce contexte, l’interrogation sur les méthodes (qui permet – ou non – les échanges transdisciplinaires) est fondamentale : le tournant réflexif et post-moderne est pris.
La discipline repose donc sur une pratique à la fois évidente mais enfouie, au point qu’on ne peut la désigner. Cet imaginaire est en effet une machine puissante pour occulter, enfouir ou réécrire (Bourgeat, 2007 ; Soubeyran, 1997) : le déni du terrain – qui joue de plus en plus le rôle d’une boîte noire – relève d’un impensé disciplinaire. A l’encontre de ce mouvement puissant de refoulement (dont il faudra interroger les modalités), le terrain émerge aujourd’hui comme un objet à interroger. En dépit de l’initiative pionnière d’Yves Lacoste qui consacre au terrain deux numéros de la revue Hérodote (Hérodote, 1977 et 1978), il faut attendre la dernière décennie pour voir (ré)apparaître ce thème comme un enjeu de questionnements suscitant sinon une large demande de la part de la communauté, du moins son intérêt. En plus de publications (par exemple Retaillé et Collignon, 2010), des manifestations variées comme une journée d’étude18, des colloques19, un café géographique20, une émission de radio21 ont servi de caisse de résonance à cette thématique et ont montré la pertinence, pour les membres de la discipline, d’interroger leurs pratiques de terrain. Ce faisant, le terrain a changé de nature : il n’apparaissait plus comme l’impensé sur lequel s’était construite la communauté disciplinaire mais comme l’une des instances essentielles de construction des savoirs géographiques qu’il est désormais nécessaire d’étudier. Dans ce glissement se lit non seulement la transformation d’un imaginaire en mémoire mais aussi les évolutions que connaît aujourd’hui la géographie. A rebours de l’enfouissement passé, les débats contemporains cherchent au contraire à exhumer le terrain : c’est une manière de questionner l’identité de la discipline, dans un contexte non plus de crise, mais d’intense débat sur sa pertinence scientifique et son utilité sociale à une époque où le monde évolue vite sans que sa lisibilité soit correctement assurée (Dory et alii, 1993 ; Knafou, 1997 ; Roques, 2006)22. Dans cette perspective, c’est la discipline dans son entier qui est mobilisée pour tenter de répondre aux enjeux contemporains : les méthodes aussi bien que les outils et les concepts sont réintégrés dans le champ des discussions. Ce qui est en jeu c’est la définition de la discipline et de son objet et tous ces éléments sont convoqués pour instruire le dossier : l’heure n’est plus à la simple représentation folklorique des géographes mais bel et bien à l’introspection et à la critique (Thiesse, 1999). Les autres disciplines connaissent des moments de flottement similaire : le cas de l’histoire a été particulièrement étudié par Gérard Noiriel, à la fois acteur et témoin de ce mouvement (Noiriel, 2003). Il propose de réinvestir et d’explorer les héritages de Foucault, Braudel, Elias ou Weber pour trouver des réponses aux questions qui sont aujourd’hui posées sur la légitimité et la pertinence des approches historiographiques contemporaines. Cet exemple est révélateur du changement de statut de l’héritage : il n’est plus guère question d’alimenter un imaginaire commun mais plutôt de tirer de la fréquentation des prédécesseurs des réflexions pour faire progresser la discipline et ses
18 « Le terrain pour les géographes, hier et aujourd’hui ». Journée d’étude de l’Association de Géographes Française coordonnée par Gérard Hugonie, Paris, 8 décembre 2006. Les actes ont été publiés, conformément aux pratiques de l’association, dans un numéro du Bulletin de l’Association de Géographes Français (Hugonie, 2007) questionnements. Ainsi, le processus à l’œuvre n’est plus celui d’un enfouissement accompagné d’une perte de sens, mais au contraire celui d’une introspection qui valorise les héritages et leurs apports réflexifs sur le fonctionnement de la discipline et la validité de sa démarche.
Pour la géographie comme pour l’histoire, l’enjeu est de répondre aux défis que posent à notre discipline les mutations du monde. L’élucidation de nos pratiques implicites et l’explicitation de nos démarches vont dans le sens d’une mise au jour des fondements mêmes de la discipline. On observe alors l’essor de projets de nature réflexive. Ainsi, au niveau individuel et à la suite de la démarche pionnière de Jacques Lévy qui lui donne un cadre fécond (Lévy, 1995) la démarche égogéographique se répand (par exemple : Allemand, 2007 ; Bataillon, 2008 et 2009 ; Bonnamour, 2000 ; Claval, 1996 ; Collin Delavaud, 2005 ; Daumas, 2007 ; Frémont, 2005 ; Gentelle, 2003 ; Lacoste, 2010a) et est même largement encouragée dès lors que le Conseil National des Universités en fait l’un des éléments constitutifs de tout dossier d’Habilitation à Diriger des Recherches23. Au niveau collectif, les années 1990 voient la mise en œuvre, sous la férule de Rémy Knafou, Isabelle Lefort, Philippe Duhamel et Jacques Lévy (Knafou, 1997), d’un projet d’ « autoscopie » de grande ampleur dont le but est de procéder, par l’évaluation de ses acquis, à un renouvellement de la discipline. Ce mouvement n’est pour autant pas général et des résistances s’observent, tant au niveau individuel qu’au niveau collectif. Ainsi, certains membres de la communauté ont-ils du mal à mettre en œuvre cette réflexivité24 : des formations différentes, des cultures scientifiques variées ou des trajectoires personnelles spécifiques peuvent expliquer de telles réticences. Les résistances peuvent également s’observer à l’échelle d’un groupe bien identifié au sein de la communauté : la discipline est travaillée par des courants théoriques et méthodologiques plus ou moins enclins à la réflexivité. Les résistances peuvent également être liées la position dans le champ institutionnel : la prise de parole n’est pas dégagée de jeux et d’enjeux institutionnels. Ce qui se lit derrière ces résistances multiples, c’est la pesanteur normative de l’institution qui continue – par son inertie – à empêcher de se pencher sereinement sur les relations que les géographes entretiennent avec leur terrain. L’imaginaire est à ce point induré et assimilé par les géographes qu’il ne parvient que difficilement à se dissiper. Cela explique le retard avec laquelle la géographie française s’empare de l’objet terrain et le traitement qu’elle en fait. Jusqu’aux années 1970 (c’est-à-dire à l’époque où se construit l’imaginaire disciplinaire en réaction à une crise qui remet en cause jusqu’à ses fondements) le terrain n’est envisagé que selon deux modalités : le récit autobiographique (selon une démarche qui n’est pas encore réflexive) comme l’ont illustré Raoul Blanchard (Blanchard 1961 et 1963) et Maurice Le Lannou (Le Lannou, 1979) ou le précepte normatif du manuel à l’usage des étudiants (Cholley, 1942 ; Meynier, 1971). Dans le premier cas, les souvenirs qui composent la geste des géographes ; dans le second, les gestes du métier à assimiler et à reproduire25. Il faut attendre l’initiative pionnière d’Yves Lacoste et la parution des deux numéros d’Hérodote consacrés à cette question pour que le terrain soit enfin discuté dans l’arène de manière renouvelée (Hérodote, 1977 et 1978) : la démarche empruntée ne cherche pas à interroger le terrain comme instance de construction des savoirs, mais plutôt à dénoncer la portée idéologique de la présence du géographe sur son terrain. Ces réflexions qui servent de prolongement au pamphlet d’Yves Lacoste, La géographie, ça sert, d’abord, à faire la guerre (Lacoste, 1976c) cherchent à saper l’autorité des maîtres et de la géographie qu’ils proposent à l’époque.
Ce retard de la géographie est d’autant plus surprenant qu’il va à rebours des démarches des autres disciplines qui ont en partage le terrain, comme la sociologie, l’ethnologie ou l’anthropologie, et qui en ont précocement fait un enjeu majeur de réflexion. La parution posthume du journal de Malinowski en 1967 et le débat qui a suivi chez ses collègues (Malinowski, 1985) ouvre le champ à la prise en compte des conditions de production des énoncés scientifiques au point que la lecture du Journal d’ethnographe est désormais le complément indispensable des Argonautes du Pacifique (Malinowski, 1963) : le savoir positif n’est plus dissocié du récit de sa fabrique. Le Journal de Malinowski, en plus d’ouvrir une voie de recherche féconde, a permis de croiser les intérêts des spécialistes avec les attentes d’un plus vaste public intéressé par les récits de terrain. Ce genre – qui oscille entre science et littérature et repose sur l’entrelacs des descriptions et des analyses – remonte au Devisement du monde de Marco Polo ou aux écrits de Jean de Léry qui relate son voyage au Brésil et trouve ses lettres de noblesse dans la collection « Terre Humaine » fondée en 1955 et dirigée depuis par Jean Malaurie26. L’intérêt du public est toujours vivace, comme le montre le succès éditorial de Nigel Barley qui relate, avec autodérision et désenchantement, les événements qui émaillent le quotidien de son travail de terrain (Barley, 1994 et 1998). Ces préoccupations méthodologiques et réflexives se retrouvent également en sociologie : le travail d’objectivation, au cœur de la discipline, tous les cas, j’ai toujours été bien reçu : les premiers voyaient peut-être un moyen de travailler cette mémoire collective alors que les seconds pensaient peut-être enrichir cet imaginaire disciplinaire.
Curieusement, alors que le terrain occupe le cœur méthodologique de la discipline de l’époque, les auteurs de manuel ne prennent pas la peine de décrire les protocoles à mettre en œuvre : il suffit de se référer au maître et de faire comme lui.
Il est illusoire de tenter d’isoler quelques ouvrages emblématiques de ce genre qui travaille à la fois le savoir positif et le récit de sa fabrique. Je me contenterais de citer les deux premiers ouvrages de la collection, sans doute les plus célèbres et ceux qui illustrent le mieux le récit de terrain : Claude Lévi-Strauss, Tristes tropiques (Lévi-Strauss, 1955) et Jean Malaurie, Les derniers rois de Thulé (Malaurie, 1955). Le positionnement disciplinaire de Jean Malaurie est révélateur : alors qu’il se implique la prise en compte des différents biais qui peuvent survenir lors de la collecte ou de l’exploitation des données (Bourdieu, 1968 ; Lahire, 2001 et 2007).
La « crise de la géographie » – et c’est le deuxième retard de la discipline – semble avoir manqué le rendez-vous du terrain. Alors que l’époque était à la remise en cause de la discipline, de ses méthodes et de ses paradigmes (Marconis, 1996 ; Orain, 2003), le terrain n’a pas fait l’objet d’une introspection en profondeur, contrairement à ce qu’a pu en retenir l’imaginaire disciplinaire27. De même, l’entreprise d’Yves Lacoste et ses deux numéros d’Hérodote ne doit pas être comprise comme un rejet du terrain ou une méfiance à son égard (ce qui serait surprenant pour un géomorphologue) mais plutôt comme une contestation politique et idéologique, dans le cadre de la définition d’une éthique du chercheur et non dans la perspective d’une déconstruction de la fabrique des savoirs. Alors que la contestation a été si vivace et qu’elle a porté au centre des débats les aspects méthodologiques le terrain n’a pourtant jamais suscité l’intérêt des géographes et est resté une boîte noire du dispositif géographique. A la suite des propositions d’Yves Lacoste, c’est la démarche du géographe qui est interrogée, notamment lorsqu’il est confronté à l’altérité radicale sur un terrain lointain. Ce questionnement du terrain sous l’angle des « aires culturelles » s’est maintenu jusqu’à aujourd’hui (Bataillon, 2008 ; Blanc-Pamard, 1991 ; Knafou, 1997 ; Sanjuan, 2008).
Les interrogations actuelles (dont je suis à la fois le témoin et l’un des acteurs) surgissent quant à elles dans un contexte « pacifié ». La crise de la géographie est passée et ses paradigmes ont été redéfinis, dessinant un nouveau modus vivendi. A l’extérieur de la discipline, les réflexions sur la construction des savoirs scientifiques s’intensifient, notamment du fait de l’essor des sciences studies (Latour, 2005), et suscitent l’intérêt des géographes (D’Alessandro-Scarpari, 2005). Ces questionnements extérieurs s’invitent dans une géographie française désormais réceptive aux débats portés par les géographies étrangères, notamment anglophones. Celles-ci se sont largement nourries par les courants de pensée post-modernistes qui, inspirés du travail des intellectuels français structuralistes et post-structuralistes, ont invité les chercheurs à déconstruire des savoirs qui apparaissent désormais situés et socialement construits (Cusset, 2003). La pertinence de ces nouvelles manières de penser et de pratiquer la discipline a été discutée par les géographes francophones qui les ont intégrées à leurs corpus théorique et méthodologique (Chivallon, 1999 ; L’espace géographique, 2004 ; Staszak, 2001 ; Staszak et Dargnell, 2006). Dans l’entreprise de déconstruction postmoderniste revendique comme géographe (il a été l’élève d’Emmanuel de Martonne), on le considère plutôt comme un ethnologue. Sa démarche est donc restée largement ignorée des géographes ; seul Pierre Gourou publie dans la collection (Gourou, 1982).
Gérard Hugonie, dans l’introduction de la journée d’étude de l’Association de Géographes Français qu’il a organisée le 8 décembre 2007, a rappelé l’épisode de la contestation des excursions de terrain menée à l’ENSET par Jacques Lévy et Christian Grataloup, alors élèves. Interrogé sur ce point, Jacques Lévy (10/11/2008) a contesté cette interprétation : à travers la contestation des excursions, ce n’était pas tant le terrain et sa pratique qui étaient visés, mais plutôt le type de géographie qu’elles légitimaient.
Un objet scientifique total
Le terrain semble donc un objet opératoire pour saisir, comme Alice nous y invite, à la fois la production des faits scientifiques dont il participe directement ainsi que l’imaginaire qui l’a durablement investi : le terrain apparaît ainsi comme un objet scientifique total calqué sur l’objet social total de Marcel Mauss que Claude Lévi-Strauss définit comme le « moment privilégié où une société se donne à voir tout entière en mettant en branle l’intégralité de ses institutions et de ses représentations » (Lévi-Strauss, 1950). Le terrain constitue donc une entrée certes limitée, mais opératoire pour appréhender l’intégralité de l’institution, à savoir les savoirs positifs, les chercheurs qui les élaborent, les méthodes qu’ils utilisent, les institutions qui les emploient et la demande sociale dont ils bénéficient. Il ne s’agit plus de dissocier le savoir du contexte qui le produit. En cela, nous suivons le programme de la sociologie des sciences : que se passerait-il si nous n’envisagions plus la géographie à l’aune de ses productions académiques – comme le font aujourd’hui l’histoire et l’épistémologie de la discipline – mais plutôt au miroir des pratiques de terrain des géographes, c’est-à-dire en centrant l’analyse sur leurs pratiques effectives, et, à partir d’elles, en démêlant ce qu’elles nous disent de l’institution dans son ensemble ? Cette interrogation ouvre un nouveau champ de recherche au sein du champ balisé de l’histoire et de l’épistémologie de la discipline qui invite à ne plus considérer la science comme un objet circonscrit et stable, mais plutôt comme un ensemble de pratiques, de relations, de productions de savoirs inscrits dans un contexte institutionnel et social donnés et donc mouvant.
Cette nouvelle démarche portera sur le « long XXe siècle de la géographie française » tel que Marie-Claire Robic l’a défini (Robic, 2006), c’est-à-dire la période qui commence avec Vidal de La Blache à la fin du XIXe siècle et court jusqu’à nos jours. C’est une manière d’accréditer (quitte à la discuter par la suite28), la thèse qui fait de Vidal de La Blache le refondateur de cette discipline ancienne et diverse dans ses méthodes et ses objets, elle n’est (re)fondée que sous l’impulsion de Vidal de La Blache qui la dote d’un objet (l’étude, à l’échelle moyenne, des relations hommes/milieux), d’une assise institutionnelle (il accède à une chaire en Sorbonne déliée de son compagnonage avec l’histoire dès 1898) et des moyens de sa diffusion (il participe à la fondation des Annales de géographie en 1891) (Buttimer, 1971 ; Claval, 1998 ; Sanguin, 1993). L’œuvre de Vidal de La Blache s’inscrit pleinement dans son contexte social et politique : la préparation de la revanche contre l’Allemagne, l’essor du mouvement colonial (Berdoulay, 1995) ou les réformes de l’enseignement (Lefort, 1992). Le terrain joue un rôle majeur dans ce nouveau dispositif : c’est l’innovation méthodologique majeure proposée par Vidal. Alors qu’auparavant on distingue strictement les explorateurs (ceux qui collectent l’information) et les géographes (ceux qui la traitent) (Surun, 2006), Vidal opère la fusion de ces deux instances. Désormais, c’est le géographe qui endosse les deux rôles, celui de la collecte et celui du traitement. Le voyage occupe désormais le géographe (Tissier, 2001). Cet impératif méthodologique marque un imaginaire qu’il influe profondément :
On attribue à Paul Vidal de la Blache cette réflexion (…) : ‘Avec les livres, on ne fait que de la géographie médiocre ; avec les cartes on en fait de la meilleure ; on ne la fait très bonne que sur le terrain’ »29 (Ardaillon, 1901).
L’ampleur du renouveau, fondé à la fois sur l’objet et la méthode, explique la grande cohérence de la communauté scientifique qui se forme dans le sillage de Vidal de La Blache (Orain, 2009). Le terrain apparaît alors comme une étape indispensable de toute recherche, ce qui explique la vigueur de l’imaginaire qui s’en est emparé.
De même que la réécriture des aventures d’Alice impliquait de changer de genre (passer du récit merveilleux au roman réaliste), cette nouvelle approche nous oblige à repenser à la fois notre manière d’étudier le fonctionnement de la discipline et les canons d’écriture pour la restituer. En termes méthodologiques, cela implique d’observer le fonctionnement global de la discipline et de l’institution qui la porte depuis le petit bout de la lorgnette, à savoir le terrain et tout ce qu’il implique30 ; c’est à ce prix que l’on peut parler d’un objet scientifique total. Cette désignation est aussi justifiée par les approches méthodologiques qui vont être mobilisées pour labourer ce champ : embrasser la totalité des thèmes mis en tension par la question du terrain oblige donc à croiser les outils disciplinaires. Si le terrain est un objet géographique légitime (dans la mesure où c’est une instance de la production des faits scientifiques), il sera ici construit grâce à des apports de disciplines diverses. Là réside la spécificité de l’objet à construire : celui-ci ne prend sens qu’en fonction d’un éclairage disciplinaire et conceptuels particulier. Ainsi, les mêmes données peuvent être interprétées différemment selon les disciplines convoquées ; tout est question d’agencement. Et l’intérêt est bien sûr de croiser systématiquement toutes ces approches, aussi diverses soient-elles. Bref, cela oblige donc à repenser également les sources et les données à mobiliser pour mener l’enquête, sans oublier l’arrière-plan dans lequel cette recherche s’inscrit.
Je remercie Denis Wolff de m’avoir communiqué le texte exact de cette citation ainsi que sa localisation précise.
Cette démarche qui consiste à embrasser une totalité en la problématisant à partir d’une question qui pourrait apparaître comme seconde sinon secondaire est assez proche de celle de l’historien de l’art Daniel Arasse qui invite à entrer dans les chefs d’œuvre de la peinture par leurs détails (Arasse, 1996).
Il faut prendre au sérieux l’hypothèse d’Anne Volvey selon laquelle la crise de la géographie n’entraîne pas de rupture radicale dans les pratiques de terrain mais plutôt une redéfinition de la place du terrain dans la construction du protocole heuristique (Volvey, 2003b). C’est donc la pérennité de cette pratique plus que ses soi-disant remises en cause qu’il faut analyser. Cette hypothèse jette un voile de doute sur le modèle structuraliste des révolutions scientifiques élaboré par Thomas Kuhn (Kuhn, 1972) tel qu’il a été appliqué avec bonheur à la géographie (Orain, 2009 ; Robic, 2006). Ce modèle, centré sur le concept de paradigme, met en effet l’accent sur les cycles de production des savoirs. A chaque paradigme bien identifié et partagé correspond une phase d’accumulation des savoirs : l’adhésion de la communauté aux mêmes fondements conceptuels ou méthodologiques permet à celle-ci d’enrichir, dans ce cadre, ses connaissances et ainsi de conforter ces fondements (l’accumulation donne rétrospectivement du crédit à ces bases). Une fois le paradigme essoufflé, une crise survient et le paradigme perd sa validité et il est remplacé par un nouveau construit sur les vestiges de la crise. Dans cette perspective, ce sont les ruptures et la succession des paradigmes qui focalisent l’attention, et non les continuités, même si, dans la succession des paradigmes, des formes de continuité peuvent s’observer en dépit des ruptures apparentes. Mais si l’on cherche à mettre explicitement en évidence les continuités (ce qu’implique le terrain comme objet), cette matrice garde-t-elle son efficience ? C’est là l’un des enjeux de la thèse.
La spécificité de l’objet ainsi construit et l’originalité de la démarche retenue (qui, dans l’horizon de la sociologie des sciences, entend se démarquer de toute lecture téléologique de la discipline), incite à insister sur les continuités et à s’intéresser aux « événements purs » (Deleuze, 1969 : 9), c’est-à-dire aux événéments pour ce qu’ils signifient à un moment donné et non comme les étapes d’un récit. Plutôt qu’une démarche fondée sur les paradigmes, il faut lui en préférer une qui, d’inspiration foucaldienne (Foucault, 1966), interroge les effets des discours et des représentations, dans leur durée et leur déploiement. La prise en compte des acquis de la sociologie des sciences nous invite donc à repenser la géographie et son évolution non plus en termes d’histoire mais d’historicité, c’est-à-dire en interrogeant « la modalité de conscience de soi d’une communauté humaine » (Hartog, 2003 : 19). Si la démarche historienne a révélé sa pertinence pour élucider le rôle méthodologique du terrain (Robic, 1996), elle ne permet pas de penser simultanément le rapport au terrain et aux représentations qu’il ne cesse de véhiculer. Au contraire, il faut abandonner la vision d’une science normale pour envisager des temporalités moins nettes, des évolutions plus subtiles et surtout des pratiques effectives qui se démarquent des discours généralisateurs. Il faut suivre la voie féconde tracée par Michel de Certeau et ses « arts de faire » (De Certeau, 1990) pour articuler les pratiques réelles des géographes avec les discours qui circulent au sein de la communauté.
Cette remise en cause de l’histoire au profit de l’historicité fait écho à un crise plus générale qui affecte les sociétés occidentales et les récits qu’elle produisent, ce qui interroge aussi notre manière de produire des faits scientifiques si l’on admet que le travail scientifique repose sur l’inscription (Latour et Woolgar, 1979). Ainsi, depuis le constat de divorce dressé par Foucault entre les choses et les mots pour les dire (Foucault, 1966), le monde occidental traverse une crise généralisée du récit qui affecte aussi bien les arts31 que les sciences sociales. La post-modernité naît de ce constat de décès. La disparition des métarécits (comme le structuralisme, le marxisme…) entraîne la profusion des micro-fictions qui témoignent d’un éclatements des points de vue contingents sur le monde (Lyotard, 1979 ; Salmon, 2008 et 2010). Ces nouvelles manières de penser et de voir le monde ont des impacts sur l’écriture des sciences sociales contemporaines qui doivent les prendre en charge (Berthelot, 2001 et 2003). Notre nouvelle manière d’interroger l’épistémologie de la géographie doit donc également s’accompagner d’un profond aggiornamento des protocoles d’écriture : le projet de rendre compte ici d’une totalité, c’est-à-dire la géographie entendue à la fois comme une discipline, des méthodes, une institution, un corps social et des acteurs qui, tous, évoluent dans le temps, oblige à repenser une écriture qui ne peut être qu’un simple récit, dans la mesure où ce projet récuse même le principe d’une approche chronologique de la discipline.
Table des matières
LIVRE PREMIER – RÉFLEXIVITÉ
« Faisons comme si »
Les paradoxes d’Alice
Principe de symétrie
Réflexivité, imaginaire et production des savoirs
Un imaginaire à explorer
Un objet scientifique total
Les terrains du terrain
LIVRE DEUXIÈME – CONSTRUCTION
Introduction : Penser/classer
La construction du regard
L’oeil du géographe
Le terrain sous l’oeil du maître
Le terrain à côté
Observer l’observation
La controverse : regards disciplinaires
En quête du terrain
La production du texte
Séparer le terrain du lieu vrai
Carnets de terrain
Ecriture et réflexivité
Des écritures référentielles
Usages savants
Terrain public
La généalogie du discours
La géographie, ça se fait, d’abord, sur le terrain
Terrain d’affrontement
Parcours de la méconnaissance
La double contrainte comme préliminaire du rite initiatique
Sur le terrain si j’y suis
Un terrain désormais polyphonique
Conclusion : Tentative d’épuisement de la crise
LIVRE TROISIÈME – LABYRINTHE
Introduction : Vivre ensemble ?
La prolifération des récits
La geste des gestes du terrain
La crise de la géographie et la fin des métarécits
L’avènement des micro-récits
Les communautés interprétatives
La multiplication des identités
Le géographe de terrain, une figure historiquement construite
Le mot et la chose
Dis-moi comment tu fais du terrain, je te dirai qui tu es.
Dis-moi où tu fais du terrain, je te dirai qui tu es.
Un capital spatial
La justification de la scientificité
In medias res
« L’histoire est entièrement vraie, puisque je l’ai imaginée d’un bout à l’autre »
D’un mode de véridiction à un autre
Une science ou un savoir ?
Conclusion : « Il faut avoir un point fixe pour en juger »
LIVRE QUATRIÈME – DÉCONSTRUCTION
Introduction : Le pacte de terrain
L’invention de l’objet
L’offre et la demande
Au commencement étaient les livres
Le recours à l’archive
La création des formes
Ma présence in abstentia
Le cheminement
« Ce n’est pas une image juste, c’est juste une image »
Qu’est-ce que le terrain ?
Le « faire » du terrain
Le terrain : un acteur réseau
Une espèce d’espace
Conclusion : Tenir ensemble
Bibliographie