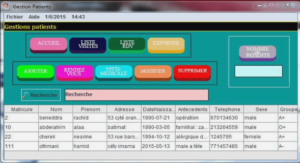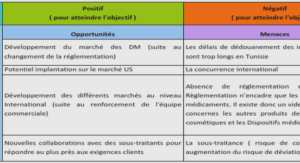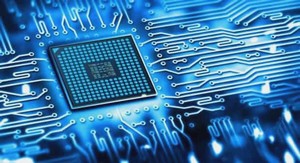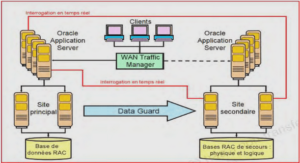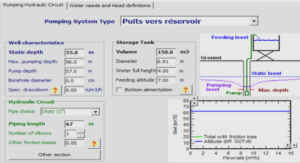La victime, un artefact social du conflit
Victimologie, reconstruction et politique Depuis les années 1980, les victimes se sont vues accorder un statut et une préséance jusqu’alors inédite au sein de la justice transitionnelle27. Certes, la consécration des victimes ne se limite pas à ce domaine. « Société des victimes28 », « ère des victimes29 », « temps des victimes30 », autant d’expressions qui mettent de l’avant le sentiment que « [les] victimes ont tout envahi : les imaginaires, les médias et la politique […]31 ». Cette impression résulte, notamment, de la convergence de trois phénomènes — l’essor important de la psychiatrie, l’avènement de l’individu comme sujet du droit national et international ainsi que des multiples luttes pour la reconnaissance politique et mémorielle qui en ont découlé32 — trois évènements qui ont fait des « victimes », une catégorie d’acteurs désormais incontournable. Cependant, l’importance accordée aux victimes dans le champ de la justice d’après-guerre est particulièrement révélatrice. Absentes lors du Tribunal de Nuremberg, la présence des victimes parait dorénavant indissociable de la réussite des procédures visant à faire la vérité sur les exactions du passé et à lutter contre l’impunité afin de construire, ultimement, un avenir sur des bases renouvelées33 . C’est désormais au nom des victimes que les mécanismes de justice transitionnelle sont mis en place, si ce n’est pas directement en réponse à leurs revendications34. À ce titre, pensons au cas emblématique de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP – Commission nationale sur la disparition de personnes) qui a découlé de l’activisme des Madres de la Plaza de Mayo (ou Mères de la place de Mai) en Argentine Tandis que les victimes sont peu à peu devenues un enjeu dans l’espace juridique, la criminologie s’est dotée d’une branche spécifique pour étudier cette catégorie sociale, la victimologie36. Les pionniers de ce champ d’études, tels que Benjamin Mendelsohn, Hans von Hentig et Marvin Wolfgang, se sont d’abord intéressés à ce que l’examen des victimes pouvait amener à la compréhension du crime37. Ce n’est qu’avec la dénonciation des disparitions forcées en Amérique latine par la communauté internationale que les victimes des violences politiques sont devenues un champ d’études pour quelques victimologues38. En parallèle, les victimes ont aussi reçu l’attention de la science politique. Essentiellement abordées dans des études portant sur la mémoire collective39 et sur les mobilisations sociales40, les victimes sont devenues, depuis peu, un objet à part entière des recherches sur les conflits41 . Bien que ces trois disciplines — le droit, la criminologie et la science politique — semblent indispensables pour définir la notion de victime, nous désirons essentiellement susciter un questionnement de cet objet d’étude dont la science politique se saisit trop souvent sans interroger les luttes de signification qui entourent la définition même du terme de victime et les multiples usages qui en sont faits42. Dans le langage courant, le terme « victime » est employé pour désigner la personne ayant subi un préjudice ou la partie lésée dans ses droits civils et politiques, voire sociaux43. Partant de cette conception familière, nous souhaitons mettre en évidence les enjeux définitionnels qui entourent le terme de victime dans un contexte de transition politique, en nous attardant plus spécifiquement aux commissions de vérité en tant que mécanisme de justice transitionnelle. Pour ce faire, une lecture simultanée de la littérature en science politique et en criminologie apparaît comme la démarche la plus adaptée. La première partie de ce chapitre est donc consacrée à la figure de la victime, par rapport à celle qui lui est antinomique, l’agresseur. Cependant, les commissions de vérité sont également des « entrepreneurs mémoriels » et, en tant qu’émetteur d’un discours sur les violences politiques, elles contribuent à définir les victimes. Aussi, la deuxième partie de ce chapitre s’attarde plus longuement sur les commissions de vérité en tant que processus de cadrage de la catégorie victimaire.
La justice « pour » les victimes : une approche légaliste
Puisque les commissions de vérité sont principalement des mécanismes instaurés lorsqu’une société, à la sortie d’un conflit violent, souhaite tourner la page sur son passé trouble, il est parfois plus facile de circonscrire la catégorie de victimes à l’aide de chiffres et de statistiques, plutôt que d’en donner une définition substantielle44. Néanmoins, dans une volonté de dépasser la logique du dénombrement, le droit international propose une littérature abondante faisant référence à la définition des victimes de violences politiques. Divers instruments du droit international offrent d’ailleurs une définition de ce type de victimes 45, tels que la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir46 , les Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire47 et dans le Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale internationale48 . Bien qu’un certain nombre d’éléments définitionnels soient partagés par ces traités internationaux, il existe, néanmoins, des divergences significatives ; c’est dire à quel point la définition de la victime ne fait pas consensus. L’idée de victimes en tant qu’objets du droit trouve écho dans la littérature sur les commissions de vérité. Ces approches, basées essentiellement sur les droits humains (rights-based approaches), définissent les victimes en fonction des normes du droit international49. La conception des victimes se construit alors en référence à la nature des crimes qu’elles ont subis (par exemple, victimes de violences sexuelles, de disparitions forcées, violations de droits humains, etc.), ainsi qu’aux caractérisations de ces crimes (telles que crime contre l’humanité, génocide, politicide, etc.). Cette approche se traduit aussi dans le discours des commissions de vérité, où la « vérité » rapportée est souvent exprimée à l’aide du langage juridique50. Ce cadrage légaliste se perçoit, notamment, par les titres à connotation « juridico-légale » conférés aux victimes en fonction des rôles qui leur sont attribués au sein des commissions de vérité (victime-témoin, bénéficiaire, représentant, etc.). Autre référence aux instruments de droit international, les commissions de vérité peuvent concevoir des divisions entre victimes « directes » et « indirectes », en essayant de capturer l’ampleur de la douleur causée à la victime. En effet, l’impossibilité évidente des individus touchés de plein fouet par les violences à venir témoigner — les victimes directes ou primaires — fait en sorte que ce sont les proches — les victimes indirectes ou secondaires — qui viendront participer à l’effort d’éclaircissement du passé. Au demeurant, la distinction entre la personne ayant expérimenté directement la violence et la douleur ressentie par la personne de son entourage ne se fait pas sans difficulté comme l’a remarqué la Commission de Vérité et de Réconciliation sudafricaine51 . Les fréquents recours aux paradigmes des droits humains dans les discours des commissions de vérités s’expliquent, entre autres, par les nombreux mouvements d’opposition à des régimes dictatoriaux qui ont adhéré au plaidoyer en faveur des droits fondamentaux afin de s’assurer du soutien de la communauté internationale, et ce, au détriment de considérations idéologiques et/ou politiques qui cimentaient ces mobilisations sociales.