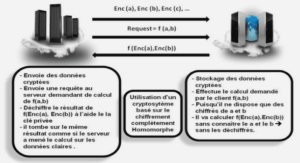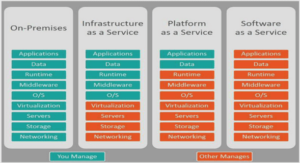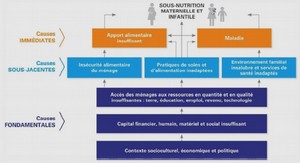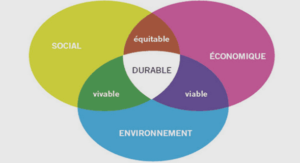LES VOYAGES DE GULLIVER
VOYAGE À LILLIPUT
Chapitre I
L’auteur rend un compte succinct des premiers motifs qui le portèrent à voyager. Il fait naufrage et se sauve à la nage dans le pays de Lilliput. On l’enchaîne et on le conduit en cet état plus avant dans les terres.
Mon père, dont le bien, situé dans la province de Nottingham, était médiocre, avait cinq fils : j’étais le troisième, et il m’envoya au collège d’Emmanuel, à Cambridge, à l’âge de quatorze ans. J’y demeurai trois années, que j’employai utilement. Mais la dépense de mon entretien au collège était trop grande, on me mit en apprentissage sous M. Jacques Bates, fameux chirurgien à Londres, chez qui je demeurai quatre ans. Mon père m’envoyant de temps en temps quelques petites sommes d’argent, je les employai à apprendre le pilotage et les autres parties des mathématiques les plus nécessaires à ceux qui forment le dessein de voyager sur mer, ce que je prévoyais être ma destinée. Ayant quitté M. Bâtes, je retournai chez mon père ; et, tant de lui que de mon oncle Jean et de quelques autres parents, je tirai la somme de quarante livres sterling par an pour me soutenir à Leyde. Je m’y rendis et m’y appliquai à l’étude de la médecine pendant deux ans et sept mois, persuadé qu’elle me serait un jour très utile dans mes voyages.
Bientôt après mon retour de Leyde, j’eus, à la recommandation de mon bon maître M. Bates, l’emploi de chirurgien sur l’Hirondelle, où je restai trois ans et demi, sous le capitaine Abraham Panell, commandant. Je fis pendant ce temps-là des voyages au Levant et ailleurs. À mon retour, je résolus de m’établir à Londres. M. Bates m’encouragea à prendre ce parti, et me recommanda à ses malades. Je louai un appartement dans un petit hôtel situé dans le quartier appelé Old-Jewry, et bientôt après j’épousai Melle Marie Burton, seconde fille de M. Edouard Burton, marchand dans la rue de Newgate, laquelle m’apporta quatre cents livres sterling en mariage.
Mais mon cher maître M. Bâtes étant mort deux ans après, et n’ayant plus de protecteur, ma pratique commença à diminuer. Ma conscience ne me permettait pas d’imiter la conduite de la plupart des chirurgiens, dont la science est trop semblable à celle des procureurs : c’est pourquoi, après avoir consulté ma femme et quelques autres de mes intimes amis, je pris la résolution de faire encore un voyage de mer. Je fus chirurgien successivement dans deux vaisseaux ; et plusieurs autres voyages que je fis, pendant six ans, aux Indes orientales et occidentales, augmentèrent un peu ma petite fortune. J’employais mon loisir à lire les meilleurs auteurs anciens et modernes, étant toujours fourni d’un certain nombre de livres, et, quand je me trouvais à terre, je ne négligeais pas de remarquer les mœurs et les coutumes des peuples, et d’apprendre en même temps la langue du pays, ce qui me coûtait peu, ayant la mémoire très bonne.Le dernier de ces voyages n’ayant pas été heureux, je me trouvai dégoûté de la mer, et je pris le parti de rester chez moi avec ma femme et mes enfants. Je changeai de demeure, et me transportai de l’Old-Jewry à la rue de Fetter-Lane, et de là à Wapping, dans l’espérance d’avoir de la pratique parmi les matelots ; mais je n’y trouvai pas mon compte.Après avoir attendu trois ans, et espéré en vain que mes affaires iraient mieux, j’acceptai un parti avantageux qui me fut proposé par le capitaine Guillaume Prichard, prêt à monter l’Antilope et à partir pour la mer du Sud. Nous nous embarquâmes à Bristol, le 4 de mai 1699, et notre voyage fut d’abord très heureux.
Il est inutile d’ennuyer le lecteur par le détail de nos aventures dans ces mers ; c’est assez de lui faire savoir que, dans notre passage aux Indes orientales, nous essuyâmes une tempête dont la violence nous poussa ; vers le nord-ouest de la terre de Van-Diemen. Par une observation que je fis, je trouvai que nous étions à 30° 2’ de latitude méridionale. Douze hommes de notre équipage étaient morts par le travail excessif et par la mauvaise nourriture. Le 5 novembre, qui était le commencement de l’été dans ces pays-là, le temps étant un peu noir, les mariniers aperçurent un roc qui n’était éloigné du vaisseau que de la longueur d’un câble ; mais le vent était si fort que nous fûmes directement poussés contre l’écueil, et que nous échouâmes dans un moment. Six hommes de l’équipage, dont j’étais un, s’étant jetés à propos dans la chaloupe, trouvèrent le moyen de se débarrasser du vaisseau et du roc. Nous allâmes à la rame environ trois lieues ; mais à la fin la lassitude ne nous permit plus de ramer ; entièrement épuisés, nous nous abandonnâmes au gré des flots, et bientôt nous fûmes renversés par un coup de vent du nord :
Je ne sais quel fut le sort de mes camarades de la chaloupe, ni de ceux qui se sauvèrent sur le roc, ou qui restèrent dans le vaisseau ; mais je crois qu’ils périrent tous ; pour moi, je nageai à l’aventure, et fus poussé, vers la terre par le vent et la marée. Je laissai souvent tomber mes jambes, mais sans toucher le fond. Enfin, étant près de m’abandonner, je trouvai pied dans l’eau, et alors la tempête était bien diminuée. Comme la pente était presque insensible, je marchai une demi-lieue dans la mer avant que j’eusse pris terre. Je fis environ un quart de lieue sans découvrir aucune maison ni aucun vestige d’habitants, quoique ce pays fût très peuplé. La fatigue, la chaleur et une demi-pinte d’eau-de-vie que j’avais bue en abandonnant le vaisseau, tout cela m’excita à dormir. Je me couchai sur l’herbe, qui était très fine, où je fus bientôt enseveli dans un profond sommeil, qui dura neuf heures. Au bout de ce temps-là, m’étant éveillé, j’essayai de me lever ; mais ce fut en vain. Je m’étais couché sur le dos ; je trouvai mes bras et mes jambes attachés à la terre de l’un et de l’autre côté, et mes cheveux attachés de la même manière. Je trouvai même plusieurs ligatures très minces qui entouraient mon corps, depuis mes aisselles jusqu’à mes cuisses. Je ne pouvais que regarder en haut ; le soleil commençait à être fort chaud, et sa grande clarté blessait mes yeux. J’entendis un bruit confus autour de moi, mais, dans la posture où j’étais, je ne pouvais rien voir que le soleil. Bientôt je sentis remuer quelque chose sur ma jambe gauche, et cette chose, avançant doucement sur ma poitrine, monter presque jusqu’à mon menton. Quel fut mon étonnement lorsque j’aperçus une petite figure de créature humaine haute tout au plus de trois pouces, un arc et une flèche à la main, avec un carquois sur le dos ! J’en vis en même temps au moins quarante autres de la même espèce. Je me mis soudain à jeter des cris si horribles, que tous ces petits animaux se retirèrent transis de peur ; et il y en eut même quelques-uns, comme je l’ai appris ensuite, qui furent dangereusement blessés par les chutes précipitées qu’ils firent en sautant de dessus mon corps à terre. Néanmoins ils revinrent bientôt, et l’un d’eux, qui eut la hardiesse de s’avancer si près qu’il fut en état de voir entièrement mon visage, levant les mains et les yeux par une espèce d’admiration, s’écria d’une voix aigre, mais distincte : Hekinah Degul. Les autres répétèrent plusieurs fois les mêmes mots ; mais alors je n’en compris pas le sens. J’étais, pendant ce temps-là, étonné, inquiet, troublé, et tel que serait le lecteur en pareille situation. Enfin, faisant des efforts pour me mettre en liberté, j’eus le bonheur de rompre les cordons ou fils, et d’arracher les chevilles qui attachaient mon bras droit à la terre ; car, en le haussant un peu, j’avais découvert ce qui me tenait attaché et captif. En même temps, par une secousse violente qui me causa une douleur extrême, je lâchai un peu les cordons qui attachaient mes cheveux du côté droit (cordons plus fins que mes cheveux mêmes), en sorte que je me trouvai en état de procurer à ma tête un petit mouvement libre. Alors ces insectes humains se mirent en fuite et poussèrent des cris très aigus. Ce bruit cessant, j’entendis un d’eux s’écrier : Tolgo Phonac, et aussitôt je me sentis percé à la main de plus de cent flèches qui me piquaient comme autant d’aiguilles. Ils firent ensuite une autre décharge en l’air, comme nous tirons des bombes en Europe, dont plusieurs, je crois, tombaient paraboliquement sur mon corps, quoique je ne les aperçusse pas, et d’autres sur mon visage, que je tâchai de découvrir avec ma main droite. Quand cette grêle de flèches fut passée, je m’efforçai encore de me détacher ; mais on fit alors une autre décharge plus grande que la première, et quelques-uns tâchaient de me percer de leurs lances ; mais, par bonheur, je portais une veste impénétrable de peau de buffle. Je crus donc que le meilleur parti était de me tenir en repos et de rester comme j’étais jusqu’à la nuit ; qu’alors, dégageant mon bras gauche, je pourrais me mettre tout à fait en liberté, et, à l’égard dos habitants, c’était avec raison que je me croyais d’une force égale aux plus puissantes armées qu’ils pourraient mettre sur pied pour m’attaquer, s’ils étaient tous de la même taille que ceux que j’avais vus jusque-là. Mais la fortune me réservait un autre sort.
VOYAGE À BROBDINGNAG
Chapitre I
L’auteur, après avoir essuyé une grande tempête, se met dans une chaloupe pour descendre à terre et est saisi par un des habitants du pays. Comment il en est traité. Idée du pays et du peuple.Ayant été condamné par la nature et par la fortune à une vie agitée, deux mois après mon retour, comme j’ai dit, j’abandonnai encore mon pays natal et je m’embarquai, le 20 juin 1702, sur un vaisseau nommé l’Aventure, dont le capitaine Jean Nicolas, de la province de Cornouailles, partait pour Surate. Nous eûmes le vent très favorable jusqu’à la hauteur du cap de Bonne-Espérance, où nous mouillâmes pour faire aiguade. Notre capitaine se trouvant alors incommodé d’une fièvre intermittente, nous ne pûmes quitter le cap qu’à la fin du mois de mars. Alors, nous remîmes à la voile, et notre voyage fut heureux jusqu’au détroit de Madagascar ; mais étant arrivés au nord de cette île, les vents qui dans ces mers soufflent toujours également entre le nord et l’ouest, depuis le commencement de décembre jusqu’au commencement de mai, commencèrent le 29 avril à souffler très violemment du côté de l’ouest, ce qui dura vingt jours de suite, pendant lesquels nous fûmes poussés un peu à l’orient des îles Moluques et environ à trois degrés au nord de la ligne équinoxiale, ce que notre capitaine découvrit par son estimation faite le second jour de mai, que le vent cessa ; mais, étant homme très expérimenté dans la navigation de ces mers, il nous ordonna de nous préparer pour le lendemain à une terrible tempête : ce qui ne manqua pas d’arriver. Un vent du sud, appelé mousson, commença à s’élever. Appréhendant que le vent ne devînt trop fort, nous serrâmes la voile du beaupré et mîmes à la cape pour serrer la misaine ; mais, l’orage augmentant toujours, nous fîmes attacher les canons et serrâmes la misaine. Le vaisseau était au large, et ainsi nous crûmes que le meilleur parti à prendre était d’aller vent derrière. Nous rivâmes la misaine et bordâmes les écoutes ; le timon était devers le vent, et le navire se gouvernait bien. Nous mîmes hors la grande voile ; mais elle fut déchirée par la violence du temps. Après, nous amenâmes la grande vergue pour la dégréer, et coupâmes tous les cordages et le robinet qui la tenaient. La mer était très haute, les vagues se brisant les unes contre les autres. Nous tirâmes les bras du timon et aidâmes au timonier, qui ne pouvait gouverner seul. Nous ne voulions pas amener le mât du grand hunier, parce que le vaisseau se gouvernait mieux allant avec la mer, et nous étions persuadés qu’il ferait mieux son chemin le mat gréé.
Voyant que nous étions assez au large après la tempête, nous mîmes hors la misaine et la grande voile, et gouvernâmes près du vent ; après nous mîmes hors l’artimon, le grand et le petit hunier. Notre route était est-nord-est ; le vent était au sud-ouest. Nous amarrâmes à tribord et démarrâmes le bras de dévers le vent, brassâmes les boulines, et mîmes le navire au plus près du vent, toutes les voiles portant. Pendant cet orage, qui fut suivi d’un vent impétueux d’est-sud-ouest, nous fûmes poussés, selon mon calcul, environ cinq cents lieues vers l’orient, en sorte que le plus vieux et le plus expérimenté des mariniers ne sut nous dire en quelle partie du monde nous étions. Cependant les vivres ne nous manquaient pas, notre vaisseau ne faisait point d’eau, et notre équipage était en bonne santé ; mais nous étions réduits à une très grande disette d’eau. Nous jugeâmes plus à propos de continuer la même route que de tourner au nord, ce qui nous aurait peut-être portés aux parties de la Grande-Tartarie qui sont le plus au nord-ouest et dans la mer Glaciale.
Le seizième de juin 1703, un garçon découvrit la terre du haut du perroquet ; le dix-septième, nous vîmes clairement une grande île ou un continent (car nous ne sûmes pas lequel des deux), sur le côté droit duquel il y avait une petite langue de terre qui s’avançait dans la mer, et une petite baie trop basse pour qu’un vaisseau de plus de cent tonneaux pût y entrer. Nous jetâmes l’ancre à une lieue de cette petite baie ; notre capitaine envoya douze hommes de son équipage bien armés dans la chaloupe, avec des vases pour l’eau si l’on pouvait en trouver. Je lui demandai la permission d’aller avec eux pour voir le pays et faire toutes les découvertes que je pourrais. Quand nous fûmes à terre, nous ne vîmes ni rivière, ni fontaines, ni aucuns vestiges d’habitants, ce qui obligea nos gens à côtoyer le rivage pour chercher de l’eau fraîche proche de la mer. Pour moi, je me promenai seul, et avançai environ un mille dans les terres, où je ne remarquai qu’un pays stérile et plein de rochers. Je commençais à me lasser, et, ne voyant rien qui pût satisfaire ma curiosité, je m’en retournais doucement vers la petite baie, lorsque je vis nos hommes sur la chaloupe qui semblaient tâcher, à force de rames, de sauver leur vie, et je remarquai en même temps qu’ils étaient poursuivis par un homme d’une grandeur prodigieuse. Quoiqu’il fût entré dans la mer, il n’avait de l’eau que jusqu’aux genoux et faisait des enjambées étonnantes ; mais nos gens avaient pris le devant d’une demi-lieue, et, la mer étant en cet endroit pleine de rochers, le grand homme ne put atteindre la chaloupe. Pour moi, je me mis à fuir aussi vite que je pus, et je grimpai jusqu’au sommet d’une montagne escarpée, qui me donna le moyen de voir une partie du pays. Je le trouvai parfaitement bien cultivé ; mais ce qui me surprit d’abord fut la grandeur de l’herbe, qui me parut avoir plus de vingt pieds de hauteur.
Je pris un grand chemin, qui me parut tel, quoiqu’il ne fût pour les habitants qu’un petit sentier qui traversait un champ d’orge. Là, je marchai pendant quelque temps ; mais je ne pouvais presque rien voir, le temps de la moisson étant proche et les blés étant de quarante pieds au moins. Je marchai pendant une heure avant que je pusse arriver à l’extrémité de ce champ, qui était enclos d’une haie haute au moins de cent vingt pieds ; pour les arbres, ils étaient si grands, qu’il me fut impossible d’en supputer la hauteur.
Je tâchais de trouver quelque ouverture dans la haie, quand je découvris un des habitants dans le champ prochain, de la même taille que celui que j’avais vu dans la mer poursuivant notre chaloupe. Il me parut aussi haut qu’un clocher ordinaire, et il faisait environ cinq toises à chaque enjambée, autant que je pus conjecturer. Je fus frappé d’une frayeur extrême, et je courus me cacher dans le blé, d’où je le vis s’arrêter à une ouverture de la haie, jetant les yeux çà et là et appelant d’une voix plus grosse et plus retentissante que si elle fût sortie d’un porte-voix ; le son était si fort et si élevé dans l’air que d’abord je crus entendre le tonnerre.