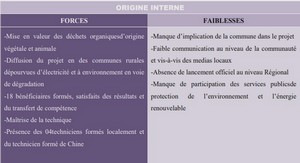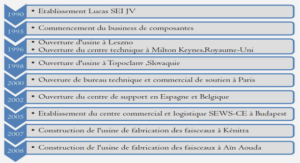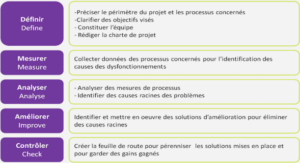Nouvelles réalistes et fantastiques du XIXème siècle
La Dot de Maupassant
(nouvelle parue dans le Gil Blas, 1884)
Personne ne s’étonna du mariage de maître Simon Lebrument avec Mlle Jeanne Cordier. Maître Lebrument venait d’acheter l’étude de notaire de maître Papillon ; il fallait, bien entendu, de l’argent pour la payer ; et Mlle Jeanne Cordier avait trois cent mille francs liquides, en billets de banque et en titres au porteur. Maître Lebrument était un beau garçon, qui avait du chic, un chic notaire, un chic province, mais enfin du chic, ce qui était rare à Boutigny-le-Rebours.Mlle Cordier avait de la grâce et de la fraîcheur, de la grâce un peu gauche et de la fraîcheur un peu fagotée ; mais c’était, en somme, une belle fille désirable et fêtable.La cérémonie d’épousailles mit tout Boutigny sens dessus dessous.On admira fort les mariés, qui rentrèrent cacher leur bonheur au domicile conjugal, ayant résolu de faire tout simplement un petit voyage à Paris après quelques jours de tête-à-tête.Il fut charmant, ce tête-à-tête, maître Lebrument ayant su apporter dans ses premiers rapports avec sa femme une adresse, une délicatesse et un à-propos remarquables. Il avait pris pour devise : « Tout vient à point à qui sait attendre. » Il sut être en même temps patient et énergique. Le succès fut rapide et complet.
Au bout de quatre jours, Mme Lebrument adorait son mari.
Elle ne pouvait plus se passer de lui, il fallait qu’elle l’eût tout le jour près d’elle pour le caresser, l’embrasser, lui tripoter les mains, la barbe, le nez, etc. Elle s’asseyait sur ses genoux, et, le prenant par les oreilles, elle disait : « Ouvre la bouche et ferme les yeux. » Il ouvrait la bouche avec confiance, fermait les yeux à moitié, et il recevait un bon baiser bien tendre, bien long, qui lui faisait passer de grands frissons dans le dos. Et à son tour il n’avait pas assez de caresses, pas assez de lèvres, pas assez de mains, pas assez de toute sa personne pour fêter sa femme du matin au soir et du soir au matin.
Une fois la première semaine écoulée, il dit à sa jeune compagne :
« Si tu veux, nous partirons pour Paris mardi prochain. Nous ferons comme les amoureux qui ne sont pas mariés, nous irons dans les restaurants, au théâtre, dans les cafés-concerts, partout, partout. » Elle sautait de joie.
« Oh ! oui, oh ! oui, allons-y le plus tôt possible. » Il reprit :
« Et puis, comme il ne faut rien oublier, préviens ton père de tenir ta dot toute prête ; je l’emporterai avec nous et je paierai par la même occasion maître Papillon. » Elle prononça :
« Je le lui dirai demain matin. » Et il la saisit dans ses bras pour recommencer le petit jeu de tendresse qu’elle aimait tant, depuis huit jours.
Le mardi suivant, le beau-père et la belle-mère accompagnèrent à la gare leur fille et leur gendre qui partaient pour la capitale.
Le beau-père disait :
« Je vous jure que c’est imprudent d’emporter tant d’argent dans votre portefeuille. » Et le jeune notaire souriait.
« Ne vous inquiétez de rien, beau-papa, j’ai l’habitude de ces choses-là. vous comprenez que, dans ma profession, il m’arrive quelquefois d’avoir près d’un million sur moi. De cette façon, au moins, nous évitons un tas de formalités et un tas de retards. Ne vous inquiétez de rien. » L’employé criait :
« Les voyageurs pour Paris en voiture. » Ils se précipitèrent dans un wagon où se trouvaient deux vieilles dames.
Lebrument murmura à l’oreille de sa femme :
« C’est ennuyeux, je ne pourrai pas fumer » Elle répondit tout bas :
« Moi aussi, ça m’ennuie bien, mais ça n’est pas à cause de ton cigare. » Le train siffla et partit. Le trajet dura une heure, pendant laquelle ils ne dirent pas grand-chose, car les deux vieilles dames ne dormaient point.
Dès qu’ils furent dans la cour de la gare Saint-Lazare, maître Lebrument dit à sa femme :
« Si tu veux, ma chérie, nous allons d’abord déjeuner au boulevard ; puis nous reviendrons tranquillement chercher notre malle pour la porter à l’hôtel. » Elle y consentit tout de suite.
« Oh oui, allons déjeuner au restaurant. Est-ce loin ? » Il reprit :
« Oui, un peu loin, mais nous allons prendre l’omnibus. » Elle s’étonna :
« Pourquoi ne prenons-nous pas un fiacre ?
Il se mit à la gronder en souriant :
« C’est comme ça que tu es économe, un fiacre pour cinq minutes de route, six sous par minute, tu ne te priverais de rien.
— C’est vrai » , dit-elle, un peu confuse.
Un gros omnibus passait, au trot des trois chevaux. Lebrument cria :
« Conducteur ! eh ! conducteur ! » La lourde voiture s’arrêta. Et le jeune notaire, poussant sa femme, lui dit, très vite :
« Monte dans l’intérieur moi, je grimpe dessus pour fumer au moins une cigarette avant mon déjeuner » Elle n’eut pas le temps de répondre ; le conducteur, qui l’avait saisie par le bras pour l’aider à escalader le marchepied, la précipita dans sa voiture, et elle tomba, effarée, sur une banquette, regardant avec stupeur par la vitre de derrière, les pieds de son mari qui grimpait sur l’impériale.
Et elle demeura immobile entre un gros monsieur qui sentait la pipe et une vieille femme qui sentait le chien.
Tous les autres voyageurs, alignés et muets — un garçon épicier, une ouvrière, un sergent d’infanterie, un monsieur à lunettes d’or coiffé d’un chapeau de soie aux bords énormes et relevés comme des gouttières, deux dames à l’air important et grincheux, qui semblaient dire par leur attitude : « Nous sommes ici, mais nous valons mieux que ça » , deux bonnes sœurs, une fille en cheveux et un croque-mort, avaient l’air d’une collection de caricatures, d’un musée des grotesques, d’une série de charges de la face humaine, semblables à ces rangées de pantins comiques qu’on abat, dans les foires, avec des balles.
Les cahots de la voiture ballottaient un peu leurs têtes, les secouaient, faisaient trembloter la peau flasque des joues ; et, la trépidation des roues les abrutissant, ils semblaient idiots et endormis.
La jeune femme demeurait inerte :
« Pourquoi n’est-il pas venu avec moi ? » se disait-elle. Une tristesse vague l’oppressait. Il aurait bien pu, vraiment, se priver de cette cigarette.
Les bonnes sœurs firent signe d’arrêter, puis elles sortirent l’une devant l’autre, répandant une odeur fade de vieille jupe.
On repartit, puis on s’arrêta de nouveau. Et une cuisinière monta, rouge, essoufflée. Elle s’assit et posa sur ses genoux son panier aux provisions. Une forte senteur d’eau de vaisselle se répandit dans l’omnibus.
« C’est plus loin que je n’aurais cru » , pensait Jeanne.
Le croque-mort s’en alla et fut remplacé par un cocher qui fleurait l’écurie. La fille en cheveux eut pour successeur un commissionnaire dont les pieds exhalaient le parfum de ses courses.
La notairesse se sentait mal à l’aise, écœurée, prête à pleurer sans savoir pourquoi.
D’autres personnes descendirent, d’autres montèrent. L’omnibus allait toujours par les interminables rues, s’arrêtait aux stations, se remettait en route.
Rose de Maupassant
(Contes du jour et de la nuit, 1885)
Les deux jeunes femmes ont l’air ensevelies sous une couche de fleurs. Elles sont seules dans l’immense landau chargé de bouquets comme une corbeille géante. Sur la banquette du devant, deux bannettes de satin blanc sont pleines de violettes de Nice, et sur la peau d’ours qui couvre les genoux un amoncellement de roses, de mimosas, de giroflées, de marguerites, de tubéreuses et de fleurs d’oranger, noués avec des faveurs de soie, semble écraser les deux corps délicats, ne laissant sortir de ce lit éclatant et parfumé que les épaules, les bras et un peu des corsages dont l’un est bleu et l’autre lilas.
Le fouet du cocher porte un fourreau d’anémones, les traits des chevaux sont capitonnés avec des ravenelles, les rayons des roues sont vêtus de réséda ; et, à la place des lanternes, deux bouquets ronds, énormes, ont l’air des deux yeux étranges de cette bête roulante et fleurie.
Le landau parcourt au grand trot la route, la rue d’Antibes, précédé, suivi, accompagné par une foule d’autres voitures enguirlandées, pleines de femmes disparues sous un flot de violettes. Car c’est la fête des fleurs à Cannes.
On arrive au boulevard de la Foncière, où la bataille a lieu. Tout le long de l’immense avenue, une double file d’équipages enguirlandés va et revient comme un ruban sans fin. De l’un à l’autre on se jette des fleurs. Elles passent dans l’air comme des balles, vont frapper les frais visages, voltigent et retombent dans la poussière où une armée de gamins les ramasse.
Une foule compacte, rangée sur les trottoirs, et maintenue par les gendarmes à cheval qui passent brutalement et repoussent les curieux à pied comme pour ne point permettre aux vilains de se mêler aux riches, regarde, bruyante et tranquille.
Dans les voitures on s’appelle, on se reconnaît, on se mitraille avec des roses. Un char plein de jolies femmes vêtues de rouge comme des diables, attire et séduit les yeux. Un monsieur qui ressemble aux portraits d’Henri IV lance avec une ardeur joyeuse un énorme bouquet retenu par un élastique. Sous la menace du choc les femmes se cachent les yeux et les hommes baissent la tête, mais le projectile gracieux, rapide et docile, décrit une courbe et revient à son maître qui le jette aussitôt vers une figure nouvelle.
Les deux jeunes femmes vident à pleines mains leur arsenal et reçoivent une grêle de bouquets ; puis, après une heure de bataille, un peu lasses enfin, elles ordonnent au cocher de suivre la route du golfe Juan, qui longe la mer.
Le soleil disparaît derrière l’Esterel, dessinant en noir, sur un couchant de feu, la silhouette dentelée de la longue montagne. La mer calme s’étend, bleue et claire, jusqu’à l’horizon où elle se mêle au ciel, et l’escadre, ancrée au milieu du golfe, a l’air d’un troupeau de bêtes monstrueuses, immobiles sur l’eau, animaux apocalyptiques, cuirassés et bossus, coiffés de mâts frêles comme des plumes, et avec des yeux qui s’allument quand vient la nuit.
Les jeunes femmes, étendues sous la lourde fourrure, regardent languissamment. L’une dit enfin :
— Comme il y a des soirs délicieux, où tout semble bon. N’est-ce pas, Margot ?
L’autre reprit :
— Oui, c’est bon. Mais il manque toujours quelque chose.
— Quoi donc ? Moi je me sens heureuse tout à fait. Je n’ai besoin de rien.
— Si. Tu n’y penses pas. Quel que soit le bien-être qui engourdit notre corps, nous désirons toujours quelque chose de plus… pour le cœur.
Et l’autre, souriant :
— Un peu d’amour ?
— Oui.
Elles se turent, regardant devant elles, puis celle qui s’appelait Marguerite murmura : La vie ne me semble pas supportable sans cela. J’ai besoin d’être aimée, ne fût-ce que par un chien. Nous sommes toutes ainsi, d’ailleurs, quoi que tu en dises, Simone.
— Mais non, ma chère. J’aime mieux n’être pas aimée du tout que de l’être par n’importe qui. Crois-tu que cela me serait agréable, par exemple, d’être aimée par… par…
Elle cherchait par qui elle pourrait bien être aimée, parcourant de l’œil le vaste paysage. Ses yeux, après avoir fait le tour de l’horizon, tombèrent sur les deux boutons de métal qui luisaient dans le dos du cocher, et elle reprit, en riant : « par mon cocher. »
Mme Margot sourit à peine et prononça, à voix basse :
— Je t’assure que c’est très amusant d’être aimée par un domestique. Cela m’est arrivé deux ou trois fois. Ils roulent des yeux si drôles que c’est à mourir de rire. Naturellement, on se montre d’autant plus sévère qu’ils sont plus amoureux, puis on les met à la porte, un jour, sous le premier prétexte venu parce qu’on deviendrait ridicule si quelqu’un s’en apercevait.
Mme Simone écoutait, le regard fixe devant elle, puis elle déclara :
— Non, décidément, le cœur de mon valet de pied ne me paraîtrait pas suffisant. Raconte-moi donc comment tu t’apercevais qu’ils t’aimaient.
— Je m’en apercevais comme avec les autres hommes, lorsqu’ils devenaient stupides.
— Les autres ne me paraissent pas si bêtes à moi, quand ils m’aiment.
— Idiots, ma chère, incapables de causer, de répondre, de comprendre quoi que ce soit.
— Mais toi, qu’est-ce que cela te faisait d’être aimée par un domestique. Tu étais quoi… émue… flattée ?
— Emue ? non ― flattée ― oui, un peu. On est toujours flatté de l’amour d’un homme quel qu’il soit.
— Oh, voyons, Margot !
— Si, ma chère. Tiens, je vais te dire une singulière aventure qui m’est arrivée. Tu verras comme c’est curieux et confus ce qui se passe en nous dans ces cas-là.
Il y aura quatre ans à l’automne, je me trouvais sans femme de chambre. J’en avais essayé l’une après l’autre cinq ou six qui étaient ineptes, et je désespérais presque d’en trouver une, quand je lus, dans les petites annonces d’un journal, qu’une jeune fille sachant coudre, broder, coiffer, cherchait une place, et qu’elle fournirait les meilleurs renseignements. Elle parlait en outre l’anglais.
J’écrivis à l’adresse indiquée, et, le lende main, la personne en question se présenta. Elle était assez grande, mince, un peu pâle, avec l’air très timide. Elle avait de beaux yeux noirs, un teint charmant, elle me plut tout de suite. Je lui demandai ses certificats ; elle m’en donna un en anglais, car elle sortait, disait-elle, de la maison de lady Rymwell, où elle était restée dix ans.
Le certificat attestait que la jeune fille était partie de son plein gré pour rentrer en France et qu’on n’avait eu à lui reprocher, pendant son long service, qu’un peu de coquetterie française.
La tournure pudibonde de la phrase anglaise me fit même un peu sourire et j’arrêtai sur-le-champ cette femme de chambre.
Elle entra chez moi le jour même ; elle se nommait Rose.
Au bout d’un mois je l’adorais.
C’était une trouvaille, une perle, un phénomène.
Elle savait coiffer avec un goût infini ; elle chiffonnait les dentelles d’un chapeau mieux que les meilleures modistes et elle savait même faire les robes.
J’étais stupéfaite de ses facultés. Jamais je ne m’étais trouvée servie ainsi.
Elle m’habillait rapidement avec une légèreté de mains étonnante. Jamais je ne sentais ses doigts sur ma peau, et rien ne m’est désagréable comme le contact d’une main de bonne. Je pris bientôt des habitudes de paresse excessives, tant il m’était agréable de me laisser vêtir, des pieds à la tête, et de la chemise aux gants, par cette grande fille timide, toujours un peu rougissante, et qui ne parlait jamais. Au sortir du bain, elle me frictionnait et me massait pendant que je sommeillais un peu sur mon divan ; je la considérais, ma foi, en amie de condition inférieure, plutôt qu’en simple domestique.
Or, un matin, mon concierge demanda avec mystère à me parler. Je fus surprise et je le fis entrer. C’était un homme très sûr, un vieux soldat, ancienne ordonnance de mon mari.
Il paraissait gêné de ce qu’il avait à dire. Enfin, il prononça en bredouillant :
— Madame, il y a en bas le commissaire de police du quartier.
Je demandai brusquement :
— Qu’est-ce qu’il veut ?
— Il veut faire une perquisition dans l’hôtel.
Certes, la police est utile, mais je la déteste. Je trouve que ce n’est pas là un métier noble. Et je répondis, irritée autant que blessée :
— Pourquoi cette perquisition ? À quel propos ? Il n’entrera pas.
Le concierge reprit :
— Il prétend qu’il y a un malfaiteur caché.
Cette fois j’eus peur et j’ordonnai d’introduire le commissaire de police auprès de moi pour avoir des explications. C’était un homme assez bien élevé, décoré de la Légion d’honneur. Il s’excusa, demanda pardon, puis m’affirma que j’avais, parmi les gens de service, un forçat !
Je fus révoltée ; je répondis que je garantissais tout le domestique de l’hôtel et je le passai en revue.
— Le concierge, Pierre Courtin, ancien soldat.
— Ce n’est pas lui.
— Le cocher François Pingau, un paysan champenois, fils d’un fermier de mon père.
— Ce n’est pas lui.
— Un valet d’écurie, pris en Champagne également, et toujours fils de paysans que je connais, plus un valet de pied que vous venez de voir.
— Ce n’est pas lui.
— Alors, monsieur, vous voyez bien que vous vous trompez.
— Pardon, madame, je suis sûr de ne pas me tromper. Comme il s’agit d’un criminel redoutable, voulez-vous avoir la gracieuseté de faire comparaître ici, devant vous et moi, tout votre monde ?
Je résistai d’abord, puis je cédai, et je fis monter tous mes gens, hommes et femmes.
Le commissaire de police les examina d’un seul coup d’œil, puis déclara :
— Ce n’est pas tout.
— Pardon, monsieur, il n’y a plus que ma femme de chambre, une jeune fille que vous ne pouvez confondre avec un forçat.
Il demanda :
— Puis-je la voir aussi ?
— Certainement.
Je sonnai Rose qui parut aussitôt. À peine fut-elle entrée que le commissaire fit un signe, et deux hommes que je n’avais pas vus, cachés derrière la porte, se jetèrent sur elle, lui saisirent les mains et les lièrent avec des cordes.
Je poussai un cri de fureur, et je voulus m’élancer pour la défendre. Le commissaire m’arrêta :
— Cette fille, madame, est un homme qui s’appelle Jean-Nicolas Lecapet, condamné à mort en 1879 pour assassinat précédé de viol. Sa peine fut commuée en prison perpétuelle. Il s’échappa voici quatre mois. Nous le cherchons depuis lors.J’étais affolée, atterrée. Je ne croyais pas. Le commissaire reprit en riant :
— Je ne puis vous donner qu’une preuve. Il a le bras droit tatoué. La manche fut relevée. C’était vrai. L’homme de police ajouta avec un certain mauvais goût
— Fiez-vous-en à nous pour les autres constatations.Et on emmena ma femme de chambre !