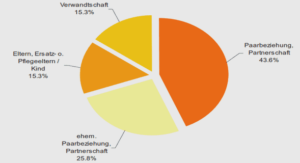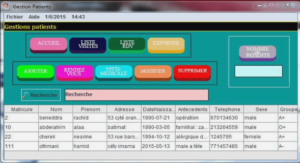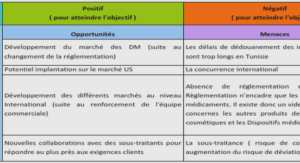La gestion de la nature pour le bien-être humain
« Le mot « gestion » est l’un des termes les plus employés à notre époque » (Génot, 2003). L’utilisation de ce terme à propos de l’environnement est devenue courante dans les discours scientifiques (e.g. « ecosystem management » (Grumbine, 1994; Roe and Van Eeten, 2002) et politiques (avec la « gestion des ressources naturelles »). Si la recherche de la maîtrise sur l’environnement n’est pas une démarche nouvelle, au vu des développements connus en zootechnie, en agronomie, et dans une moindre mesure à propos de la gestion de la faune sauvage (e.g. Messmer et al., 1999; Cvetkovich and Winter, 2003), la conception de la nature comme un « bien à administrer » est relativement récente. Des études scientifiques indiquent que nous sommes entrés dans une phase d’extinction de masse et que beaucoup d’écosystèmes ont été détruits ou sont en danger (Brooks et al., 2002). Contrairement aux précédentes crises d’extinctions massives, celle-ci se produit sur une période de temps réduite (Singh, 2002) -les taux seraient de 1000 à 10 000 fois supérieurs à ceux déterminés d’après les fossiles (Singh, 2002) – et pourrait être due aux activités humaines. Ces études présentent cependant des points faibles : les estimations du nombre d’espèces sont très variables, il est donc difficile d’apprécier l’intensité de l’extinction actuelle. Cependant, les études sur la crise de la biodiversité ont posé la question de la responsabilité des humains sur leur environnement et les impacts de sa modification pour la vie des « générations futures » (rapport Brundtland, 2010). En effet, l’érosion de la biodiversité menace les ressources dont nous disposons, et nombre d’exemples mettent en évidence la responsabilité humaine dans la « crise environnementale » (Larrère et Larrère, 1997). La crise est « une multitude de dommages précis, de pollutions localisées, de dangers identifiés, mais aussi de catastrophes exemplaires (Seveso, Bhopal, Tchernobyl, la « mort de la mer d’Aral », les « marées noires »…) et jusqu’à la probable menace qui pèse sur nos ressources (érosion de la diversité biologique, déforestation des régions tropicales) ou sur La gestion de la nature pour le bien-être humain. Chapitre I – Introduction 2 notre vie (déchirure de la couche d’ozone, effet de serre etc..) » (Larrère et Larrère, 1997). La crise de la biodiversité a ainsi été reconnue sur la scène politique, à travers plusieurs sommets et accords internationaux comme la Convention sur la Diversité Biologique (1992), le protocole de Kyoto (1997), le protocole de Nagoya (2010), et des textes nationaux comme la stratégie nationale pour la biodiversité (2004) et le Grenelle de l’environnement (2007). Les préoccupations locales concernant la conservation d’espaces et d’espèces, laissent la place à l’appréhension d’une nature globale, dont la conservation devient un enjeu planétaire (Larrère et Larrère, 1997). Dans la sphère scientifique, les sciences de la conservation qui ont une vocation à l’action (Maris, 2006), tendent vers l’interdisciplinarité, dont l’importance est soulignée par Balmford et Cowling (2006): « The key to increasing the future contribution of biologists to on-the-ground conservation interventions lies in accepting that reality [that conservation is primarily not about biology but about people and the choices they make] and in working much more closely with experts from other disciplines, especially social sciences ». Au-delà des techniques de réintroduction ou de restauration des populations, la conservation de la biodiversité est une problématique politique, au sens large du terme. Son application sur le terrain dépend alors des arguments dont les chercheurs, les organisations et les associations pour la protection de l’environnement disposent face aux divers interlocuteurs qu’elles peuvent rencontrer pour agir. Or, la discipline de la biologie de la conservation s’est construite à partir d’une conception de la nature qui donne à sa protection une valeur normative, c’est-à dire qu’il « faut » la protéger (Maris, 2006). Elaborée à partir des idées de Kant, cette posture morale peut refléter l’attribution d’une valeur intrinsèque aux êtres vivants, en considérant que tout organisme est une « fin en soi » (Larrère et Larrère, 1997). Une telle conception n’appelle pas à justifier la protection de la biodiversité puisque la légitimité de la protéger est déjà supposée.
Les développements scientifiques sur les services écosystémiques
Les études fondatrices du concept de service écosystémique ont débuté avant le MEA. Comme l’indique la terminologie, ce concept a été principalement développé par des économistes de l’environnement et a donné lieu à des évaluations monétaires (Hawkins, 2003) dans le but de favoriser la protection d’espèces ou d’espaces « utiles ». Par exemple, la valeur des services écosystémiques à l’échelle mondiale avait été évaluée à 30 000 milliards de dollars en 1997 (Costanza et al., 1997), le marché des médicaments issus des plantes représentait 36 milliards de dollars par an aux Etats Unis en 1998 (Pimentel, 1998), ou encore, les organismes pollinisateurs procuraient un service estimé de 4,1 à 6,7 milliards par an en 1997 (Nabhan and Buchmann, 1997). Bien que ces approches soulignent l’intérêt d’une gestion durable des écosystèmes, les informations qui en sont issues sont limitées et ne prennent pas en compte l’incertitude et les phénomènes d’irréversibilité (Chee, 2004). La valeur monétaire donnée à un élément naturel, une espèce ou un processus issu d’interactions entre un ensemble d’espèces et avec leur environnement biophysique, ne peut être absolue (Daily, 1997). Les évaluations ont un caractère relatif dépendant de la méthode d’évaluation mais aussi de la conjoncture économique au moment de l’évaluation ou des hypothèses sous jacentes aux modèles de prévision de la demande. Hormis les critiques que des économistes ont pu faire sur l’aspect méthodologique (e.g. Serafy, 1998), cette démarche soulève un problème éthique concernant l’utilisation de tels calculs dans des décisions politiques (Toman, 1998; Nunes and van den Bergh, 2001). La réduction des entités naturelles à une valeur unidimensionnelle et atemporelle ouvre la possibilité les intégrer dans des logiques marchandes, ou de les soumettre à des analyses coûts-bénéfices basées sur des évaluations partielles et contextuelles de leurs valeurs (Meral, 2011). De plus, on peut noter que les économistes ont reclassé les services écosystémiques, sans prendre en compte les services de support, difficiles à évaluer économiquement (Meral, 2011). En écologie, le concept de service écosystémique apporte une dimension nécessaire à la compréhension des mécanismes naturels (i.e. pollinisation, eutrophisation…), sans pour autant modifier en profondeur les méthodes de travail puisque l’étude des propriétés des systèmes naturels, des attributs, des fonctions des écosystèmes et des interactions entre espèces sont les bases de la recherche. Les nouveaux défis sont générés par la grille de lecture en termes de services, par exemple l’identification des entités productrices de service, les Chapitre I – Introduction 6 facteurs qui peuvent les influencer et les échelles temporelles et spatiales auxquelles ils sont associés (Luck et al., 2003; Kremen, 2005), la recherche de proxis plus pertinents pour représenter la relation entre la productivité d’un service et la biodiversité (Reiss et al., 2009). Cependant, les dimensions sociales et économiques sont souvent simplifiées, les humains sont encore souvent considérés simplement comme des sources exogènes d’impact sur les systèmes étudiés (Armsworth et al., 2007). Des études plus interdisciplinaires examinent la conciliation possible entre des systèmes économiques et écologiques (Farber et al., 2006; Egoh et al., 2007; Tallis et al., 2008). Lorsqu’elles sont plus ancrées dans la discipline économique, elles peuvent par exemple concerner la recherche de mesures standards afin de produire un indicateur quantitatif des services écosystémiques, équivalent au PIB par exemple (Boyd and Banzhaf, 2007). Un tel indicateur permettrait de comparer les performances de mesures environnementales dans différents endroits et de réduire les budgets de collectes de données. Mais de la même manière que pour les évaluations monétaires, l’indicateur devrait perdre en informations sur la qualité des services écosystémiques.
Les vautours, des producteurs de services en déclin dans le monde
Les services rendus par les vautour
Les seuls vertébrés charognards exclusifs sont de grands planeurs (Ruxton and Houston, 2004), plus communément appelés vautours. Ces rapaces nécrophages appartiennent à l’ordre des falconiformes, qui regroupe 22 espèces scindées en deux groupes : 15 espèces de vautours de l’Ancien Monde présentes en Afrique, en Asie et en Europe (famille des Accipitridae), et 7 espèces de vautours du Nouveau Monde en Amérique (famille des Cathartidae). Ces deux groupes sont polyphylétiques1 et présentent une convergence écomorphologique liée à leur régime alimentaire (Rich, 1983; Sibley and Halquist, 1990; Mundy et al., 1992; Donázar, 1993; Hertel, 1994). Par ce dernier, toutes ces espèces 1 Ils n’ont pas d’ancêtre commun mais présentent des caractères similaires. Chapitre I – Introduction 9 fournissent un service de régulation ; elles recyclent la matière organique et régulent des maladies (Şekercioğlu et al., 2004). Les services rendus par les rapaces charognards sont spécifiques aux aires culturelles où ils sont présents, des bénéfices différents étant identifiés selon les sociétés. En effet, Markandya (2008) répertorie de nombreux services rendus par les vautours en Inde. Par exemple, les vautours régulent la propagation de la rage, représentent de l’attrait pour le tourisme, sont intégrés dans la culture des Pârsîs, et utiles aux tanneurs et collecteurs d’os (Markandya et al., 2008). Ces derniers cas n’existent pas en Europe. En revanche, dans les pays où des entreprises d’équarrissage éliminent et recycle les carcasses d’animaux domestiques, les avantages d’un équarrissage par les vautours sont alors moins la diminution de propagation de maladies que le fait que cet « équarrissage naturel » puisse être plus écologique et moins coûteux.
Le déclin des vautours
En 2007, l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature publie un communiqué de presse inquiétant sur l’état de conservation des vautours, annonçant que 5 espèces ont vu leur statut de conservation s’aggraver (IUCN, 2007). Aujourd’hui 8 espèces sont considérées en danger ou menacées (IUCN, 2010). Il a été montré, du moins pour les populations africaines de vautours, qu’ils sont l’un des groupes d’oiseaux dont le déclin est le plus rapide (Thiollay, 2006). Les causes d’extinction locales sont essentiellement d’origine anthropique (Terrasse, 1983; Wilbur, 1983; Houston, 1987; Donázar, 1993). Ces oiseaux charognards peuvent être victimes de persécutions directes comme le tir ou surtout l’empoisonnement, pratiquées par le passé dans des pays européens tels que la France (Sarrazin et al., 1994) et encore récemment en Roumanie (Marton and Mertens, 2006), mais aussi dans d’autres régions du monde, en Afrique (Thiollay, 2006; Virani et al., 2011) et en Asie du Sud (Pain et al., 2003). Par ailleurs, les facteurs de mortalité de vautours peuvent être occasionnés indirectement, par divers accidents liés au mode de vie humain, tels que des collisions et des électrocutions avec des aménagements électriques (Margalida et al., 2008) et des éoliennes (De Lucas et al., 2008; Drewitt and Langston, 2008), comme des mortalités suite à des ingestions de déchets non organiques (verre, plastique) (Houston et al., 2007).