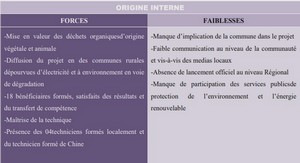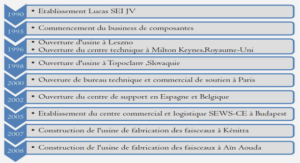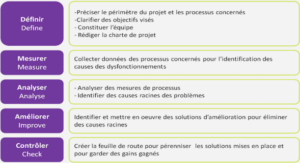APPRENDRE LE CARE
La notion de care, développée à partir des années 80 aux Etats-Unis (Gilligan 2008 [1982], Tronto 2008) et plus récemment en France permet de rendre compte à la fois d’une forme de « travail » et d’une expérience morale particulière (Molinier, Paperman et Laugier 2012), qui consiste à se soucier du bien-être d’autrui au quotidien. Ce courant d’analyse dans les sciences sociales cherche à réhabiliter des pratiques souvent ignorées, sous-estimées, voire méprisées, généralement féminines alors qu’elles apparaissent comme centrales pour comprendre les rapports sociaux. Les soins maternels sont apparus comme typiques de ce travail de care. Les travaux sur l’histoire des femmes avaient déjà montré le caractère historiquement construit des soins aux enfants, aussi important en termes de quantité de travail que socialement invisible (Thébaud, Duby et Perrot 2002, Knibiehler 2001). Les théories du care insistent sur toutes les formes de vulnérabilité et de dépendance, constitutives des expériences qui forment chaque sujet à un moment de son existence. Une grande partie des travaux vise à construire une « éthique du care », une philosophie morale qui s’oppose aux théories de la justice. Mais c’est surtout la dimension de l’expérience et de pratique qui nous intéressent ici, puisque nous nous proposons d’explorer des pratiques dans « l’immanence de la vie ordinaire100 » (Laugier 2005). Pour Tronto, il s’agit de considérer le care comme une « pratique »Le changement de condition des enfants, qui ont désormais des droits (Théry 1992, Woodhead 2007) mais aussi des besoins (Woodhead 2000 [1990]) de soin, impose aux parents un temps et une énergie considérables pour les honorer et y répondre. Ce travail est rendu invisible socialement du fait de la naturalisation de l’éducation parentale ainsi que par la naturalisation du processus de développement des enfants (Andenaes 2014). Pourtant, le soin aux enfants n’a rien de naturel. Non seulement le soin est historiquement construit, mais encore il est un apprentissage pour les adultes. Les recherches menées par Pascale Molinier montrent que « c’est l’expérience du travail qui construit, aiguise et stabilise le sens de la sollicitude ou la sensibilité à la détresse d’autrui » (Molinier 2004 : 14). Les apprentissages s’effectuent par le partage d’espaces et d’activités. Les adultes et les enfants construisent un sens à partir du partage de certaines activités (Rogoff 2001).
Le care et les illusions de l’autonomie
Nous avons vu que les parents cherchent à mettre en œuvre ce qu’ils considèrent comme des pratiques de soin. Ils recherchent un équilibre entre les « besoins » affectifs et les séparations qui sont censées mener à l’autonomie de l’enfant. Ils disposent des jeux dans la chambre pour qu’il développe ses facultés créatives. Ils pensent bien faire mais s’interrogent beaucoup sur « ce qui est bien » pour leur enfant. Comme le souligne Herman, le concept d’autonomie « incarne un principe socialisateur qui s’exprime à la fois en tant qu’objectif du processus de socialisation et en tant que moyen ou forme prise par le socialisation » (2007 : 47). Définie comme « la faculté de se déterminer par soi-même, de choisir, d’agir librement102 », la notion est aujourd’hui considérée comme un objectif essentiel, tant pour les parents que pour l’école et les lieux de loisir. L’autonomie des 6-8 ans consiste, pour les parents, en premier lieu à pouvoir réaliser les gestes de la vie quotidienne « seul » : manger seul, couper, se nourrir, dormir, se laver, faire ses devoirs, ranger les objets qu’on utilise. En second lieu, la capacité à maitriser son environnement. Le concept inclut les notions de responsabilité103, de choix, de participation aux décisions. Les enfants, disent les parents, ont besoin d’autonomie. Le discours des parents sur « l’autonomie » des enfants est omniprésent. Mais là encore, cette autonomie n’est pas « définie » de la même manière par les enfants et les adultes. Les normes de la formation de l’individualité et de l’autonomie, de la séparation des corps s’imposent tant aux adultes qu’aux enfants aussi. L’enfant doit apprendre à faire seul : dormir seul, faire leurs devoirs seul, jouer seul. L’objectif, pour les 6-8 ans, est de pouvoir prendre sa douche seul, s’habiller seul, ranger seul, faire ses devoirs seul, jouer seul, parfois s’endormir seul, préparer ses affaires seul. Devenir grand est valorisé par les adultes comme la capacité à faire progressivement seul. Le discours consistant à affirmer la différence par le fait que les enfants « ne savent pas faire seul », doivent apprendre à « ranger leur chambre seul » justifie la nécessité de piloter leurs activités. L’usage du terme de « besoin » a été bien déconstruit par Woodhead. Pour Woodhead (2000), les « besoins des enfants » sont un dispositif rhétorique dans les relations de pouvoir entre des spécialistes de l’enfant et les familles. Les présupposés des « besoins de l’enfant » ne sont pas explicités : ils vont de soi. Les besoins de l’enfant apparaissent comme inhérents au développement des enfants. Ils se présentent comme naturels, en ce qu’ils ne dépendent pas de l’intention et du projet de tel ou tel groupe social de former tel ou tel type d’enfant. Woodhead distingue plusieurs usages des « besoins de l’enfant ». Le premier type d’usage se rapporte à une description de la nature psychologique de l’enfant : « les besoins104 d’amour, de sécurité, de nouvelles expériences, de félicitation, de reconnaissance et de responsabilité sont identifiés avec la composition bio-psychologique des enfants, c’est-à-dire leurs instincts, leurs pulsions, leurs désirs105 » (Woohhead 2000 [1990] : 67). Le deuxième modèle repose sur une approche pathologique : les besoins de l’enfant correspondent à ce qu’il est nécessaire de lui procurer pour son bien être psychologique, considéré comme universel. La logique est celle du diagnostic qui, face à un risque de pathologie, détermine une prescription106 . Un troisième usage de la notion de besoins de l’enfant correspond aux expériences de l’enfant qui sont jugées comme favorisant son adaptation à la société. Enfin, un quatrième usage correspond à la définition d’expériences sociales répondant, en fait, à des standards culturels, dont la particularité est masquée, présentée comme universelle. Par exemple, l’affirmation que tous les enfants ont besoin de faire de la musique. Des attentes sociales et culturelles en matière de compétences dans un cadre de rapports de pouvoir, sont ainsi transformées en « besoins ». Ces dernières permettent de rendre implicite le désir des adultes et les rapports de pouvoirs entre adultes, ainsi qu’entre adultes et enfants. Cette notion va de pair avec l’image d’un enfant qui se présente comme gouverné par son fonctionnement bio-psychologique, sa nature. En cela si le discours de « l’enfant acteur » est omniprésent, le discours des besoins le rend passif. L’ubiquité de la notion d’autonomie couvre la pluralité des normes souvent implicites circulant à propos des enfants. Ainsi, les enfants « ont besoin » de jouer, ils ont besoin de s’opposer, mais ils ont aussi besoin que les adultes sachent « dire non », dit monsieur Natchez. Ils ont « besoin » de stabilité, mais ils ont besoin de « mobilité », comme dit madame Cachin. Pour Woodhead, pour comprendre l’ubiquité des définitions des « besoins », il faut considérer la relation entre les experts qui affirment et les parents qui doivent accepter leurs affirmations. Formuler les jugements professionnels en termes de « besoins » des enfants permet de souligner la position dominante des adultes, de qui proviennent ces jugements. Projetés sur les enfants eux-mêmes, les « besoins » acquièrent une objectivité fallacieuse : les « spécialistes » ne disent pas qu’ils en savent plus que les parents, ils naturalisent le fonctionnement des enfants : c’est l’enfant qui a des besoins. La notion de besoin d’autonomie permet enfin de rendre réelle une différence entre adultes et enfants qui s’avère difficile à atteindre autrement. Pour une majorité de parents, l’idéal entre enfants et parents est de « tout partager ». S’il s’agit de répondre à tous les besoins de l’enfant, l’ampleur de la tâche semble alors immense. Les besoins de « sécurité affective », les besoins de jouer (il faut des jouets, et souvent un partenaire) doivent trouver une réponse. En ce sens, les missions des parents sont si pressantes qu’il est très utile d’alléger ces injonctions par une injonction contraire. Cela permet aux parents de se décharger de la mission très lourde de répondre aux besoins. Cela permet aux adultes de réguler leur propre tentation « totalitaire » (« étouffante », dit-on), celle d’un contrôle de chaque instant visant à vérifier si l’enfant trouve une réponse à ses besoins de créativité et de sécurité affective.
Quand les parents apprennent le care
Le care désigne ce travail à prendre soin sans nuire. Est-ce que les parents apprennent à prendre soin ? En quoi cet apprentissage suppose-t-il une tension entre pouvoir et soin ? Prendre soin demande un travail réflexif constant de la part des parents ; lesquels comme on l’a vu, « culpabilisent » assez souvent. La séparation entre les activités qui relèvent d’un soin aux enfants et celles qui relèvent d’un pouvoir sur eux n’est jamais tout à fait claire. C’est ce qu’énonçait Everrett Hughes (1997) à propos des relations dites « de service » : Tout enfant à l’école est amené parfois à croire que certaines choses sont faites sur lui plutôt que pour lui ; dans une maison de correction, les jeunes sont presque toujours de cet avis […]. Voilà quelques-unes des ambiguïtés les plus simples rencontrées dans ces activités que l’on nomme services aux individus ou professions de service. Peut-être faut-il rappeler que “servir” s’oppose à “desservir” et que la frontière qui les sépare est mince, indistincte et mouvante. Lorsque des personnes font des choses les unes pour les autres, ce “pour” peut souvent être transformé en “à” par un léger excès de zèle ou de changement d’humeur […]. Partout où des personnes vont ou sont envoyées pour recevoir une aide ou subir une intervention, existe le danger d’une altération majeure des finalités et des relations dans le cadre d’une fonction officiellement définie (Hughes, 1997 : 62). La frontière est d’autant plus incertaine que les enfants sont considérés comme des personnes qui grandissent. L’activité de soin est elle-même traversée par une activité normative. Car si le soin est protection d’un sujet vulnérable et encouragement de sa capacité d’agir, il est nécessaire de disposer d’une représentation générale des « besoins » des enfants ou de sa capacité d’agir. Or, ici, le général peut être parfois fort éloigné du singulier ; s’en rapprocher demande donc du temps et des efforts de la part des parents. Aux efforts que nécessite le soin au sens général (faire à manger, par exemple), s’ajoute l’effort pour assurer le soin au sens particulier (faire à manger ce qui convient à l’enfant à ce moment-là dans cette situation) 107 . La distinction entre action pour et action « à », selon l’expression de Hughes, fait la différence entre soin et pouvoir. Au quotidien, les parents tentent de ne pas confondre pouvoir et soin, mais n’y parviennent pas toujours. Le care est ainsi une notion ambivalente.