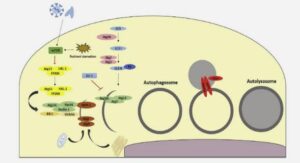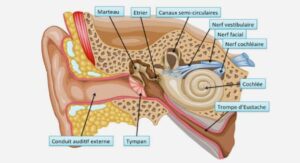Télécharger le fichier original (Mémoire de fin d’études)
Les limites du jeu sur les binômes : le brouillement des frontières
À l’heure où les travaux portant sur les rapports entre la ville et la nature sont reconnus comme objet d’étude, l’analyse systématique de la biodiversité en ville en est au stade des balbutiements. Dans les discours, deux formes de nature s’opposent. Selon Paul Arnould & al. [2011], « le caractère fondamentalement hybride et composite des questions de biodiversité en ville, qui combine constamment le sauvage et le domestique, le public et le privé, l’esthétique et le nourricier, le local et le mondial, l’indigène l’exotique, l’ordonné et le fouillis, le contrôlé et le rebelle, le trop connu et le mal connu, etc., contribue à brouiller les discours ». Tout comme dans l’opposition nature et culture, l’homme serait, pour Philippe Descola, [2002] au centre des raisons de vouloir opposer deux formes de nature :
« […] pour désigner les rapports entre la nature et la culture, nombreux sont les termes qui, empruntant au vocabulaire des techniques ou à celui de l’anatomie, mettent l’accent tantôt sur la continuité – articulation, jointure, suture ou couplage –, tantôt sur la discontinuité – coupure, fracture, césure ou rupture –, comme si les limites de ces deux domaines étaient nettement démarquées et que l’on pouvait en conséquence les séparer en suivant un pli préformé ou les rabouter l’un à l’autre comme deux morceaux d’un assemblage ».
Quand le domestique se ré-ensauvage
La vision occidentale selon laquelle le monde du vivant serait dominé par l’opposition domestique/sauvage est une hypothèse qui, selon Philippe Descola [1986], ne serait pertinente que dans un certain nombre de sociétés – la nôtre en particulier –, et ne vaudrait peut-être que dans le contexte d’une époque circonscrite.
Nous nous attacherons ici à discuter de l’opposition sauvage-domestique en montrant, à travers divers exemples empruntés à la littérature grise, que l’animal en ville se trouve parfois à la frontière du domestiqué et du sauvage. La présence de la nature sur un territoire est en effet une juxtaposition des deux éléments, le sauvage et le domestique. En outre, même si les jeux de domination et de concurrence sont bien réels, ces éléments créent un écosystème particulier où chacun peut trouver sa place, dès lors et d’autant plus que l’homme se positionnera en gestionnaire de ce tout.
Ainsi par exemple, le chat errant illustre bien ce statut ambigu. Le chat errant vit dans les rues mais son existence et sa survie sont largement favorisés par l’intervention de l’homme qui, volontairement ou indirectement, lui fournit de quoi se nourrir quotidiennement. Sa présence dans l’écosystème d’un territoire urbain dépend du degré d’acceptation ou de rejet de l’espèce sur l’espace concerné. Une espèce animale peut ainsi être considérée indésirable du fait de caractéristiques qui la rendent potentiellement invasive [Cooper, 1987 ; Clergeau, & al, 1996]. Dans les pays du Maghreb, les chats errants ne sont pas nourris par les populations. Le potentiel invasif est par conséquent absent. La régulation s’opère de manière naturelle et l’espèce demeure confinée dans une portion congrue de l’espace. La question du désir ou du rejet s’inscrit fortement dans l’échange humain. Les travaux de Nathalie Blanc [1995] sur l’animal en milieu urbain montrent combien cette présence animale cristallise les points de vue, qu’elle soit objet de désirs (animaux de compagnie) ou de rejets (pigeons ou blattes). Selon Philippe Clergeau [2007], le citadin veut une nature de « proximité, riche en espèces animales et végétales, et pas n’importe quelles espèces… ». Dans son étude sur la présence et la diversité des oiseaux à Rennes, il décrit les disparités de comportements des habitants des lotissements situés en banlieue, entre ceux qui accueillent et ceux qui rejettent les volatiles. Lorsqu’on s’approche de la campagne, le rapport à la nature évolue. L’attention portée à l’existence et à la diversité des oiseaux augmente. Nourrit, attiré ou rejeté, l’oiseau sauvage dans la ville reflète les ambivalences du citadin vis-à-vis de la nature. Source de conflits (bruits, déchets, odeurs, chiens dangereux) ou de consensus (cygnes et canards), l’animal en ville fait l’objet d’un regain d’attention sociale et politique aujourd’hui. A travers la notion de « communauté hybride » définie comme «une association d’hommes et d’animaux, dans une culture donnée, qui constitue un espace de vie pour les uns et pour les autres, dans lequel sont partagés des intérêts, des affects et du sens», Dominique Lestel [2004] affirme que « comprendre l’animalité urbaine doit s’appuyer sur une vision à la fois plus subtile et plus réaliste de l’animal dans la cité. Il convient en conséquence d’élaborer une conception de l’animalité qui ne se base plus a priori sur le paradigme de la séparation de l’homme et de l’animal, mais sur celui de leur complémentarité, sur celui de la recherche de convergences entre les uns et les autres, et sur celui de la vie partagée ».
Source : Étude Siloé pour Millénaire 3, Centre Ressources Prospectives du Grand Lyon. Note réalisée à l’occasion de la journée prospective du 16 mars 2004, sur le thème de «L’Homme et l’animal en milieu urbain»
Tableau 1: Population d’animaux domestiques dans le Grand Lyon et en France en 2003.
Les espèces emblématiques en ville sont les pigeons, les abeilles, les arbres – généralement platanes ou peupliers –, les chiens et les chats. La ville constitue néanmoins un refuge ou un milieu propice au développement de la faune sauvage. À Londres, les quelque 10 000 renards installés en ville en constituent un bon exemple. Pour introduire cette partie, il semble alors intéressant de revenir sur une question générale mais fondamentale : « Y a-t-il place pour du sauvage dans la ville ou n’y trouve-t-on qu’une biodiversité domestique ? » [Arnould, 2006]. Au-delà du questionnement autour de la place d’une biodiversité sauvage dans la ville, c’est bien le couple sauvage/domestique qui retient notre attention. La ville n’est-elle pas à même d’accueillir une biodiversité sauvage, naturelle, à l’image de ce que les friches ou autres délaissés urbains laissent entrevoir ? La main de l’homme, en créant, en artificialisant, en jouant de l’esthétique, ne domestique-t-elle pas quelque peu la biodiversité en ville ? Par ailleurs, la nature domestiquée, gérée, peut-elle côtoyer voire même retrouver un caractère sauvage ? Est-ce envisageable ? Est-ce souhaitable ? Quelle frontière poser entre ces deux termes ? Faut-il d’ailleurs formellement les opposer ? Une conciliation, une juxtaposition peut-elle être envisagée ?
Selon Augustin Berque [2010], « nous associons généralement le sauvage (silvaticus) à la forêt (silva) et à ses hôtes, les bêtes sauvages et les ermites ». Pourtant, la place du sauvage dans la ville semble indiscutable [Lizet & al., 1997]. L’ouvrage cité plus haut regroupe un ensemble de textes de naturalistes qui s’attachent notamment à inventorier la place de la nature « sauvage » dans la ville. Les villes constituent en effet de véritables milieux de substitution et/ou de refuges pour de nombreuses espèces. A New-York – ou même à Lyon mais de manière plus modeste –, les faucons pèlerins nichent en haut des buildings et des tours, éléments architecturaux qui leur rappellent leur environnement naturel. Les agglomérations constituent en effet un refuge pour de nombreuses espèces sauvages.
Figure 1. Bienvenue à l’animal sauvage en ville.
Les contrats de territoire et les corridors biologiques viennent à son secours. Il passe d’un état sauvage (image de gauche) à un état domestique (image de droite). En tant qu’animal domestique, il convient d’adopter une posture humaine. Le blaireau (Meles meles), au centre de l’image mais également au centre de plusieurs contentieux (dégâts occasionnés aux cultures et aux infrastructures ferrées notamment), se hisse ainsi sur ses deux pattes pour s’informer sur la direction à prendre pour continuer son chemin. Recherchant ainsi sa position dans la ville, le blaireau (qui n’en n’est pas un au sens figuré du terme parce qu’il semble être le plus savant des trois individus) s’attarde sur un plan de ville recentré sur une trame verte et spécifiquement destiné à l’orientation de l’animal de passage. Blaireaux (Meles Meles), cerfs (Cervus elaphus) et grenouilles (Rana sp) ne peuvent que remercier les instigateurs de leur sauvetage qui ont su lire la « notice de montage » (image de gauche).
Ainsi, afin d’organiser la présence et la valorisation de l’animal en ville, le Grand Lyon crée en 2005 la mission « animalité urbaine ». Prônant une « démarche globale de gestion de l’animal en ville »1, ce groupe de réflexion décline une gestion en six axes. Ce sont d’abord des actions organisées autour de promenades urbaines offrant « un parcours de santé, de bien-être, d’éducation et de détente des chiens urbains et de leurs maîtres ». L’objectif de ce type d’initiative est avant tout pédagogique. Elle est une invitation à se plier aux bonnes pratiques en ville pour permettre une meilleure cohabitation entre l’homme et l’animal en milieu urbain. À ce titre, le Grand Lyon signe une convention avec la société
« Canissimo » dont les deux éducateurs canins de métier ont pour mission de former, conseiller et responsabiliser les maîtres à qui ils délivrent des diplômes de conducteurs de chiens en ville à l’issue de la formation. Une fois diplômés, les maîtres rejoignent les rangs des « ambassadeurs de l’animalité urbaine».
Figure 2. L’animalité urbaine, un concept Made in Lyon pour favoriser le rapport entre l’animal et l’homme au mode de vie urbain néanmoins prêt à se changer en naturiste (ou presque) pour vivre en harmonie avec l’animal.
Pourquoi le statut de l’animal domestique s’inscrit-il ainsi comme nouvelle question d’urbanisme ? Comment passe-t-on d’une gestion essentiellement répressive autrefois à la prévention et à la valorisation de sa présence aujourd’hui ?
En ville, la nature est omniprésente. Discrète, opportuniste ou conciliante, la vie sauvage revendique son existence chaque fois que la possibilité lui en est laissée. Les mammifères des parcs, jardins et maisons déploient des trésors d’ingéniosité pour ne pas se faire écraser, piéger, empoisonner ou dévorer. Certains fréquentent les endroits de la ville que l’homme délaisse, du grenier au terrain vague en passant par les égouts. Beaucoup sont devenus nocturnes. Pour de nombreux animaux (renard, abeille sauvage), la ville constitue un véritable refuge. C’est aussi le cas pour le gros bec casse noyaux (coccothraustes coccothraustes), passereau qui habite normalement dans les forêts de feuillus et de conifères, mais qui est très présent au sein des parcs lyonnais.
Deux espèces domestiques méritent qu’on leur consacre quelques mots : les chiens et les chats. De longue date, chiens et chats s’inscrivent directement dans l’environnement de l’homme. Ils partagent son quotidien. Ils ont un rôle social important, aussi bien dans l’espace privé que dans l’espace public. Pour les sciences du langage, la communication entre l’homme et l’animal suscite de nombreux intérêts. Les travaux du naturaliste Von Frisch [1886-1982] ou du biologiste Konrad Lorenz [1903-1989] sur la communication et le comportement animal le démontrent bien. Si la place des animaux en ville n’est qu’affaire de tolérance pour les uns et de respect pour les autres, leur présence demeure parfois source de désagréments. Le rejet de cette forme de nature en ville par les habitants peut résulter des nuisances engendrées par certaines espèces animales. À Lyon, les données de la mission « animalité urbaine » (2008) mettent en évidence leur forte présence en ville – on dénombre 40 000 chiens à Lyon intra-muros – et, en corollaire, la production de déjections canines. Celle-ci est évaluée à plus de deux tonnes par jour. Concernant les chats domestiques, il peut arriver que certains retournent à l’état sauvage : on parle alors de chats féraux. En milieu urbain, le chat qui se coupe des attaches de la vie domestique passe alors de sa confortable passivité à une activité de redoutable prédateur, nuisible pour de nombreuses espèces d’oiseaux.
Mais si chiens et chats domestiques sont les espèces animales les plus représentatives de la cohabitation de la nature et de l’homme en ville, ils ne sont de loin pas les seuls « co-occupants » de nos habitations. Le tissu bâti des villes constitue aujourd’hui un refuge pour de nombreuses espèces animales. Ainsi à Lyon peut-on observer toute une faune qui, selon les espèces, trouve abri qui dans les greniers tel le rat noir (Rattus rattus), qui dans les caves humides ou les galeries souterraines tel le surmulot (Rattus norvegicus) – lequel niche également sur les bords du Rhône et de la Saône. Quoique que fort discret, tout ce petit monde est bien présent. Et s’il arrive que l’on puisse trouver gênante, de par sa multitude, sa prolifération et certaines nuisances, la présence de nombreuses espèces animales en ville, force est de reconnaître l’intelligence et la faculté d’adaptation de ces petits squatters, voire leur utilité : qu’ils soient chasseurs d’insectes et de rongeurs nuisibles ou destructeurs de déchets, ils rendent bien des services dans nos maisons. Dans les grandes villes comme par exemple Lyon, parcs et jardins, chantiers, berges des fleuves et cours d’eau sont également autant de lieux de vie pour toute une faune sauvage et diversifiée que l’on a plutôt coutume d’associer à la vie à la campagne. La liste est longue de ces hôtes clandestins qui ont trouvé en milieu urbain un contexte propice à leur survie. De la taupe (Talpa sp.) qui vit sous terre aux musaraignes (musaraneus sp.), mulots (apodemus sp.) et campagnols (microtus sp.) en surface, en passant par les hérissons (erinaceus sp.), les écureuils (sciurus sp.), les grenouilles (rana sp.), les ragondins (myocastor coypus) et les castors (castor sp.), les abeilles (apis sp.), les renards (vulpes sp.), les blaireaux (meles meles), les sangliers (sus scrofa), certains oiseaux dont des rapaces… et bien d’autres y ont élu domicile. Pourtant, la ville n’est nullement leur milieu naturel. Il convient alors de chercher à comprendre comment et pourquoi ils y sont arrivés et s’y sont durablement établis, en dépit de la présence des citadins, du bruit et de la pollution.
Karim Lapp [2005] propose à cet égard un certain nombre d’explications. Ainsi, dit-il en ce qui concerne certaines espèces, ce ne sont pas les animaux qui sont entrés dans la ville pour s’y installer, c’est la ville qui, en étendant rapidement son emprise sur les territoires ruraux environnants, les a en quelque sorte absorbés. Une autre explication tient à l’existence de structures paysagères propices au déplacement de la faune, parce qu’elles constituent des couloirs d’accès à la ville : tels par exemple les cours d’eau aux berges verdoyantes ou les voies de chemin de fer. À la recherche de nourriture, les animaux se déplacent en empruntant ces couloirs, ce qui les rapproche progressivement des tissus urbains les plus proches de leur milieu naturel, les conduisant ainsi jusque dans les parcs et jardins des villes. À Lyon on a ainsi pu observer, ces dernières années, des sangliers dans le secteur de Vaise. Mais il y a aussi, explique Karim Lapp [2005], les cas où les animaux arrivent en ville par erreur. Cela se produit lorsque des animaux effrayés entrent dans les agglomérations lors de leur fuite. Dans d’autre cas, c’est l’attrait d’une nourriture facile et abondante qui explique l’émigration d’animaux de la campagne vers la ville : « Paris offre « le gîte et le couvert »» à un bon nombre d’espèces » [Lapp, 2005]. Ce phénomène est d’autant plus d’actualité que l’industrialisation des méthodes agricoles conduit à un appauvrissement marqué des campagnes, ce qui amène certaines espèces, dont notamment les oiseaux, à privilégier les zones urbanisées. La recherche de tranquillité constitue par ailleurs l’un des facteurs d’émigration de certains animaux vers les centres urbains : dérangés par l’agitation des campagnes de la périphérie des villes où les citadins se déplacent volontiers pour leurs activités de loisirs, ils se rapprochent du centre pour se réfugier au calme des jardins avoisinants.
Ainsi donc, la ville est occupée par tout un monde animal parallèle qui marque fortement l’intrication spontanée de la nature sauvage dans le tissu urbain, à quoi s’ajoute la présence des animaux domestiques hébergés par les citadins. Mais qu’en est-il des politiques publiques à cet égard ? Quelle conception du rapport entre ville et monde animal est à l’œuvre et comment a-t-elle évolué ? Comment s’équilibre la dualité « proscription/prescription » ?
De nombreux historiens du social défendent l’idée selon laquelle le développement urbain aurait chassé l’animal hors de la ville, par le biais d’une politique hygiéniste visant à réguler la vie et la mort des bêtes. Cette idée est souvent associée à un mouvement de séparation entre monde humain et monde animal qui se traduit par un rejet de l’animal, en opposition à une attitude considérée comme très « urbaine » où, sensibles au monde animal, les humains s’entourent d’animaux de compagnie. Mais ces deux attitudes sont-elles antagonistes ? Pour notre part, nous pensons qu’elles fonctionnent comme un ensemble. Les récents travaux d’Eric Baratay [2012], qui montrent que l’essor urbain a coïncidé avec un accroissement de la présence animale en ville, viennent à l’appui de cette hypothèse. Peut-être peut-on alors, sur cette base, proposer une sociologie de l’animalité urbaine, à travers une typologie en deux catégories. Celle de la faune domestiquée d’une part, qui comporte les animaux de compagnie tels que chiens et chats mais aussi reptiles, souris, hamsters, furets, oiseaux en tous genres, chevaux pour les loisirs ou comme animal de service… ; celle de la faune sauvage, très diversifiée : rongeurs et petits mammifères de toutes espèces, renards, ragondins et batraciens, oiseaux, animaux sauvages en captivité dans les zoo…
La présence animale en ville décline plusieurs problématiques. Elle peut en effet être considérée comme une contrainte à gérer, parce que générant des problèmes d’hygiène et de nuisances (bruit, pollution) et des risques (morsures, infections). Mais cette présence animale peut à l’inverse être tenue pour bénéfique, au sens où elle favorise la communication et le lien social, où elle est outil d’éducation et d’éveil, où elle fait fonction d’aide à la personne dans le cas des chiens pour handicapés.
Quand l’artificiel fait corps avec le naturel
En milieu urbain, la nature est administrée, réglementée, gérée. Le concept américain de wilderness ou naturalité [Arnould & Glon, 2006 ; Arnould, 2006 ; Barron-Yellès, 2005 ; Donadieu & Fleury, 1997], entendue comme « un état naturel ou spontané » selon la définition du Littré, s’oppose à la nature artificialisée et à la nature cultivée. La nature wilderness apparaît alors comme inexistante au regard de son apparence artificielle et des usages qu’elle supporte. Toutefois, si Sergio Dalla Bernardina [2001] estime que « […] nous faisons encore semblant de croire à la nature incontaminée, à la wilderness, comme à une région radicalement autre par rapport au monde social », il ajoute que « […] nous savons très bien qu’elle demeure sous la dépendance de ce dernier ». La nature sauvage, ajoute-t-il encore, « […] est devenue un lieu public où échanger, se montrer, se confronter ». Les espaces semi-naturels ou la friche, comme le montrent François Ost & al. [1993], rendent compte de cet état de fait (Chapitre 2→III→2). Si, pour Sergio Dalla Bernardina [2001] ou François Ost & al. [1993], la nature sauvage est teintée d’usages sociaux, Daniel Vallauri [2007] introduit une dimension supplémentaire. Pour lui, la naturalité permet d’appréhender la nature au regard de trois caractéristiques qui fondent les catégories suivantes : nature organisée, nature complexe et nature spontanée. Mais en milieu densément bâti, le concept de naturalité semble demeurer inadapté. Les capacités de diversification des espaces de nature s’y trouvent réduites du fait que ceux-ci sont enfermés dans des cadres de gestion. De nombreuses études [Blanc, 2004 et 2004a; Calenge, 2003 ; Certu, 2012] soutiennent alors que la nature en milieu urbain est d’abord une nature artificielle. L’artificialité fait de prime abord référence au caractère inventé, fabriqué, fictif, copié, donc au caractère antinaturel de la nature. Roger Brunet [1992], pour qui la nature correspond aussi à « […] tout ce qui, dans le monde, n’est pas « artefact » ajoute que, de son point de vue, « […] le naturel s’oppose au calcul, à la réflexion comme à l’artifice ». Il n’exclut toutefois pas que des paysages fortement anthropisés puissent « […] à force de paraître « naturels » […] ou familiers, deviennent « seconde nature » et finalement nature, quel que soit leur degré de transformation, d’artificialisation ». À cet égard, Jean Estebanez [2006] affirme que « […] chaque société décide ainsi en permanence de ce qui est naturel et de ce qui ne l’est pas ». Les « interrelations avec les urbains» [Hucy, 2010] permettraient alors de comprendre quand, pourquoi, où et comment ces rapports nouveaux à la nature, artificielle ou naturelle, prennent corps.
Déjà sous le Second Empire, les jardins en milieu urbain correspondent à une nature maîtrisée. Patrice De Moncan [2009] insiste à cet égard sur la conception d’Adolphe Alphand à propos des jardins où la nature « naturelle » n’aurait pas de place : « Il ne faut donc pas prendre pour modèle la nature simple, mais imaginer un arrangement agréable, artificiel, tout en s’éloignant du vrai qu’autant que les exigences de l’art le commandent ». Ainsi, si le jardin n’est pas synonyme de naturalité pour Adolphe Alphand, Patrice de Moncan [2009] montre que d’autres points de vue plus radicaux encore existent. Victor Fournel, dit Patrice de Moncan, est l’un de ceux qui estiment que l’« […] on se passerait parfaitement de ce qu’on appelle nature pour arriver à tous les résultats qu’elle produit. Ce n’est plus qu’à la campagne qu’on a encore la naïveté de croire à la nécessité de la nature pour avoir des fruits et des fleurs ». Quitte à être factice, la nature devrait donc, selon Victor Fournel, être conçue pour être agréable à l’œil et attractive parce que propre et luxueuse. En effet, si le caractère naturel du végétal renvoie aux contextures naturelles du paysage, pour nombre de citadins c’est d’abord la fonction de l’objet qui prime.
Le sauvage et le cultivé, l’impossible maîtrise
Selon Vincent Clément & Antoine Gavoille [1994] ou encore Laurent Piermont [2005], gérer la nature, c’est d’abord l’entretenir et la protéger, en mettant en œuvre un certain nombre de moyens techniques. A contrario, l’absence de gestion laisse porte ouverte à l’apparition d’une nature spontanée. La structure même de la ville impose de gérer les espaces de nature en ville. En effet, dans son fonctionnement des services urbains, chaque commune dédie un service aux espaces de nature, généralement appelés espaces verts [Veyret & Le Goix, 2011]. Agents techniques, agents de maîtrise et ingénieurs territoriaux des services des espaces verts réfléchissent à leur gestion. Toutefois, le caractère « géré » de cette nature est aussi largement lié à la tradition des jardins français. La taille rectiligne, la symétrie et l’homogénéité des volumes sous-tendent encore aujourd’hui les techniques d’aménagement et l’identité visuelle de ces espaces. Certaines métropoles adoptent, à la croisée d’une nature gérée et non gérée, des méthodes de gestion différenciée qui repensent la place du sauvage dans la ville. Mais parfois, l’apparence spontanée voire désordonnée de la nature telle qu’elle résulte du mode de gestion différenciée suscite de multiples réactions négatives de la part des habitants. Si pour Jean-Claude Génot [2008] « […] l’homme parachève son œuvre de domination et contraint maintenant la nature spontanée par la gestion vers une biodiversité culturellement programmée, acceptée et aseptisée », l’aspect sauvage des espaces résultant des modes de gestion différenciée dégage plutôt une impression d’abandon. Ainsi qu’Yves Luginbühl [1999] le théorise, les représentations sociales de la nature sauvage se sont construites en confrontation avec une nature « […] rendant compte de la présence humaine et en particulier manifestant les signes de la culture ». Ainsi, malgré l’intérêt qu’il peut porter à la faune sauvage dans les parcs publics, [Dorier, 2006] l’individu, qui s’est forgé une culture et une histoire sociale, demeure encore parfois perméable à ce qui pourrait signifier pour lui retour à une forme de réensauvagement. Stéphan Carbonnaux [2012] traite de cette question en exposant le fait que la nature sauvage et le réensauvagement des lieux de vie des hommes, qu’il désigne par le terme anglo-saxon « rewilding », n’est pas possible dans nos sociétés : il faudrait plutôt parler de tentative de réconciliation entre les communautés humaines et la nature. Nature sauvage et nature cultivée ne mobilisent donc pas les mêmes ressentis. De plus, l’individu veut pouvoir avoir la maîtrise de la nature qu’il choisit d’avoir au sein du territoire qu’il pratique et dans lequel il évolue. Pour Karim Lapp [2005], « […] la démonstration rassurante que l’homme maîtrise la « sauvagerie » animale trouve l’une de ses représentations urbaines à travers les zoos. » Cette exigence s’inscrit enfin plus généralement dans une société anthropocentrée, où la nature, résultant de l’action humaine, est considérée comme un nouvel écosystème appartenant à l’homme et dont le management est requis pour guider son développement [Hobbs & al., 2006].
Table des matières
INTRODUCTION GÉNÉRALE
PREMIÈRE PARTIE. DE LA NATURE DANS LA VILLE. CONTEXTE SCIENTIFIQUE ET OBJET D’ÉTUDE
CHAPITRE 1. NATURE, QUI ES-TU ? DU CONCEPT AU TERRAIN
I/ Les limites du jeu sur les binômes : le brouillement des frontières
II/ Une problématique au centre du rapport nature-société
III/ Le rapport ville-nature, vers un changement de paradigme ?
IV/ La fin d’une variable d’ajustement ?
V/ Vers une ville durable ?
CHAPITRE 2. NATURE, OÙ ES-TU?
I/ Lyon en avance dans sa relation à la nature?
II/ Une matérialité concrète : le ponctuel, le linéaire et le zonal
III/ Le centre et la périphérie
CHAPITRE 3. MATÉRIELS ET MÉTHODES
I/ Une démarche quantitative pour analyser l’évolution de la prise en compte de la nature en milieu urbain
II/ L’exploitation qualitative de l’entretien
DEUXIÈME PARTIE. DE LA MANIPULATION
CHAPITRE 4. DU CONCRET ET DE L’INGÉNIERIE
I/ Des actions pour favoriser la nature en ville : devoir de nature ou vernis vert ?
II/ La Direction des espaces verts de Lyon : en pointe ou à la traîne?
III/ Des actions d’un genre nouveau
CHAPITRE 5. DU POLITIQUE ET DU MARKETING
I/ Une nature institutionnalisée
II/ La nature, outil de marketing récupéré pour la promotion territoriale ?
III/ Étude de la communication politique de l’agglomération lyonnaise à travers la presse institutionnelle
TROISIÈME PARTIE. DE LA PATRIMONIALISATION
CHAPITRE 6. DU PATRIMOINE ET DE LA PATRIMONIALISATION
I/ De stratégies de construction identitaire aux dispositifs réglementaires : la valse des outils
II/ Le discours sur la patrimonialisation de la nature en milieu urbain
CONCLUSION GENERALE
BIBLIOGRAPHIE
TABLE DES FIGURES
TABLE DES CARTES
TABLE DES TABLEAUX
TABLE DES PHOTOS
TABLE DES MATIÈRES