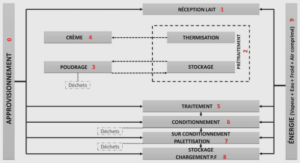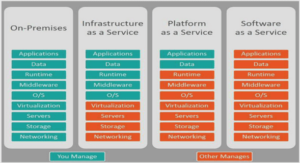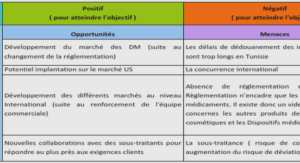L’étudiant dans la ville universitaire
Contrairement à la plupart des autres habitants des villes universitaires, les étudiants, dans leur grande majorité, y étaient là de passage, venant de province ou de l’étranger, parfois de très loin, en particulier dans les premières décennies de notre période, lorsque les lieux d’enseignements étaient encore très rares et même inexistants dans de nombreuses contrées d’Europe comme la Scandinavie par exemple. C’est ainsi qu’à Orléans, moins de 20% des écoliers appartenaient au diocèse de la ville102. A Paris, la proportion d’étudiants nés dans la capitale était encore plus faible, environ 13% en 1210, et même moins de 8% vers 1280103. Aussi, le garçon qui arrivait pour s’inscrire dans une faculté et y suivre un cursus de plusieurs années, devait mettre un certain temps à trouver ses nouveaux repères, surtout dans une grande ville comme Paris. L’agitation visuelle et sonore liée à l’intense commerce qui permettait d’alimenter la capitale, la circulation des charrettes dans des rues étroites et malodorantes, les marchands vantant dès l’aube la qualité de leurs produits, les processions, les spectacles de jongleurs, mais aussi, les vêtements qui étaient différents des leurs ou encore une langue qui leur était inconnue, tout à son arrivée devait le surprendre et sans doute le perturber, devant remettre en cause une grande partie de ses habitudes104 . Combien étaient-ils ces étudiants dans ces villes universitaires ? S’il est difficile d’avancer des chiffres précis, les recherches les plus récentes permettent de fournir une estimation relativement fiable et de se faire ainsi une bonne idée de l’ampleur du phénomène. Il semble que, dans un premier temps, ce soit Bologne qui en concentra le plus grand nombre avec environ 13.000 individus au XIVe siècle alors qu’à la même époque ils devaient être environ 6.000 à Paris et un peu moins de 2.000 à Toulouse105. Pour John Baldwin, qui a étudié le Paris de Philippe Auguste autour de l’année 1200, la population cléricale dans son ensemble représentait environ 10% de la population totale de la capitale106. Si on en soustrait le nombre des curés des différentes paroisses, des chanoines, des chantres et des moines des nombreuses abbayes, nous pouvons envisager, sans trop de marge d’erreur, un pourcentage d’écoliers de l’ordre de 5 à 6%, ce qui correspond d’ailleurs à ce qu’il sera deux siècles plus tard, au début du XVe siècle où Jean Favier, un autre historien, les estime à environ 5.000 en l’an 1400 pour une population totale de l’ordre de cent mille habitants107. Mais, au-delà de ces chiffres bruts et nécessairement approximatifs, force est de constater que tous ces écoliers étaient regroupés dans une partie seulement de la capitale française, en l’occurence dans un quartier situé sur la rive gauche de la Seine, et que, dans ce secteur encore relativement peu habité à l’époque, ils devaient constituer un groupe, sinon majoritaire, du moins très important. En témoigne, aujourd’hui encore, le nom de certaines rues, comme la rue d’Ecosse ou la rue des Anglais où se concentraient les lieux de résidence des étudiants originaires de ces pays108 . Cette concentration du monde universitaire dans une partie de la ville, n’était pas propre à Paris, mais se retrouvait partout ailleurs, comme à Angers où environ un millier d’étudiants côtoyaient une population urbaine environ douze fois supérieure à la fin du XIVe siècle109, ou à Poitiers, ville dans laquelle les universitaires représentèrent moins de 10% du total des habitants au XVe siècle110, mais là-aussi, regroupés dans un seul quartier de la cité. Quant à l’université d’Avignon, créée en 1303, elle bénéficia au XIVe siècle, de la présence de la curie pontificale et ses effectifs s’élevèrent à près de 900 étudiants en 1378- 79, pour une population totale de 30.000 habitants au maximum111, et culminèrent même à plus de 1300 à la fin du siècle. Mais, dès le début du XVe siècle, et donc en plein cœur du grand schisme, ils avaient chuté de façon spectaculaire à moins de 500 (465 maîtres et étudiants en 1403) pour finalement osciller entre 150 et 250 à partir de 1430112, date à laquelle les papes avaient définitivement réintégré Rome. Pour ce qui est d’Orléans, environ 700 étudiants étaient inscrits à la fin du XIVe siècle, tandis qu’à la même époque, ils étaient beaucoup moins nombreux à Montpellier, les chiffres avancés se situant entre 150 et 200. Que faisaient ces étudiants en dehors de leurs heures de cours ? Cette question se pose assez naturellement dans le cadre de notre sujet, car il semble inévitable de ne pas trouver là, des causes et des circonstances favorables à la dérive de certains, que ce soit dans leurs besoins économiques, dans le temps de leurs loisirs ou enfin, dans le rapport qu’ils eurent avec les autres franges de la société urbaine.
Le temps économique : se loger, se nourrir, se vêtir « Ceux qui s’adonnent aux arts meurent de faim »
Si cette affirmation d’un poète qui étudia à Paris dans la seconde moitié du XIIe siècle, est peut-être exagérée, elle n’en reflète pas moins une situation qui perdura pour certains après l’officialisation des universités, même si celle-ci s’accompagna de nombreuses mesures d’aides pour les plus démunis. Dans toutes ces villes où ils n’étaient donc là que pour quelques années, les étudiants n’y possédaient généralement pas de maisons, et même si certains – les plus riches – pouvaient s’acheter une résidence le temps de leur séjour, les autres étaient tributaires du bon-vouloir d’un logeur. Certains louaient tout un « hostel », d’autres, une simple chambre, d’autres encore cohabitaient avec des camarades dans un espace plus ou moins réduit. Ceux aux moyens les plus modestes pouvaient être hébergés par une famille, en échange de services rendus, comme faire le ménage ou apprendre des rudiments de latin aux enfants. L’université reconnaissait en son sein l’existence d’étudiants « pauvres ». C’était une situation de départ, mais, comme l’a bien montré Jacques Paquet, les critères et les seuils limites permettant de définir cet état de pauvreté, étaient plus ou moins fluctuants et de plus, variables selon les lieux114 . La vie universitaire attira autant les jeunes des milieux défavorisés que ceux des couches les plus aisées de la population. Gilles li Muisis, qui a étudié à Paris à la fin du XIIIe siècle, nous indique que cette communauté était composée dans une même proportion par « enfans de riches hommes et enfans de toiliers » Les « pauperes » 116 se rencontraient partout, mais en plus ou moins grand nombres selon les villes. En effet, certaines universités, comme celle d’Orléans117 ou la plupart des universités méridionales, étaient réputées pour leur recrutement à tendance plutôt aristocratique et étaient, de ce fait, fréquentées en majorité par des étudiants généralement sans difficulté financière particulière118 . La définition de l’état de pauvreté fut fournie lors du troisième concile de Latran en 1179. Il concernait les jeunes gens qui, faute de moyens suffisants, ne pouvaient étudier à leurs frais119. Les sommes à payer étant différentes d’une ville à une autre, et selon la faculté fréquentée et le niveau de diplôme à obtenir, cette notion de pauvreté était très relative. Mais celui qui pouvait justifier qu’il entrait dans cette catégorie, bénéficiait d’une dispense totale ou partielle des frais de scolarité120 . Dans la pratique, cela se traduisait par un privilège particulier, le privilegium paupertatis qui donnait droit à une bourse permettant de financer les frais d’inscriptions à l’université121 . Et cela constitua sans doute une motivation supplémentaire pour des fils de paysans ou d’artisans qui voyaient là une occasion unique et inespérée de se sortir, par l’étude, de la situation miséreuse que leur avait imposée leur naissance. Mais les dépenses des étudiants ne se limitaient pas, loin de là, à cette charge, et c’est toute la vie extérieure qui était particulièrement onéreuse dans les villes universitaires. Profitant de l’afflux de jeunes et de la crise du logement, les propriétaires n’hésitèrent pas à en profiter pour augmenter les prix des chambres qu’ils louaient. Ainsi, en 1189 à Bologne, le pape Clément III lui-même dut exiger de l’évêque de la ville qu’il contrôle et limite cette hausse122 . En 1310, c’est Philippe le Bel qui, s’adressant au prévôt et au bailli d’Orléans, interdisait aux habitants et aux marchands de cette ville, de vendre des aliments et de louer des logements aux écoliers à un prix exagéré
Le temps des loisirs : les tentations de la grande ville
« Tandis que je revenais d’une taverne sous l’empire de Bacchus, Je me suis aperçu qu’elle jouxtait un temple de Vénus » 158 . Ce qui leur était commun – nous en reparlerons lors de notre étude prosopographique – c’était leur sexe masculin et leur jeune âge même si celui-ci pouvait varier de quatorze ans pour ceux qui entraient à la faculté des arts, à plus de trente pour ceux qui achevaient de longues études en théologie. En dehors de leurs heures de cours, la plupart de ces jeunes gens se retrouvaient fréquemment pour se divertir. La taverne, le jeu, la fréquentation des prostituées, particulièrement nombreuses dans les villes universitaires, constituaient quelques-unes de leurs occupations favorites. Barthélémy Chasseneuz, un légiste qui fréquenta plusieurs universités à la toute fin du Moyen Âge, disait que, de son temps, on qualifiait les étudiants de chaque ville en fonction d’une de leurs distractions favorites : « Les Flusteux et Joueux de paume de Poictiers, les Danseurs d’Orleans, les Bragars d’Angiers, les Crottés de Paris, les Brigueurs de Pavie, les Amoureux de Turin,… » 159 . Pour ce qui est des jeux, les plus prisés par les étudiants étaient la paume, la soule et le jeu de dés160. Les deux premiers se pratiquaient en plein air et pouvaient d’ailleurs plutôt être assimilés à des sports. Les dés, quant à eux, trouvaient leur lieu de prédilection à la taverne où les jeunes gens venaient souvent le soir. Des Goliards leur auraient même attribué un saint patron baptisé Décius161 . La pratique de ce jeu s’achevait souvent en querelles dont certaines pouvaient dégénérer. La tricherie semblait en effet fréquente au Moyen Âge où « mauvais dez », « faulx dez », « dez ploumez » ou « dez mespoins » 162 étaient utilisés à maintes reprises, donnant lieu alors à un déchaînement de violence de la part de celui qui découvrait avoir été floué. Les lettres de rémission sont pleines d’exemples de ce type, et d’ailleurs pas uniquement pour les étudiants, loin de là. Toutes les catégories socioprofessionnelles furent concernées, du laboureur à l’artisan, de l’homme de guerre au prêtre163 . Cette pratique n’était d’ailleurs pas nouvelle et nous la retrouvons bien avant la naissance des universités, chantée par les ménestrels : « L’activité du jeu ne se sépare pas de la tromperie, Et le dépit du perdant amuse celui qui a acquis Son manteau par un subterfuge inique » 164 Ou bien encore : « Le jeu a ordinairement pour compagnons Le mensonge, les querelles, la trahison, le vol, la faim, La privation d’argent et même de vêtements. Regarde mes trois dés pipés : Je place en eux tout mon espoir de butin… »