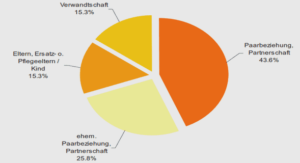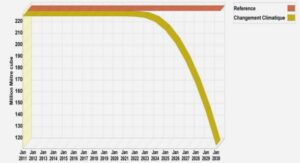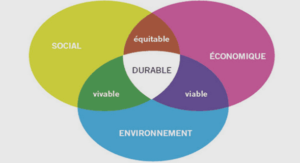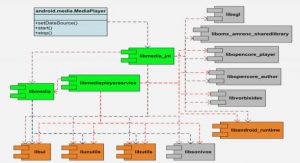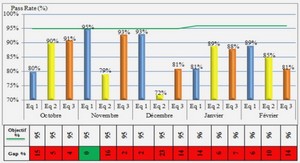Mémoires en forme de lettres
Il me sera bien difficile, Monsieur, de satisfaire votre curiosité selon vos désirs : vous voudrier que je vous mette au fait de tout ce qui s’est passé d’intéressant au monastère de La Valsainte depuis environs 15 ans que j’y ai habité. Il faudrait pour cela que j’eusse tenu un journal exact de tous les événemens et je n’ai absolument rien écrit. Il faut que je tire tout de ma mémoire. La vie silentieuse que nous menions, l’ignorance dans laquelle on nous laissait sur bien des choses qui pouvaient nous intéresser, la longueur du tems qui s’est écoulé, rien ne vous promet de trouver dans ma narration une grande exactitude. La plupart des époques m’ont échapé. Il y a bien des choses dont je n’ai entendu parler qu’imparfaitement et comme par hasard. Il y en a plus encore que j’ignore et qui cependant ont une connextion essentielle avec d’autres que je sais, de manière que mon travail ne peut être que très imparfait. Je ne laisse cependant pas de l’entreprendre. Comme mon intention est de laisser après moi quelque chose qui puisse servir à l’histoire de notre réforme en m’appliquant à la plus exacte vérité, je ne dissimulerai rien de tout ce que j’ai vue et observé, persuadé que vous saurez tirer parti de tout. Je perderais à votre égard le titre d’historien véridique si vous pouviez m’accuser de partialité. Vous trouverer sans doute dans ces mémoires bien des choses propres à vous édifier, comme vous en trouverer aussi qui vous feront voir ce que l’expérience vous a déjà suffisament appris, que l’homme se trouve [2] partout et que le sanctuaire de l’innocence, n’est pas toujours exempt des faiblesses de l’humanité.
Ce sera plus particulièrement dans ma propre conduite que vous aurez lieu de les observer. Je ne craindrai cependant pas d’en faire l’aveu, trop heureux si mon exemple peut un jour être aux autres de quelqu’utilité. En nous laissant le tableau de ses égaremens, saint Augustin n’a pas été moins utile à l’Eglise que celui qui nous a donné l’histoire de ses vertus.Je ne vous ferai point de détail, Monsieur, des circonstances malheureuses qui m’ont forcé de m’arracher à une famille chérie et au sein de laquelle, malgré les terribles et les inquiétudes inséparables d’une révolution je goûtais le seul véritable bonheur, celui de l’union et de l’amitié. Mon père, dont j’ai toujours respecté les volontés, me conseilla de me retirer en Suisse. Son intention était que je m’y établisse, soit en cherchant quelque place dans l’Eglise, soit en me servant des connaissances de médecine que mon goût pour cette science m’avait fait acquérir. En conséquence il n’épargna rien pour m’en faciliter les moyens. Peu content de m’avoir donné une somme assez considérable, de m’avoir formé une pacotille des plus honnettes, il m’assura que je pouvais recourir à lui en toute circonstance. Comme j’étais d’une très mauvaise santé, il me fit accompagner jusqu’aux frontières par un de mes frères et une de mes sœurs voulut payer seule les frais du voyage. Tant de bontés réunies me rendirent encore plus sensible ma séparation qui eut lieu dans le cours de février 1793. Après un voyage fort pénible à cause de mes infirmités, j’arrivai à Fribourg en Suisse le 5 avril. Comme la ville était pleine d’émigrés de tous états et en particulier de prêtres, j’eus beaucoup de peine à trouver à me loger.
J’eusse désiré me placer dans une chambre où il y en eut une cheminée, afin de me préparer moi-même ce qui m’était nécessaire pour ma nourriture. Mais quelque recherche que je fisse, la chose ne me fut pas possible. Il fallut me contenter d’une chambre à fourneau et aller tous les jours prendre mon repas dans une maison bourgeoise avec plusieurs ecclésiastiques. Il y a tout lieu de croire que si l’eusse fait mon ménage moi-même, je me serais fixé dans Fribourg, j’y aurais vécu économiquement, éloigné de toute compagnie et à la longue je me serais fait une manière [4] d’exister. Mais la nécessité de vivre avec le monde me mit bientôt dans le cas de le quitter. J’avais beau éviter de faire société avec qui que ce fut, j’étais souvent obligé, malgré moi, de me trouver avec différents ecclésiastiques qui, par désœuvrement, recherchaient ma compagnie. On m’engageait dans des promenades. Les discours ne roulaient le plus ordinairement que sur des nouvelles ou sur des matières au moins équivoques. Je fus d’ailleurs témoin de la conduite peu réglée d’un grand nombre, ce qui me donna un tel dégoût pour le monde et une telle apprenhension pour les dangers auxquels je me voyais exposé, que je résolus, à quelque prix que ce fut, de le quitter entièrement et de me retirer dans une communauté religieuse.
Il y en a plusieurs à Fribourg où je pouvais m’aller présenter. Mais outre qu’elles ne m’offrayent pas pour la pluspart, un azile assez sûr contre les éceuilles que je voulais éviter, je craignais que dans peu la Suisse n’éprouvât une commotion et que je ne me visse exposé à des inconvéniens qui auraient été d’autant plus grands que j’étais en pays étranger. Je m’informai alors où était située La Valsainte, communautée que me paraissait la plus propre à remplir mes vues, tant à cause de son austérité, que de l’influence que pouvait avoir sur elle une secousse révolutionaire : n’étant composée que d’émigrés et prévoyant bien qu’en cas d’événement, tous les membres se prêteraient un mutuel secours et comme d’ailleurs ma santé était des plus mauvaises, j’espérais qu’une mort prématurée viendrait, dans peu, me mettre à la brie de toutes catastrophes. Dans ces vues je me mis au-dessus de toutes mes répugnances, car la seule pensée du froid que l’on devait éprouver dans une habitation située au milieu d’une chaîne de montagnes qui étaient alors couvertes de nèges, me faisait frémir d’horreur. Je quittai Fribourg le lendemain de l’ascension 10° jour de mai sur [5] les 6 heures du matin, sans autre secours que mes jambes affaiblies par la maladie, un bâton à la main et quelques hardes dans un mouchoir. J’avais environs 8 lieux à faire.J’ignorais la route et l’asthme dont j’étais attaqué me menaçait d’éprouver les plus grandes difficultés, lorsqu’il s’agirait de gravir les montagnes. Je ne tardai pas à en faire l’épreuve. La montagne qui conduit à la porte de Bourguillon se présanta d’abord à moi. Ce ne fut qu’avec la plus grande peine que j’arrivai devant la chapelle dite de N-D. de Lorette. J’étais alors tout à fait sans respiration et incapable de continuer ma route. Que faire ? L’abandonner ? J’avais pris mon parti avec une trop forte résolution pour cela. Je me déterminai donc à entrer dans la chapelle pour y reprendre haleine et invoquer le secours de la très sainte Vierge. J’y récitai le chappellet tout entier, puis, me sentant ranimé et fortifié, je me remis en route et continuai de marcher jusqu’à La Valsainte sans éprouver aucune difficulté.