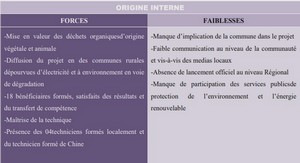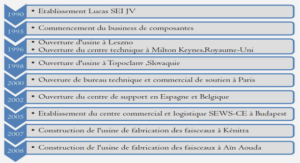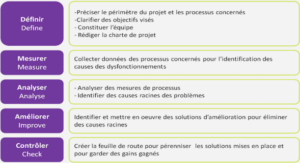Pathologie de la vie sociale
Introduction
En 1830, Balzac venait de découvrir le Monde.
Son premier succès « Les Chouans », suivi de près par : « La Physiologie du Mariage » et « La Peau de Chagrin », avait imposé sa vocation à une famille dont le rêve était de faire de lui un notaire. Pour la première fois, il avait de l’or dans les mains, ces mains prodigues, ces belles mains sensuelles qui furent toujours empressées de l’échanger contre ce qui chatoie, qui éblouit, qui est voluptueux au toucher. Les salons s’ouvraient pour lui. Il fréquentait chez Sophie Gay, la princesse Bagration, la duchesse d’Abrantès ; il approchait les femmes les plus brillantes de Paris – lui qui les aimait tant, qui aimait tout d’elles, leurs intrigues comme leurs vertus, et comme elles-mêmes, leurs parures changeantes qu’il montre tant de plaisir à décrire, mousselines de l’Inde, cachemires, pèlerines ruchées, souliers de prunelle.
Et, tout naturellement, comme le fruit de ces années-là, paraît le traité de la Vie Élégante[2].
Quelle étape il y avait à parcourir pour faire un dandy de ce jeune Balzac, qui descendait alors de sa mansarde sans feu !
Lamartine qui l’a vu à ses débuts, chez Sophie Gay, laisse de lui un amusant portrait :
« Il portait un costume qui jurait avec toute élégance, habit étriqué sur un corps colossal, gilet débraillé, linge de gros chanvre, bas bleus, souliers qui creusaient le tapis, apparence d’un écolier en vacances qui a grandi pendant l’année et dont la taille fait éclater le vêtement, voilà l’homme qui valait à lui seul une bibliothèque de son siècle. »
Quelques années seulement… et voici Balzac célèbre par le faste de son équipage, de ses habits et de ses bijoux. Un détail en est resté célèbre : cette canne, longue comme celle d’un tambour major, dont la pomme enrichie de pierreries était creuse et contenait des cheveux de femmes[3]. Il a des chevaux, des laquais, une livrée splendide rehaussée de galons et de boutons d’or sur lesquels brillaient les armes des Balzac d’Entragues.
« Il faut travailler pour ces gredins de chevaux, que je ne puis parvenir à nourrir de poésie, écrit-il en 1832. Ah ! une douzaine de vers alexandrins en guise d’avoine ! »
Werdet, qui fut un de ses éditeurs, nous a laissé le récit de la petite fête que lui offrit Balzac le soir de la mise en vente de la première édition du « Livre Mystique » qui contenait « Séraphita » et qui fut enlevée tout entière le jour même.
« Il portait, dit Werdet, un habit bleu barbeau à boutons d’or ciselé, pantalon noir à sous-pieds, gilet blanc en piqué anglais, sur lequel chatoyaient les anneaux d’une chaîne d’or microscopique ; bas de soie noire à jours, souliers vernis, linge très fin, d’une blancheur irréprochable cette fois – note le narrateur ironiquement, – gants beurre frais, chapeau à larges bords en véritable castor et, comme de juste, sa fameuse canne. »
« À la porte, nous trouvâmes l’élégant coupé aux armes d’Entragues ; sur le siège se prélassait le cocher dans sa livrée éblouissante, un véritable colosse galonné d’or ; grain de mil, le groom imperceptible grimpé derrière l’équipage. Les règles de la fashion la plus méticuleuse avaient été observées. Notre couvert chez Véry avait été dressé d’avance. »
Les amis vont au théâtre de la Porte Saint-Martin.
« Sous le péristyle nous trouvâmes Auguste[4], qui remit à son maître le coupon de la loge d’avant-scène dont, pendant un entracte, nous prîmes possession à grand bruit, suivant les us et coutumes des « Lions ».
Il y eut, paraît-il, grand succès, ce soir-là, pour l’auteur de la Comédie Humaine. « Des loges, des balcons, des galeries ces mots se répétaient : « C’est Balzac… Balzac, avec sa canne… » On n’écoutait plus la pièce, on ne regardait que Balzac, sa canne, et une gracieuse inconnue qu’il produisait à ses côtés. »
Au Café Tortoni l’empressement fut plus grand encore.Hélas ! Balzac pouvait se procurer les habits, les bijoux de prix et les équipages, il pouvait connaître le faste – mais non l’élégance que, dans son traité, il en distingue si finement.Ce n’est pas sa forme physique seulement qui s’y opposait. Un mot est symbolique dans la description de Lamartine : « habit étriqué sur un corps colossal » : ses habits étaient trop étroits pour ses muscles d’Hercule ; et il était trop étroit, le code minutieux de l’élégance, pour son impétuosité et la fantaisie de son humeur.
Évidemment, Balzac en homme à la mode nous apparaît déguisé, et assez mal déguisé. On pourrait tirer des effets de comique facile du rapprochement de ses prétentions au dandysme et de leur réalisation.
« – Mais, bourgeois, répondait à Werdet un cocher qui l’avait conduit en même temps que Balzac, avec qui pouviez-vous donc être, sinon avec un marchand de bœufs de Poissy ? »
… « Comment cela se faisait-il ? mais ses vêtements étaient toujours ou trop petits, ou trop étroits, ou trop longs, ou trop larges. »
« Il n’est pas beau, mais qu’il est gros, qu’il est petit !… C’est Falstaff, court et rouge comme un œuf de Pâques. »« Du derrière de la tête au talon chez Balzac, il y avait une ligne droite avec un seul ressaut au mollet ; quant au devant du romancier c’était le profil d’un véritable as de pique. »On pourrait multiplier de pareilles citations et les rapprocher de nombreuses caricatures, mais j’aime mieux me fier aux magnificences de la sympathie Lamartinienne et reproduire la parole du poète, de celui qui sans exactitude littérale peut-être, savait voir pourtant la vérité essentielle :
« Il était gros, épais, carré par la base et les épaules ; le cou, la poitrine, le corps, les cuisses, les membres puissants ; beaucoup de l’ampleur de Mirabeau, mais nulle lourdeur ; il avait tant d’âme qu’elle portait tout cela légèrement et gaiement : comme une enveloppe souple et nullement comme un fardeau ; ses bras courts gesticulaient avec aisance ; il causait comme un orateur parle… »
Les aspirations au dandysme ne furent pas éphémères dans la vie de Balzac. Elles se manifestent avec une impétuosité enfantine dans ses premières années de célébrité et malgré les soucis, de plus en plus absorbants, de l’art et des affaires, Balzac n’y renonce jamais.C’est désormais surtout le luxe de l’habitation qui l’attire. Dès 1830 il avait commencé à réunir des tableaux, des porcelaines, des bronzes, de vieilles soies et des tapisseries ; il possédait déjà la commode en bois d’ébène veiné d’or, armoriée aux armes de France et de Florence, qu’on dit avoir appartenu à Marie de Médicis, et le secrétaire d’Henri IV.
Les descriptions abondent de ses logis, toujours changeants, parfois doubles pour mieux dépister les créanciers, où l’on n’avait accès qu’en produisant le mot de passe. Werdet raille en évoquant les splendeurs voluptueuses de la maison de la rue Cassini, le stuc et le marbre blanc de la salle de bains, les fenêtres rouges, dont les glaces dépolies ne laissaient entrer que des rayons roses ; et la chambre blanche et rose, parfumée des fleurs les plus rares, toute ruisselante d’or : « chambre nuptiale pour une duchesse de quinze ans. » Théophile Gautier, lui, s’extasie sans cesse. Il nous a laissé la description du boudoir que Balzac devait transporter dans une Nouvelle : « La Fille aux yeux d’Or » : immense divan circulaire, tenture rouge, recouverte d’une mousseline des Indes, rideaux roses des fenêtres doublés de taffetas, bras en vermeil portant les bougies, tapis de Perse, meubles recouverts de cachemire blanc rehaussés de noir et de ponceau… des fleurs, des fleurs… à côté, la chambre à coucher garnie, sous ses draperies, de matelas qui empêchaient qu’aucun bruit pût être entendu au dehors par quelque oreille indiscrète… »On nous a parlé, peut-être en l’exagérant, des fortunes englouties dans la maison des Jardies. En 1848, nous trouvons Balzac chargé d’une dette de 100 000 francs par l’achat et l’aménagement de l’hôtel où il devait amener Mme Hanska et mourir.Qui faut-il croire ? ceux qui ont vu chez lui des merveilles artistiques, ou ceux qui y ont trouvé seulement du toc et des entassements de bric à brac ?Ce qui importe, pour nous, c’est le rêve qu’il faisait et l’acharnement qu’il mettait à le réaliser.On a répété que Balzac resta chargé pendant toute sa vie d’écrivain sous la dette qu’il avait contractée comme imprimeur. La vérité c’est que la passion du luxe, aggravée par son imagination qui lui présentait toujours avec une redoutable précision un moyen chimérique et saugrenu de s’enrichir, fut le fardeau sous lequel le pauvre grand homme s’épuisa et dut enfin s’écrouler et mourir.
*
Ce goût de l’éclat extérieur qu’eut toujours Balzac, ce souci de la représentation nous le retrouvons dans son roman. De tous ses personnages nous connaissons l’installation, l’ameublement ; nul n’y paraît que nous ne voyions comment il est vêtu. C’est un trait caractéristique de Balzac qu’il attache autant d’importance à la toilette de ses jeunes ambitieux que de ses amoureuses.Certes, on pourrait tirer des effets comiques des portraits qu’il fait de ses héros comme de ceux qu’on a laissés de lui.« Il (Charles) avait fait la toilette de voyage la plus coquette, la plus simplement recherchée, la plus adorable, pour employer le mot qui dans ce temps résumait les perfections spéciales d’une chose ou d’un homme. À Tours, un coiffeur venait de lui refriser ses beaux cheveux châtains ; il y avait changé de linge et mis une cravate de satin noir combinée avec un col rond, de manière à encadrer agréablement sa blanche et rieuse figure. Une redingote de voyage à demi boutonnée lui pinçait la taille, et laissait voir un gilet de cachemire à châle sous lequel était un second gilet blanc. Sa montre, négligemment abandonnée au hasard dans sa poche, se rattachait par une courte chaîne d’or à l’une des boutonnières. Son pantalon gris se boutonnait sur les côtés, où des dessins brodés en soie noire enjolivaient les coutures. Il maniait agréablement une canne dont la pomme d’or sculptée n’altérait point la fraîcheur de ses gants gris. Enfin, sa casquette était d’un goût excellent. »[8]
« … les beaux cheveux blonds et bien frisés de Maxime lui apprirent combien les siens étaient horribles ; puis Maxime avait des bottes fines et propres, tandis que les siennes, malgré le soin qu’il avait pris en marchant, s’étaient empreintes d’une légère teinte de boue ; enfin Maxime portait une redingote qui lui serrait élégamment la taille et le faisait ressembler à une jolie femme tandis qu’Eugène avait à deux heures un habit noir. Le spirituel enfant de la Charente sentit la supériorité que la mise donnait à ce dandy. »[9]
« Si ce portrait fait préjuger un caractère, la mise de l’homme contribuait peut-être à le mettre en relief. Rabourdin portait habituellement une grande redingote bleue, une cravate blanche, un gilet croisé à la Robespierre, un pantalon noir sans sous-pieds, des bas de soie gris et des souliers découverts. »[10]
« … Votre cousin est décoré, je suis bien vêtu, c’est moi qu’on regarde. »[11]
« Il prit un chapeau bas de forme et à bords larges.
– Voici l’ancien chapeau de Claude Vignon, grand critique, homme libre et viveur… Il se rallie au Ministère, on le nomme professeur, bibliothécaire, il ne travaille plus qu’aux Débats, il est fait Maître des Requêtes, il a 16 000 fr. d’appointements, il gagne 4000 fr. à son journal, il est décoré… eh bien ! voilà son nouveau chapeau.
Et Vital montrait un chapeau d’une coupe et d’un dessin véritablement juste-milieu. »Je ressens quelque honte à présenter ainsi ces extraits. Citer, c’est faire une opération chirurgicale qui transforme une phrase, membre plein de grâce et de sens dans sa page, en un débris mort. Et j’ai plaisir pourtant à sourire en lisant ces passages et tant d’autres de même sorte – mon Dieu ! tout simplement peut-être parce qu’ils ont provoqué tant d’ironies faciles et que c’est cette ironie qui me semble mesquine et digne de moquerie.Dans l’œuvre de Balzac rien de tout cela n’est ridicule, pas plus que ne l’était à la vue pénétrante de Lamartine son extérieur peu avantageux. Rien n’est puéril ressenti par une âme passionnée : aucun détail n’est mesquin quand il est signe.
Traité de la vie élégante
Prolégomènes
La civilisation a échelonné les hommes sur trois grandes lignes… Il nous aurait été facile de colorier nos catégories à la manière de M. Charles Dupin ; mais, comme le charlatanisme serait un contre-sens dans un ouvrage de philosophie chrétienne, nous nous dispenserons de mêler la peinture aux x de l’algèbre, et nous tâcherons, en professant les doctrines les plus secrètes de la vie élégante, d’être compris même de nos antagonistes, les gens en bottes à revers.
Or, les trois classes d’êtres créés par les mœurs modernes sont :L’homme qui travaille ;L’homme qui pense ;L’homme qui ne fait rien.
De là trois formules d’existence assez complètes pour exprimer tous les genres de vie, depuis le roman poétique et vagabond du bohème jusqu’à l’histoire monotone et somnifère des rois constitutionnels :
De la vie occupée
Le thème de la vie occupée n’a pas de variantes. En faisant œuvre de ses dix doigts, l’homme abdique toute une destinée ; il devient un moyen, et, malgré toute notre philanthropie, les résultats obtiennent seuls notre admiration. Partout l’homme va se pâmant devant quelques tas de pierres, et, s’il se souvient de ceux qui les ont amoncelés, c’est pour les accabler de sa pitié ; si l’architecte lui apparaît encore comme une grande pensée, ses ouvriers ne sont plus que des espèces de treuils et restent confondus avec les brouettes, les pelles et les pioches.
Est-ce une injustice ? non. Semblables aux machines à vapeur, les hommes enrégimentés par le travail se produisent tous sous la même forme et n’ont rien d’individuel. L’homme-instrument est une sorte de zéro social, dont le plus grand nombre possible ne composera jamais une somme, s’il n’est précédé par quelques chiffres.
Un laboureur, un maçon, un soldat, sont les fragments uniformes d’une même masse, les segments d’un même cercle, le même outil dont le manche est différent. Ils se couchent et se lèvent avec le soleil ; aux uns, le chant du coq ; à l’autre, la diane ; à celui-ci, une culotte de peau, deux aunes de drap bleu et des bottes ; à ceux-là, les premiers haillons trouvés ; à tous, les plus grossiers aliments : battre du plâtre ou battre des hommes, récolter des haricots ou des coups de sabre, tel est, en chaque saison, le texte de leurs efforts. Le travail semble être pour eux une énigme dont ils cherchent le mot jusqu’à leur dernier jour. Assez souvent le triste pensum de leur existence est récompensé par l’acquisition d’un petit banc de bois où ils s’asseyent à la porte d’une chaumière, sous un sureau poudreux, sans craindre de s’entendre dire par un laquais :
– Allez-vous-en, bonhomme ! nous ne donnons aux pauvres que le lundi.
Pour tous ces malheureux, la vie est résolue par du pain dans la huche, et l’élégance, par un bahut où il y a des hardes.
Le petit détaillant, le sous-lieutenant, le commis rédacteur, sont des types moins dégradés de la vie occupée ; mais leur existence est encore marquée au coin de la vulgarité. C’est toujours du travail et toujours le treuil : seulement, le mécanisme en est un peu plus compliqué, et l’intelligence s’y engrène avec parcimonie.
Loin d’être un artiste, le tailleur se dessine toujours, dans la pensée de ces gens-là, sous la forme d’une impitoyable facture : ils abusent de l’institution des faux cols, se reprochent une fantaisie comme un vol fait à leurs créanciers, et, pour eux, une voiture est un fiacre dans les circonstances ordinaires, une remise les jours d’enterrement ou de mariage.
S’ils ne thésaurisent pas comme les manouvriers, afin d’assurer à leur vieillesse le vivre et le couvert, l’espérance de leur vie d’abeille ne va guère au-delà : car c’est la possession d’une chambre bien froide, au quatrième, rue Boucherat ; puis une capote et des gants de percale écrue pour la femme ; un chapeau gris et une demi-tasse de café pour le mari ; l’éducation de Saint-Denis ou une demi-bourse pour les enfants, du bouilli persillé deux fois la semaine pour tous. Ni tout à fait zéros ni tout à fait chiffres, ces créatures-là sont peut-être des décimales.
Dans cette cité dolente, la vie est résolue par une pension ou quelques rentes sur le grand-livre, et l’élégance par des draperies à franges, un lit à bateau et des flambeaux sous verre.
Si nous montons encore quelques bâtons de l’échelle sociale, sur laquelle les gens occupés grimpent et se balancent comme des mousses dans les cordages d’un grand bâtiment, nous trouvons le médecin, le curé, l’avocat, le notaire, le petit magistrat, le gros négociant, le hobereau, le bureaucrate, l’officier supérieur, etc.
Ces personnages sont des appareils merveilleusement perfectionnés, dont les pompes, les chaînes, les balanciers, dont tous les rouages, enfin, soigneusement polis, ajustés, huilés, accomplissent leurs révolutions sous d’honorables caparaçons brodés. Mais cette vie est toujours une vie de mouvement où les pensées ne sont encore ni libres ni largement fécondes. Ces messieurs ont à faire journellement un certain nombre de tours inscrits sur des agendas. Ces petits livres remplacent les chiens de cour qui les harcelaient naguère au collège, et leur remettent à toute heure en mémoire qu’ils sont les esclaves d’un être de raison mille fois plus capricieux, plus ingrat qu’un souverain.
Quand ils arrivent à l’âge du repos, le sentiment de la fashion s’est oblitéré, le temps de l’élégance a fui sans retour. Aussi la voiture qui les promène est-elle à marchepieds saillants à plusieurs fins, ou décrépite comme celle du célèbre Portal. Chez eux, le préjugé du cachemire vit encore ; leurs femmes portent des rivières et des girandoles ; leur luxe est toujours une épargne ; dans leur maison, tout est cossu, et vous lisez au-dessus de la loge : « Parlez au suisse. » Si dans la somme sociale ils comptent comme chiffres, ce sont des unités.
Pour les parvenus de cette classe, la vie est résolue par le titre de baron, et l’élégance par un grand chasseur bien emplumé ou par une loge à Feydeau.
Là cesse la vie occupée. Le haut fonctionnaire, le prélat, le général, le grand propriétaire, le ministre, le valet[1] et les princes sont dans la catégorie des oisifs et appartiennent à la vie élégante.
Après avoir achevé cette triste autopsie du corps social, un philosophe éprouve tant de dégoût pour les préjugés qui amènent les hommes à passer les uns près des autres en s’évitant comme des couleuvres, qu’il a besoin de se dire : « Je ne construis pas à plaisir une nation, je l’accepte toute faite. »
Cet aperçu de la société, prise en masse, doit aider à concevoir nos premiers aphorismes, que nous formulons ainsi :
Le but de la vie civilisée ou sauvage est le repos.
Le repos absolu produit le spleen.
La vie élégante est, dans une large acception du terme, l’art d’animer le repos.
L’homme habitué au travail ne peut comprendre la vie élégante.
Corollaire. Pour être fashionable, il faut jouir du repos sans avoir passé par le travail : autrement, gagner un quaterne, être fils de millionnaire, prince, sinécuriste ou cumulard.
De la vie d’artiste
L’artiste est une exception : son oisiveté est un travail, et son travail un repos ; il est élégant et négligé tour à tour ; il revêt, à son gré, la blouse du laboureur, et décide du frac porté par l’homme à la mode ; il ne subit pas de lois : il les impose. Qu’il s’occupe à ne rien faire, ou médite un chef-d’œuvre, sans paraître occupé ; qu’il conduise un cheval avec un mors de bois, ou mène à grandes guides les quatre chevaux d’un britschka ; qu’il n’ait pas vingt-cinq centimes à lui, ou jette de l’or à pleines mains, il est toujours l’expression d’une grande pensée et domine la société.
Quand M. Peel entra chez M. le vicomte de Chateaubriand, il se trouva dans un cabinet dont tous les meubles étaient en bois de chêne : le ministre trente fois millionnaire vit tout à coup les ameublements d’or ou d’argent massif qui encombrent l’Angleterre écrasés par cette simplicité.
L’artiste est toujours grand. Il a une élégance et une vie à lui, parce que, chez lui, tout reflète son intelligence et sa gloire. Autant d’artistes, autant de vies caractérisées par des idées neuves. Chez eux, la fashion doit être sans force : ces êtres indomptés façonnent tout à leur guise. S’ils s’emparent d’un magot, c’est pour le transfigurer.
De cette doctrine se déduit un aphorisme européen :Un artiste vit comme il veut, ou… comme il peut.
De la vie élégante
Si nous omettions de définir ici la vie élégante, ce traité serait infirme. Un traité sans définition est comme un colonel amputé des deux jambes : il ne peut plus guère aller que cahin-caha. Définir, c’est abréger : abrégeons donc.
Définitions
La vie élégante est la perfection de la vie extérieure et matérielle ;Ou bien :L’art de dépenser ses revenus en homme d’esprit ;Ou encore :La science qui nous apprend à ne rien faire comme les autres, en paraissant faire tout comme eux ;
Mais mieux peut-être :Le développement de la grâce et du goût dans tout ce qui nous est propre et nous entoure ;Ou plus logiquement :Savoir se faire honneur de sa fortune.Selon notre honorable ami, E. de G…, ce serait :La noblesse transportée dans les choses.
D’après T.-P. Smith :La vie élégante est le principe fécondant de l’industrie.Suivant M. Jacotot, un traité sur la vie élégante est inutile, attendu qu’il se trouve tout entier dans Télémaque. (Voir la Constitution de Salente.)À entendre M. Cousin, ce serait, dans un ordre de pensées plus élevé :
« L’exercice de la raison, nécessairement accompagné de celui des sens, de l’imagination et du cœur, qui, se mêlant aux institutions primitives, aux illuminations immédiates de l’animalisme, va teignant la vie de ses couleurs. » (Voyez page 44 du Cours de l’histoire de la Philosophie, si le mot vie élégante n’est pas véritablement celui de ce rébus.)
Dans la doctrine de Saint-Simon :
La vie élégante serait la plus grande maladie dont une société puisse être affligée, en partant de ce principe : « Une grande fortune est un vol . »
Suivant Chodruc :Elle est un tissu de frivolités et de billevesées.La vie élégante comporte bien toutes ces définitions subalternes, périphrases de notre aphorisme III ; mais elle renferme, selon nous, des questions plus importantes encore, et, pour rester fidèle à notre système d’abréviation, nous allons essayer de les développer.Un peuple de riches est un rêve politique impossible à réaliser. Une nation se compose nécessairement de gens qui produisent et de gens qui consomment. Comment celui qui sème, plante, arrose et récolte, est-il précisément celui qui mange le moins ? Ce résultat est un mystère assez facile à dévoiler, mais que bien des gens se plaisent à considérer comme une grande pensée providentielle. Nous en donnerons peut-être l’explication plus tard, en arrivant au terme de la voie suivie par l’humanité. Pour le moment, au risque d’être accusé d’aristocratie, nous dirons franchement qu’un homme placé au dernier rang de la société ne doit pas plus demander compte à Dieu de sa destinée qu’une huître de la sienne.
Cette remarque, tout à la fois philosophique et chrétienne, tranchera sans doute la question aux yeux des gens qui méditent quelque peu les chartes constitutionnelles, et, comme nous ne parlons pas à d’autres, nous poursuivrons.
Depuis que les sociétés existent, un gouvernement a donc toujours été nécessairement un contrat d’assurance conclu entre les riches contre les pauvres. La lutte intestine produite par ce prétendu partage à la Montgomery allume chez les hommes civilisés une passion générale pour la fortune, expression qui prototype toutes les ambitions particulières ; car du désir de ne pas appartenir à la classe souffrante et vexée dérivent la noblesse, l’aristocratie, les distinctions, les courtisans, les courtisanes, etc.
Mais cette espèce de fièvre qui porte l’homme à voir partout des mâts de cocagne et à s’affliger de ne s’y être juché qu’au quart, au tiers ou à moitié, a forcément développé l’amour-propre outre mesure et engendré la vanité. Or, comme la vanité n’est que l’art de s’endimancher tous les jours, chaque homme a senti la nécessité d’avoir, comme un échantillon de sa puissance, un signe chargé d’instruire les passants de la place où il perche sur le grand mât de cocagne au sommet duquel les rois font leurs exercices. Et c’est ainsi que les armoiries, les livrées, les chaperons, les cheveux longs, les girouettes, les talons rouges, les mitres, les colombiers, le carreau à l’église et l’encens par le nez, les particules, les rubans, les diadèmes, les mouches, le rouge, les couronnes, les souliers à la poulaine, les mortiers, les simarres, le menu vair, l’écarlate, les éperons, etc., etc., étaient successivement devenus des signes matériels du plus ou moins de repos qu’un homme pouvait prendre, du plus ou moins de fantaisies qu’il avait le droit de satisfaire, du plus ou moins d’hommes, d’argent, de pensées, de labeurs, qu’il lui était possible de gaspiller. Alors, un passant distinguait, rien qu’à le voir, un oisif d’un travailleur, un chiffre d’un zéro.Tout à coup la Révolution, ayant pris d’une main puissante toute cette garde-robe inventée par quatorze siècles, et l’ayant réduite en papier-monnaie, amena follement un des plus grands malheurs qui puissent affliger une nation. Les gens occupés se lassèrent de travailler tout seuls ; ils se mirent en tête de partager la peine et le profit, par portions égales, avec de malheureux riches qui ne savaient rien faire, sinon se gaudir en leur oisiveté !…Le monde entier, spectateur de cette lutte, a vu ceux-là mêmes qui s’étaient le plus affolés de ce système le proscrire, le déclarer subversif, dangereux, incommode et absurde, sitôt que, de travailleurs, ils se furent métamorphosés en oisifs.