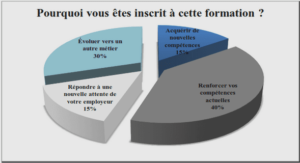PROCESSUS DE SCOLARISATION EN CASAMANCE
« L’école […] apprivoise les indigènes » 105 (1935)
Les acteurs de l’école, tant publics que privés, devaient concourir à légitimer et à asseoir la présence de la France en Afrique en véhiculant, par le biais des programmes, une image positive de l’envahisseur. Au cours du dernier quart du 19 ème siècle, l’enseignement, en Casamance, fut assuré par les congrégations religieuses. Comme le note D. Bouche, dans le contexte européen de « nationalisme exacerbé » à la fin du 19ème siècle, les missionnaires, s’ils voulaient obtenir des subventions, de l’Etat ou même de particuliers, devaient montrer qu’ils ne se limitaient pas à l’enseignement religieux, « mais qu’ils étaient aussi des instituteurs et propagateurs de l’idée française »106. Le soutien de l’administration aux missionnaires se cantonnait à un soutien politique et de manière sporadique, financier. Monseigneur Buléon, vicaire apostolique de la Sénégambie, tenta sans succès d’obtenir des aides du gouvernement justifiant ses requêtes en montrant comment les missionnaires pourraient se mettre au service de la politique coloniale en ouvrant des écoles : « Pourquoi les colonnes de pénétration qui parcourent le pays, ne seraient-elles pas suivies d’écoles de pénétration ? Leur œuvre pour être plus lente et moins terrible, n’en serait que plus durable »107 Cependant, les relations houleuses entre missionnaires et administrateurs ne permirent pas toujours une collaboration sereine, et il arriva, à maintes reprises, qu’elle fut remise en cause. A partir de 1903, avec l’institution de l’école de village, « organe d’apprivoisement, instrument de civilisation matérielle »108, s’imposa l’idée de toucher un grand nombre d’enfants. Cette exigence quantitative s’expliquait par la volonté de diffuser la langue française auprès du plus grand nombre de telle sorte que les élèves puissent comprendre quelques mots de français et ainsi de leur le faire connaître « les intentions » de la France. Les bienfaits de la présence française en Afrique sont donc enseignés aux enfants : la construction de routes, d’écoles et de dispensaires, en somme, la « mission civilisatrice » est mise en valeur contrairement aux caractères plus sombres de la domination qui en sont le pendant négatif : violence de la conquête, travail forcé, impôts divers laissant parfois exsangue les populations qui y sont soumises. Malgré le manque de supports, certains maîtres, sont parvenus à rassembler les éléments de l’histoire locale en interrogeant les « anciens » et en utilisant les monographies établies par les administrateurs. Les leçons dispensées attestaient notamment de la supériorité de la France et justifiaient la conquête en réécrivant l’histoire de contrées jugées « barbares » où régnait le désordre avant l’arrivée des Français : « On a pu, soit en lecture, soit en histoire et géographie du Sénégal, parler de la France, de ses grandes villes, de sa civilisation, de ses richesses et mettre en lumière ses grands hommes, et l’œuvre de progrès, de justice et d’humanité qu’elle ne cesse d’accomplir » Quant au cours d’éducation civique : « Il a pour but de montrer à l’indigène les bienfaits que la France lui a prodigués : « Service postal et télégraphique […] Travaux publics : routes, place publique, warf [sic] […] Service de la justice […] Service de la santé […] Service de l’agriculture […] Service de l’enseignement : instituteurs, moniteurs, écoles. » Tant de bienfaits appellent la reconnaissance : « Amour de la France et de ses représentants, obéissance aux lois, paiement régulier des impôts de toute nature dont le but est de subvenir aux dépenses de la collectivité » 109 » (1911). L’instituteur de Ziguinchor s’attelait à légitimer la présence française ainsi qu’à faire connaître aux élèves leurs devoirs envers la France: « Mais nous n’avons pas manqué de leur indiquer les devoirs impérieux qu’ils ont à remplir envers la patrie : amour de la France et de ses représentants, paiement régulier des impôts de toute nature, sans lesquels la société qui est une grande famille, ne pourrait vivre, se développer et se maintenir au rang des nations civilisées »110(1912). Le maître de l’école de Kolda dispensait ainsi une leçon sur l’histoire du Fouladou. Dans son rapport scolaire, il confiait les grandes lignes de ce cours : « Domination des mandingues dans le Fouladou vers 1867. […] Les successeurs d’Alfa Molo […] Administration actuelle du pays comparée à celle de Moussa ; bonheur des habitants, sécurité, liberté, justice, droit de propriété etc » 111(1913).
Le rôle de l’école dans la « mise en valeur » des colonies
L’enseignement théorique, français et mathématique, et l’enseignement pratique, agricole et professionnel, étaient envisagés dans l’optique jamais écartée que l’école devait également concourir à l’exploitation économique des contrées colonisées. En outre, elle introduisait insidieusement le système capitaliste au sein des populations africaines. En Afrique, comme enfants originaires des villages de Tendième et de Soutou notamment logeaient à l’école et y étaient nourris. 135 ANS, O440 (31), Rapport général sur les écoles visitées en Casamance, Tournée du 29/11 au 27/12 1937 par Charles Béart. 136 Ibidem 62 en France à la même époque, sa fonction était avant tout utilitariste et dès 1882, l’administration proposa que l’école soit obligatoire pour les traitants afin qu’ils puissent parler, lire et écrire en français et ainsi de faciliter le commerce : « Les maisons commerciales se trouvent souvent dans la nécessité de s’en remettre complètement à la bonne foi et à la sûreté de mémoire de leurs traitants à défaut de pièces comptables » . L’institution scolaire devait permettre la formation d’ouvriers, pour l’agriculture ou pour les industries, d’employés et d’interprètes pour le commerce et l’administration dont la langue commune était nécessairement le français. Parallèlement, l’économie, tant dans ses structures régionales que locales, ainsi que ses fluctuations, influa sur les orientations de l’enseignement : l’institution tenta de s’y adapter en ajustant la formation scolaire aux besoins économiques. Le rôle de l’école est de « [former] en masse des agents destinés à la vie productive »138 et créateurs de richesses. Dans un pays largement rural, l’enseignement agricole eut d’emblée une place de choix. Bien qu’il était ainsi inscrit dans les programmes des écoles des pays de protectorat, le manque de moyens investis entravait son exécution. A Carabane, depuis 1899, il existait un jardin que les élèves arrosaient chaque matin et soir mais l’instituteur notait l’absence d’instruments aratoires en 1908139. Cette activité se limitait en fait « au sarclage et à l’arrosage des plates-bandes du jardin »140. L’année suivante, l’instituteur, dont les multiples demandes de matériel agricole n’avaient eu aucun effet, décida d’arrêter : « Nous avons un emplacement bien clôturé et à la proximité de l’école où l’on développait les connaissances des élèves et le goût naturel que ces enfants ont pour l’agriculture. Mais faute d’instruments de jardinage tels : bèches, rateau [sic], arrosoirs, l’on s’est vu obligé d’abandonner ce qui pourrait donner de bons résultats »141(1911). Un rapport sur l’enseignement au Sénégal en 1915 soulignait que l’obligation pour chaque école d’entretenir un jardin n’avait pu être généralisée notamment à cause de « [l’] insuffisance ou l’éloignement des puits ».A Bignona, l’instituteur dispensait un enseignement agricole théorique, « des leçons orales sur l’agriculture et des exercices de pliage » car : « L’école ne possède ni de jardin, ni le plus élémentaire outillage agricole [demandé] à plusieurs reprises »143 . En 1916, le Gouverneur Général de l’AOF Angoulvant rappelait la nécessité de « donner à l’enseignement et à la vulgarisation agricole une activité nouvelle » afin d’amorcer une mutation profonde des pratiques de culture et de « substituer à l’exploitation routinière et partielle du sol de véritables méthodes de culture, une mise en valeur raisonnée et aussi large que possible ». Parce que les adultes seraient réfractaires à ces changements, le Gouverneur préconisa de : « Réserver le principal effort à l’éducation des jeunes esprits, plus éveillés, plus souples, plus confiants. C’est donc surtout par l’enseignement donné dans nos écoles que nous chercherons à vulgariser les méthodes qui ont fait leur preuve ; à tous les étages de l’enseignement, nous donnerons une leçon d’agriculture une place d’honneur et pas un seul des élèves qui sortirent de nos établissements n’aura le droit d’ignorer l’intérêt particulier que nous accordons aux occupations agricoles, les cultures dont nous désirons l’extension, les procédés courants dont nous recommandons l’usage »144 . Au lendemain de la première guerre mondiale, dont la France sortie exsangue, l’orientation pratique de l’enseignement s’accentua pour participer à la mise en valeur des colonies et contribuer ainsi au « redressement de l’économie métropolitaine »145. Un arrêté pris par le gouverneur Angoulvant le 1er novembre 1918 institua l’enseignement technique supérieur. Pour Albert Sarraut, le principal artisan de cette réforme, « l’instruction a d’abord pour résultat d’améliorer la valeur de la production coloniale en la multipliant »146. Comme le souligna Paul Crouzet, Inspecteur de l’Académie de Paris et Inspecteur-conseil de l’Instruction publique : « La situation économique d’après-guerre imposait de plus en plus la mise en valeur des colonies laquelle devait trouver une aide indispensable dans une instruction plus étendue et toujours mieux appropriée
Qu’en est-il des colonisées ?
Principes de l’enseignement féminin Les projets ne sont pas aussi ambitieux pour les filles que pour les garçons. Comme le souligne Arlette Gautier, « l’enseignement pour les garçons a un but professionnel et celui pour les filles une vocation domestique, que ce soit dans les colonies anglaises ou françaises » . De manière générale, les garçons sont destinés à la fonction publique. Les filles sont quant à elle, dans leur grande majorité, préparées pour leur futur rôle au sein de leur foyer167, en tant qu’épouses et mères. Avec l’ouverture progressive du marché du travail aux filles, ces principes furent maintenus et les femmes africaines avaient comme opportunités des métiers essentiellement « féminins » dans les domaines de l’éducation et de la santé168 . Les autorités coloniales et les congrégations féminines s’accordèrent parfaitement sur les principes qui sous-tendaient l’éducation des femmes en Afrique. Au cours du 19ème siècle et jusqu’à l’organisation de l’enseignement en AOF, l’enseignement des filles fut entièrement confié aux sœurs. Au Sénégal, la première école de filles fut ouverte dès 1819 à Saint-Louis par les sœurs de St Joseph de Cluny. Pour les sœurs, l’école devait « former de bonnes mères de familles, utiles par leur piété et leur savoir-faire à la société et à la civilisation169 ». A l’école des sœurs de Sédhiou, les élèves apprenaient la lecture et l’écriture, et s’appliquaient « aux ouvrages propres à leur sexe170 ». Avec la charte de l’enseignement en AOF de 1903, les programmes scolaires contiennent pour les filles comme pour les garçons des matières générales auxquelles s’ajoutaient, pour les secondes, « l’enseignement des sciences naturelles appliquées à l’hygiène – notamment infantile – du blanchissage, du repassage, de la couture, de la cuisine ». Pour l’inspecteur de l’enseignement en 1914, M. Courcelle, l’enseignement ménager, et plus particulièrement la couture, est primordial car il permettra aux jeunes filles d’ « être très utiles aux personnes qui les prendront plus tard à leur service ». En marge de cette remarque, un administrateur voulut affirmer son indignation d’un « Oh ! », ce qui montre que cet inspecteur ne faisait tout de même pas l’unanimité. Au cours de la période qui suivit la première guerre mondiale , émergea une volonté politique de développer l’enseignement des filles afin « de restaurer un équilibre social mis à mal par la formation scolaire quasi-exclusive de la scolarisation des garçons »174 et de s’immiscer au cœur des familles par le biais des femmes, en tant que mères et éducatrices elles-mêmes. A partir des années vingt, l’administration coloniale s’intéressa donc à l’éducation des filles et projeta de sélectionner une élite féminine comme le souligne Pascale Barthélémy : « L’idée que la réussite de l’entreprise de civilisation dépend de la pénétration des valeurs occidentales au cœur des familles et que les femmes africaines peuvent en être l’intermédiaire privilégiée apparaît à la fin de la première guerre » . Par la circulaire ministérielle de 1924, on reconnaissait en effet que « par la femme nous touchons au cœur même du foyer indigène »176. Dans le domaine de la santé notamment, leur rôle sembla soudainement indispensable aux colonisateurs.
Première partie |