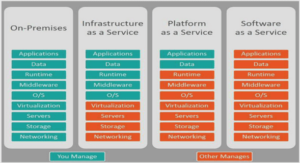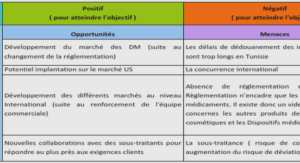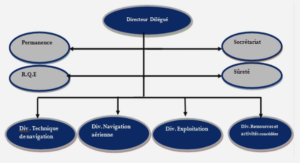L’innu et les langues algonquiennes
Contexte linguistique et géographique
Anciennement connue sous le nom de montagnais, la langue innue appartient à la branche algonquienne de la famille algique. Au Québec, la famille linguistique algonquienne regroupe les autres langues suivantes : le cri, l’algonquin, l’atikamekw, le naskapi, le micmac, l’abénaki ainsi que le malécite. Mais cette dernière n’est toutefois plus parlée aujourd’hui au Québec : elle l’est cependant encore au Nouveau-Brunswick. Plus spécifiquement, l’innu fait partie des langues algonquiennes du Centre, un sous-groupe linguistique très étendu géographiquement. Pour le cas de l’innu, sa situation géographique inclut le Labrador ainsi que la région de la (Basse) Côte-Nord au Québec. L’innu comprend tous les dialectes parlés par les Innus et s’insère dans un continuum dialectal avec le cri de l’Est et le naskapi. Les locuteurs de l’innu sont au nombre d’environ 10 000 au Québec et se répartissent en neuf communautés le long de la côte. Ces communautés sont Mashteuiatsh (Pointe Bleue) et Pessamit (Betsiamites). Celles-ci forment le groupe dialectal de l’Ouest. Uashat mak Mani-utenam (Sept-Îles) ; Matimekush (Shefferville) ; Mamit (la Basse Côte-Nord) ; Ekuanitshit (Mingan) ; Nutashkuan (Natashquan) ; Unaman-shipu (La Romaine) ; Pakut-shipu (Saint4 L’innu et les langues algonquiennes Augustin) et Sheshatshit (North West River, NL) qui forment le groupe de l’Est ou dialectes dits de Mamit (Drapeau, 2014 : 1-5). La carte présentée ci-après (Figure 1.1) permet de visualiser la situation géographique de ces communautés en fonction de leur appartenance dialectale : Cette carte présente les différents dialectes cris encore parlés au Québec aujourd’hui. En beige figure la répartition dialectale de l’innu de l’Est et en brun, le groupe de l’Ouest. Ces deux groupes se distinguent par plusieurs spécificités dialectales et phonologiques, la plus caractéristique étant la prononciation du /l/ proto-algonquin. Ainsi, le groupe de l’Ouest comprend les dialectes en /l/ 2 et le groupe de l’Est comprend les dialectes en /n/. Sinon, en vert figure la zone linguistique naskapie ; en bleu, la zone du cri de l’Est et en violet, l’aire linguistique atikamekw.
Contexte démolinguistique et sociolinguistique
Parmi le nombre de langues indigènes encore parlées en Amérique du Nord de nos jours, le Québec en compte une dizaine sur l’entier de son territoire. Selon le recensement de population mené par Statistique Canada en 2011, le 20,9% de l’ensemble des locuteurs de langue maternelle autochtone du Canada se trouve dans la province du Québec, ce qui fait d’elle la province à la tête du classement 3 . Les dix langues autochtones de cette province se regroupent en trois grandes familles linguistiques à savoir la famille algonquienne, comme nous 1. In Drapeau (2014 : 6). 2. Dans le système d’écriture innu actuel, ce /l/ est noté ‘ǹ’. 3. http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/as-sa/98-314-x/2011003/fig/fig3_ 3-1-fra.cfm 5 l’avons vu précédemment ; la famille iroquoienne qui comprend le mohawk et le huron-wendat qui n’est cependant plus du tout parlée 4 et enfin la famille esquimau-aléoute qui comporte l’inuktitut. La Figure 1.2 permet de situer géographiquement ces langues en fonction de leur appartenance communautaire respective. D’après les statistiques de populations autochtones du Québec menées en 2015, la nation innue compte une population de près de 20 000 individus, résidents et non-résidents des différentes communautés 5 . Ce chiffre n’inclut par contre pas la population innue du Labrador. La Figure 1.2 illustre la situation géographique des communautés innues du Québec se répartissant le long de la Côte-Nord et de la Basse Côte-Nord. Figure 1.2 – Les communautés innues du Québec D’un point de vue linguistique, l’innu est donc la langue maternelle et la langue d’usage de près de la moitié de la population innue, bien que celle-ci soit aujourd’hui presque complètement bilingue (innu-français et innu-anglais pour les Innus du Labrador et de Pakuashipi) 6 . En effet, selon Statistique Canada 2011, la population autochtone de langue maternelle innue au Québec et au Labrador s’élève à près de 11 000 individus. Le terme de langue maternelle est défini par Statistique Canada comme la première langue apprise à la maison dans l’enfance et encore comprise par le recensé au moment du recensement 7 . De plus, 88,6% de la population recensée a déclaré que l’innu est la langue la plus souvent parlée à la maison et 6,7% a déclaré parler régulièrement innu à la maison 8 . L’innu est de ce fait considéré comme une langue viable, mais fragile (Baraby, 2011 : 51). Mais bien que, par rapport au reste du Canada, les langues autochtones du Québec soient encore les mieux préservées depuis une vingtaine d’années, leur situation sociolinguistique change et n’est pas comparable à celle des langues majoritaires comme l’anglais ou le français qui jouissent d’un grand dynamisme. À ce propos, Drapeau (2011 : 9-10) dresse un portrait de la situation sociolinguistique qui caractérise les langues autochtones du Québec en identifiant les facteurs principaux qui rendent difficile la survie de celles-ci. En effet, chaque langue est d’abord parlée par un nombre restreint de locuteurs vivant dans de petites communautés éloignées les unes des autres et passablement isolées. Ensuite, ces langues sont de tradition orale. Jusqu’à récemment, elles ne possédaient pas de corpus écrit ni de système d’écriture uniformisé. L’écrit occupe de ce fait une place marginale au sein des communautés. De plus, le statut minoritaire des langues autochtones contraint les locuteurs à devenir bilingues. Le bilinguisme langue majoritaire/langue autochtone devient par conséquent en cours de généralisation auprès des locuteurs de ces langues minoritaires, d’une part au travers de la scolarisation et de l’usage des médias de masse et d’autre part, au travers de la communication avec les Allochtones (les non-Autochtones). Par ailleurs, ce bilinguisme généralisé entraîne alors un état de diglossie au sein des communautés : la langue autochtone est parlée dans les situations informelles et la langue majoritaire est utilisée dans les situations formelles et écrites. Enfin, le bilinguisme a également pour effet, à long terme, l’abandon progressif de la langue ancestrale au profit du français ou de l’anglais. Ainsi, d’une manière générale, plus les locuteurs sont âgés, plus ils maîtrisent la langue et plus ils sont jeunes, moins ils la maîtrisent.
Résistance culturelle
Malgré l’assimilation culturelle et linguistique qu’ont subi les Autochtones, il convient toutefois de noter les manifestations de résistance et de résilience qui ont cours depuis les années 1970. Ici, nous insisterons principalement sur la résistance linguistique qui se manifeste au travers de l’expression artistique (groupes de musique, festivals, danse, littérature, etc.) et de 8 l’appropriation des médias (radio, blogs). En ce qui concerne le cas de la communauté innue, de nombreuses initiatives ont émergé en réponse à cette assimilation. On peut d’ailleurs mentionner le projet d’amérindianisation des écoles autochtones vers la fin des années 1970, dont l’école innue de Pessamit en est un exemple, comme nous en avons déjà parlé précédemment. Or, comme le notent Hot et Terraza (2011 : 22), l’école n’est pas le seul lieu d’utilisation de la langue, bien que l’éducation représente un enjeu crucial pour l’entretien de cette résistance. Une initiative communautaire significative pour les Innus a été la création d’un institut culturel. Anciennement connu comme l’IECAM (Institut éducatif culturel atikamekw montagnais) dédié aux Innus et aux Atikamekws dès la fin des années 1960, l’Institut Tshakapesh est à l’heure actuelle un organisme uniquement dédié aux Innus et ce, depuis 1989. Il a pour mission non seulement de préserver le patrimoine culturel et linguistique des Innus, de promouvoir la réussite éducative des jeunes et l’implication des parents dans l’éducation de leurs enfants, mais aussi de veiller à la formation des enseignants et de soutenir la conception de matériel scolaire (Hot et Terraza, 2011 : 35). La SOCAM (Société de communication Atikamekw-Montagnais) représente aussi un organisme important qui illustre l’appropriation des médias par les Autochtones. Créée en 1983, la SOCAM forme un réseau radiophonique regroupant au départ les radios locales du territoire innu et aujourd’hui elle couvre quatorze communautés autochtones (2011 : 37). L’émergence d’une multitude de productions artistiques constitue un autre exemple d’initiatives implicites de résistance linguistique. Chez les Innus, la musique populaire a toujours connu un grand succès, d’abord grâce au groupe de renommée internationale des années 1980 Kashtin et aujourd’hui encore au travers de la carrière solo de son ancien chanteur, Florent Vollant, mais aussi du rappeur Shauit ou du jeune Matthew Vachon. Le festival Innu Nikamu à Sept-Îles témoigne d’ailleurs du nombre grandissant de groupes musicaux autochtones de tous horizons. Il convient également de mentionner les timides initiatives de productions littéraires en langue innue, comme les ouvrages d’An Antane Kapesh ou les œuvres poétiques de Rita Mestokosho ou de Joséphine Bacon. Bien que la jeune relève soit florissante, dont Natasha Kanapé Fontaine et Naomi Fontaine en sont des figures prometteuses, ces jeunes auteures écrivent toutefois en français, et non pas en innu. 4
An Antane Kapes
h An Antane Kapesh peut sans aucun doute être considérée comme l’auteure autochtone la plus importante au Québec. Née en 1926 dans le bois, elle connaît la vie traditionnelle et nomade jusqu’à la création de la réserve de Uashat-mak-mani-Utenam (Maliotenam), près de Sept-Îles, en 1953. Entre 1965 et 1967, elle exerce le poste de chef de bande de la réserve de Matimekosh, non loin de Schefferville. Elle n’a jamais été scolarisée, mais a toutefois appris à lire et à écrire dans sa langue (Boudreau, 1991 : 59-60). 9 Publié en 1976, son premier ouvrage Eukuan nin matshimanitu innu-iskueu – Je suis une maudite sauvagesse dénonce les méfaits du colonialisme blanc à l’encontre de la culture indienne et innue. Au travers de neuf chapitres qui constituent en somme des récits indépendants, l’essai évoque des sujets aussi divers que l’éducation blanche, la découverte du minerai dans le Nord, les maisons des Blancs, etc. Ces récits sont marqués par la tradition orale, le style étant très répétitif et redondant. Autrement dit, Kapesh écrit « en puisant aux sources mêmes de la tradition orale » (Boudreau, 1991 : 59). Pourtant, ses écrits ne constituent pas des transcriptions de l’oral, par opposition à la majorité des productions écrites en langue innue (Baraby, 2011 : 61). Soucieuse de transmettre un message fort aux siens et aux Blancs, le livre a été alors écrit en innu, mais il est publié en édition bilingue innu – français. Ceci apparaît comme une nécessité « pour rejoindre un lectorat plus large » (Gatti, 2006 : 115). Cependant, pour Mailhot (1996 : 23), le fait de publier en édition bilingue « trahit l’hésitation des Innus à accorder à leur propre langue le statut de véhicule normal de communication écrite », point rapidement soulevé à la fin de la section 1.3. An Antane Kapesh est ainsi la première femme autochtone au Canada à publier des ouvrages en français 9 . Dans la préface, Kapesh explique l’importance de l’écriture comme un acte engagé : « Dans mon livre, il n’y a pas de parole de Blanc. Quand j’ai songé à écrire pour me défendre et pour défendre la culture de mes enfants, j’ai d’abord bien réfléchi car je savais qu’il ne fait pas partie de ma culture d’écrire et je n’aimais pas tellement partir en voyage dans la grande ville à cause de ce livre que je songeais à faire. ».