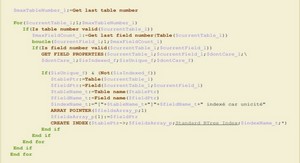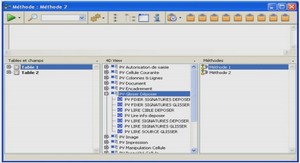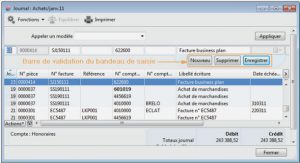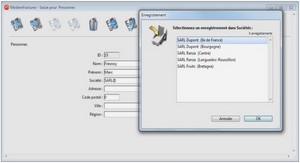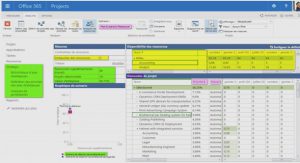Marche et photographie : se reconduire au paysage
L’écriture nous permet de revenir sur des expériences passées pour, non seulement en dégager le sens caché, mais bien pour les élaborer en ce que nous avons appelé une continuité existentielle. Elle est donc un moment où nous ne nous confrontons plus directement au paysage, mais choisissons de passer par le langage afin d’approfondir notre expérience du monde. Mais, si cette étape est nécessaire, il s’avère que, peut être, elle ne nous donne pas toutes les clefs pour retourner à ce monde que nous avons cherché à mettre en mots. L’écriture nous aide à revenir sur l’expérience du paysage, mais il nous faut peut être chercher ailleurs comment retourner à l’empirie. Il apparait que la photographie, et plus précisément la photographie articulée à la marche, permet ce retour au paysage afin d’y percevoir à la surface des choses ce que, par l’écriture, nous avions mis au jour. En tant que processus dynamique d’expression la photographie nous permet de ressaisir dans un rapport effectif au monde ce que nous avions exploré grâce aux mots. De par son instantanéité, elle est le cri qui exulte la pertinence des mots prononcés tout en, dans le même temps, les faisant vaciller. Partir ausculter le monde de ses pas et en ressaisir les apparitions par la photographie semble être être une entreprise paradoxale. En effet, il y a dans la photographie une dimension ludique très forte qui est permise par l’espace de jeu ménagé par la distance qu’instaure l’objectif entre nous et le monde, distance dont nous pouvons modifier les modalités pour tâcher d’exprimer, par des saisies, quelque chose de notre vision du monde. Mais, par là, photographier ce qui se donne dans la marche implique aussi une prise de risque, car nous remettons en jeu notre façon d’exister le paysage. L’écriture se fait dans un espace-temps que l’on maitrise assez facilement ; nous écrivons à un bureau, protégé dans une maison, nous pouvons arrêter quand nous le souhaitons. Au contraire, la photographie nous impose de prendre le risque de la surprise de ce qui, du monde, nous apparaîtra ou non. Alors, l’épreuve devient, peu à peu, de trouver ce que nous faisons de la surprise et de l’événement ; par la photographie nous essayons, d’une certaine façon, de nous en saisir pour développer à partir d’eux une coprésence moi-monde, un être au monde incarné. Par la photographie nous cherchons, non pas tant à dire le paysage, qu’à trouver la note, la secousse, à travers laquelle prendront sens les mots proférés. Nous cherchons, d’une certaine façon, à sortir du langage pour que celui-ci ne tourne pas sur lui même mais s’actualise dans une pratique, c’est à dire dans une vision. Toutefois, il est évident que, par la photographie, nous ne sortons pas du langage. En effet, au moment même où nous nous confrontons à l’empirie à travers l’appareil photographique notre vision se ressaisit de la somme des paroles passées et présentes, écrites et orales. Cela lui confère une épaisseur temporelle et sémantique qui l’instaure dans un écart avec le présent de ce 49 qui se donne. Mais ce décallage ne signifie pas que nous soyons à distance du monde, bien plutôt, il est ce qui fait que, dans notre pratique de la photographie, les phénomènes se trouvent rénovés. Peu à peu, cette totalité qu’est le paysage dans lequel nous déambulons se phénoménalise en des apparitions qui semblent se détacher plus nettement. La photographie semble être un exercice pour ramener le sens dans la forme, la profondeur à la surface, la durée lentement élaborée dans l’instant. Par là il apparait qu’elle est un bon médium pour nous permettre de retourner à l’expérience, mais à une expérience dont les modalités ont été changées. Mais il faut insister sur le fait qu’en aucun cas la photographie n’est une sortie complète du langage. Par elle, le phénomène se donne dans l’épaisseur du langage, autant au moment de la capture qu’après quand, au soir, nous rentrons chez nous et reprenons les photographies de la journée pour sélectionner les meilleures, voire les modifier. Alors, on cherche à exprimer le mieux possible, sans qu’on ne sache véritablement ce qu’il s’agit d’exprimer. On cherche la note, le ton le plus juste. Ici, le regard de l’ami se trouve avoir une cruciale importance. C’est aussi à l’aune de l’accord ou non que la photographie suscite entre nous et l’autre que nous considérons cette photo que nous avons sous les yeux. Apparaît une nouvelle fonction de la photographie ; elle nous permet d’ouvrir un espace potentiel de rencontre avec autrui, d’interpellation mutuelle moi/autre/paysage pour, finalement, opérer un retour à la discussion, à la parole, parlée ou écrite. Pour bien comprendre cette richesse de la photographie articulée à la marche, notre réflexion évoluera en deux temps. Tout d’abord nous nous concentrerons sur ce que signifie proprement particulierement partir explorer le paysage. Puis nous reviendrons plus précisément sur la photographie pour comprendre comment elle peut nourrir et se nourrir de notre marche. a) D’un paysage à explorer : l’espace circulaire Décider de partir photographier l’espace de la marche, pour tâcher d’exprimer un peu mieux ce qui se fait jour quand nous allons au devant du paysage et que nous ne nous contentons plus de notre passivité habituelle. Le paysage n’est plus simplement un environnement. Nous cherchons à sortir de la façon dont, quotidiennement, nous ignorons ce qui nous entour, ou nous contentons de le saisir à travers nos intérêts pratiques. Non pas que nous critiquions ce rapport à l’espace ; il est vital et c’est lui qui, pour une bonne part, a sculpté ce territoire. C’est par lui que les paysans ont décidé où cultiver, où faire passer les sentiers de transhumance, qui sont devenus les chemins où nous circulons aujourd’hui. Simplement, par lui, nous ratons quelque chose du pouvoir subversif du paysage qui a la force de nous confronter à un surgissement sur lequel nous sommes sans prise, surgissement de l’inattendu. Il s’agit d’entrer en jeu avec le paysage quand 50 apparaît que quelque chose en lui se dérobe dans sa manifestation même. Alors, nous poussons la porte de chez nous avec la nette conscience que le paysage n’est pas que le cadre de nos actions. Nous n’avons pas toutes les libertés ; il nous faut en respecter l’équilibre écologique, mais aussi la puissance qui fait sens en nous. Seule apparaît, pour le moment, la possibilité de l’exploration. Marcher pour expérimenter le paysage pour ce qu’il est ; un espace circulaire dans lequel c’est notre motricité qui détermine l’apparaître pathique du monde. Seulement, cette circularité ne se fait plus uniquement dans notre corps sentant. Le même mouvement unifie l’ensemble de notre corporéité. Par elle nous donnons au paysage à se manifester, dans nos articulations qui, au bout d’un moment, souffrent de la rudesse des reliefs, dans notre chair qui, peu à peu, porte les stigmates de ces lieux. Non pas seulement dans les éraflures sur nos jambes et nos mains, mais dans le fait de s’être ouvert à l’espace. Non que, en restant immobiles, nous étions dans la fermeture, mais dans la marche nous tâchons d’abolir la distance physique qui nous séparait encore du paysage. C’est dans nos mouvements qu’il vient au monde. Ils lui offrent asile et, en même temps qu’ils sont infiniment dépassés par lui et se laissent porter par ses méandres, lui donnent à être. En bas du terrain de la propriété où je réside, passe un sentier de randonnée qui serpente dans la forêt. Sa présence me rappelle que l’espace qui s’offre à moi implique que je le pratique et m’en saisisse. C’est ce que signifie, pour moi, la marche dans un tel lieu. Il ne s’agit pas simplement de s’aérer l’esprit. La marche y est une forme de connexion, de prise en charge du rythme. Tantôt je sens la pesanteur me clouer au sol et me ralentir terriblement, tantôt mon corps semble s’emballer et je n’ai plus aucun contrôle. La marche n’est plus un parcours de distance, elle devient l’occasion de s’éprouver et d’éprouver la nature du paysage à travers ce que j’éprouve de mon propre corps. La marche devient aussi l’occasion de prendre conscience du caractère inatteignable du paysage. Au moment où elle me met en contact avec lui, elle m’en éloigne. Je domine des gorges, la forêt semble s’étaler de façon rectiligne jusqu’au Tarn et au village de Brousse le château. Le paysage m’invite à cette descente ; et pourtant, quand je marche, je constate que rien n’est rectiligne, que ce que je croyais n’être qu’un petit fossé vu d’en haut est en fait un gouffre infranchissable qu’il faudra contourner, que dans une véritable forêt il est impossible de marcher droit, que mon corps est sans cesse perdu, désorienté, privé de tout repère. Marcher, c’est se jeter « dans la gueule de l’inconnu » 76, quand bien même je connais l’itinéraire à emprunter. C’est en cela que la marche est à chaque fois si précieuse : je m’y mets comme pour saisir à bras le corps ce paysage que j’observais de surplomb, et j’en reviens en me rendant compte que l’expérience que j’ai faite, plutôt que de me révéler un secret du paysage, ne fait qu’en augmenter la complexité. Mon expérience n’en n’est pas moins forte, c’est même le contraire, car elle me fait sentir le caractère en réalité secret du paysage. Je rentre de la randonnée ou de la cueillette exténué, satisfait parce que j’ai été déçu de ne pas trouver ce que j’étais allé chercher ; je m’assoie sur la terrasse, devant les montagnes. « La fatigue agit comme le fixateur sur l’épreuve photographique ; l’esprit, qui perd une à une ses défenses, doucement stupéfié, doucement rompu par le choc du pas monotone, l’esprit bat nu la campagne, s’engoue tout entier d’un rythme qui l’obsède, d’un éclairage qui l’a séduit, du suc inestimable de l’heure qu’il est. » 77 Il y a une ouverture qui se fait, par l’usure, et qui me rend plus présent à ce qui m’entoure. Le paysage n’apparaît que plus massif, insondable, fort. Mais, en plus, il n’est plus quelque chose qui est « à regarder », dans un en face. Il acquièrt une certaine texture, profondeur de l’espace qui s’offre à la déambulation.
Photographier le paysage
prise et lâcher prise D’emblée il faut souligner le fait que la photographie peut, d’une certaine façon, apparaitre comme un medium paradoxal quand il s’agit de penser le paysage non pas seulement comme quelque chose qui est vu mais comme quelque chose qui relève d’un être au monde qui s’expérimente à travers tout le corps sentant. Souvent, les photos prises sont vides ; comme si l’appareil avait été dégainé trop tard et que quelque chose s’était envolé. Dégainer ; exporter les événements, transposer les paysages. Il y a peut être une violence trop forte dans la photographie, violence d’un regard qui cherche à saisir ce qui, justement se fait jour dans un lâcher prise, « dans le recueillement d’un percevoir qui demeure un entendre » 84, dans ce que François Jullien appelle un « laisser apparaître » 85. La photographie est peut être trop du coté de la connaissance, c’est-à-dire de la saisie objective. Elle impose la prévoyance de ce qui apparaîtra, de ce qui, une fois photographié « rendra ». Elle fige ce qui se donne dans le devenir, elle transforme en vue ce qui est de l’ordre de l’ensemble du corps sentant, enclot ce qui est de l’ordre de l’ouvert. On organise, on fixe les objets en leur retirant le libre pouvoir de surgissement ; « les lointains se résignent à n’être que des lointains » 86. Par là, ils n’en sont plus vraiment, dans la mesure où ils perdent leur pouvoir d’apparaître. Cette perte du lointain implique, dans une certaine mesure, une perte de l’aura. Le paysage n’est plus au loin, nous frappant de sa transcendance ; il est là, entre nos mains. Il n’est plus une présence dont nous respirons l’unicité mais quelque chose que nous pouvons saisir et reproduire. Alors que dans le paysage, nous expérimentons la force du lointain qui nous dessaisit parfois de toute capacité d’agir, au contraire dans la photographie il devient quelque chose que nous pouvons manipuler. L’expérience du paysage n’est plus un moment unique mais devient une denrée reproductible. Par cette reproductibilité, c’est vers une certaine maîtrise de ce qui se donne que nous nous dirigons. Or, cette maîtrise, et Benjamin insiste sur cela, implique la perte de la fonction cultuelle de l’expérience esthétique. La photographie risque de nier ce qui, dans le paysage, est de l’ordre d’une présence transcendante, quasi-divine, que nous ne pouvons que respirer. De plus, de par sa nature, elle ne peut saisir que ce qui relève du visuel. Or, il semble il y avoir là un risque. Peut être que saisir le paysage comme « visuelaspectuel le retient à sa surface, l’asséchant dans ses traits, et nous maintient nous-mêmes à l’extérieur : s’y tarit déjà sa ressource. » 87 En voulant résumer notre expérience à ce qui peut être saisi mécaniquement, depuis l’extérieur, le risque est d’en diminuer drastiquement la puissance. Cela explique la méfiance répétée de Maldiney envers la photographie ou, du moins, l’idée formulée de nombreuses fois que la photographie signe la mort de l’espace du paysage. Ce dernier relève, selon Maldiney, d’une modalité pathique de l’espace où nous perdons tout sentiment de distinction entre nous et ce qui nous entoure. Or, le simple fait de sortir son appareil pour photographier ce qui se donne implique la conscience que ceci ne fait pas partie de nous, qu’il est là maintenant mais qu’il ne sera plus là dans un an (ou une minute), que, in fine, le paysage nous est radicalement extérieur et que nous sommes sans prise sur lui. Selon Maldiney, cette conscience est déjà, en quelque sorte, fautive vis-à-vis de l’espace du paysage dans la mesure où, dans le pathique, l’homme n’est pas dans la tentative d’une saisie de ce qui se présente, il est simplement dans la coprésence au monde.