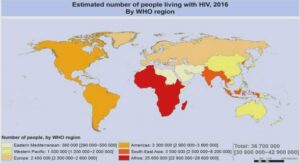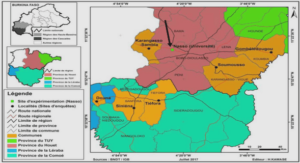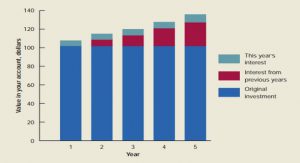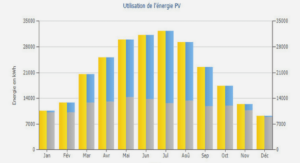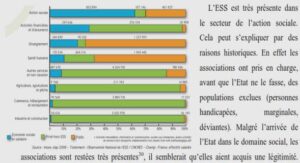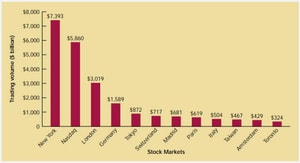Les malformations des voies biliaires extra-hépatiques sont considérées comme des maladies congénitales rares surtout dans les pays occidentaux. L’atrésie des voies biliaires (AVB) et le kyste du cholédoque (KC) constituent les types les plus fréquents (1). La première se distingue par l’existence d’une oblitération, segmentaire ou complète des voies biliaires extra-hépatiques associée constamment à une atteinte des voies biliaires intrahépatiques. Tandis que le second regroupe plusieurs types de malformations congénitales qui se caractérisent par une ou plusieurs dilatations kystiques communicantes des voies biliaires extra ou intra-hépatiques (2). Il peut se manifester à tout âge: chez l’enfant, l’adolescent et l’adulte jeune, mais 60 % des cas étant cependant observés avant l’âge de 10 ans (3).
L’AVB est de manifestation néonatale et précoce. Elle est la cause la plus fréquente des cholestases néonatales et constitue une urgence chirurgicale qui doit être diagnostiquée et traitée avant la fin du premier mois de vie (4). Non traitée, elle se complique d’une cirrhose biliaire et conduit au décès de l’enfant dans sa première année de vie. De même, le kyste du cholédoque, sans traitement efficace, évolue inéluctablement vers la cirrhose biliaire secondaire et le cholangiocarcinome. Étant considéré comme un état précancéreux, le KC doit être aussi diagnostiqué le plus tôt possible puisque la précocité de la prise en charge constitue la seule alternative efficace pour éviter cette évolution.
Ainsi, l’intérêt de notre étude est de réitérer l’importance d’un diagnostic précoce devant un tableau d’ictère cholestatique néonatal prolongé pour ne pas retarder la prise en charge chirurgicale de ces pathologies. De ce fait, notre objectif est d’étudier les éléments pronostiques des malformations des voies biliaires vues au service de Chirurgie Pédiatrique de l’HU/JRA.
RAPPELS HISTO-EMBRYOLOGIQUE, ANATOMIQUE ET PHYSIOLOGIQUE DU FOIE ET DES VOIES BILAIRES
Embryologie
Chez l’espèce humaine, le foie se forme vers la 3ème semaine de la vie intra utérine. On assiste d’abord à une apparition d’un bourgeon dans le septum transversum (partie distale du tube digestif antérieur). La connexion avec le tube digestif diminue petit à petit et se résume au canal biliaire où se développent la vésicule biliaire et le canal cystique. De l’endoderme dérive le parenchyme hépatique et les canalicules biliaires, les cellules de Kupffer avec les cellules conjonctives dérivent du mésoderme du septum, tandis que le péritoine viscéral (sauf dans la partie centrale) est issu du mésoderme de surface.
Vers la 10ème semaine, le foie représente 10% du poids de l’embryon, ceci s’explique par son activité hématopoïétique. Vers la 12ème semaine, la communication entre la voie biliaire et le duodénum se met en place, permettant la formation du méconium .
Embryogenèse des voies biliaires extra-hépatiques
Chez l’embryon humain, la première ébauche des voies biliaires et du foie est le diverticule hépatique ou bourgeon hépatique formé à 3 semaines de gestation. Il commence comme un épaississement de l’épithélium endoblastique dans la paroi ventrale de la portion céphalique de l’intestin antérieur (le duodénum dans l’avenir). Ce diverticulum présente deux protubérances correspondant selon les auteurs à une portion crâniale (pars hepatica), et une portion caudale (pars cystica).
La portion caudale croît en longueur et représente l’ébauche de la vésicule biliaire, du canal cystique et du cholédoque. Cet arbre biliaire extra- hépatique se développe à la 8ème semaine de gestation et prend une forme canalaire avec une lumière dès le début de sa formation et reste en continuité avec le foie durant toutes les étapes du développement. La vésicule biliaire apparaît comme une dilatation antérolatérale droite le long de la moitié distale du divirticulum hépatique à la 4ème semaine après fécondation, et le canal cystique n’est individualisable qu’à la 5ème semaine.
Le canal hépatique se développe à partir de la portion crâniale de divirticulum hépatique. Au 34ème jour du développement embryonnaire, le canal hépatique commun a la structure d’un entonnoir large sans canal hépatique droit ni gauche reconnaissables. Durant la 5ème semaine du développement embryonnaire, une prolifération rapide de l’entoderme prend place au-dessus de la jonction entre canal biliaire commun et canal cystique. Cette prolifération aboutit à la formation de replis puis des canaux hépatiques droit et gauche au niveau du hile. La portion proximale du canal hépatique droit et du canal hépatique gauche se développe à partir de la plaque canalaire .
Les voies biliaires extra-hépatiques et l’arbre biliaire intra-hépatique maintiennent une continuité luminale dès le début de l’organogénèse et durant toutes les étapes du développement.
Embryogenèse des voies biliaires intra-hépatiques
Plusieurs investigations sont réalisées pour pouvoir préciser le moment du développement des voies biliaires intra-hépatiques. Il en résulte que la formation de ces canaux biliaires se fait entre la 5ème et la 9ème semaine de gestation.
Plusieurs théories sont suggérées sur le développement des voies biliaires intrahépatiques. Une théorie suppose que l’arbre biliaire intra-hépatique provient de l’épithélium non développé des voies biliaires intra-hépatiques. Une autre estime que le système du drainage biliaire intra-hépatique se développe à partir des cellules précurseurs des hépatocytes. Une 3ème théorie combine les deux idées précédentes.
Le développement des branches de la veine porte détermine le développement des voies biliaires intra-hépatiques et commence au niveau du hile hépatique. Vers la 8ème semaine de gestation, les hépatoblastes forment une couche au niveau du hile hépatique. Cette couche va entourer les branches portales comme un cylindre pour former ce qu’on appelle la plaque canalaire ou ductale. Elle se dédouble d’une seconde couche avec plus de cellules riches en cytokératine.
A partir de la 12ème semaine de gestation, le remodelage de la plaque ductale prend place et des dilatations tubulaires apparaissent dans sa lumière. Ces tubules ainsi formées représentent les futurs canaux biliaires et ils restent en continuité avec la plaque ductale. Et le reste de l’épithélium non transformé en tubules disparaît graduellement. La ramification de l’arbre biliaire intra-hépatique se continue durant la vie fœtale et ceci vers la périphérie du foie .
Le processus de développement des voies biliaires intra-hépatiques nécessite schématiquement les composantes suivantes : le changement graduel du phénotype des hépatoblastes en cellules biliaires (cholangiocytes), le remodelage tridimensionnel de la structure de la plaque ductale et la maturation des canaux tubulaires remodelés.
INTRODUCTION |